Milano e altre città lombarde
Sommaire
Histoire de Milan
Chapitre 1 : Milan des origines à 1508
Chapitre 2 : Milan de 1508 à 1700
Chapitre 3 : Milan de 1700 à 1861
Chapitre 4 : Milan de l’Unité à aujourd’hui
Table des matières
Annexe 1 – Milan, croissance en largeur et en hauteur : l’arbre et la tour
Chapitre 1 : Milan des origines à 1508
1 – Milan celte, romaine et ambrosienne
Milan (Mediolanum) est-elle née romaine ? … Non, elle exista avant Rome, son site est occupé par les Celtes Ligures dès l’âge de bronze (3000 – 1000 av. J.C. : les tombeaux de la Cattabrega, près de Crescenzago), car elle est au centre d’une région fertile de plaine ; puis arrivèrent à l’Âge de Fer (1000 – 500 av.J.C. : tombeaux près de Milan) des groupes d’Ombriens et de Vénètes, et elle devient la capitale des Gaulois Insubriens, entre le Ve et le IVe siècle av. J.C., venus de Gaule et appelés « gaulois » par les Romains, avec leurs cousins Boi, Sénons et Lingons bien connus des Grecs et des Étrusques. Ils fondèrent la ville sous la conduite de leur chef légendaire Belloveso vers l’an 400 av. J.C., avec le nom celtique de Mitt-land latinisé en Mediolanum = au milieu de la plaine (cf. d’autres villes gauloises au nom d’origine celtique, Moiliens Meuliens, Miolan). Une légende voulait que Belloveso ait trouvé une truie à demi couverte de laine (in medio lanae) qui resta symbole de Milan jusqu’au IVe siècle. D’autres hypothèses expliquent la naissance de Milan par la commodité de son site à la confluence de deux fleuves, qui en favorisait la défense. Le centre de la ville aurait été piazza Duomo où, selon Polybe, les Celtes auraient adoré une divinité, Belisama, équivalent d’Athéna ou de Minerve.
Pour renforcer leur présence, ils luttèrent contre les Taurini et contre les Étrusques, dont ils détruisirent la ville de Melpo en 396 av. J.C. Les Romains commençaient alors leur remontée vers le Nord, ils furent vaincus par les Gaulois dirigés en 390 par Brennus qui ravagea Rome. Mais le consul Furius Camillus les vainquit en 367 av. J.C. près d’Alba, et la frontière fut repoussée à la plaine du Pô à partir de 235 av. J.C.
Les Romains conquirent Mediolanum en 222 av. J.C., et toute la région avec la conquête de Côme. Les Insubriens et les Boi profitèrent de la descente d’Hannibal en 218 av. J.C. pour s’allier aux Carthaginois et reprendre Crémone, et ils ne furent définitivement soumis à Rome qu’à partir de la défaite d’Hannibal à Zama en 202 av. J.C. ; Milan fut reprise en 196 av. J.C. et se transforma en castrum romain (ville fortifiée), avec un ensemble de murailles de plus de 3 kms en pierres et briques, dont il ne reste que 32 m. rue San Vito ; elle avait 4 portes, dont la porte Ticinese, sur la route de Pavie, conserve une tour au Carrobbio ; on a encore la trace de rues orthogonales au Forum, et des dalles de pavement en pierre de Vérone sous la basilique Ambrosienne ; le Musée archéologique conserve 2 colonnes toscanes et un chapiteau ionien « en corne de bélier », qui suggèrent un temple et un portique, que Virgile connut sans doute quand il vint étudier la rhétorique à Milan en 54-53 av. J.C. Peut-être connut-il aussi le Théâtre dont les fondations se trouvent sous la Chambre de Commerce.
La véritable intégration dans la romanité se fit avec Jules César qui, entre 58 et 51 av. J.C. créa dans la région les bases logistiques nécessaires à la conquête de la Gaule. C’est là, selon l’anecdote, qu’il découvre le beurre gaulois, alors qu’il ne connaissait que l’huile latine ! L’aire du castrum s’étendait environ sur 50 hectares, en forme de carré approximatif avec des côtés de 700 mètres (Cf. la structure de la Turin romaine), dont un angle est encore reconnaissable dans le tracé des rues Cornaggia et Disciplini (frontière méridionale des murailles). Le Forum se trouvait vers la place San Sepolcro, et on en trouve des traces dans les souterrains de la basilique Ambrosienne où se croisaient le cardus maximus et le decumanus maximus, au bout desquels s’ouvraient les 4 portes, la Romana (vers via Maddalena et piazza Missori), la Ticinensis (au Carrobbio), la Vercellina (croisement via Brisa et via Santa Maria alla Porta) et la Nova (place de la Scala). Après la conquête de la Gaule, César fait attribuer aux villes de la Gaule Transalpine le titre de Municipium civium romanorum qui les dotait d’un gouvernement municipal autonome, avec le droit d’élire leurs propres magistrats. Sous Octave Auguste, Milan devint chef-lieu de la XIe région d’Italie. En 48 après J.C., l’empereur Claude accorda la citoyenneté romaine à toute la Gaule transalpine, et Milan devint Colonie impériale, au cœur du système administratif et commercial romain, dans toute la vallée du Pô, puis du système militaire à partir du moment où il fallut combattre les premières invasions « barbares » venues du Nord.
À la fin du IIIe siècle, l’empereur Dioclétien divise l’empire en deux parties, et fait de Milan la capitale de la partie occidentale avec Marcus Aurelius Valerius Maximien pour empereur (286-305). Milan devient donc une capitale d’empire, en concurrence avec Rome, et elle reçoit la cour, l’armée, le gouvernement et tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement et à leur gloire, constructions, approvisionnement, ameublement, arts somptuaires. Maximien, qui avait pris le titre de Herculius, fit construire un second cercle de murs de 4,5 kms de long, entouré de fossés ; une des tours subsiste près du Corso Magenta (Cf. photo ci-dessus, dans le jardin du Musée archéologique) : il y fit ajouter 4 nouvelles portes, la Comacina (Via dell’Orso / Ponte Vetero), la Jovia (Vie San Giovanni sul Muro / Puccini), l’Argentea (piazza San Babila) et l’Herculea (Vie Cavallotti / Durini) Il embellit la ville de monuments comme les Thermes Herculéens (maintenant sous le Corso Europa) où on a retrouvé le torse d’une statue d’Hercule, copie de l’Hercule Farnese du Musée de Naples, et un grand Cirque (450 m. par 85 m.) dont l’une des tours constitue le clocher de San Maurizio Maggiore (Cf photo à droite) et à côté duquel se trouvait le palais impérial (Cf. l’église de San Giorgio « al Palazzo »). Il ordonna la construction de son mausolée et d’un sarcophage en porphyre rouge d’Égypte, aujourd’hui baptistère de la Cathédrale (Cf. photo ci-dessus à gauche). Les pilastres des arcades de deux magasins monumentaux se trouvent aujourd’hui à San Simpliciano. D’un temple restent les 16 colonnes transportées dans l’église de San Lorenzo Maggiore (Cf photo à droite). De l’époque romaine restent encore de nombreux objets de sculpture et de peinture, comme la tête colossale de Jupiter retrouvée près de la Porte Giovia, ou des sarcophages et des monnaies (Cf. photos à gauche : tête de Jupiter, et page suivante : sarcophage de l’ère constantinienne, et monnaie portant la tête de Maximien).
C’est à Milan que l’empereur Dioclétien décrète les persécutions les plus dures contre les chrétiens qui étaient remontés jusqu’à Milan dès le 1er siècle grâce à St Barnabé, selon la légende, cousin de Marc l’Évangéliste et compagnon de saint Paul (mais il n’est jamais venu en Italie) et plus probablement par le grec Anatalone, qui aurait été le premier évêque de Milan (53-61). Au second siècle sont martyrisés à Milan Saint Vital, sa femme Valérie et ses fils Gervais et Protais ; Victor, Nabor et Félix y furent aussi martyrs sous Maximien, soldats maures convertis au christianisme et qui avaient quitté l’armée, redécouverts par saint Ambroise.
C’est aussi de Milan que l’empereur Constantin proclama son Édit qui abolissait toute discrimination religieuse vis-à-vis du christianisme (313), avant que celui-ci ne devienne religion de l’État romain et qu’on ne lui restitue tous ses biens confisqués par le fisc romain. Aussitôt, le nombre de catholiques se multiplia, en particulier grâce à l’apostolat des évêques de Milan, dont on sait malheureusement peu de choses sûres, car les Milanais au XIe siècle arrangèrent l’histoire de leurs évêques pour leur donner une ancienneté aussi grande que celle des évêques romains. On parle d’un saint Anatole (Anatolone) qui aurait été envoyé par saint Barnabé, puis d’un saint Calimero, martyrisé et, selon une tradition fantaisiste, jeté dans un puits qui figure toujours dans l’église qui lui est dédiée à Milan (Ve siècle. Cf photo ci-contre de la basilique restaurée et du puits), puis d’un saint Mirocle, attesté pour avoir participé au Synode de Rome contre les donatistes (des « purs » qui refusaient la validité des sacrements délivrés par des évêques qui avaient cédé à la persécution et livré des textes sacrés aux Romains) en 313. On eut ensuite saint Eustorge (344-349), hostile à l’arianisme, auquel est dédiée une des grandes églises de Milan (Cf photo ci-contre), avant d’arriver à saint Ambroise (340-397), fils d’un préfet de Rome, haut fonctionnaire romain, nommé gouverneur à Milan où il fut élu évêque par la vox populi, de 374 à sa mort en 397, contre l’évêque arien Aussensius (355-374) soutenu par l’empereur Constance II ; il combattit les ariens, défendit les droits de l’église face à l’empereur et composa de nombreux ouvrages qui en font un des pères latins du christianisme. Il fut aussi grand constructeur, faisant édifier les plus grandes basiliques de Milan, la basilica Apostolorum (San Nazaro Maggiore), la basilica Martyrum (Sant’Ambrogio, 387), la basilica Salvatoris (San Dionigi) détruite au XVIIIe s. pour faire les Jardins Publics, la basilica Virginum (San Simpliciano, 397, décorée plus tard par les fresques représentant la victoire de Legnano sur l’empereur. Cf. photo ci-contre) et le baptistère di San Giovanni alle Fonti. Il poussa l’empereur Théodose à proclamer le christianisme religion officielle de l’empire et à interdire les cultes païens, et fit reconnaître le rite milanais (« ambrosien ») dans la musique sacrée.
Il faut ajouter d’autres églises, dont San Lorenzo Maggiore, dont les formes sont bien reconnaissables malgré les restaurations, et qui reste un des monuments chrétiens les plus importants (Cf photo page suivante : San Lorenzo Maggiore reconstituée comme elle était après les restaurations romanes).















2 – Milan de l’empire romain à la commune libre
Milan perd de son importance avec la crise de l’empire, et en 402, Honorius, fils et successeur de Théodose, lui ôte le titre de capitale de l’empire, inspiré par le général vandale Stilicon, son conseiller et tuteur. Milan subit alors le choc des invasions « barbares » : les Wisigoths passent les Alpes en 401, suivis des Burgondes appelés par Odoacre en 489, des Francs, des Vandales, des Huns (Attila dévaste la ville en 452) et des Goths d’Alaric venus de Grèce. Les envahisseurs furent séduits par l’opulence d’une ville mal protégée et commencèrent à la piller et à détruire les monuments. En 488, arrivèrent 100.000 Ostrogoths, population germanique d’origine ukrainienne, guidés par Théodoric, nommé consul et chef des armées par Zénon, l’empereur d’Orient. Théodoric l’emporta sur le roi barbare Odoacre qui avait déposé le dernier empereur romain en 476, et il s’empara de Milan en 493, malgré la défense des Burgondes, mais il déplace sa capitale à Ravenne et Milan ne reste qu’une des villes importantes à côté de Pavie ou Vérone. En 535, l’empereur Justinien envoya le général Bélisaire libérer l’Italie des Ostrogoths, et en 538, les citoyens milanais, plus latins que germains, chassèrent les Ostrogoths de la ville ; pour se venger, le Goth Uraia assiégea Milan, la conquit, détruisit toutes les églises et les maisons et massacra beaucoup d’habitants ; la mort de leur chef Totila mit fin à la domination des Goths en 551, et le général byzantin Narsès remporta la victoire.
En 568, trois ans après la mort de Justinien, arrivèrent des tribus germaniques et slaves, guidées par le Longobard Alboin. Les Longobards conquirent toute la plaine du Pô, jusqu’à Milan en 569, et bientôt presque toute l’Italie ; les autorités de la ville et le clergé s’enfuirent à Gênes pour un exil de 70 ans. Pavie fut proclamée capitale de l’empire longobard en 572 et Milan ne fut que la résidence d’un des « ducs » longobards (cf. la permanence du nom de « Cordusio », de Curia ducis, lieu où le duc exerçait son pouvoir).
Le royaume carolingien (774-888) maintint la capitale à Pavie, mais Milan, dirigée par un comes (comte), commença à reprendre de l’importance grâce à l’autorité de ses archevêques qui jouirent d’un grand prestige, dans la tradition d’Ambroise ; une vingtaine d’évêques dépendent de Milan, ils sont riches, propriétaires terriens, et souvent plus « seigneurs féodaux » que prêtres. Parmi eux, Ansperto da Biassono (868-881) fit restaurer les murailles, les églises et les hôpitaux, redonnant une vie commerciale à la ville par le développement des échanges avec l’autre côté des Alpes.
Pendant toute la période des Othon de Saxe, il y eut une solidarité entre les évêques milanais et les empereurs : l’archevêque Landolfo de Carcano investit Othon I le Salique roi d’Italie en 1024 dans la basilique de S. Ambroise ; l’archevêque Ariberto d’Intimiano (1018-1045) couronne Conrad II le Salique roi d’Italie à Milan en 1024 et empereur à Rome en 1026. Ariberto donne comme enseigne à l’armée milanaise le « Carroccio », qui allait accompagner les Milanais dans toutes leurs batailles durant le Moyen-Âge, avec le « biscione » (la couleuvre).
Un des symboles militaires de Milan, auquel les troupes communales faisaient sans cesse référence pendant la bataille, était l’insigne avec la vipère qui dévore un enfant, le biscione. Tant que l’insigne était visible, rien n’était encore perdu et tout était possible. Plus tard, on retrouvera le biscione dans l’emblème des Visconti (couleuvre bleue sur champ blanc) ; aujourd’hui, nous la retrouvons sur le blason qui se trouve sur le capot de l’Alfa Romeo, la grande industrie automobile milanaise. Les origines de cet objet symbolique sont antérieures à l’époque communale. La légende qui veut que l’emblème ait été pris sur le bouclier d’un Sarrasin n’a aucun fondement. Il est au contraire plus probable qu’il ait été pris à un symbole totémique longobard, devenu ensuite symbole militaire de la ville. La première opération qui devait être accomplie quand les troupes installaient leur campement était de placer la vipère en haut d’un lance ou sur la branche la plus haute d’un arbre. L’emblème fut déjà le drapeau de la commune durant la croisade de 1100. Bien plus, les drapeaux milanais qui allèrent en Terre Sainte furent au nombre de deux : l’un avec la vipère bleue sur champ blanc, flottait sur le campement pendant les périodes de trêve ; l’autre, avec la croix rouge sur fond blanc, flottait durant la bataille. Au terme de la croisade, dans la bouche de la vipère fut placé un enfant sanglant.
La reprise économique et démographique se confirme au Xe siècle. Très influente est la couche sociale des plus grands feudataires archi-épiscopaux, les « capitanei », détenteurs de propriétés, châteaux et droits seigneuriaux sur le territoire. À côté d’eux se trouvaient les « valvassori », insérés dans la hiérarchie féodale et chevaliers, mais de rang inférieur, et une nouvelle classe de « cives », marchands, artisans, notaires, juges, qui obligea les nobles à un accord en 1044. En 1097, ils constituent ensemble un Consulat, première expression institutionnelle de la Commune, qui revendique le gouvernement de la ville ; elle se réunissait dans le « brolo » (le jardin) de l’archevêque, puis s’émancipa de sa tutelle, en s’installant dans le palais communal, le « broletto ».
Les luttes de classes furent donc dures dans cette progressive invention de la Commune milanaise, se croisant avec les luttes pour la conquête du pouvoir dynastique en Italie et avec les concurrences pour le choix de l’évêque. Trois évêques ont eu un rôle particulièrement important, d’abord Landolfo da Carcano, élu en 979 par la volonté de l’empereur Othon II ; cette élection causa de violents troubles sociaux, qu’il réussit à calmer en rendant héréditaire le droit pour les nobles (appelés capitanei de par leur propriété d’un fief in capite, à leur nom) d’encaisser les revenus des paroisses ; cela donna aux capitanei (les milites maiores) un pouvoir de plus en plus grand qui mécontenta les valvassores (secundi milites) qui n’étaient que leurs vassaux et étaient donc souvent en violente opposition à eux et à l’archevêque. Landolfo eut pour successeur Arnolfo da Arzago (998-1018), très amateur de luxe et favorable à l’empereur, puis Ariberto d’Antimiano (1018-1045), élu avec l’appui des capitanei et de l’empereur, qui réorganisa l’Église de Milan, fonda le monastère et l’hôpital de san Dionigi et fit reconnaître la suprématie de l’évêque de Milan sur les autres évêques du Nord, entre autres celui de Ravenne (Voir ci-dessus sa tombe dans la cathédrale de Milan).
C’est en 1035 qu’éclata la première révolte des valvassori, qui trouvèrent appui auprès de Lodi hostile à Ariberto qui lui avait imposé par les armes son évêque Ambroise et dont certains territoires étaient des fiefs contrôlés par des nobles milanais. L’empereur intervint, – occasion pour lui de diminuer le pouvoir de l’évêque de Milan –, fit interner Ariberto ; mais celui-ci fut délivré par les Milanais, et Ariberto, craignant une réaction de l’empereur, fit renforcer les murailles (et c’est à cette occasion qu’il institua le Carroccio comme emblème de l’armée). L’empereur Conrad II assiégea en vain la ville, et abandonna finalement, après avoir cependant laissé un cadeau empoisonné, la Constitutio de feudis (mai 1037) qui étendait aux valvassori le caractère héréditaire des fiefs. Le peuple milanais soutint Ariberto qui lui apparaissait comme le meilleur gage d’autonomie de leur ville.
Il y eut une seconde explosion sociale, en 1042, celle des cives guidés par un noble dissident, Lanzone da Corte ; ils chassèrent de la ville capitanei et valvassori avec leurs familles que l’archevêque accompagna. On arriva à l’accord de 1044. La noblesse perdit pour un temps son pouvoir et une égalité sociale légale s’établit : c’étaient les bases de la Commune.
L’évêque suivant fut Guido da Velate (1045-1071) imposé par Henri III ; sous son épiscopat, la simonie et le concubinage se répandirent dans une partie importante du clergé. Cela produisit une réaction populaire très forte, celle des Patarins, qui affirma sa volonté de réformer ce clergé corrompu. « Patarino » signifiait « chiffonnier », du nom de la Pataria, un quartier pauvre de Milan. Ils avaient pour chefs des moines soldats comme Arialdo da Carimate et Landolfo Cotta, et un noble laïc, frère de Landolfo, Erlembaldo Cotta (Voir ci-contre le bas-relief du XIXe siècle à san Calimero de Milan). Ils luttèrent militairement contre les nobles qui soutenaient le parti épiscopal. Ils connurent une reconnaissance grâce à l’élection d’un des leurs, Anselmo da Baggio, comme pape, sous le nom d’Alexandre II, en 1061 ; celui-ci amorça la réforme du clergé poursuivie par ses successeurs Grégoire VII (1073) et Urbain VIII (1088). Guido da Velate et les prêtres concubins s’opposèrent aux réformes, en les présentant comme une atteinte à l’autonomie de l’Église ambroisienne. Excommunié par l’évêque, Arialdo obtint finalement l’excommunication pontificale pour Guido da Velate qui provoqua contre lui des troubles, le fit arrêter, torturer et jeter dans le Lac Majeur en 1066 (Voir page précédente le martyre de S.Arialdo à san Calimero de Milan). Guido fit acte de soumission au pape, mais vendit son diocèse à un de ses disciples, Gotofredo da Castiglione, qui fut approuvé par l’empereur Henri IV en 1071. Ses partisans firent assassiner Erlembaldo, qui fut canonisé comme martyr avec son frère par Grégoire VII. mais Henri IV nomma à Milan un autre évêque excommunié par le pape, Tebaldo da Castiglione (1075-1085). Le pape Grégoire VII l’emporta finalement sur l’empereur Henri IV, lui imposant sa soumission au château de Canossa. Le mouvement patarin s’arrêta vers le fin du siècle, et les franges qui subsistèrent n’acceptèrent pas les décrets publiés par Urbain II en 1089, qui déclaraient valides les sacrements délivrés par des prêtres simoniens ou corrompus ; elles furent assimilées aux cathares et condamnées comme hérétiques.
Au milieu de ces troubles religieux, Milan s’était enrichie de la participation des trois classes de citoyens, et mettait au point un nouvel ordre territorial. On a connaissance de l’existence d’un premier Consulat dès 1097 ; en faisaient partie des représentants des différentes classes ; parfois c’était un noble qui représentait les cives, comme ce fut le cas de Lanzone da Corte. L’institution communale fut le résultat de ce pacte : le Magistrat des Consuls entra en fonction dès 1099, et en 1122, la ville fut représentée par 20 Consuls, même si l’archevêque restait formellement son chef. Milan commença alors son expansion territoriale aux dépens des communes voisines plus faibles, pour mieux contrôler le commerce de l’aire transalpine et assurer l’extension des intérêts fonciers de ses citoyens riches ; cela provoqua de nouveaux conflits, avec Côme (soumise en 1127) et Lodi (détruite en 1111).
Le succès de la première croisade (1096) poussa en Lombardie une foule de pauvres, immigrés, chômeurs, à partir pour la Terre Sainte, 200.000 selon les Chroniqueurs du temps, mais en réalité autour de 20.000. Peu de soldats, aucune discipline, beaucoup de vieillards, de femmes et d’enfants guidés par Anselme, archevêque de Milan. Ils partirent en septembre 1100, et arrivèrent à Constantinople déjà largement fauchés par la maladie et la fatigue. Difficiles à contenir, ils se livrèrent au pillage ; ils reprirent la route de la Terre Sainte en mai 1101 et furent massacrés par les Turcs, tandis que femmes et enfants étaient emmenés en esclavage. Cela a inspiré à Giuseppe Verdi son opéra Les Lombards à la première croisade, sur livret de Temistocle Solera, créé à la Scala de Milan en 1843.
Le « Carroccio » était un grand char à quatre roues, tiré par des bœufs, sur lequel, devant le gonfalonier de la commune de Milan, était dressé un autel. Pendant le combat, le prêtre célébrait la messe et un clerc sonnait en permanence la « martinella », une cloche placée sur l’autel. Il semble que le carroccio ait été une invention de l’archevêque Ariberto d’Antimiano (1039), qui la proposa comme symbole de la liberté et de la foi religieuse de la commune. Sa perte était considérée comme une honte. Il fut ensuite adopté aussi par d’autres communes, jusqu’au XIVe siècle.








3 – Milan, le conflit avec l’empereur sous les Hohenstaufen
Après la fin de la dynastie carolingienne, qui s’est éteinte avec la mort de Charles III le Gros en 887, la couronne impériale passa à l’Allemagne, tandis que la France se développait comme unité nationale. Sous la dynastie de Saxe (les Othon), l’autorité des empereurs fut pratiquement éteinte en Italie, même si Othon I franchit les Alpes pour se faire couronner empereur en 962. Mais au début, les princes allemands ne furent pas convaincus de l’utilité d’une politique italienne. Cependant peu à peu, l’Italie du Nord devint dépendante des événements politiques allemands, parce que devint dominante l’idée que le Saint Empire Romain devait faire revivre la grandeur de la Rome impériale, donc l’empereur devait aussi être roi d’Italie. Les candidats au Royaume d’Allemagne étaient d’une part les partisans de la maison de Bavière, les Guelfes (de Welf, le chef de la souche) et de l’autre les partisans de la maison des Hohenstaufen de Souabe, gibelins (de Weiblingen, château de Conrad III). En 1152, Conrad III, proche de la mort, donna la couronne d’Allemagne à Frédéric de Souabe, beau jeune homme et grand guerrier aux cheveux fauves qui lui valurent le nom de « Barberousse ». Frédéric et ses successeurs eurent toujours l’idée laïque de la puissance impériale destinée à faire respecter la loi, rétablir l’ordre et la paix, indépendamment de la papauté ; ils voulaient aussi unifier l’empire de l’Allemagne à l’Italie. Cette distinction entre pouvoir temporel de l’empereur et pouvoir spirituel du pape était nouvelle, dans une période où la papauté était affaiblie par les luttes entre les familles romaines pour la conquête du pouvoir, et par un grand niveau de corruption.
« Frédéric Barberousse ne pouvait en aucune façon renoncer à l’Italie, « espace vital » pour restituer puissance, prestige et nouvelle dignité à l’autorité impériale. Il ne s’agissait pas seulement d’étendre ou, mieux, de consolider la domination et le contrôle sur les fiefs et les villes. Cela pouvait être un premier objectif, certes pas tout à fait négligeable, mais, sous l’angle de la simple conquête et reconquête, il ne se différenciait pas de façon substantielle de ce qu’avait fait son prédécesseur en Allemagne pour reprendre le contrôle sur les grands feudataires divisés entre eux. L’Italie était surtout importante parce que l’empereur, qui était le chef de l’Occident chrétien, devait obtenir la reconnaissance de sa plus ample souveraineté politique et spirituelle à travers une sorte de consécration, d’acte officiel solennel accompli par la plus haute autorité de l’église, le pape. La soumission de l’Italie au pouvoir impérial était pour Frédéric Barberousse le premier objectif dans le temps, la prémisse nécessaire pour atteindre l’autre objectif plus important : le couronnement à Saint Pierre de Rome. Un plan stratégique qui était certainement dans les intentions de Conrad III et, avant lui, de Lothaire, mais qui ne put pas être réalisé à cause des luttes dynastiques et des discordes qui avaient éclaté en Allemagne après la mort de Henri V. Frédéric Barberousse, après avoir réglé la situation de l’Allemagne, se tourna vers l’Italie où il espérait pouvoir faire valoir son autorité sans rencontrer de résistances trop fortes. Mais son action politique en Italie ne fut pas tout à fait facile. Pourtant voilà que l’occasion pour intervenir lui fut fournie par la demande d’aide de quelques grands feudataires du Nord en lutte avec la commune de Milan » (Storia degli italiani, 1974, n° 3, p. 42).
En effet, à Constance, Frédéric rencontra quelques délégués de la ville de Lodi qui venaient se plaindre de la domination violente de Milan, qui, en se renforçant, manifestait son désir d’expansion et de contrôle sur le commerce de la plaine du Pô et qui avait détruit la ville en 1111 et chassé ses habitants. Or Frédéric avait aussi à se plaindre des Milanais qui refusaient de payer leurs tributs ; il envoya à Milan un mandataire dont les Milanais se moquèrent. Frédéric décida alors de descendre en Italie en 1154, il réunit les villes et les fiefs et reconquit ceux qui s’opposèrent à son ordre de se soumettre à lui, en restituant les droits féodaux usurpés dans la période de faiblesse de l’empire : Rosate, Trecate, Galliate, Chieri, Asti, Tortona. Ce fut alors que les villes italiennes se divisèrent entre guelfes et gibelines. Même les créneaux des murailles se divisèrent entre « guelfes » (carrés ou rectangulaires) et « gibelins » (en queue de pie). Frédéric descendit ensuite à Rome où il fut couronné empereur par le pape Adrien IV le 18 juin 1155 (Cf ci-contre, Miniature du « Miroir Historial » de Chantilly). Puis, souvent attaqué par les communes où il passait, il retourna en Allemagne pour deux ans. Milan profita alors de son absence pour conquérir à nouveau Lodi, qui fut détruite et incendiée le 6 janvier 1158 ; ainsi elle éliminait l’important marché de Lodi qui faisait concurrence au commerce milanais, et elle outrageait l’empereur, protecteur de Lodi.
Barberousse descendit alors à nouveau en Italie pendant l’été 1158, avec une armée de 100.000 hommes et sous l’étendard impérial, avec l’aigle noir ; il fit reconstruire une nouvelle ville de Lodi, vainquit Milan qui dut se rendre le 7 septembre, et convoqua une diète à Roncaglia pour faire préciser ses droits financiers et administratifs sur toute l’Italie, en subordonnant les autonomies communales au contrôle impérial (autorité sur les duchés et marquisats, droits de justice, de percevoir des taxes et dîmes, réduction des fortifications de nombreuses villes, etc.).



Milan, la Ligue Lombarde et les Hohenstaufen
De nombreuses villes ne tardèrent pas à se révolter contre les décisions de la Diète. La première fut Crema en janvier 1159, elle fut suivie par Milan. Tout tendu vers son idéal de paix universelle assurée par l’empire et persuadé que ce n’étaient que des tumultes locaux et pas des révoltes, Frédéric n’ordonna pas de représailles. Les Milanais firent alors une sortie en avril 1159 et prirent Trezzo où se trouvait le trésor impérial ; Brescia, Piacenza et Gênes se rapprochèrent de Milan. Frédéric décida alors de réagir et assiégea d’abord la petite Crema pendant sept mois. La lutte fut féroce : « Un jour, l’empereur lui-même courut au galop avec un groupe de guerriers vers la fidèle Lodi pour demander des chars de bois et des bœufs en nombre assez grand pour combler le fossé et tenter de franchir les murs. On prépara de gigantesques machines de guerre, d’énormes châteaux de bois et de fer ; mais les habitants de Crema réussirent toujours à brûler les tours mobiles avant qu’elles s’approchent des murs. Frédéric fit alors attacher aux machines les otages que les habitants de Crema lui avaient donnés en gage de fidélité aux décisions de Roncaglia. Les habitants de Crema semblèrent hésiter quand ils virent leurs compagnons sur ces tours mobiles qui avançaient vers les murs, mais ensuite un nuage de flèches partit de la ville assiégée et s’abattit sur les machines. Les prélats de la suite de Barberousse réussirent à obtenir de l’empereur que ces pauvres gens soient déliés : beaucoup étaient déjà morts.
La lutte se poursuivit désespérée. Sur les remparts, les habitants de Crema tuaient les prisonniers. Les impériaux en faisaient autant. Les sorties des uns alternaient avec les attaques des autres, sans cesse, dans le sang » (Storia degli Italiani, op. cit. p. 52). mais Crema dut céder le 25 janvier 1160, les habitants abandonnèrent la ville, que Frédéric fit détruire.
Ces luttes renforcèrent l’hostilité du pape Adrien IV, qui mourut le 1er septembre 1159. Les cardinaux se divisèrent en deux partis, celui du pape fit élire le siennois Rolando Bandinelli couronné sous le nom d’Alexandre III, et celui de l’empereur le romain Ottaviano Monticelli, qui devint l’antipape Victor IV. C’était le schisme, et Alexandre III excommunia son rival et l’empereur. C’était la seconde excommunication de l’empereur depuis celle de Henri IV par le pape Grégoire VII en 1076, quand le concile décida qu’un laïc (l’empereur) ne pouvait pas nommer les évêques ; l’empereur avait dû faire pénitence à Canossa pour obtenir la révocation de l’excommunication. L’excommunication de Frédéric encouragea les Milanais à reprendre la lutte et à s’emparer du château de Carcano, contraignant Frédéric à se réfugier près de Côme. Frédéric fit alors venir de nouvelles troupes d’Allemagne, et en mai 1161 il fit dévaster le territoire autour de Milan et assiéger la ville, en l’affamant. Les Milanais se rendirent à la fin de février 1162, sans conditions, et le 26 mars 1162, Frédéric s’empara de toutes les choses précieuses (statues, marbres, le Carroccio, les drapeaux, les armes, etc.) et fit détruire Milan en 8 jours, comme les Milanais avaient fait détruire Lodi, Pavie, Crémone et Côme.
Les forces étaient donc d’une part l’empereur et les feudataires, de l’autre l’alliance des communes « démocratiques », – qui auparavant s’étaient opposées aux feudataires et maintenant devaient combattre un empereur désireux de rétablir l’autorité politique et morale de Charlemagne, pour lui condition de paix –, avec le pape ennemi de l’empereur dans un grand conflit des deux pouvoirs politique et spirituel : pour le pape, les communes étaient une épine au flanc de l’empereur, et pour les communes, le pape apparaissait comme l’allié capable de mettre en crise l’empereur sur le plan militaire et idéologique. L’empereur soutenait une idéologie laïque de séparation entre les deux pouvoirs : l’empire assurait le bonheur des hommes sur la terre, par une paix universelle, tandis que le pape assurait leur bonheur spirituel éternel ; plus tard, Dante soutint cette idéologie laïque dans son traité De Monarchia. Mais le Saint Empire Romain était désormais une réalité précaire, rendue formelle par l’aspiration des communes à une association entre égaux.
Frédéric tenta en vain d’obtenir l’appui de Louis VII, roi de France, contre le pape Alexandre III, qui était soutenu par le clergé français. Peu à peu, à partir du 27 avril 1167, les Milanais commencèrent à rentrer dans leur patrie et à reconstruire la ville hors des murs, puisque Frédéric avait interdit de reconstruire à l’intérieur des murs, et à partir de mai, ils commencèrent à reconstruire les murailles, en renforçant le système de défense et de protection des eaux. La plus grande partie des communes, qui avaient une exigence de liberté, supportaient mal le pouvoir souvent despotique et cruel des podestats nommés par l’empereur qui ajoutaient les vols privés aux vols accomplis au nom de l’empereur : par exemple, une taxe de 25% pesait sur les revenus agricoles, et de 15% sur le revenu des locations. Les ennemis de Frédéric se multipliaient, et la république de Venise, préoccupée par le voisinage des terres impériales, réussit à créer une Ligue Véronaise anti-impériale avec Vérone, Trieste, Vicenza, Trévise, Padoue, l’empereur d’Orient et le pape ; les feudataires fidèles à Barberousse, comme le podestat de Vérone, furent chassés.
Frédéric descendit une nouvelle fois en Italie en 1163, il effectua le sac de Tortona avec l’aide de la fidèle Pavie. Il essaya en vain de signer une alliance avec Henri II, roi d’Angleterre, qui avait rompu avec le pape Alexandre III ; il tenta sans succès de renforcer la puissance du nouvel antipape Pascal III en lui faisant proclamer la sainteté de Charlemagne dont il fit exhumer la dépouille. Frédéric descendit de nouveau en Italie en 1166, conquit Ancône, et parvint à entrer dans Rome, mais une terrible épidémie de peste frappa son armée et il dut abandonner la ville et remonter vers le Nord, où s’était constituée la Ligue Lombarde entre Crémone, Brescia, Bergame, Mantoue, Milan et onze autres villes, le 7 avril 1167 à Pontida, près de Bergame, où elles avaient juré « guerre vive » à l’empereur (Voir page précédente la plaque commémorative). La Ligue conquit Lodi qui avait refusé de la rejoindre, et construisit dans le Montferrat une nouvelle ville fortifiée, appelée Alessandria, en l’honneur d’Alexandre III. La Ligue se renforça par l’adhésion de Parme, Plaisance, Ferrare, Modène, Bologne, Vérone, Vicence, Padoue, Trévise, Venise, Vercelli et Novare. Alexandre III contribua largement à financer la Ligue. Grâce à l’aide des Savoie, Frédéric réussit à échapper à la Ligue et à rentrer en Allemagne en franchissant le Mont Cenis. Il était toujours plus isolé : il avait fait nommer un nouvel antipape, Calixte III, après la mort de Pascal III le 20 septembre 1168 ; une partie du puissant clergé allemand continuait à soutenir Alexandre III, et Manuel I Comnène, était hostile à l’empereur.
Frédéric organisa un nouveau corps d’expédition en 1174 et revint dans la Péninsule en passant par le Mont Cenis, conquit Asti et assiégea la nouvelle forteresse d’Alexandrie, symbole de la Ligue. Malgré l’appui de Venise, il ne parvint pas à vaincre Ancône, défendue par l’empereur d’Orient. Le 6 avril 1176, l’armée de la Ligue, commandée par Anselmo di Doara et Ezzelino il Balbo, établit son campement près de Tortona, à 20 Kms de l’armée impériale. Le 29 mai 1176 commença la bataille de Legnano, où l’armée impériale fut mise en fuite, grâce à l’intervention des 900 chevaliers de la Compagnie de la Mort, commandée par Alberto da Giussano et de la Compagnie du Carroccio. Frédéric dut s’humilier devant le pape Alexandre III le 1er août 1177 et il fut libéré de l’excommunication (Cf. l’illustration à gauche) ; il dut signer avec les communes la paix définitive de Constance le 25 juin 1183. Il meurt durant la croisade dans un fleuve d’Anatolie en 1187, ayant, malgré la défaite face à la Ligue, réalisé un immense empire qui couvrait l’Europe de la Méditerranée à la Mer du Nord ; il avait reconquis le Royaume de Sicile par le mariage de son fils Henri VI avec Constance d’Altavilla, dernière fille de Roger II, fondateur de la dynastie normande : ainsi ajoutait-il la domination du Midi à la couronne impériale ; le mariage fut célébré à Saint-Ambroise de Milan le 27 janvier 1186, et le rite nuptial fut suivi du couronnement d’Henri VI, de la main de son père, « comme Charlemagne avait couronné empereur de sa main son fils Ludovic le Pieux » (Storia degli italiani, op. cit. p. 76).
La lutte continua avec les successeurs de Frédéric Barberousse. Un nouveau pape, Innocent III, fut élu le 8 janvier 1198, et il porta l’Église à une très grande puissance. Henri VI, le fils de Frédéric, régna jusqu’à sa mort en 1197. Pour la succession furent candidats Philippe de Souabe, frère de Henri VI, à qui celui-ci avait confié son fils Frédéric de 4 ans, et Othon de Welfen Brunswick, duc d’Aquitaine, qui se fit couronner par une minorité d’ennemis de la maison de Souabe le 9 juin 1198 dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Philippe fut retardé et couronné seulement le 8 septembre. Le guelfe Othon était appuyé par le roi d’Angleterre, par le comte de Flandre et par les villes de Cologne et de Milan, le gibelin Philippe par le roi de France et par la majorité des princes allemands.
La mort d’Henri VI laissait les communes libres ; elles reprirent alors leurs querelles entre la Ligue « guelfe » (Milan, Brescia, Mantoue, Vérone, Trévise, Novare, Vercelli) et Crémone, Bergame et Pavie « gibelines » qui soutenaient Philippe ; mais les villes se déclaraient guelfe ou gibeline moins pour la cause des prétendants allemands à l’empire que par rivalité et concurrences moins nobles. Crémone, devenue commune en 1098, avait, dès les Romains, une plus grande force militaire ; elle s’était alliée à Mathilde de Canossa et elle avait appuyé Frédéric Barberousse contre Crema et Milan à l’assaut de laquelle elle avait participé en 1160 et en 1162 ; elle avait aussi reçu l’appui des nobles de Brescia chassés de leur ville par le peuple. Au contraire les communes toscanes se rebellèrent contre l’empereur ; elles formèrent la Ligue de San Genesio sous la direction de l’évêque de Volterra et détruisirent le château de San Miniato, siège de l’administration impériale. Elles contraignirent d’autres villes, comme Arezzo, Perugia, Viterbo et Certaldo, à adhérer à la Ligue. Même Ravenne, Rimini, Senigallia, Fermo, Macerata et d’autres centres se réunirent en une Ligue pour se protéger tant de l’empereur que du pape Innocent III.
Pendant ce temps, le pape faisait préparer des documents où il revendiquait la possession des terres italiennes, selon toutes les donations qui lui avaient été faites par Constantin, Pépin et divers rois ou empereurs. C’était la conséquence de l’idéal théocratique du pape, qui considérait que l’Église devait être maîtresse de toute la terre et que l’empereur recevait son épée du pape ; le puissant pontife devait donc être à la fois spirituel et politique. Il obligea même le préfet de Rome à se déclarer fonctionnaire pontifical, malgré l’hostilité du peuple romain. Il niait ainsi la théorie des deux épées, affirmant qu’il n’y avait qu’une seule épée à deux lames, celle du pape.
Même en Sicile, le peuple se souleva contre l’armée impériale à la mort de Henri VI ; il était guidé par Constance d’Altavilla qui fit expulser les soldats allemands de l’île. Pas assez forte pour y parvenir, Constance s’appuya sur le pape Innocent III, et fit couronner Roi de Sicile en mai 1198 son fils Frédéric, qui jura fidélité au pape qui devint tuteur du Roi, avec le chancelier Pagliara, évêque de Troie comme conseiller, et en un certain sens premier ministre du Roi. La guerre entre le pape et l’empereur souabe se poursuivit dans le sud de l’Italie où était en cause la possession de la Sicile. L’autre problème était pour le pape de profiter de la situation pour « récupérer » le maximum de terres en Italie. La rupture entre l’empereur Othon et le pape se produisit en 1211. Othon fut vaincu et mourut en 1218, après sa grave défaite de 1214. Milan, qui avait toujours soutenu Othon, subit des rétorsions du pape qui paralysa le commerce de la ville en faisant saisir en Europe toutes les marchandises milanaises. Les autres villes de la Ligue alliées à Othon furent vaincues par la Ligue de Crémone. Après son triomphe au Quatrième Concile du Latran, ouvert le 11 novembre 1215, Innocent III mourut le 16 juillet 1216, remplacé par Honorius III, un cardinal de 90 ans.
UN FAUX HISTORIQUE : LA DONATION DE CONSTANTIN
La « donation de Constantin » est peut-être le faux le plus célèbre de l’histoire. Il se fonde sur une légende déjà répandue à Rome au Ve siècle, relative à Saint Sylvestre I, qui fut pape de 314 à 335, au temps de Constantin.
L’empereur, comme on le sait, publia en 313 le fameux Édit de Milan, qui reconnaît officiellement le christianisme. Selon la légende, l’empereur Constantin aurait décidé d’une persécution contre les Chrétiens : alors Sylvestre se serait réfugié dans une grotte du mont Soratte. Mais l’empereur (ainsi continue la légende) tomba malade de lèpre, et suite à une vision il fit venir à lui le pape, qui lui donna le baptême et en même temps le guérit. Constantin, reconnaissant, aurait gratifié le pape de nombreuses facultés et privilèges, et en plus lui aurait fait don « de la ville de Rome et de toutes les provinces d’Italie » et de l’Occident ; il lui aurait donné primauté sur les églises d’Orient. Ce faux fut probablement fabriqué à Rome au VIIIe siècle, quand le pape Étienne II, pour défendre l’Église et la papauté des Longobards du roi Astolphe, s’accorda avec Pépin, qu’il avait lui-même couronné roi des Francs. Pépin lui promit qu’il combattrait les Longobards, et qu’en cas de victoire il ferait don au pape d’une grande partie de l’Italie péninsulaire. La promesse ne fut tenue que pour une petite part ; toutefois le faux visait à « créer un précédent », c’est-à-dire un titre de légitimité pour les revendications du pape. La fausseté de la « donation de Constantin » fut démontrée par la suite par l’humaniste Lorenzo Valla, en 1440, avec son livre De falsa et ementita donatione Constantini » (Storia degli italiani, op.cit . n° 9, p.162) (Cf. ci-dessous, La donation de Constantin, Rome, Église des 4 Saints Couronnés, XIIIe siècle)
Frédéric II prit la succession impériale. Il avait épousé la princesse Constance, sœur du roi Pierre d’Aragon. Du mariage naquit un fils, Henri, qui fut nommé roi de Sicile quand Frédéric fut couronné empereur en 1220. Constance étant morte, Frédéric épousa Yolande de Brienne, fille du roi de Jérusalem, en 1225 ; il en eut un fils, Conrad ; presque en même temps, son fils Henri, de 15 ans, épousa Marguerite d’Autriche. Le nouveau pape, élu après la mort d’Othon III le 18 mars 1227, fut un cardinal de 80 ans, Ugolino di Segni, qui prit le nom de Grégoire IX, et eut comme premier but d’envoyer Frédéric en croisade. Frédéric ne partit pas, ce qui fut cause de la rupture entre les deux grands. Mais l’empereur rencontra le Sultan d’Égypte, avec lequel il avait d’excellents rapports, et il obtint qu’il lui remît pacifiquement Jérusalem et d’autres villes voisines. Cela contraignit le pape à accepter une réconciliation formelle avec Frédéric II en 1230.
Mais la lutte reprit vite entre Frédéric et le pape qui appuyait toujours plus les communes. Frédéric entendait l’empire comme une réalité universelle qui devait se soumettre à l’empereur, garant de la paix universelle. Face à lui, Grégoire IX répondait par l’évocation de la donation de Constantin : « Les prêtres du Christ sont pères et maîtres de tous les rois et de tous les princes chrétiens. L’empereur chrétien doit se soumettre dans ses actes non seulement au pontife mais aux simples évêques ». En 1236, la Ligue se reconstitua entre de nombreuses villes, Milan, Lodi, Alessandria, Côme, Novare, Brescia, Padoue, Trévise, Ferrare, Faenza et Bologne. Mais son armée fut vaincue par les soldats de Frédéric à la bataille de Cortenuova, où Frédéric s’empara du Carroccio, du podestat de Milan, et de 4000 prisonniers. Pourtant Brescia résista à l’assaut et redonna force aux communes, et en 1239, Grégoire excommunia Frédéric II.
Le nouveau pape, successeur de Grégoire, mort le 22 août 1241, fut Innocent IV, élu le 25 juin 1243. Il se réfugia aussitôt en France à Lyon, sous la protection du roi Louis IX. Après d’autres batailles, Frédéric II mourut le 13 décembre 1250, tandis que son fils Enzo était tombé prisonnier de Bologne.
Les fils de Frédéric continuèrent la lutte, mais Manfred fut tué en 1266 à la bataille de Bénévent contre l’armée de Charles d’Anjou appelée au secours par le pape Urbain IV. Charles d’Anjou fut alors nommé roi de Sicile à Naples, mais fut chassé par les Siciliens après la guerre des Vêpres du 1er mars 1282, et Pierre d’Aragon s’installa dans l’île où la famille d’Aragon régna jusqu’en 1410. Ce fut le début d’une période sombre pour la Sicile, après la présence de deux grandes cultures, arabe et normande.
Quant au dernier héritier des Souabe, Conradin, petit-fils de Frédéric II, né en 1252, il fut vaincu par Charles d’Anjou à la bataille de Tagliacozzo le 23 août 1268, et assassiné par lui le 29 octobre. C’était la fin des Souabe et le triomphe du pape et des Guelfes en Italie. C’était aussi la fin d’une époque : « On ne peut pas faire moins que d’admirer une dynastie qui fut toute composée de princes qui se sont distingués par leur talent et leur valeur, aimant et protégeant les arts et les sciences. Ils défendirent des idées très avancées pour les temps où ils vivaient et donnèrent leur protection et leur impulsion à tout type d’étude (…) Leur vision était peut-être trop avancée par rapport à l’époque où ils se trouvaient vivre et il ne fut pas possible de tirer tous les bénéfices possibles de la politique culturellement éclairée qu’ils menèrent. Ils connurent et firent avancer des idées qui n’étaient pas encore devenues de domaine universel, mais le fait est qu’ils entendaient se servir de ces idées seulement pour augmenter leur propre pouvoir (…) Mais heureusement les idées ont survécu et même, grâce à elles, l’humanité a progressé » (Storia degli italiani, op. cit. p. 309). La dernière tentative des empereurs pour dominer l’Italie fut celle de Henri VII, qui réveilla brièvement les espérances des Gibelins italiens (Cf. le soutien de Dante et la théorie du De Monarchia, de 1312-13, où il défendait l’indépendance de l’empire et la séparation des deux pouvoirs).
Henri VII (Arrigo VII) avait succédé à Albert d’Autriche, et il fut couronné dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle le 6 janvier 1309, avec l’appui du pape Clément V contre le roi de France Philippe le Bel, et contre le roi de Naples Robert II d’Anjou. Il était soutenu aussi par les Savoie, et à Milan par les gibelins Visconti contre les guelfes Della Torre. Il descendait de la maison de Luxembourg, ducs de la Basse Lorraine. Il eut le tort de vouloir reprendre la classique politique impériale et d’imposer son autorité à une Italie déjà organisée en communes.
Il descendit en Italie de Lausanne en octobre 1310, et fut accueilli à Turin par les Savoie. Puis il resta 4 mois à Milan où il nomma ses vicaires dans les diverses villes d’Italie. Mais les Milanais commencèrent à s’agiter quand Henri demanda un tribut de 50.000 florins et 50 otages. Il rencontra l’opposition de Crémone dont il fit détruire les murailles et les tours, et de Brescia à laquelle il imposa le démantèlement des enceintes et une amende de 70.000 florins. Il descendit ensuite à Rome, après avoir condamné les Florentins ; il y arriva le 6 mai 1312, aidé par les Colonna contre les Orsini. Il se fit couronner empereur à Saint Jean de Latran le 29 juin 1312, et partit assiéger en vain Florence, tandis qu’une grande partie du Nord se rebellait contre ses vicaires. Il décida finalement de revenir à Rome, assiégea Sienne, mais il tomba malade et mourut en août 1313. Fin d’une époque !
« Le succès obtenu par les Communes en s’opposant aux revendications de souveraineté de l’empereur porte à la constitution de beaucoup d’autres « seigneuries étrangères » et annule complètement la possibilité de former en Italie une unique, vaste seigneurie, un État. Cela peut décevoir ceux pour qui un État national centralisé recouvre une valeur intrinsèque ; mais peut-être le particularisme a-t-il été toujours une caractéristique de l’histoire des italiens » (Storia d’Italia, op. cit. n° 89, pp. 25-6).









4 – Milan, de la Commune à la Seigneurie des Visconti et des Sforza
La commune de Milan, comme beaucoup d’autres et avant les communes toscanes, se transforma vite en seigneurie. La fin de l’empire avait laissé l’avenir ouvert : en France et en Angleterre, ou dans le Royaume de Sicile, un État unitaire et centralisé avait déjà commencé à se former, représenté par des parlements composés de la noblesse féodale, du clergé et des bourgeoisies urbaines. En Italie du centre et du nord, la force des autonomies locales empêcha la formation d’un processus unitaire, et la concentration resta au maximum « régionale ». La commune ne fut jamais une « démocratie » au sens moderne, mais toujours un compromis entre un régime féodal et un élargissement de la participation à la vie politique des nouvelles forces de la « bourgeoisie » locale. Il ne faut pas oublier non plus que l’Italie fut toujours une civilisation urbaine, où l’évêque était puissant, et où la noblesse féodale domina toujours et dans la campagne, dans le château et à l’intérieur de la ville. À Milan, « dès l’âge pré communal, la communauté urbaine est encadrée et organisée par la couche des grands vassaux féodaux, les capitanes ou vassi in capite. Cette couche, qui est puissante aussi bien en ville que dans le « contado », agit en rapport étroit avec l’évêque et est assistée par les éléments économiquement les plus actifs des citoyens » (Storia d’Italia, Fabbri, Bompiani, 1989, p. 197) (Le « contado » est le territoire de campagne qui entoure la ville et qui fait partie de ses possessions).
Au début, dès le XIe siècle, il y eut des consuls élus par l’assemblée générale des citoyens, magistrature collective et temporaire, ni ecclésiastique ni liée aux pouvoirs féodaux (anciens marquis, comtes, vicomtes). Cette commune consulaire fut dès le XIIe siècle l’expression de l’aristocratie urbaine, dans un équilibre instable des forces économiques, sociales et politiques, des clans et des familles, et même la lutte contre Frédéric Barberousse ne fut pas une discussion des droits et de l’autorité de l’empereur, mais un élargissement des autonomies communales et une conquête de territoires de « contado » jusqu’alors dominés par les feudataires de l’empereur.
Mais dès la fin de la menace impériale, émergèrent les contradictions et les tensions entre aristocratie urbaine et couches bourgeoises ou « populaires » qui tendaient à favoriser la production et le commerce, en même temps qu’une participation politique élargie. À Milan, les couches d’artisans et de marchands, les « popolari », forment la « Credenza di sant’Ambrogio », tandis que les grands propriétaires fonciers et les grandes familles de vieille aristocratie communale constituent la « Motta », Società dei Gagliardi, qui gouvernent ensemble. Puis les contradictions les plus aiguës conduisirent à un remplacement des consuls par un « Podestat », forme de pouvoir personnel qui rappelle le fonctionnaire voulu par Frédéric Barberousse, qui correspond à une rationalisation du pouvoir exécutif. Dans une première période, le podestat fut un citoyen ; dans une seconde période, vers la moitié du XIIIe siècle, il devint un « forestiero » (un homme de l’extérieur, « di fuori ») étranger aux luttes des parties, plus efficace pour garantir l’ordre et la paix, parce que c’est un professionnel de la gestion politique, judiciaire et militaire. Quelquefois, on lui joint un Capitaine du peuple, expression du peuple, mais généralement choisi parmi les représentants de l’aristocratie urbaine, expert en diplomatie et dans l’exercice militaire et qui aura un poids politique toujours plus grand. En somme, la commune évolue vers une autre forme politique dominée par une oligarchie sur laquelle sera d’ici peu dominant un « Seigneur ». À Milan, deux familles se disputeront le pouvoir, les Della Torre (parti populaire guelfe élu par délibération de la Credenza di sant’Ambrogio) et les Visconti (parti gibelin et nobiliaire) qui l’emportèrent à partir de 1277. Au début, à côté du seigneur, se maintint l’organisation communale ; mais elle fut peu après privée de vie, et dut se soumettre à l’homme seul qui exigea des garanties constitutionnelles et eut recours à l’empereur pour obtenir le titre de « vicaire impérial » (ou pour d’autres de « vicaire pontifical »).
Une tendance des seigneuries fut aussi l’expansion par le moyen de la guerre, pour augmenter leur pouvoir, pour satisfaire l’ambition personnelle, pour garantir la sécurité aux frontières, et pour conquérir du prestige auprès des citoyens. De là vint l’idée de constituer une dynastie qui dure dans le temps.
Ainsi commença la Seigneurie : après la victoire des communes sur Frédéric II en 1237 à Camporgnano, les populaires élirent comme podestat Pagano Della Torre en 1240, en souvenir de son intervention décisive contre Frédéric. C’était un feudataire de la Valsassina, et il fut chargé de protéger le peuple contre les abus de la noblesse.
Dans sa plaque mortuaire, il est écrit : « Magnifique chef de guerre et défenseur du peuple ambrosien, exemple de justice, splendeur des grands, aire de sagesse, défenseur de notre mère l’église, fleur de toute cette aimable patrie dans la mort de laquelle tout le decorum italien pâlit ». Mais il mourut un an après, le 6 janvier 1241. En 1247, les populaires mirent à la tête de la Credenza di sant’Ambrogio, avec le titre d’ « Ancien », le neveu de Pagano, Martino Della Torre, pour remettre de l’ordre et rétablir les finances ; il prit contre les riches des initiatives qui ne plurent pas ; en 1259 il fait élire comme capitaine du peuple le marquis Oberto Pelavicino dont il a besoin des forces militaires, mais qui était haï par le pape Clément IV qui essaya de le faire abattre par des processions de flagellants et décida finalement de soutenir les Visconti ; l’archevêque élu de 1241 à 1257 fut Leone da Perego, partisan gibelin des Visconti. Après une tentative de Martin de nommer son frère Philippe comme successeur en 1263 puis son fils Napoleone (Napo) en 1265 et après une période de luttes et de pacifications successives, le pape Urbain IV nomma Othon Visconti archevêque de Milan de 1262 à 1295. Celui-ci fut d’abord chassé de la ville par les Torriani (les partisans des Della Torre), et il se lia toujours plus étroitement aux nobles jusqu’à prendre le commandement des troupes d’exilés ; il battit les Torriani à la bataille de Desio entre le 20 et le 21 janvier 1277 et rentra à Milan avec la faction nobiliaire gibeline. Il reçut des Milanais un accueil triomphal ; les maisons des Torriani furent détruites, et Napo mourut en cage en 1278. Othon fit dissoudre tous les conseils et les sociétés populaires et nobiliaires et les remplaça par une unique magistrature, le Tribunal « di provvisione ». En 1285, il élimina même le Carroccio, considéré comme un obstacle au libre mouvement des soldats et le remplaça par un étendard qui portait l’emblème de la vipère qui avale un infidèle, avec saint Ambroise ; il envoya en exil les familles hostiles, augmenta les effectifs de police ; en 1287, il fit élire comme capitaine du peuple son neveu Matteo, en 1288 et en 1294 il lui fit obtenir le titre de Vicaire impérial. La commune était devenue formelle. Après un retour des Della Torre, Henri VII imposa la paix pour se faire couronner Roi d’Italie à Saint Ambroise en 1310. Matteo Visconti réussit à se faire nommer à nouveau Vicaire impérial avec le titre de Podestat, et les Visconti restèrent au pouvoir jusqu’en 1447. Matteo avait marié son fils Galeazzo avec Béatrice d’Este, une femme très belle et de dons intellectuels exquis en 1300 et se l’était adjoint comme Capitaine du peuple. La Commune était morte même formellement.
Matteo Visconti mourut le 22 janvier 1322. Malgré l’opposition de Florence, de Venise et du cardinal Albornoz, Milan possédait désormais tout le territoire de la Lombardie, jusqu’aux frontières de la Vénétie et de la Toscane. Galeazzo, fils de Matteo, prit sa succession, associa ses quatre frères au gouvernement de l’État. En 1324, le pape décréta une croisade, avec une armée guelfe qui fut défaite le 28 février 1324. Emprisonné par l’empereur Ludovic le Bavarois qui se méfiait de lui, Galeazzo sortit de prison le 25 mars 1328 et mourut peu après le 6 août. La seigneurie passa à son fils Azzone, qui fut de nouveau Vicaire impérial et put rentrer à Milan. Sa première préoccupation fut d’embellir la ville (il fit agrandir les enceintes, décorer les portes du blason de la famille, paver les rues avec des briques en arête de poisson qui furent un modèle pour Londres et Paris, et il fit construire l’église de San Gottardo) et d’éliminer la plaie du banditisme. Il mourut le 16 août 1336 et laissa sa succession à son oncle Luchino.
Celui-ci se révéla un homme équitable et intelligent. Il agrandit le territoire, faisant l’acquisition d’Asti, Alexandrie, Bobbio, Crema, Novare, Parme et Tortona et obligea ses ennemis à lui verser cent mille florins d’or. Il élimina les voleurs qui faisaient obstacle au commerce sur les routes, et fit de l’État un royaume de richesse et de prospérité. Le conseil général établit que désormais le principat des Visconti, d’électif, deviendrait héréditaire. À sa mort (par le poison…) en 1349, c’est donc son frère Jean qui reprit l’héritage ; il avait été évêque de Novare. Il augmenta la richesse de Milan, faisant même l’acquisition de la ville de Bologne, et il protégea les artistes, donnant entre autres l’hospitalité à François Pétrarque de 1335 à 1361.
À la mort de Jean en 1354, l’État resta uni mais fut divisé entre deux neveux de Jean, Bernabò et Galeazzo. Bernabò eut 20 fils et filles dont il sut se servir pour ses alliances : il maria son neveu Gian Galeazzo à Isabelle, fille du roi de France ; une fille fut mariée au duc de Bavière, une à Léopold d’Autriche, une au margrave de Thuringe et une au roi de Chypre, tandis que deux de ses filles naturelles épousèrent les « condottieri » Giovanni Acuto et Corrado Lando ; il contribua à la création d’un État puissant, améliorant les services publics de Milan, particulièrement les hôpitaux ; mais ce fut aussi un tyran, sur le modèle des pires empereurs romains ; la chasse au sanglier était son affaire la plus importante, et il entretenait 5.000 chiens de chasse ; des impôts lourds lui permirent de donner à chacune de ses sept filles une dot de cent mille florins, et à la mort de sa femme, il imposa un deuil d’une année à tous ses sujets. Galeazzo II mourut en 1378 et laissa le pouvoir à son fils Gian Galeazzo, né de son mariage avec Blanche de Savoie, et qui fit empoisonner son oncle Bernabò en 1385 pour récupérer sa part de pouvoir.
Gian Galeazzo fut probablement le plus grand représentant des Visconti, homme politique avisé et mécène éclairé ; après l’écroulement de la cathédrale en 1353, il fit construire la nouvelle cathédrale de Milan (qui témoignait de la piété religieuse et de la prospérité économique) et la Chartreuse de Pavie, commencer la construction de la Forteresse des Visconti et allonger les Navigli (canaux). En 1395, il obtint de l’empereur le titre de duc de Milan puis celui de duc de Lombardie, qui devint héréditaire en 1396. Le domaine des Visconti comprend alors Brescia, Bergame, Côme, Lodi, Feltre, Novare, Vercelli, Alexandrie, Tortona, Bobbio, Piacenza, Reggio, Parme, Crémone, Riva di Trento, Crema, Soncigno, Bormio, Borgo San Donnino, Pontremoli, Feliciano, Arezzo, Belluno, Bassano, Vérone, Vicenza, Sarzana, Avenza, Carrara, Santo Stefano et d’autres terres en Lucchesia (Cf. carte page suivante). Cet État, de conquête récente, se désagrégea après la mort de Gian Galeazzo, mais contribua à la prospérité de Milan qui devient un centre commercial déterminant dans le Nord Italie, et centre de production industrielle (laine et futaine) et agricole (se répand la culture du mûrier et du ver à soie, et celle du riz, et donc une grande attention à la bonification des terrains et à la qualité de l’industrie textile).
Gian Galeazzo perfectionna la politique viscontienne par la création d’un État moderne, « ennemi des particularismes, des forces centrifuges et des autonomies communales résiduelles » (Storia degli Italiani, op. cit. p. 610). Il visait à la seigneurie de toute l’Italie ; il ne fut pas un guerrier, mais il eut à son service les meilleurs condottieri, Alberto da Barbiano, Jacopo dal Verme, Francesco Gonzaga et Facino Cane ; seule sa mort le 3 septembre 1402 sauva Florence de sa conquête.
Malheureusement il maria sa fille Valentine à Louis de Valois duc d’Orléans, qui donna droit de succession à la France sur le duché de Milan.
Après deux ans de régence de Catherine, fille de Bernabò et femme de Gian Galeazzo, son fils Jean Marie (1389-1412) succéda à Gian Galeazzo I. Les deux fils de Gian Galeazzo et de Catherine furent appelés Marie pour remercier la Vierge de leur naissance, parce que, après plusieurs avortements spontanés dus au fait qu’ils étaient cousins au premier degré, ils craignaient de ne pas avoir d’enfants. Jean Marie se signala par sa cruauté et fut éliminé en 1412 par des parents de Bernabò pour venger son assassinat par Gian Galeazzo ; sa mort profita à son frère Philippe Marie (1392-1447), qui épousa la veuve de Facino Cane, Béatrice de Tende, mais il resta sans héritiers et fit décapiter sa femme, plus vieille que lui de 22 ans, pour présomption d’adultère. Il fut le premier à se servir des compagnies d’aventure pour la défense de l’État, libérant du service militaire la population, qui eut donc plus de temps pour s’occuper de commerce et d’industrie. Parmi ses condottieri, il y eut Francesco Sforza, à qui il maria sa fille naturelle Blanche Marie (1425-1268), qui légitima la succession des Sforza à la seigneurie, bien que les Français aient revendiqué le duché pour Charles d’Orléans, sous prétexte qu’il était descendant de Valentine.
À la mort de Philippe Marie, dernier des Visconti, quelques aristocrates, intellectuels humanistes de Milan, eurent l’idée de redonner vie aux institutions communales et républicaines, en fondant la « République Ambrosienne » (14 août 1447), gouvernée par un conseil de capitaines et de défenseurs de la liberté de Milan. À leur tête il y avait Giorgio Lampugnano, Innocenzo Cotta, Teodoro Bossi, Antonio Trivulzio, Bartolomeo Morone et l’écrivain Pier Candido Decembrio, historien de Philippe Marie. Le conseil fit abattre le château de Porta Povia, et brûler les écritures du fisc, confiant les finances à une collecte volontaire selon les finances de chaque citoyen. Francesco Sforza fut nommé capitaine général, mais ce gouvernement resta faible, plusieurs villes du duché se rendirent indépendantes, et dans la ville ce fut l’anarchie.
Francesco Sforza s’éleva contre la République au bout d’un an. Il se déclara héritier légitime du duché, en tant que mari de Blanche Marie, et la ville se rendit à lui, qui y entra triomphalement le 26 février 1450. La République fut une tentative humaniste de reconstituer un État sur le modèle de la Rome républicaine, et donc hostile à toute forme de tyrannie, en faveur d’une liberté totale.












MILAN DEVIENT RICHE ET PROTÈGE LES ARTS
« Même au milieu des hauts et des bas de la situation politique générale, Milan traverse une période de relative prospérité. Il est vrai que les compagnies d’aventure, surtout les mercenaires étrangers, toujours disposés à changer de drapeau, sont pour l’Italie une plaie ouverte ; il est vrai que pour payer ces troupes les seigneurs chargent d’impôts les citoyens ; mais il est aussi vrai que les marchands et les producteurs, en ville et dans le contado, peuvent se consacrer plus à leurs affaires, sans devoir participer à la défense militaire.
Dans l’arc de 90 ans, entre le duché de Gian Galeazzo Visconti et celui de Ludovic Sforza on introduit deux cultures dans la vallée du Pô : le riz et le mûrier, qui représenteront dans les siècles une des plus grandes richesses de la zone. Et si le riz est un produit populaire, le mûrier motive l’artisanat de luxe pour le marché de l’exportation. Ainsi, le travail des soies et brocards n’est plus une prérogative seulement de Venise, Florence et Gênes. Les seigneurs de Milan se montrent aussi à cette période des mécènes exquis. Galeazzo II Visconti reçoit Pétrarque, Bernabò protège l’art des Maîtres de Campione, fonde l’Université de Pavie, Gian Galeazzo fait poser la première pierre pour la construction de la cathédrale et confie à Bramante la charge d’agrandir San Satiro. Francesco Sforza commande à Filarete le Grand Hôpital, transforme le Château des Visconti de Porta Giovia en une cour fastueuse et y appelle des humanistes célèbres. Galeazzo Maria fonde la Chapelle des Musiciens en maintenant une tradition constante de mécénat qui arrivera jusqu’aux splendeurs de Ludovic le Maure » (Storia degli Italiani, op. cit. p. 504).
Le Duché des Sforza
Francesco Sforza (1401-1466) mit fin à la guerre avec Venise, en signant le 9 avril 1454 la paix de Lodi qui institua la « Ligue italique » entre Venise, Milan, Naples, Rome, Ferrare, Sienne, Lodi, Lucques, Bologne, Mantoue, Forlì ; il assura ainsi au duché une longue période de paix, qui permit un grand développement économique. L’agriculture était prospère, grâce à une irrigation et aux travaux ruraux assurés par les communautés religieuses. Milan était au centre du commerce à travers les Alpes, vers la France méridionale et vers l’Espagne ; l’industrie produisait des tapisseries, des produits de soie et de velours, des armures décorées très recherchées. Probablement, il contribua à l’assassinat d’Agnès Visconti, fille de Bernabò et femme de Francesco Gonzaga, décapitée par son mari pour présomption d’adultère. Mais sous sa domination, l’Italie effleura la réalisation d’une « révolution industrielle », et Francesco Sforza aurait été sur la voie de l’unification de l’Italie si la Florence libérale et républicaine ne s’était pas opposée à son avancée vers le centre et le sud de l’Italie.
Francesco fut « père de la guerre et prince de la paix ». Il réunit tous les petits hôpitaux en un unique grand « Ospedale Maggiore » (qui fut une des modèles de Soufflot dans l’Hôtel-Dieu de Lyon), commencé en avril 1456 par Filarete (Antonio di Pietro Averlino, appelé « Filarete » = celui qui aime la vertu, 1400-1465, théoricien de l’architecture protégé par les Sforza), qui fut la première institution laïque en Europe, protégée par le duc. Il fit aussi creuser le canal de la Martesana et continuer la construction de la cathédrale. Il mourut après seize ans de règne le 8 mars 1466 et fut regretté par les Milanais.
Quelques condottieri des Visconti
Un des plus grands fut Facino Cane. De petite noblessede Casale Monferrato, il fut appel Bonifacio, puisBonifacino, et enfin Facino. Il fut aussitt apprci pour sesgrandes capacits militaires et il avait combattu pour lesgrands seigneurs de l’poque, surtout pour Gian GaleazzoVisconti. Il s’tait constitu un vaste domaine autourd’Alexandrie et de Varese, et il essaya toujours del’agrandir. Il mourut Pavie le 16 mars 1412, tandis qu’iltentait de conqurir Bergame.Francesco Bussone da Carmagnola (1390-1432) fut lefils de paysans, d’abord gardien de porcs puis simple soldatdans l’arme de Philippe Marie Visconti. Il se distingua etpassa vite au commandement de l’arme milanaise etpousa Antonia Visconti. Puis il se rendit hostiles lesVisconti et s’enfuit Venise qui le mit la tte de sonarme. Il gagna la bataille de Maclodio en 1427, mais aprsquelques dfaites, les Vnitiens dcidrent de le condamneret de le tuer. Il inspira Alessandro Manzoni une tragdie,Le Comte de Carmagnola (1826) et Eugne Sue uneoeuvre lyrique avec musique d’Ambroise Thomas,Carmagnola (1841).Alberto (Alberico) da Barbiano (1344-1409) tait dela famille romagnole des Comtes de Barbiano. Il apprit l’artmilitaire dans la compagnie d’aventure de John Hawkwood(Giovanni Acuto). Puis il cra sa propre compagniecompose seulement d’Italiens, o se forment d’autrescondottieri, Jacopo dal Verme, Facino Cane, Braccio daMontone et Muzio Attendolo, pre de Francesco Sforza. Ilrenouvela la cavalerie, en modifiant les armures et lesarmes d’attaque, armant les cavaliers d’une pique mortelledans une charge. Sa compagnie dut ddie SaintGeorges et connut beaucoup de grandes victoires.Jacopo dal Verme (1350-1409), d’une clbre famille decondottieri, fut au service des Visconti. Il devint seigneurde Bobbio, Voghera et Castel San Giovanni. Son fils servitsous les Sforza.






À Francesco succéda son fils Galeazzo Maria Sforza (1444-1476), lui aussi mécène et amateur de culture mais homme cruel. Il épousa en 1468 Bonne de Savoie, sœur de la femme de Louis XI de France, aggravant les futurs problèmes dynastiques. Sa dissolution lui attira la haine de nombreuses familles, les taxes et les impôts opprimèrent les citoyens, ses fêtes les scandalisaient. Il avait exilé et peut-être tué sa mère Blanche Marie le 23 octobre 1468. Il fut tué en 1476 par une conjuration de nobles, partisans de la République Ambrosienne, de liberté et d’indépendance des institutions ; il laissait un fils de 8 ans, Gian Galeazzo (1469-1494) confié à la tutelle de Bonne de Savoie et protégé par un fidèle serviteur de Francesco Sforza, Francesco (Cicco) Simonetta qui assura la régence. Un frère de Galeazzo Maria, Ludovic dit le Maure pour la couleur de sa peau ou parce que son nom était Mauro (1452-1508) profita de la régence pour émerger, contre le gré de Simonetta, que Ludovic réussit à faire décapiter le 28 octobre 1480. Gian Galeazzo mourut en 1492 et Bonne de Savoie fut exilée de Milan ; Ludovic s’était fait confier la régence, et fut nommé duc de Milan par l’empereur Maximilien. Ce fut une période d’or pour Milan. Ludovic avait épousé Béatrice d’Este, fille du duc Hercule I d’Este, grâce à l’impulsion de laquelle la ville connut un faste de fêtes, bals, tournois, et présence de grands artistes, parmi lesquels Léonard de Vinci (de 1482 à 1500), Bramante (de 1478 à 1500) et Luca Pacioli (qui y écrit en 1497 son Compendium de divina proportione), malgré la rivalité avec Isabelle d’Aragon, fille d’Alphonse d’Aragon et d’Hyppolite Sforza et femme de Gian Galeazzo. Léonard peignit Cecilia Gallerani, une maîtresse de Ludovic, dans La Dame à l’hermine, et une autre maîtresse du duc, Lucrezia Crivelli dans la Belle ferronnière ; il réalisa aussi la Dernière Cène dans le réfectoire de l’église de Santa Maria delle Grazie, et la Vierge des Rochers. Bramante participa à la décoration d’églises, de l’abside de Santa Maria delle Grazie et du Château Sforza. Sous la domination de Ludovic se réalisèrent aussi des travaux d’ingénieur civils et militaires, canaux, fortifications, et le mûrier devint un élément important de l’économie lombarde. Quand Louis XII, roi de France et prétendant au duché de Milan parce que neveu de Valentine Visconti, descendit en Italie, il conquit le duché en s’appuyant sur une révolte du peuple opprimé par les impôts. Ludovic se réfugia près de l’empereur Maximilien mais fut capturé par les Français le 10 avril 1500 et mourut le 27 mai 1508 dans le château de Loches où il était prisonnier. Milan perdit son indépendance et passa sous domination étrangère pour 360 ans ; ce fut la première seigneurie italienne à tomber sous la domination d’une monarchie nationale, France, Espagne ou Autriche.Après 12 ans de domination française, le duché fut restitué à Hercule Maximilien, fils de Ludovic et de Béatrice d’Este, mais il se fit haïr et François 1er de France reprit le duché en 1515. En 1521, une victoire espagnole permit le retour de François II, frère de Maximilien Sforza, figure inconsistante qui gouverna sous la domination de Charles Quint, qui occupa la ville à sa mort en 1535 et l’incorpora dans ses possessions. La Lombardie était espagnole pour 165 ans. Donc, avec Gian Galeazzo Visconti et Ludovic le Maure, se confirme une réalité : l’Italie n’était pas sur la voie d’une unification nationale sur le modèle des grands états nationaux qui se constituaient autour d’elle, France, Angleterre, Espagne. Gian Galeazzo avait tenté cette voie, mais en vain, et il avait dû établir avec la Toscane et avec Venise un équilibre de puissances régionales. « L’Italie du XVe siècle ne pouvait donner vie qu’à un ordre régional, qui naît en ces années pour se renforcer et se définir en termes géo-économico-politiques à partir du XVIe siècle jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle, pour arriver à l’optimum avec la paix de Vienne de 1748. Évidemment cette analyse procède du refus préliminaire de l’équation, par tant d’aspects axiomatique, de l’unité synonyme de perfection politique et débouché fatal des destins de la nation italienne. Elle procède aussi de la constatation que, dans la péninsule italienne, a surgi une nation polycentrique qui s’est articulée en paramètres régionaux non déterminés par la volonté hasardeuse d’individualités plus ou moins grandes ou par la rationalité plus ou moins rusée d’un projet politique, mais par l’objectivité de l’économie et par la force de la tradition » (Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. n° 100, pp. 289-290).





Autres condottieri des Visconti et des Sforza
Muzio Attendolo Sforza tait n Cotignola (Ravenne) en 1369 ; il futform par Alberico da Barbiano, mais aussi par d’autres condottieri ; il futune lance brise , alli tantt avec l’un tantt avec un autre. Il futd’abord au service du pape Jean XXIII, qui le nomma Comte de Codignola,et du roi de Naples. Il mourut en 1424 pendant une guerre contre Braccioda Montone. Il fut le pre de 7 enfants, parmi lesquels Francesco Sforza. Cefut son courage qui lui donna le surnom de Sforza .Niccol Piccinino (1386-1444), n ct de Perugia, surnomm ainsipour sa petite taille, il tait fils d’un boucher et commena sa carriremilitaire sous les ordres de Braccio da Montone, dont il prit lecommandement des milices, et dont il pousa la nice aprs sa mort en1424. En 1434, il conquit Bologne pour le duc de Milan. Il fut toujoursennemi de Francesco Sforza, partir du moment o celui-ci passa auservice de Venise, et fut assassin par lui aprs avoir pous une de sesfilles naturelles, Drusiana.
Andrea Fortebraccio appel Braccio da Montone (1368-1424), d’unefamille de petite noblesse, il commena sa carrire militaire dans laCompagnie de Saint Georges, aux ordres d’Alberico da Barbiano. Puis en1390, il forma sa propre compagnie. Il combattit pour Florence, pour lepape, contre le pape, pour le roi de Naples, contre Sforza, etc. Il domina unepartie importante de l’Ombrie et mourut la bataille de l’Aquila le 5 juin1424.
Piémont, Lombardie, lagune vénitienne et terre ferme Vénète, Florence et Toscane, État pontifical, Midi continental et les deux grandes îles, sont les aires qui constituent l’Italie jusqu’à son unité de 1861.Il y eut de grandes communes hégémoniques sur d’autres villes, comme Florence et Milan, mais cela ne créa pas une structure d’État ou une ère juridique homogène : chaque cité dominée maintient son autonomie, ses propres institutions, ses propres lois, ses propres habitudes ; par diverses évolutions, s’affirme dans la commune le pouvoir d’un individu (avec le consentement des citoyens avides de paix et de prospérité, et avec l’approbation de l’empereur et du pape qui lui confèrent la fonction vicariale contre d’importantes sommes d’argent) et se constituent des aires régionales, en correspondance avec la grande crise économique qui culmine à la moitié du XIVe siècle, puis avec la reprise entre le XVe et le début du XVIe siècle, l’élan de la seconde moitié du XVIe à la moitié du XVIIe, et avec le second écroulement à la fin du XVIIe et la stagnation du début du XVIIIe siècle.Le rêve vénitien de créer une « monarchie d’Italie » s’écroule dans sa défaite du 14 mai 1509 dans la plaine d’Agnadello, entre Crémone et Bergame, contre les forces de la Ligue de Cambrai et le roi Louis XII de France ; on en a fêté en mai 2009 le 500ème anniversaire par trois jours de manifestations (Cf. Guicciardini, Storia d’Italia, Livre VIII, chapitres IV et V).
Le rêve milanais s’écroule avec la fin des Sforza en 1508. Et les rêves d’empire universel de Dante dans son De Monarchia (1312-13), et d’unité nationale de Machiavel dans son Prince (1513), après l’appel de Pétrarque dans sa Chanson 128, « Italia mia, ben che ‘l parlar sia indarno,» (1345), restent des phénomènes minoritaires, encore inspirés par la nostalgie de l’ancienne Rome.

Chapitre 2 : Milan de 1508 à 1700
5 – La domination espagnole (1535-1700)
De capitale d’un duché indépendant, Milan se retrouve donc désormais chef-lieu d’une province espagnole, avec la surcharge des guerres régulières entre Français et Espagnols et des troupes étrangères installées dans toute la Lombardie, et coupables de permanentes violences contre les populations, en ville et à la campagne. « Le duché de Milan était une possession clé pour les ambitions hégémoniques continentales des Habsbourg, qui leur accordèrent une attention particulière. Au centre des grandes voies de communication, le duché était souvent confié à des hommes d’armes, qui pouvaient ainsi exploiter convenablement les ressources du territoire et intervenir rapidement quand s’en présentait la nécessité. À la tête de l’État, il y avait un gouverneur, qui répondait directement de l’administration au roi d’Espagne. Ses pouvoirs étaient très vastes et il avait la possibilité de condamner et de confisquer. Aussitôt après le gouverneur il y avait le grand chancelier, qui suivait en fait l’administration de l’État, surtout quand le gouverneur était un militaire et s’absentait pendant les guerres. Le grand chancelier faisait aussi l’intermédiaire avec les magistratures locales. Il y avait le Conseil Secret, composé de hauts personnages auxquels on ajoutait des hommes connus pour leur doctrine et leur richesse, qui avait une tâche politique et administrative, semblable à notre Conseil des Ministres. Ensuite venait le Sénat, dont les fonctions avaient été clarifiées par Charles-Quint et qui disposait du droit d’infirmer éventuellement les décisions du gouvernement, même si en substance ce droit se réduisait à peu de choses. Des 15 membres du Sénat, 3 devaient être espagnols.
Dans les magistratures mineures, il y avait un magistrat de la santé, qui s’occupait de l’hygiène publique.
Les milices étaient de deux types, l’une paysanne et l’autre urbaine. Comme les citoyens ne s’enrôlaient pas volontiers, on leur donna quelques privilèges, comme celui de porter librement des armes pour leur défense personnelle, privilège non négligeable en ces temps où le brigandage pouvait rééquilibrer les coups d’une fortune adverse. L’armée était encadrée par les nobles, à qui revenait par leur richesse le droit d’être nommés officiers.
La politique espagnole avait des égards particuliers pour eux, même si parfois elle sentait le besoin de rétablir les distances par des punitions exemplaires » (Storia degli Italiani, op. cit. n° 44, p. 862).
Les Lombards ne furent donc pas totalement exclus du gouvernement : outre le Sénat, restèrent des magistrats comme le Vicaire et les « Douze de Provision », sorte de maire et de conseil d’adjoints qui parvinrent à faire respecter la population et une forme d’indépendance par rapport aux fonctionnaires espagnols arrogants et rapaces à tous niveaux. Les citoyens ambrosiens gardèrent aussi un vif sentiment d’indépendance, et réagirent souvent, en en subissant les conséquences, au mauvais gouvernement étranger. Cependant l’appartenance aux organes de gouvernement était réservée à un cercle restreint de la société, la noblesse milanaise ancienne ou ceux qui s’y étaient intégrés, marchands et financiers enrichis qui menaient en ville une vie « de noble ». La paix de Cateau-Cambrésis, en 1559, confirma la domination espagnole sur l’Italie, duché de Milan, royaume de Naples, royaume de Sicile et de Sardaigne (Cf. carte). Au-dessus des pouvoirs locaux se trouvait le Conseil Suprême d’Italie qui siégeait à Madrid, mais dont l’éloignement le limitait à être un organe consultatif, laissant le pouvoir réel aux fonctionnaires résidant sur place, qui eurent pour constante d’humilier la noblesse locale, l’attachant à eux par des privilèges et par les attractions de la vie de cour, qui impose les pratiques d’une Espagne désormais décadente et préoccupée seulement de maintenir le pouvoir qu’elle a acquis après la conquête de l’Amérique.
« Abus et corruption chez les officiers furent des phénomènes répandus, et pas seulement dans l’État de Milan qui fut l’objet d’études classiques de Frédéric Chabod, auxquels il est toujours utile de se référer. Chabod rappelait qu’était emblématique ‘l’inquisition générale’ des années 1552-54 qui avait même enquêté sur le gouverneur Ferrante Gonzaga. Parmi les chefs d’accusation, le plus grave était de vente des offices judiciaires sans considérer la qualité des personnes et avec une fréquence et une publicité vraiment stupéfiantes. Il est vrai qu’il existait une vente légale, « autorisée, et même voulue par le souverain, d’offices publics, souvent sous forme de subventions ou de prêts à la Chambre » ; cette vente faisait partie du phénomène de l’ampliacion de los oficios commun en Espagne comme dans le Royaume de Naples, et on y recourait quand le Trésor Public était en difficulté. Cependant ce système ne valait pas pour les plus hautes charges, dont l’attribution était réservée au souverain, et pour la « magistrature judiciaire surtout était de règle l’interdiction absolue de toute vente ». Au centre de l’enquête se trouvait au contraire le ‘trafic des offices’, fait extra legem « entre personnes privées avec bénéfices seulement privés », trafic qui restait illégal, même quand il y avait assentiment, implicite ou explicite, du gouverneur qui dans ce cas se rendait complice. Il est de fait que souvent ventes légales et ventes illégales s’entrecroisaient, fournissant l’image d’une administration en proie aux cupidités des individus et à une faim chronique de la part du Trésor. Inutilement Charles-Quint, dans ses « Ordres de Worms » de 1545 avait disposé que les charges fussent données à des personnes méritantes et sans but marchand. Les « subornations » restaient tout à fait interdites non moins que très fréquentes, et même avant l’empereur le gouverneur marquis del Vasto en 1543 avait interdit à quiconque « de demander des offices avec offre d’argent ou autre promesse, sous peine de confiscation des biens pour celui qui promettait et pour celui qui acceptait » ; il avait cherché à frapper les « pratiques pour obtenir des places, des capitaineries, des commissariats et autres offices par le moyen de personnes familières et agréables à Son Excellence, par des offres et des promesses d’argent aux dits familiers et agréables ». Le phénomène étudié par Chabod se manifestait donc comme véritable corruption ; il s’agissait de malos baratos analogues à ceux que Charles-Quint dénonçait pour la Castille, et il était d’autant plus déplorable de devoir admettre que « en la administracion de justicia ha y muy gran corrupcion » (Storia d’Italia, op. cit. n° 111, p. 167 et F. Chabod, Usi e abusi dell’amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il ‘500, in Studi in onore de Giocchino Volpe, Vol. I, Firenze, 1958, pp. 100-113).
Le duché de Milan, comme toute l’Italie, connaît une période de régression économique. À Milan, la production textile tombe en deux siècles de 15.000 pièces de drap à 100 pièces, avec une seule entreprise ; à la fin du XVIe siècle, étaient actives 500 entreprises artisanales de travail de la soie et de l’or, au XVIIIe siècle il en resta 32. Les productions hollandaises, françaises et anglaises étaient plus modernes et moins coûteuses ; l’Espagne en grave crise et l’Allemagne appauvrie par la guerre de Trente ans ne fournissaient plus de débouchés à la production milanaise. Même l’agriculture devint plus pauvre : les zones marécageuses s’agrandirent, à cause des guerres interminables et de la décadence politique ; les étangs devenaient cause de malaria et de misère, et se transformaient en zones de pêche et de chasse pour les nobles ; le seul avantage fut le développement de la culture du riz ; la tendance à transformer les terres cultivées en terres ouvertes contribua aussi à développer l’élevage et l’industrie fromagère.
Le manque de blé porta quelquefois à l’augmentation du prix du pain qui provoqua de terribles révoltes populaires, comme celle de 1628 racontée par Manzoni dans Les Fiancés, suivie par la grande épidémie de peste apportée à Milan par le passage des 25.000 Lansquenets envoyés à l’assaut de Mantoue ; la peste dura de 1630 à 1632. Milan avait une organisation hospitalière très perfectionnée, il y avait plusieurs hôpitaux spécialisés outre le Grand Hôpital créé à l’époque ducale. Le gouvernement espagnol se servit de la superstition populaire des « untori » (porteurs de peste) comme source possible de la peste, et des centaines de ceux-ci, innocents, furent arrêtés, pendus et brûlés de façon horrible, par exemple Pietro Paolo Rigotto, dont Manzoni raconte la mort. L’immense Lazaret de Milan, décrit par Manzoni, ne fut démoli qu’à la fin du XIXe siècle.
Un des grands personnages de la période espagnole fut Charles Borromée, dont l’œuvre fut facilitée par le fait qu’il appartenait à la couche dominante. Il venait d’une ancienne famille de San Miniato en Toscane : un certain Lazare avait aidé les pèlerins qui allaient à Rome pour le Jubilé de 1300, et il avait reçu le nom de « Buon romeo » (bon pèlerin), puis celui de Borromeo. La famille se transfère à Milan, et en 1445, Vitaliano Borromeo devient Comte d’Arona ; la famille acquiert en 1501 l’île de San Vittore (Isola Madre) sur le Lac Majeur, puis les deux autres îles. Charles (1538-1584), neveu du pape Pie IV (1499-1565, milanais), fut nommé secrétaire d’État du pape, puis archevêque de Milan en 1560 et cardinal. Il fut un des organisateurs du Concile de Trente (1545-1563) et un des plus grands interprètes de la Contre-Réforme : « Par d’énergiques initiatives, il voulut faire de Milan le rempart de la réforme catholique, combattant toute indulgence envers les doctrines laxistes et suspectes d’hérésie et entreprenant une œuvre systématique et rigoureuse d’orientation de la vie religieuse et de réforme du clergé. Borromée fonda la congrégation des Oblats, dits ensuite « de saint Charles », il favorisa la naissance ou la pénétration dans Milan de nouveaux ordres répondant mieux à la nouvelle discipline (les Barnabites, –créés dans l’église de saint Barnabé de Milan –, les Théatins, les Jésuites), il fit dissoudre l’ordre milanais médiéval des Humiliâtes de Brera en l’estimant déchu de ses buts d’origine, et il remit leur ancienne maison aux Jésuites, il réorganisa les confréries restantes en unifiant et en fermant des monastères. Il se prodigua avec générosité dans un fort engagement de charité, avec la fondation de nombreux instituts de bienfaisance et d’assistance, ainsi qu’avec la création de diverses institutions religieuses (comme le Grand Séminaire et le Collège Helvétique) et éducatives (le Collège de Brera, le Collège Milanais « des Nobles » et celui de Pavie), consacrées à la formation d’un clergé et d’une classe dirigeante laïque plus adaptés aux temps nouveaux. Il appliqua les préceptes de la Contre–Réforme même aux édifices sacrés, restructurant beaucoup d’anciennes églises milanaises (son architecte de confiance fut Pellegrino Tibaldi) et faisant enlever les sépulcres laïcs des églises. Pour la protection des prérogatives de l’Église ambrosienne, il sut s’opposer même aux autorités espagnoles ; mais sa figure prit une renommée légendaire en particulier pour son œuvre active de pénitence et d’assistance menée personnellement et avec générosité durant la peste de 1576-77 (définie pour cette raison et par la suite « la peste de S. Charles ») et les années de famine qui suivirent. L’archevêque Borromée fut canonisé en 1610, à seulement 27 ans de sa mort » (Valentino De Carlo, Breve storia di Milano, Tascabili economici Newton, 1995, p. 38).
Après la mort de Pie IV, il revint à Milan pour se consacrer à la réforme d’un clergé tombé très bas, le pire d’Italie : les clercs exerçaient n’importe quelle profession, même déshonorante, ils se promenaient armés, profanaient les lieux sacrés, disaient la messe en état d’ébriété, exhibaient leurs femmes et concubines. En 1566, Charles interdit qu’on mange, qu’on boive, qu’on joue et qu’on fasse du commerce dans les églises. Pendant la peste, il laissa un don de 40.000 écus aux pauvres, et dans son testament il fit son héritier le Grand Hôpital de Milan.
Son cousin, Frédéric Borromée (1564-1631) fut nommé cardinal par Sixte IV en 1587, et archevêque de Milan en 1595. Il continua l’œuvre de Charles pour la réforme du clergé et la fondation d’églises et de collèges ; il manifesta une grande charité durant la peste de 1630 (Cf. Manzoni) ; il fonda la Bibliothèque Ambrosienne en 1607 et fit ériger la statue de son cousin à Arona (voir ci-contre son portrait par Cesare Procaccini en 1610). Quatre autres membres de la famille Borromée furent cardinaux et membres de la Curie romaine au XVIIe siècle. L’intransigeante application du Concile de Trente par Frédéric alla de pair avec un important mécénat culturel. La Bibliothèque Ambrosienne fut dotée de 30.000 volumes et 14.000 manuscrits ; on y ajouta la Pinacothèque en 1621, qui aida le développement de la peinture milanaise (la famille Campi, la famille Procaccini, Giovanni Battista Crespi dit Cerano, tous protégés par Frédéric Borromée) ; en d’autres domaines, furent fécondes la littérature (Giovanni Ambrogio Biffi, qui mit au point la phonétique milanaise, Carlo Maria Maggi, père de la littérature milanaise moderne et introducteur au théâtre du personnage de Meneghin) et les sciences (Girolamo Cardano, astrologue, mage, mathématicien, Ludovico Settala, médecin cité au chapitre XXVIII des Fiancés de Manzoni, Alessandro Tadino).
La politique brutale et obtuse pratiquée par les Espagnols dans le domaine des impôts n’empêcha pas un développement économique du Milanais, un progrès de l’agriculture (céréales et plantes fourragères, riz, élevage) grâce aux investissements de capitaux de la ville ; le paysage lombard prend sa forme caractéristique, avec ses fermes (les « cascine »), ses canaux pour l’irrigation (les « rogge »), les rizières, les peupliers ; même les activités manufacturières et financières se développèrent, profitant d’un climat de paix, interrompu seulement par la guerre de la Valtellina en 1620 contre les protestants. Seule la peste de 1630 marqua un moment d’arrêt du développement, réduisant la population milanaise de 130.000 personnes à 70.000 ; mais la population remonta à 120.000 en 1680.
À la mort sans héritier de Charles II d’Espagne en 1700, le duché de Milan passa à Philippe d’Anjou, neveu du roi de France Louis XIV, qui imposa des conseillers, des troupes dans les Pays Bas et en Lombardie, et des privilèges commerciaux de la France dans les colonies espagnoles. S’opposa alors à lui en 1701 une coalition formée de l’Autriche, l’Angleterre et les Provinces-Unies. Milan fut envahie par une armée autrichienne commandée par Eugène de Savoie ; le Piémont et le Portugal avaient rejoint la coalition en 1703. Les troupes françaises furent défaites dans les Pays Bas et au Piémont en 1706 (la victoire piémontaise qui fut à l’origine de la construction de la Basilique de la Superga). Milan et la Lombardie furent envahies par l’Autriche qui conserva sa souveraineté, confirmée par le traité de Rastadt (1714) jusqu’à Napoléon, exceptée la période, de 1733 à 1736 où la France occupa Milan.
La domination espagnole eut de nombreuses conséquences dans la vie quotidienne des Milanais, d’abord dans le comportement « mondain », du baisemain au luxe et à l’amour-propre dans les rapports sociaux. La langue fut fortement influencée par l’espagnol : Benedetto Croce a souligné des centaines et milliers d’hispanismes introduits dans la langue italienne, baciamano, complimento, creanza, sussiego (condescendance), sfarzo (luxe), puntiglio (amour-propre), marrano (traître), fanfarone, appartamento, zimarra (simarre), soppressata (saucisson de porc avec des épices), marmellata (confiture), quintale, tonnellata, astuccio (trousse), dispaccio (missive), lindo (élégant), impegno (engagement), vigliacco (lâche), titres de Signore, don, Marchesa, il torrone (le nougat), termes de marine (flotta, baia, babordo) … (Cf Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Sansoni, 1961, pp. 419-421). La forme grammaticale du « Lei », comme valeur autonome de troisième personne de politesse reste vivante dans le langue jusqu’à aujourd’hui.
Les Espagnols influencèrent aussi la mode : « À la fin du XVIIe s. dans son caractère d’ensemble, l’habillement s’inspire de façon plus rigoureuse des préceptes de la mode espagnole. Les vêtements féminins se ferment alors autour du cou avec de grands colliers plissés et amidonnés, et ils acquièrent dans leur ligne une pesanteur luxueuse. Dans ce style hautain est évidente l’influence de l’orgueil de caste espagnol. Le résultat est totalement négatif du point de vue esthétique » (Rosita Levi Pisetzky, la mode espagnole à Milan, in Storia di Milano, Vol. X, Milano, 1957, p. 682). Les Milanais, désormais, s’habillent à l’espagnole.
Tels furent quelques aspects de la vie milanaise (et des autres possessions espagnoles en Italie qui firent de la fin du XVIe et du XVIIe siècles une période d’immobilisme et même de décadence qui fut celle de l’empire espagnol. Le mariage entre l’Italie et l’Espagne fut « une décadence qui embrassait une autre décadence » (Benedetto Croce). Cela est confirmé par l’évolution du paysage : « L’histoire du paysage agraire italien du XVIe et du XVIIe siècles reproduit fidèlement, en termes visibles, un long cycle de la vie de l’économie agraire, qui d’une phase d’expansion effrénée passe, à la fin du XVIe siècle et dans une mesure croissante au cours du XVIIe siècle, à une phase régressive plus ou moins ressentie dans les diverses régions de la Péninsule (…) Il est indéniable que, dans son ensemble, le paysage agraire du XVIIe siècle est le témoignage sûr d’un monde agricole en grande partie tombé dans la misère et devenu stérile ; un monde empoisonné par les conceptions féodales, qui provoquent à une concentration injuste et improductive de la propriété foncière et dégradent l’esprit d’entreprise des classes rurales » (Aldo De Maddalena, Il mondo rurale italiano, in Rivista Storica Italiana, 1964, pp. 362-363).
Comme l’Espagne, l’Italie fut incapable de rénover le prestigieux modèle communal qu’elle avait créé durant le moyen âge, mélange de féodalité et de commerce, et qui peu à peu laissa les pouvoirs à une nouvelle aristocratie composée de l’ancienne noblesse élargie à une partie minime de la nouvelle bourgeoisie : « À Milan aussi était en vigueur une incompatibilité rigide entre noblesse et exercice d’activités économiques. Sur cela veillait le Collège des jurisconsultes qui, dès 1487, n’admettait pas en son sein le candidat qui avait exercé, lui ou son père, des arts vils. Si l’incompatibilité avait concerné jusqu’alors le seul exercice direct, en 1593, le même Collège l’étendait aux gestionnaires adjoints, même secrets. Face aux dommages manifestes que produisait une semblable situation s’élevèrent au milieu du XVIIe siècle des voix discordantes. Déjà en 1663 l’avis du jurisconsulte G. Borri soutenait que depuis toujours la richesse était partie intégrante de la condition de vie du noble. En 1668, un conseil du Sénat sanctionnait cette nouvelle orientation : le statut nobiliaire ne se perd pas en exerçant le commerce ou l’échange mais seulement on le passe sous silence, toujours à condition que ces activités s’exercent par le moyen de gestionnaires et de l’œuvre d’autrui » (Storia d’Italia, op. cit. n° 108, p. 91).
Cette couche dominante était constituée au maximum par quelques centaines de familles, couche fermée renforcée par une idéologie nobiliaire, faite d’honneurs, de précédence, de faste et de duels, à l’espagnole. La corruption y était importante et aggravait celle de l’administration espagnole. En 1675, Gregorio Lieti écrit à propos de l’État de Milan : « Les Ministres Royaux de cet État en tirent pour leur propre bourse de si grandes sommes que les italiens ont l ‘habitude de dire par proverbe que les Gouverneurs de Sicile plument, ceux de Naples mangent, mais ceux de Milan dévorent » (G. Lieti, L’Italia regnante, II, Genève, 1675, p. 204). Il y eut en somme une sorte de « reféodalisation » de la Lombardie autour de quelques familles qui réinvestissent dans la propriété foncière, tout en exerçant les pouvoirs politiques en ville : « Même à Milan les mutations sont évidentes. Les D’Adda qui au milieu du XVIe siècle, selon les annotations de Chabod, étaient des marchands et industriels en grand et en même temps grands accapareurs de biens, ont au XVIIe siècle des propriétés terriennes pour 12230 perches milanaises et ont acquis le titre de marquis. Leur propriété s’étend jusqu’à atteindre 25.000 perches d’une valeur que De Maddalena calcule autour du million de lires. Les Arese sont une autre dynastie qui s’éloigne du monde des affaires jusqu’à atteindre dans le cours du XVIIe siècle une possession foncière autour de 11.000 perches pour une valeur de plus d’un demi million de lires. Plus contenue la possession foncière des Melzi, qui pendant longtemps s’étaient consacrés aux activités commerciales : elle se monte au XVIIe siècle à 2500 perches pour une valeur de 150.000 lires. Les Caravaffi, autre importante dynastie de marchands, réunissent au XVIIe siècle une propriété foncière de 4000 perches pour une valeur de 250.000 lires. Et on pourrait multiplier les exemples, tous vont dans le sens d’une oligarchie qui accentue son profil de propriétaires terriens, finissant par conférer à la ville les stigmates de chef-lieu d’un district agricole où sont décentralisées les activités de transformation » (Storia d’Italia, op. cit. n° 128, p. 168).
Au « fiscalisme » et à la corruption s’ajoute l’occupation militaire ; contre la violence des soldats et leurs vols il y eut beaucoup de protestations et de rébellions, par exemple contre l’obligation de « loger » les militaires espagnols. Un résultat fut l’augmentation de la pauvreté et la nécessité de construire des édifices, pour les pauvres qui étaient enfermés et parfois « employés » dans les grands « Hôtels » des pauvres ou instituts pour les femmes en péril : « À Milan, outre deux maisons de converties nées dans les années Trente du XVIe siècle, entre 1555 et 1645 avaient été fondés, avec le soutien des archevêques Charles et Frédéric Borromée et Cesare Monti, quatre conservatoires pour jeunes filles en danger gérés par les Ursulines, une congrégation qui s’occupait du « triage » des filles entre les divers conservatoires et cinq instituts pour femmes tombées ou en difficulté conjugale et jeunes filles vierges. Dans les intentions des fondateurs, ces instituts – à la différence des maisons de converties – devaient être des lieux temporaires d’internement, dans l’attente d’un placement dans le monde comme épouses ou religieuses, dans le cas de celles qui étaient nubiles, ou bien de réconciliation avec leur mari. En réalité, étant donnée l’augmentation constante des jeunes filles contraintes à rester enfermées toute leur vie, à cause de la difficulté de trouver des débouchés extérieurs (il semble que le montant des dots avait considérablement augmenté dans la seconde moitié du XVIe siècle), les conservatoires et les maisons de dépôt ou de secours tendaient souvent à se transformer en institutions conventuelles avec l’obligation de paiement d’une pension, même si elle était de moindre ampleur que les dots demandées pour accéder dans les monastères de plus ancienne tradition. Le présupposé de cette transformation était l’expulsion des femmes tombées, considérées comme irrécupérables et donc déshonorantes pour le bon renom de la maison. Ainsi c’étaient précisément les plus pauvres et celles qui avaient le plus besoin d’aide, auxquelles à l’origine était destinée l’offre d’assistance de la Contre Réforme, qui finissaient par rester exclues. Pour remédier à ces déviations des intentions d’origine, à Milan, fut instituée, en 1640, la Pia Casa di Santa Pelagia pour les pécheresses pénitentes qui n’avaient pas la possibilité de payer la pension demandée dans les autres instituts féminins » (Storia d’Italia, op. cit. n° 129, p. 175).
Dans cette stagnation, il y eut peu d’interventions d’urbanisme : les plus importantes furent les nouveaux murs qui correspondirent à un agrandissement de la ville et la transformation du Château. Les nouveaux murs furent commencés en 1548 par le gouverneur Ferrante Gonzaga ; le nouveau cercle bastionné fut achevé en 1580, il était long de 11 kms, un des plus grands périmètres européens ; il était entouré d’un fossé, et il avait conservé ses dix portes médiévales, plus deux aux côtés du Château. Celui-ci, construit sous les Visconti, fut le siège du gouvernement, puis réduit à un quartier de logement pour les troupes. Ferrante Gonzaga le fit entourer d’une enceinte fortifiée en forme d’étoile à douze pointes, longue de 2,5 kms. La ville s’étendit jusqu’à 800 hectares, avec un agrandissement de 580 par rapport aux anciennes murailles médiévales ; mais la surface nouvelle fut occupée par des jardins et par de nouveaux édifices.










Milan au XVIIIe siècle (Stampe Bertarelli, Milan)


Chapitre 3 : Milan de 1700 à 1861
6 – La domination autrichienne et napoléonienne
L’occupation autrichienne suivit donc l’occupation espagnole, pendant 90 ans, à l’exception de quelques années d’occupation franco-piémontaise. Sous le gouvernement des deux derniers empereurs de la famille des Habsbourg, Charles VI (1711-1740) et Marie-Thérèse (1740-1780) et le premier des Habsbourg-Lorraine, Joseph II, fils de Marie-Thérèse (1780-1790) puis le neuvième des 16 enfants de Marie-Thérèse, Léopold II (1790-1792), ex Grand duc de Toscane (1765-1790), puis de son fils, François II, dernier duc de Milan de 1792 à 1796.
Tous firent de Milan le centre d’un élan réformateur actif, appuyé par des fonctionnaires comme le comte de Trente, Carlo Firmian (1718-1782), et le comte Johan de Wilzseck. Marie-Thérèse fit instituer un nouveau cadastre qui permit d’uniformiser les impôts fonciers, fit réformer les administrations locales, abolir la servitude de la glèbe, libérant de nombreux hommes pour le développement de l’industrie et du commerce ; Wilzseck introduisit la dénomination des rues et la numérotation des édifices en 1786.
Ce climat réformateur permit l’apparition d’un climat intellectuel de grande animation et de grande ouverture, avec quelques hommes de lettres comme Ludovico Muratori (1672-1750), bibliothécaire de la Bibliothèque Ambrosienne, historien auteur de 38 volumes (Rerum Italicarum Scriptores, Antiquitates Italicae Medii Aevi, Novus Thesaurus Veterum Inscriptionum, Annali d’Italia, première grande histoire d’Italie). Un grand poète fut Giuseppe Parini (1729-1799), auteur de Il Giorno, poème satirique sur la noblesse milanaise, des Odes et d’œuvres théâtrales ; le juriste Cesare Beccaria (1738-1794) révolutionna la pratique de la justice européenne avec son livre Des délits et des peines (1762), où il propose la séparation de la justice et de la religion, condamne la torture (et donc l’inquisition pratiquée par l’Église qui condamne aussitôt le livre) et la peine de mort, et affirme la supériorité de la prévention sur la répression. L’écho fut immense dans toute l’Europe, le traité devint le manifeste des Lumières dans le domaine du droit pénal. Les frères Alessandro (1741-1816) et Pietro (1728-1797) Verri seront les plus importants économistes et juristes des Lumières à Milan et en Europe ; de 1764 à 1766 ils publièrent « Il Caffè », revue qui réunit les forces les plus dynamiques de la ville, développant une conscience critique envers les préjugés, les lois et les traditions culturelles dépassées ; auteur de nombreuses œuvres d’économie politique, Pietro a aussi écrit une Histoire de Milan.
Firmian protégea les artistes, par exemple il fit venir Mozart à Milan de 1769 à 1773. En 1708, le Théâtre de Cour dans le Palais Royal fut détruit par un incendie en 1776, et le Ministre confia à Giuseppe Piermarini (1734-1808), architecte de la cour la construction d’un nouveau théâtre lyrique sur les ruines de l’église de Santa Maria alla Scala ; il commença en 1776 et le Théâtre de la Scala fut inauguré en 1778 par une œuvre d’Antonio Salieri, L’Europa riconosciuta, avec un orchestre de 70 musiciens, les décors des frères Bernardino et Fabrizio Galliari, une compagnie de chant qui comprenait les célèbres castrats Pacchiarotti et Rubinelli. Ce fut un des plus importants théâtres lyriques d’Europe, avec La Fenice de Venise, le San Carlo de Naples et le Reggio de Turin. Ici furent chantées les premières de Rossini, Bellini, Donizetti, Puccini et surtout Verdi (Oberto Conte di San Bonifacio en 1839, Nabucco en 1842, I Lombardi alla prima crociata en 1843, Aida en 1872, Otello en 1887 et Falstaff en 1893) Des dizaines de premières danseuses partirent de la Scala et y ont chanté les sopranos Maria Felicita Malibran (1808-1836) et Giuditta Pasta (1797-1865).
Piermarini a aussi réalisé à Milan le Palais Ducal, à côté de la Cathédrale, le Palais Greppi, le Palais Belgioioso, le boulevard planté d’arbres qui relie la ville avec la villa de Monza et les Jardins Publics de Porta Orientale.
La domination autrichienne fut donc un despotisme éclairé qui forma en Lombardie une couche dirigeante d’esprit libéral, qui avait détesté la domination espagnole et qui eut de bons rapports avec les empereurs ; Pietro Verri fut même fonctionnaire du Duché de Milan. Mais le réformisme autrichien s’affaiblit après la disparition de Joseph II, et la classe dirigeante accueillit favorablement les idées des révolutionnaires français et l’expérience napoléonienne.
La grande réforme de Marie-Thérèse fut la réforme du cadastre, qui remplaça les diverses taxes par un impôt foncier égal pour tous et basé sur un cadastre élaboré entre 1709 et 1760, qui mesura tous les terrains et fixa leur valeur ; ce fut un impôt d’égalité, proportionnalité et universalité. L’Église fut exemptée de taxes pour les biens acquis avant 1575. Le cadastre fit apparaître que les nobles possédaient 31,55% des surfaces, les « autres » (ni nobles ni religieux) 29,49% et les sociétés ecclésiastiques 23,59%. Bonaparte conduisit victorieusement la campagne d’Italie, vainquit l’Autriche à Lodi le 10 mai 1796, à Millesimo le 13 mai, et Masséna entra à Milan le 15 mai, porteur des idéaux de la Révolution française. Il fut accueilli avec enthousiasme par le peuple, par la bourgeoisie et par les intellectuels, l’arbre de la Liberté fut dressé Place de la Cathédrale, et la ville connut un « triennat jacobin ». Masséna saccagea les églises, les musées, les caisses publiques, le Mont de Piété et imposa de nouveaux impôts. On peut lire le récit fait par Stendhal dans la Chartreuse de Parme.
Bonaparte institua la République Transpadane (la Lombardie), La République Cispadane (Bologne, Ferrare, Modène et Reggio Emilia, prises à L’État Pontifical), avec le drapeau tricolore. Le Traité de Campoformio (17 octobre 1797) entre Bonaparte et l’Autriche mit fin à la première guerre ; l’Autriche reconnaît la République Cisalpine qui comprenait tous les territoires conquis par Bonaparte en Italie septentrionale, avec Milan pour capitale, mais Bonaparte abandonnait la République de Venise à l’Autriche, avec l’Istrie et la Dalmatie.
La noblesse et les patriciens milanais se rapprochèrent de Bonaparte, dans un conflit animé entre monarchistes conservateurs et républicains démocrates, aggravé par l’exploitation pratiquée par la France ; la République Cisalpine devait fournir des hommes et des rentrées fiscales, qui provoquèrent une forte intolérance envers les Français.
La seconde guerre contre l’Autriche coalisée avec la Russie, l’Angleterre, la Turquie, le Portugal et le Royaume de Naples commença en avril 1799, profitant du fait que Bonaparte était bloqué en Égypte. Le 27 avril, les Français furent vaincus par le général russe Souvorov qui entra dans Milan. Napoléon revient d’Égypte, reprend la situation en main, renverse le Directoire (Coup d’État du 18 Brumaire) et se fait nommer premier Consul. Puis en mai 1800, il descend par le passage le plus difficile, le Grand Saint Bernard (Cf. le portrait de David ci-contre), en Italie où l’armée française est en difficulté, réoccupe Milan le 2 juin 1800, vainc les Autrichiens à Marengo le 14 juin. Le 26 janvier 1802, les Comices de Lyon transforment la Cisalpine en République Italienne, avec Milan pour capitale, Bonaparte président et Francesco Melzi d’Eril (1753-1816) vice-président.
Bonaparte se fit couronner empereur en novembre 1804 et le 19 mars 1805 transforma la République Italienne en Royaume d’Italie dont il ceignit la couronne, avec Melzi d’Eril comme chancelier et garde des Sceaux, sa femme Joséphine reine et son beau-fils Eugène de Beauharnais comme Vice roi.
Le « triennat jacobin » fut souvent considéré comme une période de domination étrangère éloignée de la tradition italienne. En réalité, « les études les plus récentes ont modifié sensiblement cette tendance d’interprétation, soulignant au contraire l’importance fondamentale du triennat jacobin dans l’élaboration de l’expérience politique italienne. C’est pendant ces années en effet que l’on doit rechercher les origines du mouvement national qui se développera dans la Péninsule après l’écroulement du système napoléonien et particulièrement les racines du sentiment républicain et unitaire. Depuis lors l’idée d’une république unitaire et indépendante de l’étranger restera toujours présente dans la pensée des patriotes italiens. Ce sera à une hypothèse républicaine, vue comme cas limite ou comme point de référence idéal, que toute politique rénovatrice sera mesurée les années suivantes » (Storia degli Italiani, op. cit. n° 59, p. 1187). Il y eut d’un côté une pression des exilés italiens rentrés en Italie avec l’armée française ; de l’autre, les constitutions des nouvelles républiques, inspirées par la constitution de la Révolution française, répondaient aussi aux aspirations locales et à l’expérience réformiste du Grand Duché de Toscane sous Pierre Léopold. Le seul point négatif fut que le mouvement jacobin fut animé par une élite qui ne comprenait pas et ne partageait pas les aspirations populaires, par exemple la faim de terre des paysans ; cela provoqua une rupture entre intellectuels patriotes et peuple, l’échec des révolutions (celle de Naples en 1799), et le triomphe d’une nouvelle bourgeoisie appuyée par Napoléon et qui constituera la base de la classe dirigeante du XIXe siècle.
La politique de Napoléon n’avait pas pour but la réalisation d’une Italie unie mais de royaumes soumis à la France, sous son autorité. Il rassura donc les nobles qui le rejoignirent peu à peu et les modérés. À Milan, le 3 janvier 1798 fut publié le « Manifeste » qui annonçait la naissance d’un nouveau journal, le « Moniteur italien », promu par Melchiorre Gioia et Ugo Foscolo, qui valorisait les idées de la révolution Française, les principes républicains et démocratiques et l’indépendance par rapport à une France alliée en vue d’une future unité de l’Italie. Les Français supprimèrent le journal en avril, après trois mois d’existence. Milan connut cependant une certaine prospérité sous la domination napoléonienne grâce à Francesco Melzi d’Eril et à son Ministre des Finances, Giuseppe Prina, qui se consacra à l’assainissement de l’État : il unifia le système monétaire, développa l’instruction publique (école élémentaire obligatoire dans chaque commune, bourses d’étude, création d’Académies des Beaux Arts à Milan et à Bologne …), il aida la naissance de nouvelles industries qui favorisèrent la bourgeoisie mais aussi les ouvriers qui doublèrent leur salaire, il augmenta la consommation de la farine et du pain de blé. La population, qui était restée stable jusqu’en 1800 (Milan passa de 128.000 habitants à 132.000 entre 1775 et 1800), atteignit 142.000 habitants dix ans après, en partie grâce à l’immigration de main-d’œuvre pour les travaux publics. On développa les canaux, les ponts et les routes (ouverture du col du Simplon) ; on introduisit le code civil, pénal et commercial sur le modèle français ; on créa des hôpitaux, des maisons de soin et des cours de mise à jour pour les médecins urbains ; les étrangers comme Stendhal se sentirent « milanais (« Henry Beyle Milanais », sur sa tombe). Milan accrut donc son poids économique et démographique mais resta politiquement une dépendance de Paris, Napoléon en resta le seul maître.
Napoléon dut valoriser les produits italiens pour aider sa politique de guerre, et particulièrement le blocus imposé à l’Angleterre ; il misa sur les produits liés aux nécessités de guerre, comme l’acide sulfurique produit à Milan, ou le raffinement du sucre extrait de la betterave. Il eut aussi besoin de développer les routes, comme les cols alpins, Simplon et Mont Cenis ; le blocus continental fit de l’Italie septentrionale une grande voie de trafic vers l’Orient, et Milan se trouva au centre du trafic commercial. Mais Napoléon réduisit aussi l’Italie à être un pays agricole et presque « colonial », producteur de matières premières et consommateur de produits français. L’Italie dut assurer à la France le coton, la laine, le chanvre, les cuirs, la soie grège à bas prix, et ne put pas acheter d’autres produits que français, velours de coton, étoffes, draps de laine, de coton et peaux, piqués et nanquins. Cela créa des phénomènes de chômage dans certains secteurs, comme celui des tissus de qualité. Cependant à plus longue échéance, la période napoléonienne permit de sortir de l’immobilisme, supprimant les barrières douanières, modernisant les instruments de travail, favorisant le développement d’une bourgeoisie agraire, par l’augmentation des prix des denrées agricoles (froment, riz …) ; les marais, abandonnés par les ordres religieux négligents, furent convertis en terrains cultivables par les nouveaux patrons bourgeois ; mais dans l’immédiat, l’économie italienne eut plus de dommages que de bénéfices, selon les régions. Milan connut cependant une grande reprise : ce fut la capitale, et le gouvernement cisalpin développa les mines lombardes (galène argentifère) et la métallurgie (fabriques d’armes : la région de Brescia fournissait chaque année 40.000 fusils, 6.000 sabres et beaucoup de canons).
Dans un autre domaine, Napoléon eut besoin de soldats. En plus d’un million de Français enrôlés entre 1800 et 1812, plus de 300.000 Italiens participèrent à l’armée napoléonienne. Les Italiens reprirent goût à la guerre et dans le royaume d’Italie furent recrutés 80.000 hommes de valeur, qui se distinguèrent dans toutes les grandes batailles, et particulièrement en Russie (passage de la Beresina). Ce réveil de la conscience militaire italienne fut présent durant le Risorgimento. Et le territoire italien fut désormais divisé seulement en trois royaumes : empire français, Royaume d’Italie et Royaume de Naples (Cf. carte plus haut).
Les interventions d’urbanisme furent commandées par des projets d’adaptation de la structure urbaine à la nouvelle situation de capitale. La façade de la cathédrale est construite sur ordre de Napoléon par Carlo Amati (1776-1852) et Giuseppe Zanoia (1752-1817), entre 1805 et 1813. Une autre œuvre est la construction du dernier corps, vers la gauche, du Grand Hôpital, de Pietro Castelli. L’architecte Giovanni Antonio Antolini projette d’abattre les bastions espagnols qui entouraient le Château des Sforza pour créer un « Forum Bonaparte » sur l’exemple du Forum Romain, avec autour un ensemble d’édifices publics et privés, pour des bureaux, des marchés, des théâtres, vers la nouvelle route pour le Simplon, avec une restructuration du réseau des rues, en partant du plan de circonférences concentriques pour aller vers des axes orthogonaux. Le projet ne fut pas réalisé parce que trop coûteux, et trop innovant, mais il commanda les changements de Milan après l’Unité (Cf. ci-dessus : Démolition des fortifications du Château le 15 mars 1801).
En 1807 fut commencé l’Arc du Simplon (Arc de la Paix) en honneur de Napoléon, sur projet de Luigi Cagnola (1762-1833) ; il fut fini en 1826 en l’honneur de François I, empereur d’Autriche et inauguré en 1933 (Cf photo ci-contre). Sous Napoléon, Milan fut aussi un centre actif de vie culturelle avec de grands écrivains comme Melchiorre Gioia (1767-1829), économiste et homme politique, le poète Vincenzo Monti (1754-1828), Alessandro Volta (1745-1827), physicien inventeur de la première pile électrique, le comte Vincenzo Cuoco (1770-1823), homme de lettres, économiste et philosophe, Ugo Foscolo (1778-1827), auteur des Dernières lettres de Jacopo Ortis, poète des Odes, des Sépulcres, des Grâces, et le poète dialectal Carlo Porta (1778-1821). Mais il faut rappeler Giuseppe Parini (1729-1799), un des plus grands poètes du XVIIIe siècle. La génération de la littérature romantique du début du XIXe siècle se prépare : Ludovico di Breme (1780-1820) qui appuya Madame de Staël quand elle vint à Milan dans l’hiver 1815-16, Giovanni Berchet (1783-1851) qui soutinrent la nouvelle école romantique ; Luigi Porro Lambertenghi (1780-1851) et Federico Confalonieri (1785-1846), le plus grand représentant de la bourgeoisie libérale, créèrent « Il Conciliatore » en 1818, avec l’aide de Silvio Pellico (1789-1854), l’auteur de Mes prisons, récit de son incarcération au Spielberg de 1820 à 1830, de Pietro Borsieri (1788-1852), et avec hésitation de Ugo Foscolo. « Il Conciliatore » fut supprimé par la censure autrichienne après un an de publication.


Pompeo Batoni,Pierre Léopold (à gauche) et Joseph II Empereur(droite). - Martin Van Meyden, Marie Thérèse d’Autriche





De gauche à droite : Ludovico Muratori, Giuseppe Parini, Cesare Beccaria. Alessandro et Pietro Verri












Milan, Cathédrale avant la construction de la façade et après la construction en 1813













7 – Le Risorgimento
Le 16 avril 1814, les Milanais eurent la nouvelle du renoncement de Napoléon aux trônes d’Italie et de France, depuis 10 jours. Les Autrichiens, campés aux portes de la ville, avaient besoin d’un prétexte pour entrer dans la capitale du Royaume d’Italie. Les 20 et 21 avril, des partisans du parti favorable à l’Autriche provoquèrent une révolte populaire contre l’occupation française, firent saccager la maison du Ministre des Finances, Giuseppe Prina (1466-1814), place San Fedele et firent tuer le Ministre (Cf. photo ci-contre, tableau de Giovanni Migliara, Musée de Milan, Saccage de la maison de Prina). La garde nationale intervint, une fois les choses faites, l’armée autrichienne entra en ville pour « rétablir l’ordre », et la Lombardie fut incorporée dans l’empire autrichien le 12 juin.
En octobre 1814, au Congrès de Vienne, l’Angleterre, l’Autriche, la Russie, la Prusse signèrent le Traité de division de l’Italie : le Royaume de Sardaigne était restitué aux Savoie avec l’adjonction de la république de Gênes et des Savoie, le Royaume lombardo-vénète était uni à l’Autriche, le duché de Parme, Plaisance, Guastalla était confié à Marie-Louise, seconde femme de Napoléon, le Principat de Massa et Carrare était donné à Marie-Béatrice d’Este, mère du duc de Modène, le duché de Modène, Reggio et Mirandola était confié à François IV, parent des Habsbourg, le Grand Duché de Toscane (avec l’État des Presidi) est redonné à Ferdinand III, des Habsbourg Lorraine, le duché de Lucques est confié aux Bourbons, l’État Pontifical restitué au Pape et le Royaume de Naples est donné à Ferdinand IV de Bourbon (Cf. page précédente la séance plénière du Congrès de Vienne - Estampe, Milan). Le traité fut signé « au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité … et conformément aux paroles de la Sainte Écriture » et prit le nom de « Sainte Alliance », que l’Angleterre ne voulut pas signer. L’Alliance servit surtout à contrôler et à dominer les États italiens et à réprimer tout mouvement révolutionnaire inspiré par les idéaux de la Révolution française. Ce fut une « Restauration ».
Milan perdit son autonomie politique, bien qu’elle fût capitale du nouveau Royaume Lombardo – Vénète ; l’Autriche revint à son pouvoir autoritaire, antérieur aux Lumières de Marie-Thérèse, nomma vice roi du Royaume l’archiduc d’Autriche Ranieri Giuseppe (1783-1853) et comme président du gouvernement le comte de Strassoldons qui se gagnèrent l’aversion des patriotes ; l’empereur imposa aussi la nomination à Milan d’un archevêque autrichien, le comte Charles Gaétan de Gaisruck, évêque de Derben ; même les aristocrates et les grands bourgeois, plutôt favorables au retour des Habsbourg, retirèrent à l’Autriche leur bienveillance parce que les taxes douanières leur portaient tort ; les intellectuels, déçus par l’obscurantisme autrichien, et la bourgeoisie administrative de l’époque napoléonienne, écartée du service parce qu’elle avait servi les Français, manifestèrent vite une sourde hostilité aux Autrichiens. Ceux-ci imposèrent de lourdes taxes (le Royaume payait un cinquième des impôts de tout l’empire des Habsbourg) ; de nouvelles barrières douanières autour du Royaume limitèrent le commerce pour protéger les industries autrichiennes.
Et pourtant la ville continua à se développer ; de nouveaux « Navigli » (canaux) furent installés (celui pour Pavie), on améliora les égouts, on acheva la disposition des bastions en boulevards plantés d’arbres ; la première ligne de chemin de fer de Milan à Monza (13 Kms) fut inaugurée en 1840, le premier établissement balnéaire (réservé aux hommes) fut ouvert en 1842 à Porta Orientale ; en 1845, l’éclairage au gaz vint apporter la lumière à un sixième de l’espace public ; les routes furent élargies ; en 1844, fut installé un service d’omnibus à chevaux ; même l’agriculture se développa dans la plaine (fourrages, riz, céréales, vigne, élevage de bovins) en même temps que l’industrie agroalimentaire, les fromageries, et les charcuteries et avec l’industrie du coton et de la soie qui se mécanisent et développent leurs exportations. La population augmenta jusqu’à 200.000 habitants en 1860, poussant une activité de construction importante qui occupa les terrains libres, comme les grandes propriétés ecclésiastiques, et poussa à la restauration de nombreuses vieilles maisons.
Les premières années, la lutte ouverte contre les Autrichiens fut impossible, la censure était très sévère (le « Conciliatore » fut supprimé après un an de publication, en 1819) et la répression très dure contre toute opposition : en 1821, Federico Confalonierti (1785-1846), chef et mécène des patriotes, fut arrêté et conduit au Spielberg où le rejoignirent Silvio Pellico, Pietro Maroncelli et l’acteur Angelo Canova ; avec lui furent condamnés le marquis Giorgio Pallavicino-Trivulzio et d’autres aristocrates milanais. La carboneria fut une première forme de lutte, jusqu’en 1830 ; elle naquit comme scission de la puissante franc–maçonnerie qui avait été encouragée par Napoléon, et répondit à la nécessité d’agir dans la clandestinité, divisée en « vendite » (sections) formées de 20 ou 30 « buoni cugini » (bons cousins = associés) qui se réunissaient dans les « baracche » (lieu de rencontre) où les femmes étaient les « giardiniere ». La clandestinité ne servit pas à la diffusion des idées ni à la coordination entre les groupes des diverses régions ; les adhérents étaient une élite d’officiers, employés, nobles progressistes, et membres des couches sociales qui avaient appuyé la Révolution française et étaient opposées à la domination autrichienne. Parmi ses dirigeants, il y avait Filippo Buonarroti (1761-1837) et Santorre di Santarosa (1783-1825). Plusieurs mouvements échouèrent en 1821, et la Révolution française de 1830 porta les patriotes de quelques régions à tenter la lutte contre la Restauration, mais ce fut une défaite, particulièrement en Émilie-Romagne où fut arrêté et pendu Ciro Menotti, qui marqua ainsi la fin de la carboneria.
Un autre mouvement commença alors à être actif, la « Giovine Italia » fondée à Marseille en 1831 par Giuseppe Mazzini (1805-1872) ; il avait participé à la carboneria, mais il l’accusait de négliger le peuple ; pour lui, l’Italie devait être « une, indépendante, libre et républicaine » et il refusait la solution monarchique autour de la famille de Savoie ; l’unité devait se faire « pour le peuple et par le peuple » ; il fonda aussi une « Giovine Germania », une « Giovine Polonia », une « Giovine Svizzera ». Un autre penseur fut le Milanais Carlo Cattaneo (1801-1869), élève du juriste et philosophe Gian Domenico Romagnosi (1761-1835, et partisan d’un fédéralisme républicain, tandis que l’abbé turinois Vincenzo Gioberti (1801-1852) proposait une unité et une indépendance de l’Italie sous la direction de Rome et du pape (Del primato morale e civile degli Italiani, 1846) et que Cesare Balbo (1789-1853) proposait une unité sous la direction du roi de Piémont – Sardaigne (Delle speranze d’Italia, 1844).
La protestation des Milanais contre l’Autriche commença de façon passive, par une abstention du jeu de lotto et du tabac, qui étaient des monopoles d’État ; ce fut une manifestation symbolique qui irrita beaucoup les autorités autrichiennes qui répliquèrent en demandant à leurs soldats de se promener dans les rues en fumant un ou même deux cigares. La révolution française de février 1848 et l’instauration d’un gouvernement républicain lança le mouvement insurrectionnel en Italie et en Europe. À Milan, ce furent les Cinq Journées du 18 au 22 mars 1848, où les Milanais prirent les édifices publics et chassèrent l’armée autrichienne de Milan. Carlo Cattaneo constitua un conseil de guerre pour diriger les insurgés ; le maréchal Radetzky se réfugia dans le quadrilatère de Vérone, Legnago, Mantoue et Peschiera. Giuseppe Montanelli raconte la mobilisation de la population dans ses Mémoires sur l’Italie (Turin, 1853) « Hommes, femmes, vieillards, jeunes gens, enfants, les voilà tous occupés à des barricades : tous pour combattre. Le mauvais matelas de l’artisan, le carrosse du marquis, la bibliothèque du séminariste, le banc d’église, le décor de théâtre, apparaissent dans la rue, tranchées citadines. Antonio Vago, fabricant de pianos, met en barricade un piano à queue de Fritz ! Contre seize mille hommes armés, les Milanais opposaient à peine six cents arquebusiers. Mais de couteaux de cuisine et de table, de masses de fer aiguisées, de clous au bout des bâtons, des précieuses antiquités du musée d’armes d’Ambrogio Ubaldo, des escopettes et des épées des théâtres, de tout le peuple combattant fait une arme. Et aux artilleries répondent les cloches … ». Les Autrichiens durent abandonner Milan et s’en allèrent, emmenant avec eux 19 otages, parmi lesquels le fils d’Alessandro Manzoni.
Charles Albert, roi de Piémont, attendit le 23 mars, il craignait que la Lombardie ne prît une orientation républicaine. Finalement, poussé par Cavour, il fit intervenir l’armée piémontaise contre l’armée autrichienne : ce fut la première guerre d’indépendance, qui fut rejointe par de nombreux volontaires venus de toute l’Italie, parmi lesquels Giuseppe Mazzini. Le président du gouvernement provisoire de Milan fut Gabrio Casati, - noble milanais dont la sœur avait épousé Confalonieri – qui dut passer ensuite au Piémont où il devint président du conseil de Charles Albert. Après une série de victoires et de défaites des Piémontais, la guerre se termina par la défaite piémontaise de Custoza le 25 juillet 1848. Radetzky réoccupa Milan et Charles Albert signa l’armistice de Salasco le 9 août 1848. Une nouvelle défaite à Novare le 23 mars 1849 contraignit Charles Albert à signer un armistice et à renoncer au trône de Piémont – Sardaigne au profit de son fils Victor Emmanuel II.
Durant la période de liberté, le gouvernement provisoire signa tout de suite un décret qui restituait les droits civils aux juifs, expulsés par les Espagnols en 1597, réadmis en 1633, et de nouveau privés de droits civils par les Autrichiens en 1799 ; il décida aussi l’érection d’un monument à ceux qui étaient tombés durant les Cinq Journées, appelé « Victoire » ; une majorité vota l’annexion de la Lombardie au Royaume de Piémont de Charles Albert, mais après la défaite de Custoza, Charles Albert dut céder Milan à Radetzky. Il n’y eut que 136 jours de liberté.
La répression autrichienne fut très dure, commandée par Radetzky, nommé gouverneur général militaire et civil de tout le Royaume Lombardo-Vénète, avec d’amples pouvoirs : il proclama l’état de siège, infligea des impôts très lourds aux couches supérieures qui avaient appuyé le mouvement antiautrichien, et fit fusiller les citoyens les moins riches, comme Serafino Dell’Uomo qui fut fusillé pour avoir mis un tract antiautrichien dans la main d’un soldat autrichien. Il maintint ainsi l’hostilité envers les Habsbourg, et François Joseph se plaignit de l’accueil glacial des Milanais quand il vint à Milan en septembre 1851 et en décembre 1857.
Le 31 juillet, un tapissier milanais, Antonio Amatore Sciesa, fut arrêté avec Gaetano Assi pour avoir affiché des manifestes mazziniens ; tous les deux furent jugés et condamnés à mort ; il s’en suivit l’arrestation et la condamnation de nombreux compagnons mazziniens. En réaction, Mazzini tenta un mouvement révolutionnaire à Milan le 6 février 1853 ; 10 soldats autrichiens furent tués et une cinquantaine blessés, mais ce fut un échec qui se conclut par 16 condamnations à mort et de nombreuses condamnations à la prison. L’état de siège ne fut aboli que le 1er mai 1854, et Radetzky resta gouverneur général jusqu’en 1857, mais il avait répandu dans toute la Lombardie l’idée que seule l’intégration dans le Royaume de Piémont offrait une possibilité d’évolution politique pour Milan. Au même moment, Daniele Manin et Giuseppe La Farina fondèrent à Turin la Société Nationale pour l’unification sous la Maison de Savoie, avec la devise « Italie et Victor Emmanuel » à laquelle adhéra même le républicain Garibaldi en 1857. Le nom de Verdi fut acclamé à chaque représentation d’une de ses œuvres à la Scala, comme Nabucco en 1842, et signifia « Vittorio Emanuele Roi d’Italie ».
La période entre 1849 et 1859 fut en Europe une « Seconde Restauration », un retour aux situations réactionnaires d’avant 1848 ; au contraire pour le Piémont ce fut « la décennie cavourienne ». Victor Emmanuel II était un conservateur clérical, mais il avait compris que le triomphe de son règne et de sa dynastie avait besoin de la collaboration des modérés partisans du Statut donné par Charles Albert : « Ainsi le Piémont resta un État constitutionnel dans une Italie et dans une Europe qui avaient répudié et aboli les constitutions arrachées aux souverains dans les premiers mois de 1848 et qui étaient retournés à ces régimes absolutistes » (Storia degli italiani, op. cit. n° 71, p. 1397). Le Roi ne faisait pas confiance à Camillo di Cavour, jugé trop anticlérical et proche de la gauche, mais il se rendit compte qu’il était l’homme le plus capable de diriger sa politique et il le nomma ministre de l’agriculture en 1850, ministre des Finances en 1851 et premier Ministre le 4 novembre 1852.
Cavour eut l’habileté de seconder la politique de la France et de l’Angleterre, et il envoya un corps de carabiniers dans la guerre de Crimée aux côtés de la France, de l’Angleterre et de la Turquie contre l’empire Ottoman en 1855, ce qui lui permit de participer au Congrès de Paris en 1856 et de nouer des contacts avec Napoléon III, qui conduisirent aux accords de Plombières en juillet 1858, selon lesquels l’empire français s’engageait à intervenir dans une guerre contre l’Autriche aux côtés du Royaume de Sardaigne, en cas d’attaque de l’armée autrichienne, en échange d’une cession à la France des Savoie et du Comté de Nice. Cavour s’était fait aider par son secrétaire, Costantino Nigra, et par la Comtesse de Castiglione qui eut les faveurs de Napoléon III (Cf. leurs portraits plus haut). Pour répondre au fort réarmement du Piémont, l’Autriche déclara la guerre et envahit le Piémont le 26 avril 1859 jusqu’à 50 Kms de Turin. Les Franco-Piémontais remportèrent les victoires de Palestro et de Magenta (4 juin 1859). Napoléon III et Victor Emmanuel II entrèrent à Milan le 8 juin 1859 (Cf. ci-contre tableau de Giuseppe Bertini, Milan, et en dessous de Carlo Bossoli, Turin). Le 24 juin, Français et Piémontais gagnent les batailles de Solferino et de San Martino. Ces batailles firent tant de morts et de blessés qu’elles convainquirent un citoyen suisse, Henry Dunant, de fonder la Croix Rouge en 1863.
Napoléon III décida alors de signer un armistice séparé avec l’empereur d’Autriche le 12 juillet à Villafranca. La Lombardie fut donnée à la France qui la rétrocéda au Piémont qui annexa aussi Parme, Modène, l’Émilie, la Romagne et la Toscane où les souverains furent chassés par la population ; après l’Expédition des Mille en mai 1860, le Royaume de Naples et les États Pontificaux furent annexés à l’Italie, à laquelle ne manquaient que la Vénétie et la ville de Rome. Le Royaume d’Italie fut proclamé le 18 février 1861, avec Vittorio Emanuele II comme Roi, et le drapeau tricolore vert, blanc et rouge. Milan achève donc alors son histoire de commune autonome et de capitale du Royaume Lombardo–Vénète. Son premier maire fut nommé, le « cavaliere e dottore ».



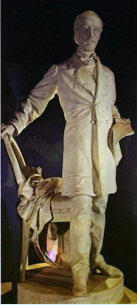






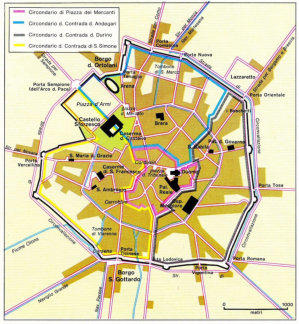





Chapitre 4 : Milan de l’Unité à aujourd’hui
8 – Milan de l’Unité au fascisme
En 1859, la Commune était limitée par le cercle de murailles du XVIe siècle, qui avait perdu sa fonction défensive, et servait d’enceinte douanière et de promenade plantée d’arbres. À l’extérieur, s’étendait la Commune des « Corpi Santi », aire populaire, « myriade de petits noyaux agricoles et de fermes isolées, traversée par des voies étroites de communication et par un fin réseau de petits canaux d’irrigation (les « rogge »). Était compris dans les Corpi Santi de la Porte orientale le splendide ensemble du XVe siècle, le Lazaret, structure depuis longtemps hors d’usage, occupée par de modestes boutiques artisanales, et résidence dégradée de la première immigration en ville » (Valentino De Carlo, Breve storia di Milano, Tascabili economici Newton, 1995, p. 49).
Milan avait connu depuis le XVIIIe siècle une intense vie culturelle, de Pietro Verri à Cesare Beccaria, du réformisme thérésien au réformisme révolutionnaire de la République Cisalpine, de Carlo Cattaneo à Alessandro Manzoni (Cf. ci-contre : Portrait de Manzoni, par Hayez, à Brera) et à Giuseppe Verdi. À Milan naquit aussi la « Scapigliatura » (la Bohême), avec le roman de Cletto Arrighi (1828-1906, La Scapigliatura, 1862) et des œuvres dialectales reprise entre autres par Dario Fo) et les romans de Giuseppe Rovani (La jeunesse de Jules César en 1872, Cento anni en (1859-64), puis avec les œuvres de Camillo Boito (1836-1914), auteur de livrets d’opéra et de nouvelles dont Senso qui inspira le film de Luchino Visconti. Il était aussi architecte), Ugo Tarchetti (1841-1869, auteur de Fosca qui inspira le film d’Ettore Scola), Carlo Dossi (1849-1910), Emilio Praga (1839-1875), les peintres Tranquillo Cremona (1837-1878) et Daniele Ranzoni (1843-1889). Leur publication « Lo scapigliato » était imprimée à Milan dans les années ’60.
Au contraire, la structure économique était restée statique et souvent artisanale : industrie textile et d’habillement, production de biens de luxe, carrosses, bijoux, artisanat d’art, industries pour la consommation de masse, alimentation, céramiques, briques ; l’industrie mécanique et chimique restait liée au marché local.
Après l’Unité, la loi électorale qui favorisait le cens écarta la bourgeoisie la plus démocratique du Risorgimento (en 1865, votèrent 276.523 électeurs sur 504.265 inscrits, choisis parmi les hommes de plus de 25 ans, qui avaient une instruction supérieure et payaient au moins 40 lires d’impôt ; les habitants étaient environ 25 millions) ; et la politique économique de la ville resta entre les mains des conservateurs et de la finance locale ; celle-ci profita des occasions offertes par l’Unité pour « requalifier » le centre historique en fonction des nouvelles célébrations patriotiques. On démolit des quartiers populaires entiers, et l’augmentation de la population de 1844 à 1861 correspondit à une diminution du nombre des maisons : en 1844, selon les chiffres de Carlo Cattaneo, 156.000 habitants et 5085 maisons ; en 1871, 196.000 habitants et 4.647 maisons ; remplacement de constructions à basse densité d’habitants par des édifices à forte densité, ce qui signifie une aggravation des conditions d’habitation et de vie pour les plus pauvres. Le temps était passé où à Milan cohabitaient les riches et les pauvres, les boutiques artisanales et les fastueuses demeures ; le centre fut saccagé au profit des institutions bancaires, des monuments à la Finance et de grandes structures de célébration. Les couches les plus démunies furent repoussées vers les maisons populaires de la périphérie et de la campagne (Voir dans notre site, 5.1- Diverses formes de législation électorale en Italie).
L’architecte bolonais Giuseppe Mengoni (1829-1877) réalisa en 1865-68 les grands ensembles de la Piazza Duomo et de la Galerie Victor-Emmanuel II, qui absorbèrent 43,5% du budget communal entre 1860 et 1882, au milieu de grandes difficultés financières, parmi lesquelles la faillite de la société anglaise qui devait faire les constructions. La Place de la Cathédrale fut tracée en détruisant tout un quartier médiéval jugé de peu d’intérêt historique et peu adéquat au prestige de la ville. Un incident arrivé à quelques heures de l’inauguration coûta la vie à l’architecte Mengoni, qui fut enterré dans le nouveau Cimetière Monumental inauguré en 1867 (architecte : Carlo Maciacchini, 1818-1899). Au contraire, les édifices considérés comme monuments dignes de l’histoire et comme documents de « génie national », furent restaurés, comme San Simpliciano et San Marco (1871), Sant’Eustorgio (1878), Santa Maria del Carmine (1879), San Lorenzo Maggiore (1878-80), Santa Maria delle Grazie (1881) ; un concours de 1884-88 pour compléter la façade de la cathédrale ne donna pas de résultats concrets. D’autres travaux commencèrent piazza Mercanti, piazza della Scala, Porta Ticinese et Porta Nuova. Le Lazaret fut détruit au profit d’un des pires quartiers de Milan d’habitations à haute densité. Le Château fut sauvé par l’adjoint et architecte Luca Beltrami (1854-1933), mais le quartier entre le Château et piazza Mercanti fut éventré. Selon les prévisions du Plan Régulateur lui-même, les murailles espagnoles furent démolies ; plus tard on couvrit le cercle des Navigli.
Les lignes ferroviaires mirent la ville en relation avec le réseau national, élément du projet de faire de Milan la capitale de la finance européenne ; on construisit la première Gare Centrale de Chemin de Fer (1857-1864. Cf. photo ci-dessus) sur l’actuelle place de la République (à ne pas confondre avec la Gare actuelle, inaugurée en 1931), et la Gare de Porta Genova (1865) ; on réalisa en 1876 le chemin de fer à cheval Milano-Monza avec terminus à Porta Venezia (Cf. photo page précédente). Les nouvelles gares orientèrent l’expansion urbaine au sud et au nord de la ville, aux dépens des zones vertes agricoles.
La librairie du suisse Ulrico Hoepli en 1871 marqua le début d’une nouvelle saison de l’édition milanaise, qui deviendra un des points forts de Milan, avec les éditeurs Vallardi, Treves, Sonzogno, et plus tard Mondadori et Rizzoli. Milan est aussi la ville où se développent le plus les grands journaux, généralement liés aux partis politiques de l’époque. En 1866 est créé le quotidien Il Secolo par Edoardo Sonzogno, le plus grand organe de presse radical et le quotidien italien le plus diffusé jusqu’à l’apparition du Corriere della Sera. Dans le nouveau Parti Républicain Italien, créé en 1879, s’exprimaient les opinions radicales de la petite et moyenne bourgeoisie professionnelle et artisanale, qui confluaient avec tous les opposants à la « Consorteria », qui regroupait les modérés détenteurs du pouvoir local. Il Secolo fut leur expression et devint un journal populaire, contre la presse conservatrice de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie, Il Pungolo et La Perseveranza. Son tirage était supérieur à celui de tous les autres journaux réunis.
Le 5 mars 1876 sortit Il Corriere della Sera d’Eugène Torelli-Viollier, avec son supplément La Domenica del Corriere, de 1899 à 1989, qui devint un des principaux quotidiens nationaux (La Domenica del Corriere en couleurs atteignit un tirage d’un million et demi de copies). C’était un journal modéré, dont le créateur avait compris que désormais Milan devenait le plus grand centre industriel et bancaire ; en 1885, il forme une société en commandite avec l’industriel du coton Benigno Crespi (1833-1920) qui lui permet de créer une industrie journalistique moderne, avec son propre siège, sa propre typographie, sa propre agence de recueil de publicité, et avec 123 employés. Torelli-Viollier resta à la direction du Corriere della Sera jusqu’en 1898, quand il fut exclu pour les positions qu’il avait prises contre la répression gouvernementale qui limitait la liberté de la presse qui était un de ses principes fondamentaux, émané par le Statut de Charles Albert (À gauche, premier numéro du Corriere della Sera, 5-6 mars 1876). Il fut éliminé et remplacé par Luigi Albertini (1871-1941, choisi par Torelli comme successeur et qui resta directeur du journal jusqu’en 1925) ; celui-ci modernisa le quotidien et en fit le premier en Italie (10.000 copies en 1901, 150.000 en 1906, 600.000 pendant la guerre), référence de la bourgeoisie bien-pensante et hostile à la personne de Giolitti.
La presse catholique eut aussi à Milan une place importante pour ses positions sur l’attitude politique des catholiques. L’Osservatore Cattolico fut l’organe semi-officiel des intransigeants dans le conflit entre l’État et l’Église sur la nomination des évêques. Il était dirigé par Don Davide Albertario (1846-1902), qui appuya l’esprit nouveau exprimé par l’encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum (1891), plus attaché aux problèmes sociaux et au régimes démocratiques. Il fut lui aussi arrêté en 1898 pour ses positions contre la répression des mouvements sociaux. D’autres titres catholiques conservateurs furent La Lega lombarda qui finit par s’unir à l’Osservatore cattolico en 1907 pour former L’Unione qui s’appellera L’Italia en 1912 et formera avec Il Popolo le premier grand trust de la presse catholique italienne.
Milan est aussi le siège de naissance de la presse satirique ; en 1882 naît un hebdomadaire qui dure jusqu’en 1950, Il Guerrin Meschino, de tendance modérée, qui devint populaire pour ses vignettes et les poésies satiriques écrites en paraphrasant des textes littéraires célèbres. Tous ces journaux vivent grâce à la publicité et aux annonces de funérailles, et les scandales sont nombreux à propos des pressions exercées par les politiques et par l’administration sur les rédactions, particulièrement au moment des élections.
L’industrialisation de la région qui se développe à partir des années ’80 se traduisit par des progrès d’un prolétariat qui peu à peu prit conscience de sa propre existence et de la nécessité de s’organiser. À Milan en 1882, un publiciste milanais, leader des socialistes évolutionnistes, Osvaldo Gnocchi-Viani (1837-1917), fonda le « Parti Ouvrier Italien », réservé aux travailleurs manuels. Jusqu’alors, les ouvriers avaient été organisés dans le « Consulat ouvrier » et dans la « Confédération Lombarde des Ouvriers » aux mains de radicaux comme Antonio Maffi ou Carlo Romussi, rédacteur du Secolo, ou d’associations anarchistes ou mazziniennes favorables à l’abstentionnisme dans les élections au Parlement. Après 1889, plusieurs membres du Parti adhérèrent à la « Ligue Socialiste Milanaise » fondée par Filippo Turati Cf photo ci-dessus), compagnon d’Anna Kuliscioff, qui publiait une revue, « Critica Sociale », dans laquelle il propageait l’idée d’une union entre le mouvement ouvrier et les idées des intellectuels les plus avancés. Influencés par les critiques d’Antonio Labriola, les socialistes allèrent vers la fondation d’un Parti Socialiste qui se créa les 14 et 15 août 1892 à Gênes, « Parti Socialiste des Travailleurs Italiens », sous la direction de Filippo Turati, Leonida Bissolati et Camillo Prampolini. Ce fut le premier vrai parti italien : jusqu’alors, les autres partis, de droite et de gauche, étaient des regroupements d’associations locales, de cercles de « fiefs personnels » en vue des élections ; le parti socialiste se donna au contraire une structure centralisée, avec des adhésions individuelles. Dans les élections de fin de siècle, les socialistes obtinrent plusieurs députés, jusqu’à 32 en 1900, surtout dans la plaine du Pô. En 1902, Arturo Labriola (1873-1959) publia à Milan « Avanguardia socialista », organe du syndicalisme révolutionnaire, et il prit le contrôle de la fédération du Parti et de la Chambre du travail de Milan. Le 16 septembre 1904 partait de Milan la première grève générale d’Italie, malgré les résistances des socialistes réformistes. Enrico Leone, leader des syndicalistes révolutionnaires, écrivit : « Le prolétariat d’Italie jusqu’alors n’avait pas encore agi seul comme une classe autonome et comme antagoniste de tout le reste de la société. Maintenant au contraire dans sa grève générale, il s’est montré sur la rampe de l’histoire sans l’aide de la collaboration d’aucune autre couche sociale, bien plus il a agi face au mécontentement déclaré de cette même petite bourgeoisie boutiquière qui s’est sentie blessée dans sa bourse, qui est son cœur de métal, et de cette même démocratisante « petite propriété suante » qui fait la politique du ventre ». Les socialistes réformistes avaient appelé à reprendre le travail pour obtenir au Parlement une loi qui interdise l’usage des armes de la part de la police ; ils furent battus et prirent leurs distances des révolutionnaires dans la gestion de la grève.
Giolitti laissa faire la grève, fidèle à sa politique de non intervention sinon quand l’ordre public était troublé ; il justifia ainsi son choix : « Mes prévisions optimistes se sont révélées totalement vraies parce que la grève n’a pu durer que quelques jours. Les éléments révolutionnaires eux-mêmes ont fini par comprendre que cet instrument, qui pouvait sembler si terrible quand ils se limitaient à en parler et à menacer de son usage, à l’épreuve des faits se révélait presque inoffensif, et tel qu’il mettait plus dans l’embarras ceux qui l’employaient que ceux contre lesquels il était dirigé. L’impression de faillite était générale. La pratique sincère et logique de la politique de liberté acquérait ainsi un nouveau mérite avec la destruction de l’épouvantail et du mythe de la grève générale, dont la menace avait pendant si longtemps troublé l’esprit du pays. Ces violences avaient démontré que la liberté était surtout crainte par les éléments révolutionnaires, lesquels, dans un régime libre perdent toute raison d’être et pour cela tout prestige. Le gouvernement maintenait donc intact son programme de liberté, qui trouvait de vifs opposants dans les deux partis extrémistes de droite et de gauche, ayant une confiance illimitée dans le bon sens du peuple italien auquel l’histoire a enseigné que la démagogie et la réaction étaient ses ennemis dangereux ». Dans le triangle industriel Milan-Turin-Gênes, se formèrent parallèlement les Chambres du travail (celle de Milan fut instituée en 1890) et les Fédérations de métiers, première forme des syndicats nationaux. Milan fut donc le cœur du développement du mouvement ouvrier et socialiste, et plusieurs mouvements s’y organisèrent, par exemple contre l’aggravation de la douane sur le pain en 1885. Le mouvement milanais se constitua entre ouvriers spécialisés qui se considéraient comme l’aristocratie de la nouvelle classe ouvrière, et, à côté d’eux il y avait un sous-prolétariat urbain qui était encore plus profondément touché par le malaise économique. Ivano Bonomi (1873-1951, leader socialiste réformiste) écrivait : « Il ne s’agissait pas de pauvres plèbes méridionales qui, ayant l’illusion d’interpréter la justice du roi lointain, brûlaient la maison communale qui représentait pour eux l’injustice proche. Ici il y avait des foules, dans lesquelles était passée la propagande des socialistes, des républicains, des radicaux, et dans lesquelles s’était éveillée une aspiration vague à des choses nouvelles et à des renouveaux profonds. Pour ces foules l’augmentation du prix du pain n’était que l’occasion, mais le but était tout autre et plus élevé ». La bourgeoisie industrielle, de tradition autoritaire, fut incapable d’affronter cette nouvelle lutte de classe, sinon à travers la répression politique et militaire. La loi Crispi de 1894 imposa la dissolution des associations ouvrières et socialistes. En 1896, Francesco Crispi (1819-1901) fit dissoudre la Chambre du travail de Gênes et en 1897 celle de Rome. Au printemps 1897, le prix du pain avait augmenté de 35 à 50 et 60 centimes le kilo et les grèves agraires se répandirent pour le pain à bon marché et contre le chômage. « Pain et travail » criaient les manifestants. Le pain était alors l’élément de base, et parfois le seul, de l’alimentation de la majorité des Italiens, et avec le système tributaire, les moins aisés payaient 731 millions sur 1361 millions d’entrées tributaires. En 1898, les manifestations prirent souvent un caractère politique et les assauts aux mairies et aux sièges du gouvernement se multiplièrent ; le gouvernement réagit comme s’il voulait punir ces attaques au système politique. Le 6 mai, à la Pirelli, un ouvrier fut arrêté parce qu’il distribuait des tracts socialistes ; l’atmosphère se tendit aussitôt, et un manifestant fut arrêté parce qu’il criait « Vive la révolution » tout en lançant des cailloux sur la police. L’agitation s’étendit et les manifestants prirent d’assaut la station de police où étaient retenus ceux qui avaient été arrêtés ; les soldats et la police tirèrent et deux morts et plusieurs blessés restèrent sur le terrain ; la répression ne rétablit pas l’ordre, malgré les appels de Turati à ne pas répondre aux provocations de la police, et aux charges des soldats, les manifestants répondaient en lançant des cailloux depuis les toits, les fenêtres ou les barricades des rues. Le 7 mai, cependant, le mouvement pouvait être considéré comme éteint quand, sans raison, l’armée tira des coups de canon sur la Porte Ticinese, par peur qu’arrivent les étudiants de Pavie ; plusieurs personnes moururent sur la porte de leur maison. Le 10 mai, l’armée fit tirer contre le couvent des capucins d’où auraient été tirés des coups de fusil, mais c’était faux. La troupe entra dans le couvent, tua deux mendiants qui y étaient hébergés, et en plusieurs lieux de Milan commença à tirer sur des personnes innocentes, en en tuant environ 80 et en en blessant 450. Le général qui donna l’ordre de tirer fut le commandant d’armée de Milan Fiorenzo Bava-Beccaris (1831-1924) ; il fit aussi arrêter tout le corps de rédaction du journal républicain « Italia del Popolo », suspendit « Il Secolo » et fit arrêter son directeur ; même le directeur de l’Osservatore Cattolico, don Davide Albertario fut arrêté pendant quinze jours, en même temps que toutes les personnalités de l’extrême-gauche, Turati, Anna Kuliscioff, Bissolati accusés de « conspiration » contre l’État et qui furent envoyés devant le tribunal militaire. Un ingénieur fut arrêté parce qu’on trouva dans ses poches une carte des égouts de Milan qui lui servait pour son activité professionnelle, et qui fut prise pour un plan d’insurrection révolutionnaire. Ce fut une manifestation de la grande peur de la bourgeoisie face à l’apparition des syndicats et du socialisme, et une occasion de tenter d’abolir les libertés constitutionnelles établies par le Statut de Charles Albert.
Ci-contre : Gaetano Bresci. Dessous : le roi Humbert I.
Les accusés de ces procès furent au nombre de 803, dont 224 étaient mineurs et 26 des femmes ; les tribunaux décidèrent de peines pour une somme de 1390 ans 3 mois et 2 jours de réclusion. Turati fut condamné à 12 ans, Anna Kuliscioff à 2 ans, don Davide Albertario à 3 ans …
Benedetto Croce écrivit : « Le nombre de deux soldats morts, face au nombre de 80 morts et de 450 blessés donné par les statistiques officielles et que d’autres jugèrent inférieur à la vérité, suffit à démontrer que la répression fut démesurée, sans qu’il soit nécessaire de rappeler l’assaut de la troupe au couvent des capucins avec l’arrestation de dangereux rebelles qui s’y étaient enfermés et se révélèrent être des frères et des mendiants, et d’autres erreurs aussi grotesques, qui prouvent que ces jours-là les autorités avaient perdu la tête. Tout cela n’eut aucune proportion avec les incidents qui les occasionnèrent, les états de siège proclamés non seulement à Milan, Florence et ailleurs. Dans ces excès de l’autorité politique et militaire, on sentait la trépidation convulsive de la partie réactionnaire ».
Le roi eut le mauvais goût de nommer Bava-Beccaris préfet de Milan et de le décorer, « pour récompenser le service qu’il a rendu aux institutions et à la civilisation ». Pour cette lettre au général, le roi Humbert I fut assassiné par l’anarchiste Gaetano Bresci (1869-1901) le 29 juillet 1900 à Monza de trois coups de revolver. Bresci fut condamné au bagne et après dix mois fut trouvé pendu dans sa cellule le 22 mai 1901, probablement assassiné par ses gardiens. Par ailleurs les élections communales de 1899 éliminèrent la mairie de droite favorable à Bava-Beccaris et donnèrent la majorité à la gauche, et le radical Giuseppe Mussi (1836-1904) devint le premier maire progressiste de Milan, jusqu’en 1903.
L’administration démocratique réalisa la municipalisation de l’électricité en 1903, et fit construire plusieurs quartiers populaires, dont deux furent réalisés par la Société Humanitaire, institution pour l’instruction professionnelle des pauvres promue par la Commune grâce au legs d’un financier juif, Moïse Loria, en 1892. En 1901 fut fondée l’Université Populaire. Une municipalité libérale prit le pouvoir en 1904 après la démission de Mussi et mit en route le projet pour une nouvelle gare plus efficace, initiative qui ne fut portée à terme qu’en 1931. En 1906, fut voté le grandiose projet de l’Exposition Internationale, destinée à fixer une image positive et optimiste de l’industrie italienne ; elle fut inaugurée dans le Parc le 28 avril et obtint un immense succès malgré un incendie qui détruisit une bonne partie des installations.
Le début du XXe siècle fut une période d’intenses conflits sociaux, auxquels le gouvernement Giolitti essaya de répondre par de nouvelles réformes sociales qui donnaient plus de droits aux travailleurs et par le recours aux guerres coloniales (guerre de Libye en 1911). À l’automne 1906 fut fondée à Milan la Confédération Générale du Travail (CGL, qui deviendra la CGIL. Cf. photo ci-dessous à droite).
À Milan se développa aussi le premier mouvement de démocratie chrétienne, sous l’impulsion de l’avocat Filippo Meda (1869-1939), favorable à une participation des catholiques à l’État italien, interdite par l’encyclique Non Expedit (Il ne convient pas) de Pie IX en 1868, qui avait interdit aux catholiques de participer aux élections italiennes. Meda prit la direction de l’ « Osservatore cattolico » de don Davide Albertario, et tempéra sa polémique antiétatique et antilibérale ; les catholiques intransigeants étaient regroupés autour de la « Lega Lombarda » dirigée par le marquis Carlo Ottavio Cornaggia avec lequel il parvint à faire une fusion dans l’organe unique « L’Unione » qui devint « L’Italia ». Les catholiques avaient formé à Milan une union électorale « Religion et patrie » en août 1904 pour les élections de novembre où fut élu Cornaggia mais pas Meda. Fait nouveau : cas par cas, des catholiques indépendants pouvaient se présenter aux élections politiques, même si Léon XIII avait interdit dans l’encyclique « Graves de communi » en 1901 la constitution d’un parti démocrate chrétien. L’alliance entre les catholiques démocrates chrétiens et les libéraux giolittiens (le « clérico-modérantisme ») se réalisa en 1913 par le Pacte Gentiloni qui permit l’élection de catholiques et de libéraux avec appui réciproque. Benoît XV abolit la Non Expedit en 1919, et naquit alors le Parti Populaire dont rêvait en 1905 Don Luigi Sturzo (1871-1959).
C’est aussi de Milan que le poète Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) lance en 1909 le mouvement futuriste, et publie dans le numéro de février-mars « Poésie » qui avait son siège à Milan le Manifeste du Futurisme, qu’il fit aussi publier en français par le Figaro du 20 février 1909. Les peintres futuristes firent une Exposition d’Art Moderne à Milan en 1911.
Le suffrage « presque universel » (la loi de juin 1912 avait porté à 8 millions le nombre des électeurs) ramena à Milan une administration de gauche en 1914. Le gouvernement conservateur Salandra proclama d’abord la neutralité de l’Italie, mais, particulièrement à Milan, les partisans de l’intervention dans la guerre étaient nombreux, parmi lesquels Benito Mussolini (1883-25 avril 1945), ex-directeur du quotidien socialiste « Avanti » (fondé à Milan en 1896), qui créa un journal à lui, « Il Popolo d’Italia », allié aux industriels et aux nationalistes favorables à l’entrée en guerre, et l’Italie déclara la guerre à l’Autriche-Hongrie le 24 mai 1915. Milan subit son premier bombardement aérien avec des bombes incendiaires lancées par des avions autrichiens le 14 février 1916. Mais les industries milanaises, reconverties à la production de guerre (Breda, Marelli, Isotta Fraschini) connurent au contraire un développement extraordinaire, supérieur à 30%, avec une main-d’œuvre surtout féminine. La guerre se conclut par la bataille de Vittorio Veneto et la victoire fut proclamée le 4 novembre 1918 ; une épidémie de grippe espagnole tua à Milan 6.000 personnes (et 40.000 en Italie), ce pour quoi les cortèges civils et funèbres furent interdits.
Après la guerre, le chômage croissant, l’inflation, la politique réactionnaire du gouvernement provoquèrent à Milan un mécontentement social qui se manifesta par des grèves et des manifestations qui donnèrent le prétexte à une réaction fasciste dont Milan fut souvent le cœur. En 1910, Luigi Federzoni (1878-1967) avait créé l’Association Nationaliste Italienne avec l’appui du milieu industriel milanais ; l’ex-socialiste Benito Mussolini s’en servit pour entrer dans la vie politique nationale, et donna vie à Milan le 23 mars 1919 aux Faisceaux Italiens de Combat (les « fasci »), dans le siège de l’Alliance Industrielle et Commerciale (l’association des patrons italiens qui venait d’être fondée et qui deviendra la future Confindustria) place San Sepolcro (Cf. photo à droite).
Le 15 avril 1919, les Faisceaux détruisent la typographie milanaise de l’Avanti, tandis que le maire socialiste inaugurait la première Foire de Milan et que le pâtissier Angelo Motta inventait le gâteau de Noël, le « panettone » qui s’imposa dans tout le domaine national. Aux élections de novembre 1919, le « bloc fasciste » obtint encore peu de voix, dans la circonscription de Milan, 4657 sur 270.000 votants, et aucun élu.




















9 – Milan sous le fascisme
Milan fut l’une des capitales du fascisme et le capitalisme milanais y fut toujours un fort soutien du régime qui le favorisa dès le début par l’abolition des associations coopératives et des syndicats ; beaucoup d’entreprises passèrent à la charge de l’État à travers l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale, créé après la crise de 1929), l’Alfa Romeo, la Breda, la Marelli, la Banca commerciale et le Credito Italiano. À Milan fut fondée la première entreprise radiophonique en 1925 (Cf. photo à droite, l’Exposition Nationale de Radio Balilla).
Le fascisme continua la politique de transformation et de destruction de la Milan classique. Le plan régulateur de 1934, rédigé par l’Ingénieur et urbaniste communal Cesare Albertini prolonge la vision de celui de Cesare Beruto de 1884, qui avait déterminé une zone d’expansion entre l’anneau défini par les bastions, progressivement démantelés et la nouvelle ceinture ; le plan Albertini, symbolisé par le premier gratte-ciel surnommé le « rubanuvole » (vole nuages), la Torre Snia Viscosa (Cf photo à gauche) accomplit ce travail d’édification intensive ; il exaspéra les éventrations déjà prévues dans le plan de 1909 et détruisit une partie importante des anciennes rues du centre : concentration de structures de direction dans l’ensemble de la place Diaz, le cours Littorio (Matteotti), la nouvelle gare centrale inaugurée en 1931, « hymne emphatique au Progrès encore lié au monumentalisme du XIXe siècle » (Valentino De Carlo, Breve storia di Milano, op. cit. p. 57). Les Navigli furent couverts et transformés en rues, sacrifiant l’aspect de la ville aux exigences du trafic et des édifices. Un nouveau Grand Hôpital fut commencé en 1938 à Niguarda ; on construisit de nouvelles universités, en imposant le serment de fidélité fasciste aux professeurs en 1931 : le Politecnico eut de nouveaux édifices dans la Città degli Studi qui accueillit aussi une partie de l’Université d’État fondée en 1924 ; l’Université Catholique obtint un nouveau siège dans les cloîtres du couvent de Sant’Ambrogio et l’Université Bocconi eut un nouveau siège (de G. Pagano et G. Predeval, 1938-41, de marque rationaliste). En 1923, la ville avait annexé 11 communes voisines, portant la population à 865.000 habitants sur une superficie de 183 km2. Beaucoup d’édifices publics furent transférés, la Fiera Campionaria en 1923, le Palazzo dell’Arte en 1931, le Palais de Justice en 1932, l’Idroscalo et l’aéroport Forlanini en 1935, le vélodrome Vigorelli et le stade San Siro déjà agrandi en 1926 et de nouveau dans le second après-guerre.
Le fascisme voulut donc avant tout construire une ville « nouvelle », digne du XXe siècle et représentative du régime ; il fut favorisé par la stratégie de Margherita Sarfatti, par la revue « Valori plastici » de Mario Broglio et par les écrits de Giorgio De Chirico, Savinio, Carlo Carrà, Mario Sironi.
Toutes ces constructions contribuèrent à expulser du centre les couches populaires, en détruisant 122.000 logements entre 1927 et 1937 ; on réalisa des logements ultra populaires dans les zones méridionales de la ville et des « maisons minimales » dans d’autres zones. Les travaux furent interrompus par l’entrée de l’Italie en guerre, annoncée par Mussolini Piazza Duomo le 10 juin 1940 ; il prévoyait une guerre éclair et victorieuse contre la France et contre l’Angleterre. L’entrée en guerre fut précédée par deux décisions : d’une part les lois raciales de juillet 1938 qui ôtaient tout droit civil aux citoyens juifs, ce qui fit disparaître la grande maison d’édition Treves ; d’autre part, la signature du Pacte d’Acier de 1939, alliance entre l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie.
À Milan, l’économie de guerre imposa des mesures de propagande comme la culture du blé dans les pelouses de Piazza Duomo (1942). La ville fut partiellement détruite par les bombardements de l’aviation anglaise sur les monuments du centre, à moitié abattus : le Château, la Scala, la Galleria, Brera, le Grand Hôpital, le palais Marino, siège de la mairie, le Palais Royal, la cathédrale, et l’Ultima Cena de Léonard risqua la destruction. 25% des habitations furent touchées, et beaucoup d’édifices d’intérêt stratégique, installations ferroviaires et usines.
10 – Milan après-guerre
a) La reconstruction de la ville
La première urgence de l’après-guerre fut la reconstruction des 25% de maisons détruites, des installations ferroviaires et des grandes usines. Le plan régulateur adopté en 1948 mais approuvé définitivement seulement en 1953 définit la nouvelle ville du boom économique, dessinant un nouveau centre directionnel (entre la Gare centrale et la vieille gare de Porta Garibaldi), un nouveau système de viabilité (avec deux autoroutes urbaines qui permettent l’accès des voitures au centre directionnel et au centre historique), la répartition en zones du territoire communal selon les destinations d’usage (habitation, industrie, vert public, services, quartiers résidentiels), construction du réseau métropolitain commencé en 1957 et dont la première partie de la ligne fut inaugurée en octobre 1964. Le métro était devenu une nécessité première : dans le centre, les bureaux avaient remplacé les habitations, créant la diminution des Milanais résidents et une augmentation considérable des « pendolari » (les banlieusards qui travaillent en ville et vivent en banlieue) qui ont conduit à un étranglement du trafic du centre occupé toujours plus par des gratte-ciels et des grands magasins et depuis toujours moins vert. C’est seulement après les années ’80 et l’arrivée de l’informatique qui se transféra hors de l’aire urbaine que les choses commencèrent à s’améliorer. Mais le choix était clair, commandé par le capital et par la spéculation immobilière, de détruire au maximum la Milan populaire traditionnelle, sous le prétexte du coût trop élevé de la restauration des édifices touchés par les bombardements mais récupérables ; la victoire de la Démocratie Chrétienne (DC) dans les élections du 18 avril 1948 rendit possible ce choix réactionnaire commandé seulement par les intérêts patronaux et souvent mafieux (Voir le film de Vittorio De Sica, Miracolo a Milano, de novembre 1951. Image ci-contre).
Avant le plan, le maire socialiste, Antonio Greppi, fit éliminer une énorme quantité de décombres en périphérie, dans la zone de Lampugnano, en créant, entre légalité et spéculation, couche après couche, le Mont Stella, d’une hauteur de 170 mètres ! Apparurent aussi des quartiers provisoires de baraques pour les personnes évacuées qui occupèrent même les zones vertes.
Le plan se réalisa dans un total mépris pour le patrimoine historique de l’architecture urbaine, éventrations de quartiers historiques (heureusement interrompus par le changement d’administration et par un fort mouvement d’opposition de la population qui n’acceptait pas l’éloignement des ouvriers vers la périphérie). L’expansion dans les zones périphériques fut cependant énorme : 430.000 logements entre 1951 et 1961, 437.000 entre 1962 et 1970, et encore 161.000 entre 1971 et 1977. Les constructions occupèrent des zones agricoles et industrielles de façon formellement légale et hors du plan, édifices précaires à démolir en cas de réalisation du plan ; la plus grande partie des édifices ne fut jamais « autosuffisante », elle resta sans assez de services et dotés de peu de qualité urbaine. Le dialogue entre Adriano Celentano (Il ragazzo della via Gluck, 1966) et Giorgio Gaber (La risposta al ragazzo della via Gluck, 1966) rend compte des discussions de l’époque sur ce problème des constructions.
L’architecture des années ’50 et ’60 connut donc des réalisations d’édifices développés en hauteur : le gratte-ciel Pirelli (piazza Duca d’Aosta, par l’étude de Giò Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli, Giuseppe Valtolina, Egidio dell’Orto, 1955-60), siège symbolique de la Région Lombardie, la tour Velasca (sur la place homonyme, par l’étude BBPR, Gianluigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgioioso, Enrico Peressuti, Rogers, 1956-58), la maison multi étages le long du cours Sempione (Piero Bottoni, 1955-57), l’édifice de Piazza della Repubblica de Mattioni et des Soncini, la Tour Tirrenia des Soncini sur la Piazzetta Liberty, la Tour Galfa de Melchiorre Belga, la Tour « Al Parco » de Vico Magistretti, la tour de Luigi Mattioni que le largo Quinto Alpini, la Tour de l’administration communale Via Pirelli, de Vittorio Gandolfi, Renato Bazzoni, Luigi Fratino et Aldo Putelli, la Tour de Pietro Lingeri via Melchiorre Gioia. Le style du « Rationalisme » fut dominant. On peut citer l’Hôtel dei Cavalieri d’Emilio Lancia, la nouvelle Rinascente de Ferdinando Reggiori et Aldo Molteni, le Couvent de Sant’Angelo de Giovanni Muzio, le Palais des Assurances Générales de Enrico Griffini, l’édifice pour habitations et bureaux de Piazza San Babila de Giò Ponti, Eugenio Soncini, Giuseppe De Min et Alessandro Rimini, le Palais de l’Arengario (1937-42, de Pietro Portaluppi).
Dans cette reconstruction de Milan sont donc intervenus de grands architectes comme Piero Bottoni (1903-1973, maisons, palais), Luigi Moretti (1905-1973, Ensemble d’habitations de Corso Italia), Luigi Figini (1903-1964) et Gino Poletti (1903-1991), auteurs de maisons populaires, de villas (Villa Becchi Campiglio via Mozart, de Piero Portaluppi, 1888-1967), d’édifices religieux (églises de la Madonna dei Poveri et des Saints Giovanni e Paolo), Ignazio Gardella (1905-1999, la maison « Al Parco »), Luigi Caccia Dominioni (1913-, édifices d’habitation) et beaucoup d’autres. Mais la première réalisation fut la reconstruction de la Scala inaugurée le 11 mai 1946 par un concert dirigé par Arturo Toscanini à peine revenu de l’exil auquel l’avait contraint le fascisme. Une nouvelle transformation fut effectuée par Mario Botta de 2002 à 2004, avec la construction de deux nouveaux volumes.
Une attention plus grande fut accordée à quelques monuments préexistants ; furent remis en ordre les Musées Civiques du Château des Sforza, et fut restauré le Grand Hôpital, endommagé par la guerre dans lequel fut installée une partie de l’Université d’État (1953).






b) Quelques grandes innovations milanaises
Dans la période qui va des années ’50 à la moitié des années ’60, deux domaines furent particulièrement importants : le premier fut le développement des infrastructures, autoroutes, chemins de fer, téléphones, radio et télévision, l’autre fut la création d’un secteur industriel plus ouvert et plus libéral qui redonne vigueur au système productif italien. Milan fut le centre de grandes innovations dans ces deux domaines ; d’une part Enrico Mattei (1906-1962), député démocrate-chrétien et ex-partisan, au lieu de liquider l’AGIP (Azienda Generale Italiana dei Petroli), comme cela le lui avait été demandé, s’en servit pour développer le secteur du gaz (recherches de méthane dans la plaine du Pô) et du pétrole, avec la création à Milan en 1953 par Enrico Mattei de l’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), dans une concurrence effrénée avec les grandes compagnies pétrolières internationales (« les 7 sœurs »), proposant aux pays producteurs des accords à 50% / 50% au lieu des 75% / 25% pratiqués. En 1956, il créa aussi à Milan un nouveau journal, Il Giorno. Il mourut en 1962 dans un accident d’avion, peut-être provoqué par un sabotage du moteur (Voir le film de Francesco Rosi, Il caso Mattei, 1972) : il fut probablement un de ceux qui créèrent un système de rapports de corruption entre le secteur public et le secteur privé, qui se développa jusqu’à son explosion en 1992 (« Mani pulite », Mains propres). La nationalisation de l’industrie électrique en 1962 libéra de nouveaux capitaux (les indemnités données aux industries privées rachetées par l’État) qui furent investis dans une spéculation immobilière effrénée.
Dans un autre domaine, à partir de 1946, il fut clair que l’on devait procéder à la réalisation d’un réseau de transmetteurs reliés entre eux qui couvrît tout le territoire national ; ce fut à la RAI de Milan que commencèrent le 12 avril 1953 les transmissions expérimentales de la télévision publique, d’abord diffusées sur le circuit radiophonique qui relia Milan à Turin, puis sur tout le territoire national à partir du 3 janvier 1954. Deux ans après, les installations furent transférées à Rome, mais Milan fut un banc d’essai fondamental pour la naissance du service de la Télévision.
Dans le secteur du téléphone, la diffusion des appareils dans les maisons restait parmi les plus basses d’Italie ; toutefois Milan fut la troisième ville européenne par densité téléphonique (32 appareils pour 100 habitants). Au-delà de la TV et du téléphone, Milan eut les premières autoroutes : les travaux de la A1 commencent en 1956 sur le tronçon Milan – Parme, facilitant la mobilité des personnes, des idées et des marchandises.
Dans le domaine industriel, Milan eut un rôle fondamental dans l’industrie électronique, qui produisit les radios, les téléviseurs, les tourne-disques, etc. ; quelques grandes entreprises, déjà depuis les années ’20 et ’30, s’étaient affirmées, la Safar, la Magneti Marelli (Radiomarelli, Allocchio&Bacchini, Fimi, Phonola). 80% des industries électroniques avaient leur siège à Milan et employaient des milliers d’ouvriers et de techniciens ; elles répondaient aux nouveaux « besoins » de consommation nés avec le boom économique, particulièrement parmi les jeunes, tourne-disques et magnétophones à bandes magnétiques portables, transistors, téléviseurs.
Se développa aussi le secteur des électroménagers, brosses électriques, machines à laver, aspirateurs, frigos, lancés par la mode américaine et par un développement très important de la publicité : les palissades des chantiers de construction se recouvrent d’affiches qui invitent à acheter les produits de tout genre, de l’habillement au scooter. Dans ce domaine, Milan fut à l’avant-garde, avec ses véhicules publicitaires, sa Fiera Campionaria, les réclames lumineuses de Piazza Duomo, les émissions télévisées comme Il Carosello.
Il ne faut pas oublier l’industrie des transports, automobiles, motocyclettes, bicyclettes. Les industries mécaniques ont été très détruites, elles doivent se reconstruire et passer de la production de guerre à une production civile. Alfa Romeo commence par la production de rideaux de fer et de cuisinières à gaz ; mais en 1950, elle produit la belle 6C 2500 Freccia d’Oro, en même temps que des véhicules industriels, avant de lancer la 1900 et la Giulietta. Des marques comme Isotta Fraschini, Bianchi (la « Bianchina »), Touring, Zagato, reprennent leurs activités. Innocenti crée un scooter à succès, la Lambretta, Gilera revient à ses puissantes motos ; San Cristoforo propose le scooter Nibbio et Breda un cyclomoteur…. On est entré dans la motorisation de masse, dans laquelle cependant Turin dépassera Milan avec la 600 et la 500 FIAT.
Milan fut aussi la capitale de la mode, à côté de Paris, Londres, New York ; après la guerre, le premier désir des gens humbles fut de sortir de la misère de la guerre et de travailler à la maison pour améliorer la qualité des vêtements : dans chaque maison il y a une machine à coudre, et des revues comme « Vesta » proposent des patrons pour aider les couturières à la maison. Mais à partir de 1947, le plan Marshall envoie pour l’industrie textile italienne du Nord 34.000 tonnes de coton brut, tandis que le gouvernement en importe 50.000 tonnes pour permettre la réouverture des usines du secteur. Le foulard noué sous le menton pour cacher des cheveux peu soignés est remplacé par le chapeau orné de fleurs et de voiles ; réapparaissent les gants, et les chaussures retrouvent leurs talons hauts, les parfums et de nombreux produits invitent les femmes à retrouver charme et élégance.
La mode renaît donc avec l’ouverture dans la Salle Blanche du Palais Pitti à Florence du premier défilé collectif de mode italienne, le 12 février 1951, organisé par le marquis Giorgini, qui lance une nouvelle façon de s’habiller « à l’italienne ». Les maisons milanaises sont aussitôt en première ligne, Biki, Iole Veneziani, Germana Marucelli, Novaresco, Wanna ; dans le salon de Germana Marucelli, les stylistes se retrouvent avec des poètes et des artistes, Ungaretti, Montale, Savinio, Quasimodo, Getulio Alviani ; et la mode se marie avec le design dans les années ’60. On crée des habits de soirée sophistiqués dans leur volume et avec des étoffes précieuses, des dentelles, des paillettes, des manteaux de soirée somptueux, des fourrures de vison pour les premières de la Scala. Les habits de jour sous le genou mettent le sein en évidence, soulignent par une ceinture la taille qui se pince aussi dans les tailleurs, et les chevelures bouclées par la permanente se couvrent de chapeaux à larges bords ou de petites toques. Les femmes recommencent à se farder avec l’eyer-line noir, le rimmel, le fard à paupières et des rouges qui rendent les lèvres sensuelles.
Même la mode masculine se raffine ; plus tard elle s’inspirera des vêtements de Marlon Brando , de James Dean et d’Elvis Presley. À Milan s’ouvrent dans les années ’50 les boutiques qui diffusent des produits de bonne qualité à la portée de la moyenne bourgeoisie ; qui ne peut pas les acheter les imite avec l’aide de couturières à domicile, avec des tissus moins coûteux. Plus tard, à partir des années ’70, s’établirent à Milan les plus grands stylistes qui créèrent une mode plus bourgeoise mais moins arrogante que celle de Paris, imposant dans le monde le « made in Italy », dans des magasins établis dans les quartiers les plus beaux de la ville : le classique quadrilatère de la mode (Vie Montenapoleone, Spiga, Manzoni, Venezia), le magasin de Giorgio Armani dès 1975 via Borgonuovo, le siège de Gianfranco Ferrè via Pontaccio, celui de Gianni et Donatella Versace via Montenapoleone, la boutique de Dolce et Gabbana via Spiga et via San Damiano, le quartier général de Nicola Trussardi dans le palais Marino à la Scala, place de la Scala, tandis que Gucci est via Venezia et via Montenapoleone, Prada dans la Galerie Victor Emmanuel et via Sant Andrea, Etro via Spartaco.
Milan se confirme comme siège de la bonne bourgeoisie italienne, dans sa tradition et dans sa modernité de bourgeoisie d’État. Le symbole de l’activité commerciale de la ville est la Fiera Campionaria , « la plus grande structure commerciale et le plus grand ensemble d’exposition d’Italie, en chiffre d’affaires et en renommée ». Créée en 1920, elle passa bientôt sur l’ex-Place d’Armes. Détruite par les bombardements, elle est reconstruite dès 1946 et connaît maintenant une progression illimitée.
Ainsi Milan fut au cœur de nouvelles contradictions qui éclatèrent dès la fin des années ’60, entre un développement capitaliste effréné qui connut aussitôt la spéculation immobilière et industrielle et les conséquences sur une population ouvrière qui subissait les contrecoups du développement et qui luttait pour s’en libérer, souvent en accord avec les aspirations culturelles des artistes et des architectes. En architecture, la « beauté » n’est pas seulement celle des formes (des monuments, des espaces, etc), mais elle est aussi leur rapport avec les personnes qui y vivent ; or la ville de Milan a été pensée surtout en fonctions des personnes des classes dominantes, de la nouvelle bourgeoisie italienne contemporaine du boom économique des années ’50 et ’60. Les conflits qui suivront en seront la conséquence.



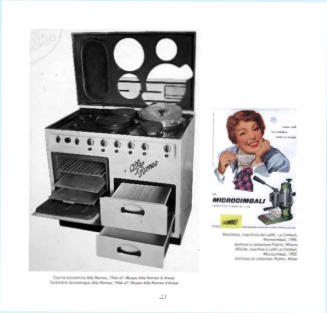








c) La rupture des années ’60 et les années suivantes
Une première rupture dans l’histoire moderne de Milan se produisit dans le mouvement de 1968 et dans ses conséquences. Milan fut un centre important de la protestation étudiante qui se joignit au mouvement syndical dans « l’automne chaud » de 1969. Les Universités furent occupées, on tenta d’imposer le « 6/10 politique » aux examens. La D.C. tenta de se maintenir au pouvoir en encourageant une « stratégie de la tension » entre les mouvements de l’extrême-gauche et les mouvements violents de l’extrême-droite néofasciste, grâce à des interventions ambiguës des Services Secrets, qui durent être réorganisés de façon radicale. Le premier acte de violence fasciste fut la bombe déposée à la Banque de l’Agriculture de Piazza Fontana le 12 décembre 1969, qui provoqua 17 morts et 88 blessés. On accusa d’abord les anarchistes, le danseur de la Scala Pietro Valpreda ; un témoin anarchiste, le cheminot Giuseppe Pinelli, pendant son interrogatoire, tomba d’une fenêtre du quatrième étage du commissariat et se tua : suicide ou assassinat ? La gauche considéra qu’était responsable le commissaire Luigi Calabresi, qui sera tué par un groupe d’extrême-gauche, dans des conditions peu claires, le 17 mai 1972. Les divers procès qui suivirent conclurent que la bombe du 12 décembre était au contraire d’origine néofasciste, mais personne ne fut jamais arrêté. Suivirent d’autres homicides de droite et de gauche, et la ville connut une période très lourde, dite les « années de plomb ». Les Brigades Rouges(BR) et d’autres groupes furent très actifs à Milan, tuant de nombreuses personnalités, agents de police dans des conflits armés ; des juges (Emilio Alessandrini, 29 janvier 1979), des journalistes (Walter Tobagi, 26 mai 1980, des militants de la CGIL, etc.. Pendant 10 ans, Milan devint la capitale du terrorisme, noir et rouge. Les BR constituèrent à Milan le Collectif Politique Métropolitain dans l’automne 1969, qui donna ensuite vie à la Gauche Prolétarienne. Elles furent actives jusqu’en 1982.
Dans cette atmosphère se développa à Milan le nouveau Parti Socialiste Italien (PSI), sous la direction du Milanais Bettino Craxi, qui en fit une force de pouvoir et de gouvernement à partir de 1976, dans une alliance étroite avec la D.C. et avec d’autres forces de droite, et dans un enchevêtrement permanent avec la mafia. Craxi fut Secrétaire du PSI de 1976 à 1992, et Président du Conseil de 1983 à 1987 ; il fut condamné dans le cadre de l’opération « Mani Pulite » (Mains propres) à 27 ans de prison pour financement illicite des partis et corruption ; il s’enfuit en Tunisie où il mourut en 2000. Il fut un des premiers protecteurs politiques de Silvio Berlusconi dans ses opérations immobilières milanaises, parmi lesquelles la construction du quartier Milan 2.
En effet, les magistrats milanais ont commencé en 1992 une série de procès contre le système de corruption et de financement illégal des partis qui était pratiqué par toute la classe politique italienne, mais avant tout par la D.C. et le P.S.I. On parla de « Tangentopoli » (le pays des dessous-de-table). Le groupe d’enquête était dirigé par deux magistrats qui devinrent très populaires, Antonio Di Pietro et Gherardo Colombo, qui furent aussitôt attaqués par les politiques d’abus professionnel et de complot politique « communiste » : c’est Craxi qui commença et continuera ensuite Berlusconi qui parvint à provoquer la démission de Di Pietro de la magistrature en décembre 1994. Mais cette enquête « Mani Pulite » liquida toute la classe politique italienne, provoqua le suicide de plusieurs inculpés, dont Raoul Gardini, et mit en accusation plus d’un millier d’hommes politiques.
Le Milanais Silvio Berlusconi transféra alors son activité de l’immobilier à la télévision, constituant avec ses 6 émetteurs de télévision un réseau très puissant, la FININVEST, et aux médias : entre autres, il réussit à absorber la maison d’édition Mondadori, une des plus importantes d’Italie. Grâce aux potentialités de ses télévisions, il arrive à gagner les élections de 1994, dans une alliance de centre-droit avec la Ligue et avec l’ex-parti néofasciste, Alleanza Nazionale, et à former un premier gouvernement dirigé par lui, qui démissionna au bout de 8 mois à cause de la sécession de la Ligue qui lui fit perdre la majorité. Il garda ensuite son pouvoir sur Milan : le 18 juillet 2010 il obtient le prix du Grand Milan remis par la province, par les mains de Guido Podestà, ex-employé d’une société de Berlusconi, avec la mention : « Homme d’État d’une rare capacité, aimé par tous les Italiens parce que homme parmi les gens et avec les gens, qui conduit avec lucidité et conscience lucide le Pays vers un avenir de femmes et d’hommes libres qui composent une société solidaire fondée sur l’amour, la tolérance et le respect de la vie (…) Avec une extraordinaire clairvoyance et lucidité il a rendu Milan, sa ville aimée, grande en Italie et dans le monde » ! On verra qu’il n’a pas totalement perdu ce pouvoir avec l’arrivée du centre-gauche à la Mairie.













Bibliographie
Voici quelques uns des ouvrages consultés et que vous pouvez vous procurer. Pour tout complément, vous pouvez aussi consulter les sites Internet en vous référant d’abord aux noms propres des personnages évoqués, presque tous commentés, hommes politiques, artistes, savants, ou des institutions évoquées. Vous pouvez aussi consulter des sites historiques, comme : Storia di Milano, Lombardiabeniculturali, Milano, etc. où vous trouvez absolument tout ce que vous pouvez chercher sur l’histoire de Milan, ses personnages, ses saints, ses légendes, ses chansons, ses mythes, ses artistes, son architecture, etc.
Parmi les ouvrages consultés :
Storia degli Italiani, Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1974, 130 fascicules, 2558 pages + XXXVIII pages d’index. Beaucoup d’illustrations.
Storia d’Italia, Bompiani, 1989, 168 fascicules, 4032 pages dont 216 pages d’index chronologiques, et beaucoup d’illustrations thématiques.
Storia d’Italia, Vol. VI, Atlante, Giulio Einaudi 1976, Milano, pp. 244-261.
Valentino De Carlo, Breve storia di Milano, dalle origini ai giorni nostri, Tascabili economici Newton, 1995, 66 pages.
Milano, Touring Club Italiano, La Biblioteca di Repubblica, 2005, 792 pages. Beaucoup de cartes et plans. Le guide le plus complet de Milan.
Pietro Verri, Storia di Milano, 1783, Firenze, Sansoni, 1963 (consultable sur Internet et téléchargeable en tapant : Pietro Verri Storia di Milano.
Storia di Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 17 vol. Milan, 1953-1966.
Catalogue de l’exposition « L’après-guerre à Milan, industrie et design, communication, art et mode », Lyon, 6-21 mars 2008.
Piero Bottoni, Antologia di edifici moderni in Milano, Editoriale Domus, Milano 1954, Reprint 1990, 314 pages + Postfazione di Lodovico Meneghetti, 38 pages. Beaucoup de photos en NB.
Sebastiano Brandolini, Milano, Nuova architettura, Skira, 2005, 216 pages, Préface de Enrico Regazzoni. Nombreuses photos en couleurs.
Revue Bell’Italia, nombreux numéros et articles sur Milan, illustrés de photos de qualité, en particulier :
Milano segreta, I luoghi e le città, dicembre 1992, 116 pages
Milano, I luoghi, le città, le regioni, n° 42 – ottobre 1999, 72 pages
Bell’Italia, n° 197, settembre 2002, pp. 148-160 : San Lorenzo Maggiore
Bell’Italia, n° 248, dicembre 2006, pp. 96-114 : Santa Maria delle Grazie
Bell’Italia, n° 261, gennaio 2008, pp. 116-122 : La Fiera Campionaria, etc.
Culture populaire milanaise et chansons
Nous avons évoqué rapidement la littérature et l’art milanais. Il faudrait y ajouter quelques mots sur ce peuple milanais qui a eu aussi ses formes d’expression littéraire et musicale. Un des auteurs milanais les plus importants en dialecte milanais fut Carlo Maria Maggi (1630-1699), le père de la littérature milanaise ; contre les puristes florentins de L’Académie de la Crusca, il décida d’écrire en dialecte ses vers et ses comédies. C’est lui qui introduisit au théâtre le personnage de Meneghino qui est l’expression de Milan comme Gianduia celle de Turin et Guignol celle de Lyon. Meneghino est le diminutif de Domenico en milanais ; sa femme est la Cecca, diminutif de Francesca. Vous pouvez trouver d’autres personnages populaires milanais sur le site Internet : Catégorie : Maschere / Tradizioni e costumi di Milano : Barbapedana, Scior Carera et d’autres. Parmi les autres auteurs milanais, Carlo Porta (1775-1821), un des plus grands poètes dialectaux de son siècle.
La chanson dialectale milanaise est riche depuis le XVIe siècle. Vous pouvez consulter le site Internet : Canzone milanese. Il vous donnera les informations de base sur la chanson depuis la création de la maison Ricordi en 1857, les auteurs et compositeurs (Alfredo Bracchi, 1897-1976, et Giovanni D’Anzi, 1906-1974, Vittorio Mascheroni, 1895-1972, Nino Rastelli, 1913-1962…) du début de la première moitié du XXe siècle, et les chanteurs de la deuxième moitié du XXe siècle : Enzo Jannacci, 1935-2013, Giorgio Gaber, 1939-2003, Maria Monti, 1935- , Ornella Vanoni, 1934- , Dario Fo, 1926- , et Franca Rame, 1929-2013, Walter Valdi, 1930-2003, ou Nanni Svampa, 1938- , chanteur de chansons traditionnelles milanaises (Antologia della canzone lombarda dans les années ’70), et traducteur de Brassens en dialecte milanais et en italien.
Mais Milan est aussi un grand centre d’édition et de création de la chanson italienne, d’Adriano Celentano aux Gufi en passant par Ricky Gianco, Lucio Battisti, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi et tant d’autres (Voir notre Histoire de la chanson en Italie, Vol. II).
Annexe 1 – Milan, croissance en largeur et en hauteur : l’arbre et la tour
Milan a grandi de façon particulière, d’abord en largeur : comme un arbre, la ville s’agrandit en cercles concentriques ; les plans successifs le montrent clairement, le mode d’expansion est très différent de celui de Turin par exemple, qui reproduit côte à côte le schéma du castrum romain primitif. Ici, peu à peu la ville trace un cercle plus large, à partir du même centre.« Il est vraiment impressionnant de noter que les tracés successifs du périmètre urbain – depuis ceux des XIIIe et XVIe jusqu’à l’anneau des deux ceintures contemporaines – donnent une image dilatée et fidèle de la forme de la ville comme elle fut définie à l’époque républicaine (la seule variation consistante dans l’image se manifeste au cours du XVIe s. avec l’ « évasement » déterminé par le château, une ville dans la ville avec des fonctions de contrôle encore plus que de défense de cette dernière. Ainsi les principaux accès le long des murs romains trouvent leur réplique exacte dans les murs médiévaux et espagnols, en en conservant même la dénomination ; le lieu central de la vie associée, le forum, ne s’est déplacé que de quelques centaines de mètres (…) et enfin les premiers axes de sortie de la ville ont toujours été et restent toujours les plus grandes lignes directrices du développement (…). Milan, si pauvre de monuments anciens, conserve et enrichit peu à peu la matrice primitive » (Storia d’Italia, Einaudi, Vol. 6, p. 244).Le second aspect est celui de la tour : Milan se construit très tôt en hauteur, et les tours y abondèrent, se reproduisant aujourd’hui dans l’abondance des gratte-ciels : « Le gratte-ciel a transformé la vie des Milanais. De mystérieuses activités se déroulent dans ces villes verticales, que la ville horizontale ignorait, doucement étendue dans sa plaine, avec ses palais bas et ses jardins fermés… » (Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore città).
(Milan, la ville de Mediolanum, De antiquitatibus, Biblioteca Trivulziana, vers 1320)







Expo de Milan : le pavillon italien, l’arbre de la vie
La peste de Milan en 1630 dans le dossier L’Italie marquée par le souvenir de la peste

La nouvelle épidémie de coronavirus est vécue de façon différente dans chaque pays, selon son histoire et son inconscient propres. L’Italie est gravement touchée aujourd’hui, et cela lui rappelle quelque chose de très fort dans son inconscient collectif : le souvenir de la peste. Ce n’est pas un hasard si ces dernières semaines, le livre dont les ventes augmentent le plus fortement est La peste d’Albert Camus (1947). Mais quoi qu’en disent les mauvaises langues et ceux qui ne connaissent pas l’Italie, ce n’est pas actuellement le pays qui réagit le plus mal à cette nouvelle épidémie.
-
La peste est connue depuis l'Antiquité : la Bible parle déjà des pestilences envoyées par Dieu pour punir les péchés des hommes (Exode, 9,3, Deutéronome, 28,21, 2 Samuel 24, 1-25, Lévitique, 13-14, Luc, 21,11), l'épidémie est le cinquième fléau dont Moïse menace le Pharaon. On parle de la peste d'Athènes de 430-429 av.J.C. (probablement le typhus), décrite par l'historien Thucydide (Guerre du Péloponnèse, II, 49). Périclès en mourut, parmi 70.000 victimes. À Rome, déjà en 81 après J.C., la peste semble avoir tué l'empereur Titus. Après ses campagnes militaires d'Orient contre les Parthes, en 166 après J.C., la légion romaine aurait rapporté dans l'Empire une épidémie de peste qui aurait tué un quart ou un tiers de la population et aurait causé la mort de l'empereur Marc Aurèle en 180. Pendant les guerres de Rome contre les « Barbares », sous les empereurs Valérien (195-260) et Claude II (214-270), deux autres épidémies auraient frappé la Légion entre 260 et 270 après J.C. Des médecins comme Hippocrate (460-377 av.J.C.) et Galien (129-216), des philosophes comme Platon (428-348 av.J.C.) et Aristote (384-322 av.J.C.) avaient aussi décrit ces épidémies, dont ils rendent responsables les « miasmes » de l'atmosphère. Mais on pense maintenant que la peste était déjà présente en Chine il y a 2600 ans.
-
Une grande pandémie aurait ravagé l'Europe à partir de 541 après J.C., dite « Peste de Justinien », commencée à Constantinople, décrite par l'écrivain Procope de Césarée (500-565) et favorisée par le mouvement des troupes durant la Guerre Gothique (535-553) entre l'empire byzantin et les Ostrogoths pour la reconquête de l'Italie par l'Empire byzantin ; elle tua plus de 40% de la population de la ville, puis se propagea dans toute l'aire méditerranéenne jusque vers 747, causant entre 50 et 100 millions de morts. Elle arriva à Rome en 543, puis en 590 et fut arrêtée, dit la légende, par une procession du pape Grégoire le Grand à laquelle apparut l'archange Michel. Mais elle favorisa en tout cas l'avancée et la victoire des troupes barbares, car la peste favorisa l'Europe septentrionale. Le monde musulman ne fut pas épargné et connut 5 épidémies de peste entre 627 et 717. Et rappelons que saint Louis mourut de la peste à Tunis en 1270.
-
La seconde grande pandémie, celle que l'on appela « la peste noire » (Mors nigra ou Atra mors), – nom donné plus tard au nazisme –, frappa l'Europe et particulièrement l'Italie entre 1347 et 1353, mélange de peste pulmonaire et de peste bubonique. La population avait doublé en France et en Italie et triplé en Allemagne entre le Xe et le XIVe siècle et l'Europe bénéficia alors d'un climat doux qui permit d'augmenter la productivité de cultures dont les techniques s'amélioraient (rotation triennale, instruments plus sophistiqués, etc.) ; l'état des routes s'améliora, et les relations commerciales se multiplièrent avec la Mer Noire et l'Empire byzantin à partir du XIIIe siècle (la route de la soie avec l'Orient…). Les villes italiennes de plus de 10.000 habitants étaient nombreuses, Milan avait 150.000 habitants, Venise et Florence plus de 100.000, Gênes 60.000. Mais à partir du début du XIVe siècle commença ce qu'on appela une « petite ère glaciaire », la température diminua, les récoltes aussi du fait d'étés trop pluvieux entre 1325 et 1340 et la population fut affectée de disettes terribles qui tuèrent de 5 à 10% des habitants et affaiblirent tout le monde (par exemple la grande famine européenne de 1315 à 1322). En 1337 commença aussi la guerre de Cent ans entre la France et l'Angleterre qui augmenta les difficultés à la campagne (pillages, impôts, rançons, etc.) et poussa de plus en plus de paysans à s'entasser dans les villes : tout cela créait des conditions idéales pour la diffusion de l'épidémie apparue dès 1347 dans les ports de la Méditerranée. Des prières disaient : « Délivre-nous, Seigneur, de la faim, de la peste et de la guerre ». Ce fut un choc terrible, on avait oublié les épidémies précédentes après deux siècles de prospérité, et voilà qu'en trois jours, des dizaines de milliers de personnes mouraient de la peste.
-
Ce fut la pire pandémie de l'histoire, elle frappa la moitié de la population par l'apparition de bubons noirs sur la peau et les muqueuses, d'où son nom. Même si alors on interpréta la maladie comme une punition de Dieu (même si Jésus avait affirmé qu'une maladie ne pouvait venir d'un péché : voir Jean, 9-13) et si le pape Clément VI (1291-1352) fit organiser des pèlerinages à Rome, des processions et des prières collectives, on sait que l'apparition de la peste était due à l'augmentation des opérations commerciales entre l'Italie et le Moyen-Orient. La peste était apportée par un virus qui arrivait du Désert de Gobi (entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie), que les Mongols auraient transmis à la Chine (où moururent 65% des habitants, disent les historiens) puis à la Russie, et en 1347 à Caffa (aujourd'hui Féodosia ou Théodosie, port de la Mer Noire, en Crimée), où se trouvait une importante colonie commerciale de Gênes. Elle avait été assiégée par la Horde d'or du khan Djanibeg qui fit lancer par ses catapultes par-dessus les murs de la ville des cadavres de ses soldats infectés par la peste, provoquant ainsi la contagion, première expérience de guerre bactériologique. Les navires génois, farcis de rats et de gerbilles venus de Mongolie (les principaux porteurs de virus), transportèrent ensuite la maladie à Constantinople, à Chypre, à Alexandrie, à Venise, à Messine, à Pise, puis Gênes attendit trop longtemps avant de chasser ces navires de son port et de les renvoyer dans tous les autres ports de la Méditerranée, dont ceux de la Grèce et Marseille, d'où elle remonte à Avignon puis dans toute l'Europe jusqu'à Paris, Londres, l'Allemagne. Elle tua alors au moins un tiers de la population européenne, et peut-être plus, surtout dans les quartiers surpeuplés des villes. On estime le nombre de morts dans le monde entre 75 et 200 millions, dont 25 à 45 millions en Europe.
-
Les médecins ne savaient encore rien des causes de la peste (comme aujourd'hui nous ne savons presque rien des causes du coronavirus), le virus ne fut découvert que plus tard, et ils attribuaient la maladie aux humeurs du corps humain qu'ils soignaient par des saignées et des purges, et à la position des corps célestes qui faisaient monter de la terre des exhalaisons funestes que l'on combattait en allumant de grands feux de substances aromatiques. On confondait encore la peste avec d'autres maladies, comme la variole, le choléra, le typhus, la rougeole ou la syphilis, et au Moyen-Âge, le mot général de « peste » venait d'un mot latin qui signifiait destruction, ruine, épidémie. Mais la meilleure réaction était d'abandonner les zones infectées et de se réfugier dans des lieux sains, comme le font les 10 jeunes gens du Décaméron de Boccace dans une de leurs villas sur la colline, mais cela n'était possible qu'aux riches...
-
Cette pandémie fut plusieurs fois décrite par des écrivains contemporains, d'abord le chroniqueur florentin Giovanni Villani (1276-1348, victime de la peste en 1348) dans sa Nuova chronica (jusqu'en 1346) poursuivie par son frère Matteo Villani (1283-1363, tué aussi par la peste) qui décrit l'épidémie elle-même (de 1348 à 1363), puis d'autres chroniqueurs comme le Florentin Marchionne di Coppo Stefani (1336-1385). Un autre chroniqueur siennois du XIVe siècle, Agnolo di Tura, a aussi décrit la peste de 1348.
-
À partir du XIXe siècle, les historiens montrèrent que la peste de 1348 avait conduit à une transformation de toute la société médiévale : la peste ne transforme pas en elle-même, elle ne déclenche pas par elle-même, mais sa présence catastrophique accélère et exacerbe les transformations sociologiques déjà en cours. Par exemple, la disparition de la main-d'œuvre et la recherche de nouveaux ouvriers agricoles, accéléra l'abolition du servage médiéval. La peste transforme aussi les paysages, laissant en friche de nombreuses terres, la production agricole diminue, les famines se multiplient, provoquant des jacqueries et des révoltes paysannes. On s'aperçoit aussi que la peste de 1348 avait gagné l'Afrique subsaharienne, à cause des relations commerciales entre l'Europe occidentale et l'Afrique centrale et orientale : on s'est aperçu récemment que l'Éthiopie adorait dès le XVe siècle les saints protecteurs de la peste, saint Roch et saint Sébastien.
-
Par la suite, après la fin de la pandémie, la maladie reprit régulièrement avec une force moindre, à intervalles de 6 à 12 ans, frappant les jeunes et les habitants les plus pauvres jusqu'en 1480, puis tous les 15 à 20 ans, du fait des mesures de protection prises par des villes comme Milan, Venise, Florence, etc. Les plus grandes reprises furent celles de Milan en 1576-77, puis en 1630 (racontée par Alessandro Manzoni dans les Promessi sposi, 1821-1842), suivies par d'autres villes européennes, Londres en 1665 qui tue entre 75.000 et 100.000 personnes, et d'autres jusqu'à celle de Marseille en 1720 qui tue la moitié de la population. Une troisième grande pandémie se produisit en Chine à partir de 1855, après laquelle le médecin franco-suisse Alexandre Yersin (1863-1943) découvrit au Vietnam en 1894 le bacille et amorça les recherches d'un premier vaccin, d'où le nom du bacille, Yersinia pestis. Toutefois la peste reste une maladie qui peut être infusée à l'homme par des animaux, surtout les rats et les puces.
-
On peut donc estimer que la peste est une maladie qui fut favorisée par trois facteurs, l'augmentation de la population et l'entassement dans les villes, les guerres et les changements climatiques. On doit constater aussi que cette maladie provoqua de nouvelles réactions collectives, de fuite, de ruptures de toute forme de solidarité et de recherche de boucs émissaires ; on identifia les responsables de la peste dans les communautés juives, accusées d'empoisonner les puits, à partir de 1319 en Franconie (Bavière), de 1321 dans le Dauphiné, puis en Italie à partir de 1348, et dans toute l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle : on arrêtait les juifs comme « untori » (semeurs de peste), on les torturait pour les faire avouer, on les brûlait, on pratiquait des pogroms qui pouvaient se traduire par l'assassinat de centaines de juifs, on s'emparait de leurs biens ou on arrêtait de payer les dettes vis-à-vis de ces Juifs à qui l'Europe chrétienne avait confié l'usure et le petit prêt à intérêt. Le pouvoir impérial tente souvent de protéger les ghettos mais en vain, et les meurtriers ne sont que rarement punis. Une des raisons pour lesquelles l'Europe connut alors ce regain d'antisémitisme fut que la maladie touchait peu les communautés juives, tout simplement parce que les Juifs appliquaient les conseils de la Bible (en particulier Lévitique, 13-14), se laver, isoler les personnes affectées, etc. Paradoxalement, le pape Clément VI protégea les Juifs d'Avignon et punit les persécuteurs, mais ses décisions n'eurent pas d'effet en-dehors de la ville du pape. On brûla aussi des milliers de sorciers et de sorcières entre 1348 et 1700.
-
Ci-dessus : Haselbach Engelharide, Massacre de Juifs « empoisonneurs de puits », Chronique d'Eger, 1571. A droite : Bûcher de Juifs pendant la peste noire. La peste avait d'ailleurs déclenché de fortes réactions religieuses, puisqu'elle était l'œuvre punitive de Dieu, mais aussi parce qu'elle avait suscité une forte angoisse et une peur accrue de la mort ; cela développa le culte de Marie, ou le culte des reliques que des charlatans multiplièrent à plaisir ; l'Église développe la pratique des indulgences, il fallait racheter l'âme de ceux qui étaient morts trop rapidement sans confession. Tout cela augmente aussi l'angoisse du salut et amène de nombreuses communautés à s'interroger et à faire des propositions de réforme, d'abord les préréformateurs : le tchèque Jan Huss (1369-1415, brûlé par l'Inquisition) et l'anglais John Wyclif (vers 1330-1384, contemporains de la peste noire, puis Luther (1483-1546) et Calvin (1509-1564).
-
Les Chrétiens réagissaient généralement par la prière, mais pratiquaient parfois la flagellation (les dits « flagellants ») ou les danses rituelles. Jan Huss au bûcher, Chronique illustrée de Diebold Schilling le Vieux, 1485. John Wyclif, Nuremberg, 1493.
-
L'art commence aussi à représenter des danses macabres (comme le Triomphe de la mort du Palais Sciafani à Palerme, dont s'inspirera Picasso pour Guernica ou le Triomphe de la mort de Pieter Brueghel l'Ancien, 1562), après les rencontres des trois morts et des trois vivants et autres représentations de la mort. Les objets symboliques de la mort se multiplient, les squelettes, les sabliers, les horloges, les lampes éteintes, les crânes, les instruments de musique aux cordes brisées, etc.

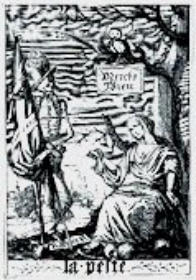








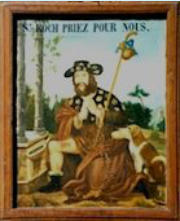



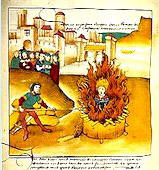






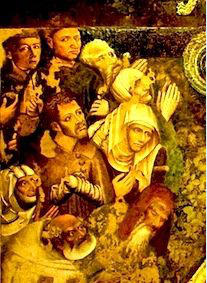


Par la suite les XVIe et XVIIe siècles traitèrent souvent le thème du triomphe de la mort, par exemple à Naples après la peste de 1656, ou en Sicile :



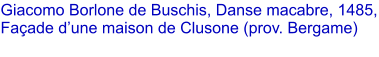
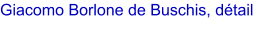
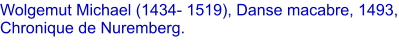

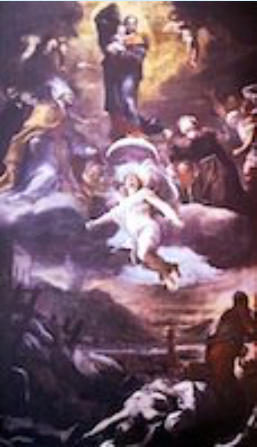

ANNEXES :
Annexe 6 : Un document sur les remèdes contre la peste : le vinaigre des quatre voleurs
Martine Dupalais, la présidente de l’Association De Condate à Lyon Confluence (DCLC) transmet sur son site ce document sur la peste, un remède inattendu, et nous nous permettons de vous le communiquer avec son autorisation, en la remerciant d’avoir indiqué notre dossier sur la peste à ses correspondants. Occasion pour nous de vous inviter à consulter le site de cette association, une des plus intéressantes sur l’histoire de Lyon de l’Antiquité romaine à nos jours, et une des plus actives (ww.dclc/fr) ; adhérez à l’association si les visites de Lyon vous intéressent).Le texte de Chantal Rousset Beaumesnil ci-dessous se réfère à l’ouvrage suivant : Monique Lucenet, Les grandes pestes en France, 1985, Coll. Aubier Floréal, Maury-Imprimeur 45330 Malesherbes, 282 pages.
Martine Dupalais nous transmet aussi un beau texte de Fred Vargas de 2008 sur la nécessité et la possibilité d’une troisième révolution. Écoutez-le sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=w3qbkV-SdxQ
D’autres villes lombardes : Monza, Bergame, Varese, Pavie et la Chartreuse de Pavie, Castiglione Olona et Castelsèprio