Jean Guichard
Essai sur Histoire des peuples d'Italie dans la chanson
I. Préhistoire et histoire ancienne
Les grecs et les peuples italiques
Quelques traces de cette Italie primitive dans la chanson populaire
Les « cantautori », l’histoire grecque et romaine, la mythologie
- Ulysse et Ithaque
- Orphée et Eurydice
- De l’Atlantide à Vénus et Ajax et à Alexandre le Grand
- Au-delà de la mythologie grecque, l’Italie préromaine dans la chanson dialectale
I.1 - Les grecs et les peuples italiques
I.2 - Quelques traces de cette Italie primitive dans la chanson populaire
I.3 - Les « cantautori », l’histoire grecque et romaine, la mythologie
1) Ulysse et Ithaque
2) Orphée et Eurydice
3) De l’Atlantide à Vénus et Ajax et à Alexandre le Grand
4) Au-delà de la mythologie grecque, l’Italie préromaine dans la chanson dialectale
II. Rome monarchique, Rome républicaine, Rome impériale
III. L’Ancien Testament et l’histoire de Jésus dans la chanson
I. Des invasions barbares à la Renaissance
Les invasions barbares des Goths à Charlemagne
De Charlemagne au XIIe siècle
La féodalité s’installe, et subsiste même dans le modèle communal
La Renaissance
De la Renaissance à la Révolution française
La guerre permanente
Il est faux que la découverte de l'Amérique en 1492 ait pour conséquence la décadence de l'Italie
L'influence des changements climatiques
Les dominations étrangères
Les Turcs et autres pirates
Les Espagnols et l'Empire Romain Germanique
La France
Les Anglais et les Hollandais
Les États italiens indépendants
Une crise économique générale - Reconversion sur la terre
Apparition de nouvelles formes d'États et de religions bureaucratiques
La pauvreté involontaire augmente parallèlement à la richesse - Le temps d'une autre pauvreté - Augmentation des différences de classes
Mais c'étaient des communautés vivantes qui avaient leur culture
Un siècle d'agitation sociale, de révoltes et de banditisme contre les nouvelles bureaucraties aristocratiques - Les révoltes populaires : des "luttes de classes" ?
Le XVIIIe siècle. Et comment le peuple vit-il donc tout cela ? - Quelques chansons
Les Turcs dans la chanson - La bataille de Lépante
Chansons sur les révoltes populaires - Masaniello
La révolution napolitaine de 1799
Notes
Encore une histoire d’Italie, est-ce bien utile après les centaines qui ont été écrites avant ou après l’Unité de 1861, et à partir du 150e anniversaire de 2011 ? Mais d’abord de quoi parle-t-on ? Pour certains historiens, on ne peut pas parler d’histoire de l‘« Italie » avant 1861 : il n’y a pas de « nation italienne » avant cette date, mais des histoires de Turin, de Milan, de Venise, de Florence, de Rome, de Naples, de la Sicile … et cela ne fait pas une histoire d’Italie.
Pourtant Francesco Guicciardini choisit en 1535 d’écrire les 2000 pages de son admirable Histoire d’Italie de 1494 à 1534, et le nom d‘« Italia » est utilisé depuis au moins le Ve siècle av.J.C. par les historiens grecs, dérivé d’un probablement mythique roi Italos des Énotriens (Oenotri), du sud de l’Italie, peuple d’agriculteurs, ou d’un peuple samnite de bergers (d’un nom qui indiquait le veau).
Et pour beaucoup d’historiens, l’histoire ancienne de l’Italie commence en 753 av.J.C. avec la fondation de la ville de Rome, et son développement d’un petit peuple de « latins » à un empire qui couvre une bonne partie du monde connu. C’est l’histoire d’une Rome conquérante, derrière laquelle on oublie souvent qu’il y eut une Italie conquise, occupée bien avant la période romaine par un grand nombre de tribus, de peuples, qui avaient leur langue, leur économie, leur organisation politique, leur culture, leur mode de vie, leur religion ; on trouvera plus loin l’évocation de quelques-uns d’entre eux.
Il y avait entre ces peuples une grande diversité, de même qu’il y avait une grande diversité entre les nombreuses colonies grecques qui s’installent en Italie à partir du VIIIe siècle av.J.C. Or Rome domine peu à peu ces peuples, mais ne les supprime pas ; Rome impose la langue latine, mais cette langue déjà très diversifiée évoluera différemment, selon la langue que parlait chaque peuple, et le « latin », – loin de celui de Cicéron enseigné dans les écoles et les Universités –, parlé à Milan ne fut pas celui parlé à Florence ou à Naples, ou à Palerme ou dans les Abruzzes ; quand l’empire romain d’Occident disparaîtra, les langues évolueront donc différemment, ce qui sera l’origine des nombreux « dialectes » parlés en Italie et dans toute l’Europe, le dialecte étant une langue au sens plein du terme qui n’est pas parvenue à devenir celle d’une nation, mais ayant aussi sa syntaxe, son vocabulaire, sa prononciation.
Cette histoire dominante est donc écrite du point de vue des vainqueurs, c’est celle de la classe dominante dans le camp du peuple vainqueur, ce n’est pas celle de toute l’Italie ; il n’est pas nécessaire d’avoir lu Marx pour s’apercevoir que la plupart des « histoires » sont des histoires de « classe » et qu’on ne peut analyser la réalité historique qu’en termes de « classes » en conflit du fait d’intérêts contradictoires.
Que sont donc devenus les « vaincus », tous ces peuples qui ont continué à tenter de survivre, de conserver leur mode de vie, leur langue, leur culture, et qui se sont souvent révoltés contre leurs « seigneurs » ? Le plus souvent on n’en parle pas, la littérature et l’archéologie n’étudient que les « monuments » officiels (= ce qui évoque, fait penser à, de « monere »), les « documents » (de « docere » = enseigner) créés par les vainqueurs, ceux qui ont laissé une trace plus visible que les maisons rustiques des paysans dominés et qui ne laissaient pas de récits écrits, ils étaient analphabètes.
On s’intéresse aussi plus aux « vainqueurs » pour des raisons esthétiques : un temple grec est plus « beau » qu’une cabane de paysan, et un vase richement décoré qu’une écuelle à soupe ! Mais ces « vaincus » représentaient 80%, 90% ou plus, de la population totale ; en 1861 encore, voter était le droit de 1 à 2% de la population italienne, ce sont ceux qui prennent les décisions, les autres regardent. Comment pourtant les ignorer si on veut écrire une histoire vraie ?
Notons seulement que c’est encore notre réalité : on parle plus des gouvernants, des patrons, des académiciens que des marginaux, des paysans, des travailleurs manuels ou des intellectuels contestataires … C’est pourquoi il serait important que ceux-ci laissent aussi des traces écrites de leur vie, de leur histoire ; cela commence !
Vers quoi se tourner alors pour écrire cette histoire plus vraie (sans ignorer l’autre, mais cela oblige à l’écrire autrement), sinon vers les éléments les plus proches de cette réalité des peuples dominés, vers leurs traces orales dialectales, vers leur toponymie, vers leur forme physique, leurs habitudes alimentaires, leur « culture matérielle », comme aimait dire Gianni Bosio ? … Et où trouve-t-on tout cela mieux que dans cette forme première d’expression qu’est leur chant, et les traces qu’il nous livre encore aujourd’hui.
D’où notre propos de composer ce dossier sur « Histoire des peuples d’Italie et chanson ». Entreprise difficile : on ne dispose pas de chants des peuples italiques, pratiquement rien des Grecs, et rien de la période romaine : tant qu’on n’en écrit pas les partitions, le chant ne laisse pas de traces ; les témoignages ne remontent au mieux qu’au bas Moyen-Âge. Pourtant ces peuples anciens ont laissé des traces dans les cultures dialectales d’aujourd’hui, c’est ce que nous chercherons d’abord, ce substrat populaire préromain indestructible. Et puis un certain nombre de « cantautori » (Auteurs-compositeurs-interprètes) se sont intéressés à des faits ou à des personnages historiques ou mythologiques importants de l’Italie, de Rome, de la Grèce, nous essaierons de les connaître.
Première partie
I. Préhistoire et histoire ancienne
Les grecs et les peuples italiques


Histoire des Peuples d'Italie
Notre sujet n’est pas l’étude des peuples qui ont occupé l’Italie avant l’arrivée des Grecs (vers 775 av.J.C à Ischia - Pitecusa, et vers 750 à Cumes) et avant la fondation de la ville de Rome (vers 753 av.J.C.), mais nous voulons seulement rappeler leur existence, que Rome ne supprime pas, et qui continue à déterminer les comportements, les modes de vie, les langues et les cultures d’aujourd’hui. Rome ne fait qu’accorder une forme plus ou moins complète de citoyenneté romaine aux peuples italiens conquis, et leur demander en échange de fournir des soldats et des richesses, mais ils peuvent généralement conserver leur religion en complément des dieux de Rome (la société est polythéiste), leurs coutumes, leur langue, qui se latinise peu à peu après avoir été influencée par la langue grecque, et le latin d’une région sera donc différent de celui de la voisine ; la « colonisation » romaine n’est pas du même type que celle que pratiqueront plus tard les peuples de l’Europe chrétienne.
Une dernière remarque : arrêtons de parler de peuples d’origine « indoeuropéenne » : cette invention d’une langue « indoeuropéenne » a été une hypothèse du XVIIIe siècle, certes utile en son temps, qui a permis par exemple le développement de la linguistique comparative. Mais des linguistes comme Giovanni Semerano (1911-2005) ont montré combien elle était inutile, alors que l’on peut se référer à une langue ancienne, connue maintenant, comme l’akkadien, langue sémitique, le plus souvent ignorée des linguistes qui ne veulent pas démordre de leur « indoeuropéen » et de leur refus d’une langue « sémitique », mais soutenue par de nombreux philosophes et linguistes italiens. « L’indoeuropéen » permettait d’échapper à une origine sémitique (juive et arabe) de nos langues, et cela favorisa l’idéologie nazie de notre nature « aryenne » : une race distincte des autres « races » (dont les Sémites), et supérieure, faite de blancs et dont il fallait garder la « pureté » (aryanisme, qui n’a rien à voir avec les théories théologiques du prêtre Arius (256-336), à l’origine de l’arianisme, qui affirmait que seul le Père est Dieu, le Fils ayant été humainement engendré). Ces théories ont été aussi utilisées pour justifier le colonialisme : les Noirs étaient inférieurs dans la hiérarchie des « races », avec les Tsiganes et les Asiatiques, juste avant les Juifs et après les Slaves et les Méditerranéens.
Les deux cartes ci-dessus indiquent les plus importants de ces peuples :
1) Au nord :
* Les Celtes (i Celti, originaires d’Europe centrale, entre 2000 et 1000 av.J.C. mais d’origine plus lointaine incertaine) : établis en Italie à partir du VIIe siècle av.J.C., mais surtout à partir du IVe s. av.J.C. : ils étaient eux-mêmes divers, les Boïens (i Boii), les Lingons (i Lingoni), les Sénons (I Senoni), au sud du Pô, les Cénomans (I Cenomani), les Insubriens (Gli Insubri), les Comasques (I Comaschi qui laisseront peut-être sur les bords du lac de Côme une trace contemporaine), et d’autres tribus.
* Les Camunes (I Camuni), d’origine obscure, installés dans la Val Camonica, et producteurs des incisions rupestres parmi les plus importantes que l’on connaisse.
* Les Rhètes (I Reti), qui descendraient des Étrusques, disaient les Anciens (Caton l’Ancien parla de leur vin ; on connaît un peu la langue rhétienne, proche de l’étrusque ; le ladin en serait un élément encore vivant) ; apparus au Néolithique, ils se seraient installés en Italie vers 500 av.J.C.
* Les Paléovénètes (i Paleoveneti) ou encore « Énètes » qui, selon la légende, auraient été des alliés des Troyens, des éleveurs de chevaux, et auraient émigré en Italie par la mer après la victoire des Grecs, conduits par Anténor, le père d’Énée (on montre son tombeau légendaire à Padoue !), tandis qu’une autre partie remontait par voie de terre jusqu’à la région de Vannes, en Bretagne. En Vénétie, les Énètes, pour s’installer, chassèrent les Euganéens (Gli Euganei) qui se confondirent avec les Rhètes.
* Les Ligures (I Liguri), un des plus anciens peuples d’Italie, bien antérieurs à la guerre de Troie ; ils avaient la réputation d’un peuple sauvage, dont le physique faisait peur, et qui vivait dans des conditions primitives, ayant tout oublié de ses origines. Ils seraient originaires de la péninsule ibérique et se seraient répandus dès le néolithique ; ils descendraient pour certains de l’homme de Cro-Magnon.
* Les Salasses (I Salassi), de même origine que les Celtes ; une légende en faisait des descendants d’Hercule ; de la souche de Saturne, ils auraient fondé Cordelia dans le Val d’Aoste. On ne trouve des traces de leur langue que dans la toponymie valdostaine (la « Dora », de la racine « dor » ; une autre racine, « Bar », donne son nom aux villes de Bard, Bardonecchia, etc.) Les lois sur le mariage civil des Salasses prévoyaient une parfaite égalité entre l’homme et la femme.
* Les Taurins (i Taurini), d’origine ligure ou celte ; un mythe les fait descendre d’Éridan (qui fut aussi l’ancien nom du Pô), fils de Phaéton, qui aurait introduit un culte égyptien du dieu Apis, en forme de taureau ; leur ville principale était Torino (qui a conservé l’emblème du taureau).
2) Au centre :
* Les Étrusques d’abord, Tyrrhéniens pour les Grecs, Etrusci ou Tusci pour les Romains (d’où la mer « thyrrénienne » et la « Toscane »). On discute encore sur leur origine : autochtone ? (Villanoviens ? Rhètes ?), ou bien venus du Moyen-Orient (ancienne Lydie) ? probablement les deux : un peuple autochtone qui a connu des apports orientaux. Leur culture vient de l’époque des « Villanoviani », vers le Xe s. av.J.C., et elle s’étendra au maximum de la plaine du Pô aux abords de la Campanie, avec des colonies en Corse, en Ligurie et en Gaule Cisalpine. À partir de leurs terres riches en minéraux, ils avaient développé une industrie qu’ils exportaient (ils auraient par exemple amélioré l’ancre de navire), leur agriculture était riche, leur culture très raffinée. On a reconnu leur langue, mais on dispose de trop peu de documents pour la déchiffrer en totalité. Ils auraient dominé Rome au début de la Monarchie. Ils influencent fortement la culture latine dans tous ses domaines (religion, organisation politique, littérature, peinture...).
* Au sud-est de l’Étrurie se trouvent les Falisques (i Falisci), dont la capitale est Faléries (Civita Castellana) ; la langue falisque était proche du latin, mais c’était un peuple indépendant allié des Étrusques dans les guerres contre Rome.
* Les Latins (i Latini) sont un des nombreux petits peuples de l’ancien Latium, le Latium Vetus, qui existent bien avant la fondation de Rome. Leur centre fut la ville d’Albe-la-Longue, capitale de la Ligue Latine qui lutta longtemps contre Rome. Les Latins étaient installés sur la côte de la mer Tyrrhénienne à partir du IIe millénaire av.J.C., provenant soit d’Europe centrale soit de l’Asie Mineure. Selon la légende (reprise par Virgile), ce peuple du roi Latino aurait fusionné avec les Troyens conduits ici par Énée ; il a une influence déterminante dans la fondation de Rome, et bientôt, après la destruction d’Albe, on confondra en général les « Latins » avec les « Romains ».
* Tout autour de l’aire latine, on trouve vers l’est et le sud-est un peuplement « sabellique » (Sabellico), Samnites (Sanniti), qui avaient pour emblème le taureau avec les Sabins ; ils remplacent les Opiques, d’où dérivent les Lucaniens (Lucani), Campaniens (Campani) et Bruttiens (Brettii ou Bruttii) de Calabre, Sabins (Sabini) (avec dérivation des Picéniens, Piceni qui avaient pour emblème le pic) et Ombriens (Umbri), qui formèrent vers les VI-V siècles av.J.C. une unité très différente de celle des Latins, sur le plan tant linguistique que culturel. Les Sabins ne furent conquis par les Romains qu’en 290 av.J.C. Les Ombriens étaient réputés être la plus ancienne population italique sur un territoire très vaste qui allait du Pô à la Campanie. Plus proches de l’Adriatique, on trouvait les Marrucins (i Marrucini), les Marses (i Marsi), les Frentans (i Frentani), les Caracins (Carricini), une des quatre tribus samnites, les Pentriens (i Pentri), les Caudiniens (i Caudini), les Hirpins qui avaient pour emblème « hirpus », le loup (gli Irpini), les Capénates (Capenae Veteres), un petit peuple de langue sabine allié aux Étrusques, et plusieurs autres. Les hostilités avec Rome commencent en 343 av.J.C. et se terminent par la défaite des Samnites en 82 av.J.C. En tout cas, entre Marches, Ombrie, Abruzzes et Campanie, il faudra être attentif à ce qui a pu laisser des traces différentes de celles que nous laisse la civilisation romaine.
3) Au sud :
* Les Iapyges (Gli Iapigi), qui se divisaient en Dauniens (i Dauni), Peucétiens (i Peucezi) et Messapiens (i Messapi). Ils seraient arrivés vers le IIe millénaire av.J.C., auraient résisté longtemps à l’hellénisation du sud de l’Italie et n’auraient été conquis par les Romains que vers la fin du IVe s. av.J.C. On dit parfois qu’ils auraient été « civilisés » par les Grecs, oubliant qu’avant l’arrivée des Grecs, ils constituaient déjà une civilisation originale, connue par exemple pour ses céramiques (du XIe au IIIe s. av.J.C.) ou ses modes d’inhumation. Leur nom latin aurait été Iapydia ou Japùdia, transformé par les Samnites en Apudia et Apulia, d’où le nom italien de Puglia (les Pouilles). Il y a toujours aujourd’hui un « Festival dei Monti Dauni », un orchestre appelé « Daunia », etc. Les habitants de cette région des Pouilles, très active culturellement, n’ont pas oublié leur passé lointain.
* Les Grecs (I Greci) : Ils commencent à coloniser l’Italie surtout à partir du VIIIe s. av.J.C, de Cumes (–750) et Ischia (Pitecusa, vers –775), jusqu’à Tarente, fondant de nombreuses villes dont Neapolis (future Naples). Lorsqu’une ville grecque apparaissait trop peuplée, ou si elle avait trop de problèmes, on invitait une partie de ses jeunes habitants à s’installer à l’étranger. Les récits d’Homère des navigations d’Ulysse avaient donné aux Grecs l’idée d’une Italie accueillante, dont les habitants établissaient avec les étrangers des relations commerciales amicales. Les Grecs s’établirent donc tant à Pitecusa qu’à Messine (Zangle), Reggio (Regio) et Tarente (la seule ville fondée par Sparte), lieux les plus favorables pour contrôler les voies commerciales des métaux : c’était leur but plus que de « coloniser », contrôler de nouveaux territoires ; ils parlaient eux-mêmes d’« émigration » ou de « déménagement », plutôt que de « colonisation ». Leur richesse culturelle se fit peu à peu sentir, malgré la résistance des Étrusques et des Samnites au Nord et des Iapyges au Sud. Les Grecs occupèrent les côtes, sans pénétrer beaucoup dans l’intérieur des terres, mais ils laissent partout de splendides monuments (temples, théâtres, sculptures, céramiques …), plus riches que ceux qui subsistent en Grèce. Ce fut la « Grande Grèce » (Megale Hellàs), souvent inspirée par des philosophes comme Pythagore à Crotone, ou des savants comme le mathématicien Archytas à Tarente, ou encore Parménide qui démontre la sphéricité de la terre. Mais les guerres fratricides, les conflits avec les voisins et bientôt la colonisation romaine eurent raison de la Grande Grèce : les Romains sont vainqueurs en 272 av.J.C., puis s’installent définitivement 60 ans plus tard, s’emparant, dit-on, de 30.000 esclaves, de 83.000 livres d’or et de nombreuses œuvres d’art qui, transportées à Rome, vont transformer la vie culturelle romaine. Cette présence grecque a laissé des traces aujourd’hui dans la langue : le « griko » et le « grecanico » sont encore parlés et chantés par de petites communautés contemporaines (Voir plus loin).
* Il faudrait citer d’autres peuples comme les Lucaniens (i Lucani), italiques de langue osque arrivés vers le Ve s. av.J.C. dans la région qui garde leur nom, la Lucanie.
4) La Sicile (voir carte ci-contre) :
Elle fut un élément central dans la vie et l’histoire du sud italique, elle était au cœur des routes commerciales entre l’Est et l’Ouest de la Méditerranée. Elle fut habitée depuis au moins le milieu du IIe millénaire, mais, vers 1250, elle était occupée par trois peuples, les Elymes (gli Elimi), qui se seraient enfuis de Troie après la guerre, et seraient descendants d’Élymos, un fils bâtard d’Anchise. Leur centre principal aurait été Ségeste. Un second peuple repoussé en Sicile centrale par les Sicules était les Sicanes (i Sicani), le plus ancien de toute la Sicile, d’origine probablement ibérique ; c’est à eux que la Sicile, qui s’appelait « Trinacria », devrait de s’appeler Sicania, puis Sicilia. Le troisième peuple est celui des Sicules (i Siculi), un peuple proche des Latins qui aurait été chassé de Toscane (il aurait appartenu à la culture villanovienne) puis de Calabre, puis ils auraient traversé le détroit de Messine pour s’installer en Sicile. Tous eurent des rapports avec des marchands phéniciens ; puis arrivèrent les Grecs, dont les fondateurs de Naxos en 735 av.J.C., et les luttes auraient été incessantes pour le contrôle de l’île, et même Athènes dut intervenir au Ve siècle. La Sicile connut aussi les guerres avec les Carthaginois jusqu’à leur abandon définitif de l’île en 241 av.J.C.
5) La Sardaigne :
Elle fut habitée depuis probablement 100.000 ans av.J.C. Mais à l’âge des Métaux dont nous parlons, on arrive à la civilisation que l’on appelle « nouragique » (du nom des constructions fortifiées, les « Nuraghi ») productrice des petites statues en bronze appelées « bronzetti ». Puis arrivèrent les Carthaginois vers le VIe s. av.J.C., qui s’intégrèrent assez bien dans la civilisation nouragique et enfin les Romains, qui obtinrent la Sardaigne à partir de 238 av.J.C. ; ils s’entendirent mal avec les indigènes sardes qui se réfugièrent dans le centre de l’île, que les Romains appelèrent « la Barbagia », la zone des « Barbares ». (Voir ci-contre les tribus « nuragiques » selon Polybe).
Tout cela ne veut pas être une « histoire » de l’Italie primitive, mais est seulement destiné à nous faire prendre conscience que l’histoire de l’Italie ne commença pas avec Rome, elle était déjà depuis longtemps celle d’une multitude de peuples divers, que les Latins (les Romains) ont ensuite conquis, mais dont la vie a continué sous des formes de langue et de civilisation nouvelles, et qui ont laissé leurs traces dans l’histoire moderne de l’Italie, en particulier dans la culture populaire et dans les langues dialectales. Où trouver ces traces mieux que dans les chansons ?
Ces cultures anciennes ont subi la pression de deux civilisations qui les ont suivies, d’abord la pression romaine, ensuite la pression chrétienne ; les deux les ont conquises, assimilées, utilisées à leur profit, et au besoin réprimées lorsqu’elles ne se soumettaient pas bien. On connaît les cruautés de la conquête romaine ; on commence à reconnaître celles de la conquête chrétienne, de l’inquisition à la condamnation des « hérétiques » ou des « sorcières » qui étaient les héritières de ces cultures paysannes d’autrefois.
Et malgré tout, ces cultures ont survécu, elles ont été influencées par le grec, par le « latin » de Rome, puis par celui de l’Église chrétienne et par ses cultes et rites, mais elles ont continué à exister. Nous nous efforcerons d’en retrouver les traces, l’héritage linguistique et culturel. Opération difficile mais passionnante et riche d’enseignements.

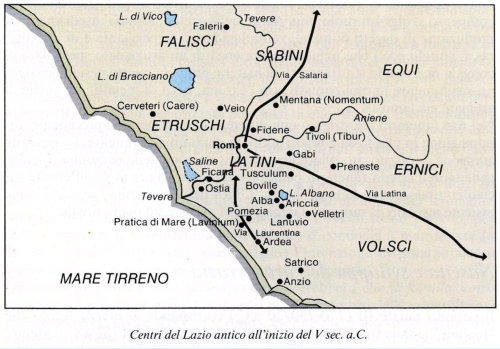

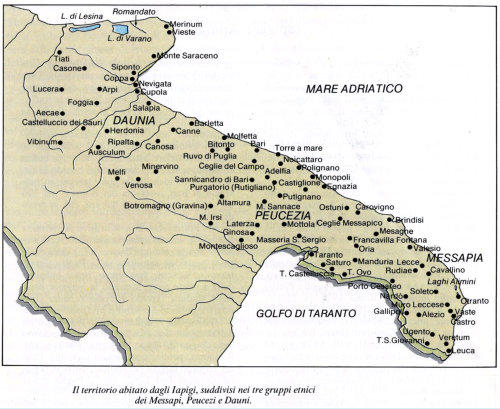
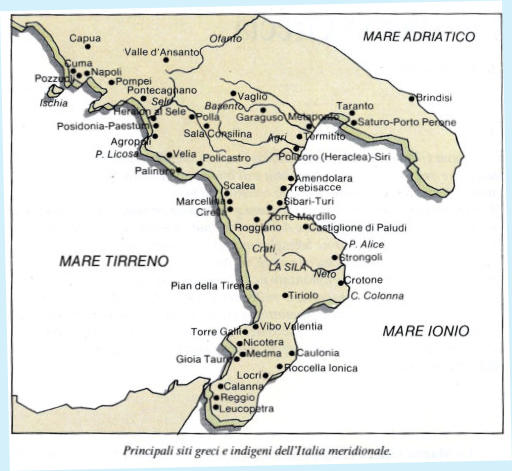
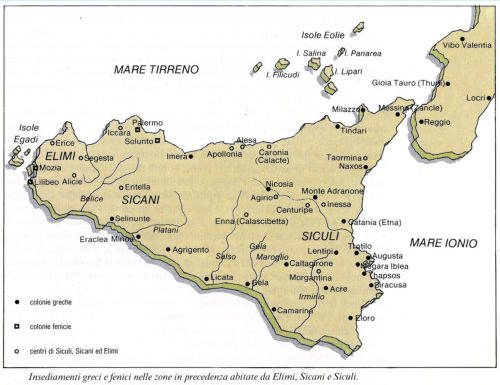

Quelques traces de cette Italie primitive dans la chanson populaire
Écoutons d’abord deux chansons de Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi, 1965- , Monza). Son nom signifie en dialecte cosmasque « ils vont en contrebande » (van di frodo). Ces chansons ne reprennent certes pas la langue des peuples comasques préromains, mais elles constituent malgré tout un témoignage de la langue que produisit le latin implanté dans cette rive du lac de Côme. La « brèva » est le vent qui souffle du sud au nord du lac, le « tivano » souffle du nord au sud ; on les fait souvent dériver du français « brise » et « petit vent », mais d’où vient le mot « brise » ? (peut-être du latin « brevem » = court, parce que ce vent ne dure pas longtemps ?). La « Valtellina » est une région de Lombardie, la vallée de l’Adda lorsqu’elle se jette dans le lac de Côme : c’est dans cette direction que regardent les habitants des bords du lac (« el laag ») pour savoir quel temps il fera, la Valtellina claire annonce l’orage, et moins d’orage si elle est sombre. C’est probablement une habitude de très anciens temps, de même que la navigation sur le lac où on devait transporter les marchandises, en craignant que d’un moment à l’autre la tempête se déchaîne.
Chansons et Histoire des Peuples d'Italie
Écoutons d’abord deux chansons de Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi, 1965- , Monza). Son nom signifie en dialecte cosmasque « ils vont en contrebande » (van di frodo). Ces chansons ne reprennent certes pas la langue des peuples comasques préromains, mais elles constituent malgré tout un témoignage de la langue que produisit le latin implanté dans cette rive du lac de Côme. La « brèva » est le vent qui souffle du sud au nord du lac, le « tivano » souffle du nord au sud ; on les fait souvent dériver du français « brise » et « petit vent », mais d’où vient le mot « brise » ? (peut-être du latin « brevem » = court, parce que ce vent ne dure pas longtemps ?). La « Valtellina » est une région de Lombardie, la vallée de l’Adda lorsqu’elle se jette dans le lac de Côme : c’est dans cette direction que regardent les habitants des bords du lac (« el laag ») pour savoir quel temps il fera, la Valtellina claire annonce l’orage, et moins d’orage si elle est sombre. C’est probablement une habitude de très anciens temps, de même que la navigation sur le lac où on devait transporter les marchandises, en craignant que d’un moment à l’autre la tempête se déchaîne.
Brèva e Tivànn
Brèva e Tivànn, Brèva e Tivànn
La vela La se sgunfia e’l timòu l’è in di mann,
Valtelena ciàra e Valtelena scüra
L’è una pàrtìda a dama cun’t el cieel che fa pagüra ...
Sòlti in sôe l’unda e pô se làssi nà...
el soo che fra un pezzètt el tàca a tempestà,
el soo che in sôe la riva i henn là tücc a pregà,
me ciàpen per un màtt che vôer dumà negà ...
E la barca la dùnda e la paar che la fùnda,
Che baraùnda vèss che in mèzz al laagh...
El laagh che l’e’ balòss, el laagh che’l tradìss,
el fülmin lüsìss e’l cieel el tusìss ...
Brèva e Tivànn. Brèva e Tivànn,
i tìren e i mòlen e i te pòrten luntàn,
vàrda de scià e vàrda de là,
la spùnda la ciàma ma la barca la và ...
Ma urmài sun chè... in mèzz al tempuraal
tuìvess fôe di bàll che a me me piaas inscè...
E urmài sun chè... in mèzz al tempuraal
tuìvess fôe di bàll che a me me piaas inscè...
Brise et p’tit vent
Brise et p’tit vent, brise et p’tit vent
la voile se gonfle et le timon est dans la mer
Valtellina claire, Valtellina sombre
c’est une partie de dame avec le ciel qui fait peur
Je saute dans l’eau puis je me laisse aller
je le sais que sous peu la tempête commencera
je le sais que sur la rive ils sont tous là à pleurer
ils me prennent pour un fou qui ne veut que se noyer …
Et la barque se balance et il semble qu’elle coule
Quelle bagarre être là au milieu du lac ..
le lac qui est fourbe, le lac qui trahit
la foudre brille et le lac tousse …
Brise et p’tit vent, brise et p’tit vent
Ils tirent et ils larguent et ils t’emportent loin
regarde ici, regarde là
la rive t’appelle mais la barque va …
Mais désormais je suis là … au milieu de l’orage
Tirez-vous de là car je suis bien comme ça
Et désormais je suis là … au milieu de l’orage
Tirez-vous de là car je suis bien comme ça.
Quant à la contrebande, c’était une activité traditionnelle de cette région convoitée par la Suisse, les Espagnols et l’Autriche, la meilleure voie de communication entre l’Italie du Nord et les vallées de l’Inn et du Rhin. On passait le sel, le tabac, puis le riz, le café, les cigarettes, c’était une forme de brigandage populaire contre des lois commerciales insupportables pour les pauvres ; le passage par ces cols et la contrebande sont restés, depuis une lointaine antiquité, une activité identitaire des habitants de ces lieux. Certes le christianisme est passé par là, car on craignit ensuite la pénétration des idées protestantes venues de Suisse, et la souffrance du contrebandier est exprimée dans une image de la Croix du Christ, mais il reste derrière ce chant la trace d’une ancienne civilisation.
Ninna Nanna del Contrabbandiere
Ninna nanna, dorma fiôô...
el tò pà el g’ha un sàcch in spala
e’l rampèga in sô la nòcc...
Prega la loena de mea fàll ciapà
prega la stèla de vardà in duvè che’l va
prega el sentée de purtàmel a ca’...
Ninna nanna, ninna oh.....
Ninna nanna, dorma fiôô...
el tò pà el g’ha un sàcch in spàla
che l’è piee de tanti ròpp :
el g’ha deent el sô curàgg
el g’ha deent la sua pagüra
i pàroll che’ll po’ mea dì....
Ninna nanna, ninna oh....
Ninna nanna, dorma fiôô...
che te sògnet un sàcch in spàla
per rampegà de dree al tò pà...
sô questa vita che vìvum de sfroos
sô questa vita che sògnum de sfroos
in questa nòcch che prégum de sfroos.
Prega el Signuur a bassa vuus...
un la sua bricòla a furma de cruus....
Berceuse du contrebandier
Dodo, fais dodo mon petit garçon
ton papa a un sac sur l’épaule
Il grimpe dans la nuit …
Prie la lune de ne pas le faire prendre
prie l’étoile de regarder où il va
prie le sentier de me le ramener à la maison.
Dodo, fais dodo oh
fais dodo, mon petit garçon
ton papa a un sac sur l’épaule
qui est plein de tant de choses
dedans il a son courage
dedans il a sa peur
et les mots qu’il ne peut pas dire …
Dodo, fais dodo oh
fais dodo, mon petit garçon …
qui rêve d’avoir un sac sur les épaules
pour grimper derrière ton père …
dans cette vie que nous vivons en contrebande
dans cette vie que nous rêvons en contrebande
dans cette nuit où nous prions en contrebande.
Prie le Seigneur à voix basse
avec son sac en forme de croix …
Les Abruzzes sont une autre région qui a gardé un rapport étroit avec son histoire et son patrimoine préromain, samnite, voyez sur Internet les nombreux sites « Dialetti abruzzesi ». Une quantité d’associations et de groupes musicaux diffusent les proverbes, les poésies et les chansons en dialecte des Abruzzes. Certes la langue originaire a été supplantée par le latin et les abruzzophones ont été massacrés par les Romains, en particulier par Sylla (138-78 av.J.C.), dont on dit qu’il élimina un million d’habitants ; et la culture a été ensuite marquée par la tradition chrétienne, qui n’a pourtant pas réussi à supprimer tous les cultes antérieurs (Voir la fête des serpents à Cocullo). La référence au passé garde donc toute sa valeur.
J’abbruzzu
So’ sajitu aju Gran Sasso
so’ remastu ammutulitu
me para che passu passu
sajesse a j’infinitu !
Che turchinu, quante mare,
Che silenzio, che bellezza,
Pure Roma e j’atru mare
Se vedea da quell’ardezza.
Po’ so’ jitu alla Majella,
la muntagna è tutta ‘n fiore
quantè bella, quant’è bella,
pare fatta pe’ l’amore !
Quantu sole, quantya pace,
Che malia la ciaramella
Ju pastore veja e tace
Pare ju Ddiu della Majella.
Po’ so’ jitu alla marina
E le vele colorate
Co’ ju sole la mmatina
Se so’ tutte ‘lluminate.
Se recanta la passione
Ju pastore alla muntagna,
Ji responne ‘na canzone
Dajiu mare alla campagna.
Les Abruzzes
Je suis monté au Gran Sasso
je suis resté muet
il me semblait que pas après pas
on montait vers l’infini !
Que de ciel bleu, que de mer,
quel silence, quelle beauté,
même Rome et l’autre mer
se voyaient de cette hauteur.
Puis je suis allé sur la Maiella,
la montagne est toute en fleur
qu’elle est belle, qu’elle est belle,
elle semble faite pour l’amour !
Que de soleil, que de paix,
quel enchantement le chalumeau
le berger veille et se tait
On dirait le Dieu de la Maiella.
Puis je suis allé au bord de la mer
et les voiles colorées
avec le soleil du matin
se sont toutes illuminées.
Il chante à nouveau sa passion
le berger pour la montagne,
une chanson lui répond
de la mer à la campagne.
C’est une référence intéressante à ce que fut toujours le peuple des Abruzzes, des tribus de bergers des montagnes (La Maiella est un grand massif du centre des Abruzzes, culminant à 2793 mètres), mais aussi des tribus de marins attachés à leur source de vie, la mer. Quant au « saltarello » du groupe Mantice, il se réfère explicitement à une tradition (« le usanze ») qui est encore de l’époque païenne, libre de toute référence à la morale chrétienne de l’amour :
In mezzo al petto mio
In mezzo al petto mio ce sta ‘n serpente
Ma ci lavora a punta di diamante
Chi non trova l’amore non trova gnente
Sonatee sonatore famo sala
ca si lo fa ‘n balletto la padrona
Sapesse la virtù che tie’ lo gaglio
de le gagline se capa la meglio
Ce fa cuccuruccù, monta a cavaglio
Quando passi di qua passace armato
Ca le finestre mie buttano foco
Ca me l’ho fatto ‘n artro fidanzato
Ma quanto sona bbe’ stu sonatore
Le mani ce se pozzano ‘ndurare
(Dimmela bella e dammela va)
Ma quanto sona bbe’ sto tambureglio
Ma chi lo sona è ‘n giovanotto bello
Pe ‘no bicchier de vino ca me bbeve
Cento pensieri alla menda me leve
Nun pozzo più cantà ca non c’ho voce
L’ho persa l’altra sera alla fornace
L’ho persa sott’ a ‘n arbero de noce
Però a cantà co’ mme nun te ce mettene
Ca so’ la figlia dell’ammazzasette
e chi non vo’ senti’ questa mia voce
che s’atturi la recchia co’ lla pece
e questo so’ le usanze del mio paese.
Au milieu de ma poitrine
Au milieu de ma poitrine il y a un serpent
qui le grave comme une pointe de diamant
Qui ne trouve pas l’amour ne trouve rien
Joue, musicien, dans le salon
comme ça, la maîtresse fait un ballet
Si vous connaissiez les vertus du coq
qui parmi les poules ne choisit que la meilleure
Il lui fait cocorico et puis il la monte
Quand tu passes par ici viens armé
car mes fenêtres jettent du feu
Parce que je me suis créé un autre fiancé
Mais comme il joue bien ce musicien,
Que ses mains puissent s’endurcir
(Parle-moi, ma belle, et donne-la moi, allez)
Mais comme il joue bien ce tambourin
Mais celui qui en joue est un beau jeune homme
Pour un verre de vin que je bois
Je m’enlève cent soucis de l’esprit
Je ne peux plus chanter parce que je n’ai plus de voix
Je l’ai perdue l’autre soir au four
Je l’ai perdue sous un noyer
Viens donc pas chanter ici avec moi
car je suis une fille de matador
et celui qui ne veut pas écouter ma voix,
qu’il se bouche les oreilles avec de la poix.
Tels sont les usages de mon pays.
Des communautés grecques existent encore dans les Pouilles et en Calabre. Parmi d’autres, un groupe a hérité de leur musique traditionnelle, le Canzoniere Grecanico Salentino (CGS, créé en 1975). Est-il un héritier des premières communautés grecques de la région ? on ne peut pas le savoir. Ce qui par contre est certain, c’est que beaucoup de communes, d’associations, de groupes musicaux du sud qui font partie de cette minorité linguistique grecque et qui parlent le « grecanico » (le « griko »), revendiquent leur ascendance préhistorique et gardent des rapports privilégiés avec la nation grecque d’aujourd’hui. Déjà en 1924, Gerhard Rohlfs (1892-1986) écrivait : « Avec le grec d’Athènes, de Crète, de Rhodes et de Chypre, le grec de Bova (Calabre, Province de Reggio Calabria - NDR) remonte à la même mère. Ce sont tous des fils indépendants et légitimes de la grande mère antique » (Cité dans : Domenico Nunnari, Viaggio in Calabria : dalla Magna Grecia al terzo millennio, Gangemi Editore, 2009). On compte aujourd’hui 23 communes (dont certaines importantes comme Reggio Calabria) qui ont des communautés de langue grecque, entre Calabre, Pouilles et Sicile, et on commence à les redécouvrir, après des siècles d’oubli ou de répression, et à en reconnaître la valeur et l’originalité culturelles. Le Canzoniere Grecanico Salentino n’est qu’un des groupes qui chantent en tentant de revitaliser cette culture. Il utilise des instruments traditionnels très anciens, la chitarra battente, instrument semblable à la guitare baroque avec des éclisses plus hautes, un fond plus bombé et des cordes doubles, la zampogna, la cornemuse, les flauti, petites flûtes utilisées dans les campagnes, les tamburelli, tambourins marquant le rythme. Répétons encore que le chant « traditionnel » n’est pas un souvenir mourant d’un passé révolu, mais qu’il est la trace vivante des civilisations des pauvres d’hier, où se retrouvent les pauvres d’aujourd’hui, même si la cause de leur pauvreté est différente, urbaine et non plus paysanne. Mais le développement de ce qu’on appelle abusivement le « progrès » ne vide pas le réservoir de cultures patrimoniales existant depuis plusieurs millénaires.

Ìtela
Ìtela na su po’ c’emmabastèi
na pai na pi’ tis màna-su na s’armàsi
àrte ise kièccia ce se ccumetèi
jènese mali ce mèni koràsi
ìtela na su po’ ce na su dìzzo
t’ardàri pu vastò mesa so ‘ppettola
plaie to sòma si ‘ccardìa-mu na to sfizzo
sur crà-mme sfittà me sena, sindè ipetto !
Ìtela na su po’: jatì, jatì,
ci si portèdda-su panta climmèni ?
Su prepi cajo na statì anittì
apa’ so limbitàri chatimmèni !
Ìtela
Je voudrais te dire mais la voix me manque
d’aller demander à ta mère de te marier
tu es encore petite et cela te convient
tu deviendras grande et tu resteras vieille fille.
Je voudrais te dire et te montrer
la plaie que je porte dans la poitrine
sur mon cœur je voudrais te serrer
Tiens-moi serré contre toi sinon je tombe !
Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi
ta petite porte est toujours fermée ?
Il faudrait que tu la laisses ouverte
et que je te tienne assise sur le seuil.
Tira cavallu
Nunn ci suntu cchiuili trainieri
Se dice ca ete megghiu mio la vita
Ma tocca tiri oce comu ieri
E certu lu cavallu no te aiuta
Subbra le spaddhe teni pisi e veleni
E tantu erta pare la salita
E senza né trainu né fatia
Silu trainieri de malencunia.
Tira cavallu
Il n’y a plus de charretiers
On dit que maintenant la vie est meilleure
mais tu dois tirer aujourd’hui comme hier
Et le cheval ne t’aide certainement pas
tu as sur les épaules des poids et des poisons
et la montée semble si raide
et sans char ni travail
Nous sommes des charretiers qui traînons notre mélancolie.
Les « cantautori », l’histoire grecque et romaine, la mythologie
La culture italienne a toujours été imprégnée de culture gréco-romaine et de mythologie, les dieux et les héros de l’Antiquité ont toujours été une référence dans la littérature, la poésie, la sculpture, la musique italiennes ; elles se sont toujours inspirées du « mythe », c’est-à-dire du récit de la vie des dieux et des héros, pour donner une explication de leur vie et de leur sens du sacré, c’est-à-dire du surnaturel, de l’extraordinaire, de ce qui ordonnait le monde et le sauvait du chaos. Les Italiens n’ont jamais cessé de vivre dans les restes de l’Antiquité romaine ou grecque.
On connaît la place de la mythologie dans l’œuvre de Dante Alighieri (voir le beau livre de Paul Renucci, Dante disciple et juge du monde gréco-latin, Les Belles Lettres, 1954), Boccace consacre des années à écrire en latin ses Genealogia deorum gentilium, sur les principales divinités antiques, et chez de nombreux écrivains on trouvera les mêmes références à la culture gréco-romaine, qui imprégnait non seulement la culture mais la vie quotidienne des Italiens. On parle très peu de la chanson et c’est bien dommage, car la culture grecque a aussi influencé un certain nombre de musiciens, de chanteurs et de « cantautori » (= auteurs-compositeurs-interprètes) par son histoire et par sa mythologie.
Dans le dernier tiers du XXe s., en particulier, plusieurs compositeurs de chansons ont choisi des thèmes dans l’histoire ou la mythologie grecques. C’était à la fois un retour sur les sources profondes de la société italienne, et souvent une façon détournée de parler de la société contemporaine, en comparant la corruption d’un empereur à celle des hommes politiques d’aujourd’hui, en actualisant le personnage d’Ulysse, etc. (Voir l’intéressante étude de Mariangela Galatea Vaglio, La lira e il cantautore : l’antico nelle canzoni italiane della seconda metà del Novecento, une des rares études sur cette question). Le XXIe siècle semble avoir transformé un peu cette tradition, à l’exception de Vinicio Capossela (1965- ), Caparezza (1973- ), tous deux méridionaux, et quelques autres, en traitant les thèmes mythologiques non plus comme références de problèmes sociaux et politiques, mais de questions plus psychologiques et privées.
- Ulysse et Ithaque
C’est d’abord le thème d’Ulysse et d’Ithaque qui est développé par les cantautori. Il a toujours inspiré les Italiens, qui connaissent Homère, cet auteur grec qui aurait écrit aussi une suite à l’Odyssée, aujourd’hui perdue, où il racontait le départ d’Ulysse vers les Colonnes d’Hercule ; il les aurait franchies et après un sacrifice à Neptune, il serait revenu mourir en paix dans son île. On connaissait le Pseudo Apollodore, et son récit de la mort d’Ulysse tué par le fils qu’il aurait eu de Circé. Mais tous ceux qui ont suivi la « scuola media » connaissent surtout Dante dans le chant XXVI de l’Enfer, où Ulysse ne rentre pas à Ithaque mais entraîne directement les derniers compagnons de son navire vers le dépassement des Colonnes d’Hercule, jusqu’à la montagne du Purgatoire où il fait naufrage. On connaissait Foscolo (A Zacinto, 1802), et Giovanni Pascoli dans les 24 chants de son Dernier voyage (L’ultimo viaggio, Poemi Conviviali, 1904), où Ulysse veut refaire son voyage à l’envers et fait naufrage près de l’île des Sirènes ; pour Gabriele d’Annunzio (Laudi, Livre I), Ulysse sera un modèle de surhomme, que critiquera ironiquement Guido Gozzano en faisant d’Ulysse un dandy moderne sur son yacht (L’Ipotesi, Poesie sparse, 1907).
L’Italie écrit aussi des opéras sur Ulysse, de Claudio Monteverdi (Il ritorno di Ulisse, 1641) à Ippolito Pindemonte (Ulisse, 1778), de Luigi Dallapiccola (Ulisse, 1968) à Luciano Berio (Outis, 1996, c’est le nom qu’avait donné Ulysse à Polyphème pour le tromper, signifiant « personne »). L’Italie écrit sur Ulysse des films, comme celui de Francesco Rossi en 1968. En somme Ulysse apparaît bien comme le personnage héroïque le plus prisé par toute la culture italienne savante ou populaire.
Itaca
Un des premiers cantautori à parler d’Ulysse fut Lucio Dalla (1943-2012) avec ses chansons Itaca (1971) et Ulisse coperto di sale (1975) :
Itaca
Capitano che hai negli occhi il tuo nobile destino
pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino
capitano che hai trovato principesse in ogni porto
pensi mai al rematore che sua moglie crede morto
itaca, itaca, itaca la mia casa ce l’ho solo la’
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare
dal mare, dal mare, dal mare.
Capitano le tue colpe pago anch’io coi giorni miei
mentre il mio piu’ gran peccato fa sorridere gli dei
e se muori è un re che muore la tua casa avrà
quando io non torno a casa entran dentro fame e sete
itaca, itaca, itaca la mia casa ce l’ho solo la’
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare
dal mare, dal mare, dal mare.
Capitano che risolvi con l’astuzia ogni avventura
ti ricordi di un soldato che ogni volta ha piu’ paura
ma anche la paura in fondo mi da’ sempre un gusto strano
se ci fosse ancora mondo sono pronto dove andiamo
itaca, itaca, itaca la mia casa ce l’ho solo la’
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare
dal mare, dal mare, dal mare.
Ithaque
Capitaine, toi qui as dans les yeux ton noble destin,
Penses-tu parfois à ton marin à qui manquent le pain et le vin
Capitaine, toi qui as trouvé des princesses dans chaque port,
Penses-tu parfois au rameur que sa femme croit mort
Ithaque, Ithaque, Ithaque, ma maison n’est que là
Ithaque, Ithaque, Ithaque
Et chez moi je veux revenir
De la mer, de la mer, de la mer.
Capitaine, tes fautes je les paie moi aussi de mes jours
Tandis que mon plus grand péché fait sourire les dieux
Et si tu meurs, c’est un roi qui meurt, ta maison aura
Moi quand je ne rentre pas chez moi, entrent la faim et la soif
Ithaque, Ithaque, Ithaque, ma maison n’est que là
Ithaque, Ithaque, Ithaque
Et chez moi je veux revenir
De la mer, de la mer, de la mer.
Capitaine, toi qui résous astucieusement toute aventure,
Te souviens-tu d’un soldat qui a plus peur chaque fois,
Mais même la peur me donne au fond toujours un goût étrange,
S’il y avait encore un monde, je suis prêt, où allons-nous ?
Ithaque, Ithaque, Ithaque, ma maison n’est que là
Ithaque, Ithaque, Ithaque
Et chez moi je veux revenir
De la mer, de la mer, de la mer.
Ulisse coperto di sale
Ulisse coperto di sale
Vedo le stanze imbiancate
tutte le finestre spalancate
neve non c’è, il sole c’è,
nebbia non c’è, il cielo c’è !
Tutto scomparso, tutto cambiato
mentre ritorno da un mio passato
tutto è uguale, irreale
sono Ulisse coperto di sale !
E’ vero la vita è sempre un lungo, lungo ritorno
ascolta io non ho paura dei sentimenti
e allora guarda, io sono qui,
ho aperto adagio adagio con la chiave
come un tempo
ho lasciato la valigia sulla porta
ho lasciato la valigia sulla porta.
Ho guardato intorno prima di chiamare, chiamare
non ho paura, ti dico
che sono tornato per trovare, trovare
come una volta
dentro a questa casa
la mia forza
come Ulisse che torna dal mare
come Ulisse che torna dal mare.
Una mano di calce bianca
sulle pareti della mia stanza
cielo giallo di garbino,
occhio caldo di bambino !
Tiro il sole fin dentro la stanza
carro di fuoco che corre sul cuore
perché ogni giorno è sabbia e furore
e sempre uguali non sono le ore !
Voglio dirti
non rovesciare gli anni come un cassetto vuoto,
ascolta :
anche i giovani non hanno paura di un amore
mai, mai, mai strappano dal cuore
i sentimenti ;
io ti guardo
la tua forza è un’ombra di luce
la tua forza è un’ombra di luce.
Ulysse couvert de sel
Je vois les chambres blanchies
Toutes les fenêtres grandes ouvertes.
Il n’y a pas de neige, il y a le soleil,
Il n’y a pas de brouillard, il y a le ciel !
Tout a disparu, tout a changé
tandis que je reviens d’un passé qui m’appartient
Tout est égal, irréel
Je suis Ulysse couvert de sel !
Il est vrai que la vie est toujours un long, long retour.
Écoute, je n’ai pas peur des sentiments.
Et alors regarde, je suis ici,
J’ai ouvert tout doucement avec la clé ;
Comme dans le temps
J’ai laissé ma valise sur la porte
J’ai laissé ma valise sur la porte.
J’ai regardé autour de moi avant d’appeler, appeler
Je n’ai pas peur, je te dis
que je suis revenu pour trouver, trouver
comme autrefois
à l’intérieur de cette maison
ma force
Comme Ulysse qui revient de la mer
Comme Ulysse qui revient de la mer.
Une couche de chaux blanches
sur les murs de ma chambre
Ciel jaune de vent du sud-ouest,
Œil chaud d’enfance !
Je tire le soleil jusque dans la chambre,
char de feu qui court sur mon cœur
Car chaque jour est sable et fureur
et les heures ne sont pas toujours égales !
Je veux te dire :
Ne retourne pas les années comme un tiroir vide.
Écoute :
Même les jeunes n’ont pas peur d’un amour
Jamais, jamais, jamais, ils n’arrachent de leur cœur
les sentiments ;
Je te regarde
Ta force est une ombre de lumière
Ta force est une ombre de lumière.
Un autre « cantautore », Gianni Nebbiosi (1944- ), a écrit un Testament d’Ulysse en 1974. Nebbiosi était médecin psychiatre à Rome, et, dans les années ’60 et ’70, il se battit dans le même sens que Franco Basaglia (1924-1980) pour une psychiatrie plus démocratique. Et comme arme, il prit sa guitare et composa des chansons qui parlaient des conditions du malade mental dans un premier disque de 1972 (E ti chiamaron matta), tandis que son deuxième et dernier disque de 1974 (Mentre la gente se crede che vola) contenait des sujets plus généraux, dont ce Testament d’Ulysse. Il a travaillé aussi avec le Canzoniere del Lazio en 1974.
Il testamento di Ulisse
Il testamento di Ulisse
La sera vicino alla tenda sicura
gli eroi si toglievano freddo e paura,
le donne ed il vino e pensare al ritorno
scordavano presto i morti del giorno
poi quando nel sonno moriva la noia
tu ancora guardavi le mura di Troia.
E tu non pensavi a duelli futuri
a lance più forti a scudi più duri
capisti che a farvi tremenda la sorte
era quell’amore a un gioco di morte
smettesti di credere in Marte o Giunone
usando a preghiera la sola ragione...
e ti volò in testa un cavallo lucente
che avrebbe portato laggiù la tua gente
e ti volò in testa un cavallo infernale
che avrebbe portato allo scontro finale.
Ad Itaca un giorno calava la notte
te Ulisse sentì che arrivava la morte
te volle suo figlio in quel brutto momento
te volle suo figlio per far testamento
sentiva nel cuore i passi del boia
e ancora pensava alle mura di Troia.
Le testament d’Ulysse
Le soir dans la sécurité de la tente
les héros se libéraient du froid et de la peur,
les femmes et le vin et penser au retour
faisaient vite oublier les morts de la journée
puis quand l’ennui mourait dans le sommeil
tu regardais encore les murs de Troie.
Et tu ne pensais pas aux duels futurs
à des lances plus fortes, des boucliers plus durs
tu as compris que ce qui vous faisait un sort terrible
c’était cet amour pour un jeu de mort
tu as cessé de croire à Mars et à Junon
te servant comme prière de ta seule raison...
et dans ta tête vola un cheval luisant
qui porterait là-bas tous tes gens
et dans ta tête vola un cheval infernal
qui conduirait au combat final.
À Ithaque un jour la nuit tomba
Ulysse sentit que la mort arrivait
il voulut voir son fils dans ce vilain moment
il voulut voir son fils pour faire son testament
il sentait dans son cœur les pas du bourreau
et il pensait encore aux murs de Troie.
Le sicilien Kaballà (Gianni « Pippo » Rinaldi, né à Caltagirone en 1953) a écrit, en une langue qui mêle le dialecte et l’italien, une chanson sur le retour d’Ulysse dans sa patrie, Itaca, en se souvenant lui aussi du texte de la Divine Comédie où Ulysse voit les deux rives de la Méditerranée, la Sardaigne puis l’Espagne et le Maroc :
Itaca
Itaca
Davanti a mia c’è l’Africa
davanti a mia
c’è sempre tempu e libertà
Itaca ora mi po’ aspittari
sta strada longa è fatta
di acqua e di sali
Davanti a mia c’è l’Africa
ma quanto mare vento e mare senza pietà
Itaca ancora po’ aspittari
mille e ‘na notti prima di riturnari
Porti d’oriente d’oro e d’argento
ambra da respirare
vinu duci chi nun fa durmiri
Danzi d’amuri aria d’incenso
preghiere da cantare
notti e notti prima di turnari
E turnari vivi
quannu scinni ‘u suli
quannu veni l’ura di turnari
Davanti a mia c’è l’Africa
davanti a mia si rapi ‘u munnu
e ‘a libertà
Itaca intanto po’ aspittari
Itaca è solo un viaggio
da raccontare
Porti d’oriente d’oro e d’argento
ambra da respirare
notti e notti prima di turnari
E turnari vivi...
E turnari vivi
quannu ‘u cielu è mari
quannu ‘u cori dici di turnari.
Ithaque
Devant moi il y a l’Afrique
devant moi
il y a toujours du temps et de la liberté
Maintenant Ithaque peut m’attendre
cette longue route est faite
d’eau et de sel.
Devant moi il y a l’Afrique
mais que de mer, que de vent et de mer sans pitié
Ithaque peut encore attendre
mille et une nuits avant de revenir
Ports d’orient d’or et d’argent
ambre à respirer
vin doux qui ne font pas dormir
Danses d’amour air d’encens
prières à chanter
nuits et nuits avant de revenir
Et revenir vivants
quand descend le soleil
quand vient l’heure de revenir
Devant moi il y a l’Afrique
devant moi on vole un monde
et la liberté
Ithaque cependant peut attendre
Ithaque n’est qu’un voyage
à raconter
Ports d’orient d’or et d’argent
ambre à respirer
nuits et nuits avant de revenir
Et revenir vivants...
Et revenir vivants
quand le ciel est la mer
quand le cœur te dit de revenir.
En 2004, Francesco Guccini (1940- ) commence son disque Ritratti par une chanson intitulée Odysseus : c’est une autre méditation, à la fois historique et actuelle sur ce personnage homérique. Guccini s’inspire de nombreux textes littéraires, l’Odyssée d’Homère, l’Enfer XXVI de Dante, L’Isola petrosa de Foscolo dans A Zacinto, l’Itaca de Costantino Kavafis (voir plus loin), et d’autres. Ulysse n’est plus un héros surhumain, il n’était qu’un paysan, un montagnard comme Guccini lui même, dans son Ithaque pierreuse, destiné au travail de la terre et pas aux aventures sur la mer, c’est ce que Guccini affirme dès le début ; mais il doit aussi se lancer dans l’aventure, pour trouver une autre vérité, comme s’il était un scientifique cherchant sans savoir s’il trouvera, mais il doit chercher comme c’est la tâche de tout homme. Guccini fait ainsi de l’histoire d’Ulysse comme une « métaphore de la vie », dira-t-il, sans rien inventer de nouveau sur Ulysse, racontant son histoire sans allusions précises à la vie sociale contemporaine mais en en faisant comme le masque de Guccini et de la psychologie d’un homme d’aujourd’hui : c’est aussi pour cela qu’elle est sans doute si émouvante.
Odysseus
Odysseus
Bisogna che lo affermi fortemente
che, certo, non appartenevo al mare
anche se Dei d’Olimpo e umana gente
mi spinsero un giorno a navigare
se guardavo l’isola petrosa
ulivi e armenti sopra a ogni collina
c’era il mio cuore al sommo d’ogni cosa
c’era l’anima mia che è contadina ;
un’isola d’aratro e di frumento
senza vele, senza pescatori,
il sudore e la terra erano argento
il vino e l’olio erano i miei ori.
Ma se tu guardi un monte che hai di faccia
senti che ti sospinge a un altro monte,
un’isola col mare che l’abbraccia
ti chiama a un’altra isola di fronte
e diedi un volto a quelle chimere
le navi costruii di forma ardita,
concavi navi dalle vele nere
e nel mare cambiò quella mia vita,
ma il mare cambiò quella mia vita.
ma il mare trascurato mi travolse :
senza futuro era il mio navigare.
Ma nel futuro trame di passato
si uniscono a brandelli di presente,
ti esalta l’acqua e al gusto del sale
brucia la mente
e ad ogni viaggio reinventarsi un mito
a ogni incontro ridisegnare il mondo
e perdersi nel gusto del proibito
sempre più in fondo.
E andare in giorni bianchi come arsura,
soffio di vento e forza delle braccia,
mano al timone e sguardo nella pura
schiuma che lascia effimera una traccia ;
andare nella notte che ti avvolge
scrutando delle stelle il tremolare
in alto l’Orsa è un sogno che ti volge
diritta verso il nord della Polare.
E andare come spinto dal destino
verso una guerra, verso l’avventura
e tornare contro ogni vaticinio
contro gli Dei e contro la paura.
E andare verso isole incantate,
verso altri amori, verso forze arcane,
compagni persi e navi naufragati ;
per mesi, anni, o soltanto settimane ?
La memoria confonde e dà l’oblio,
chi era Nausicaa, e dove le sirene ?
Circe e Calypso perse nel brusio
di voci che non so legare assieme.
Mi sfuggono il timone, vela e remo,
la frattura fra inizio ed il finire,
l’urlo dell’accecato Polifemo
ed il mio navigare per fuggire.
E fuggendo si muore e la morte
sento vicina quando tutto tace
sul mare, e maledico la mia sorte
non trovo pace
forse perché sono rimasto solo
ma allora non tremava la mia mano
se i remi mutai in ali al folle volo
oltre l’umano.
La vita del mare segna false rotte,
ingannevole in mare ogni tracciato,
solo leggende perse nella notte
perenne di chi un giorno mi ha cantato
donandomi però un’eterna vita
racchiusa in versi, in ritmi, in una rima,
donandomi ancora la gioia infinita
di entrare in porti sconosciuti prima.
Ulysse
Il faut que je l’affirme fortement
que, certainement, je n’appartenais pas à la mer
même si les Dieux de l’Olympe et les humains
m’ont poussé un jour à naviguer
si je regardais mon île pierreuse
mes oliviers et mes troupeaux sur chaque colline
il y avait mon cœur en haut de toutes choses
il y avait mon âme qui est paysanne ;
une île de charrue et de froment
sans voiles, sans pêcheurs,
la sueur et la terre étaient en argent
le vin et l’huile étaient pour moi de l’or.
Mais si tu regardes la montagne en face de toi
tu sens qu’elle te pousse vers une autre montagne,
une île embrassée par la mer
t’appelle en face vers une autre île
et j’ai donné un visage à ces chimères
j’ai construit des navires à la forme hardie,
j’ai creusé des navires aux voiles noires
et dans la mer ma vie a changé,
mais la mer a changé ma vie.
mais la mer négligée m’a emporté :
sans avenir était le fait que je navigue.
Mais dans l’avenir des trames de passé
se mêlent à des lambeaux de présent,
l’eau t’exalte et au goût de son sel
ton esprit brûle
et dans chaque voyage, il faut réinventer un mythe
à chaque rencontre redessiner le monde
et se perdre dans le goût de l’interdit
en allant toujours plus au fond.
Et aller dans des jours blancs comme la chaleur,
au souffle du vent, à la force des bras,
la main au timon et le regard dans la pure
écume qui laisse une trace éphémère ;
aller dans la nuit qui t’entoure
en scrutant le tremblement des étoiles
en haut l’Ourse est un rêve qui te fait tourner
tout droit vers le nord de l’Étoile Polaire.
Et aller comme poussé par le destin
vers une guerre, vers l’aventure
et revenir contre toute prophétie
contre les Dieux et contre la peur.
Et aller vers des îles enchantées,
vers d’autres amours, des forces mystérieuses,
compagnons perdus, des navires naufragés ;
pendant des mois, des années ou seulement des semaines ?
La mémoire confond et fait oublier,
qui était Nausicaa, et où étaient les sirènes ?
Circé et Calypso perdues dans le bourdonnement
de voix que je ne sais plus relier aujourd’hui.
Le timon, la voile et la rame m’échappent,
la fracture entre le début et la fin,
le hurlement de Polyphème aveuglé
et naviguer pour m’enfuir.
Et en fuyant on meurt et la mort
je la sens proche quand tout se tait
sur la mer, et je maudis mon sort
je ne trouve pas de paix
peut-être parce que je suis resté seul
mais alors ma main ne tremblait pas
j’ai changé les rames en des ailes au vol fou
au-delà de l’humain.
La vie de la mer indique de fausses routes
trompeurs dans la mer sont tous les tracés,
seulement des légendes perdues dans la nuit
éternelle de celui qui un jour m’a chanté
en me donnant pourtant une vie éternelle
cachée dans des vers, des rythmes et une rime,
qui me donnent encore la joie infinie
de rentrer dans des ports que j’ignorais avant.
Francesco Camattini (né à Parme en 1969), un autre jeune cantautore, écrit aussi son Itaca en 2003, qui serait peu compréhensible sans la dédicace à Constantin Kavifis :
Itaca
Itaca
Se per Itaca volgi il tuo viaggio
fallo adesso o non farlo mai più
Poseidone e ciclopi ti aspettano al varco
ma a innalzarli sarai solo tu
Poseidone e i ciclopi
non ti fermeranno
passa a fermarti non sarai tu.
Issa il cuore delle cose più care
e guarisci la tua nostalgia :
dove cresce il successo e marcisce il danaro
si indurisce la tua malattia,
dove arde il successo ed impazza il futuro
è il principio di un'altra bugia.
Ogni giorno è un colosso di nubi
se silenzi, di piccole perplessità
una cesta di scuse,
che spostan l'accento
dal nulla che ci resterà,
una cesta di frasi che reggono a stento
il mio volto, la sua brevità.
Se per Itaca volgi il tuo sguardo
sii contento di quello che hai,
non stupirti se è brutta o se è solo il miraggio
di ciò che cercavi e che vuoi,
non stupirti se è brutta, ti basti il tuo viaggio
e la gloria di non essere eroi.
E se Itaca infine hai raggiunto
Non ti sorprenda la sua povertà
né il grigiore dell'anima che perde in quel punto
Ogni sciocca ed assurda irrealtà
e non plusti lasci sconvolto se il tuo viso
non rispecchierà.
Se per Itaca volgi il tuo viaggio
fallo adesso o non farlo mai più
Poseidone e ciclopi ti aspettano al varco
ma a innalzarli sarai solo tu,
Poseidone e i ciclopi
non ti fermeranno
passa a fermarti non sarai tu.
Ithaque
Si tu orientes ton voyage vers Ithaque
fais-le maintenant ou ne le fais jamais plus
Poséidon et les Cyclopes t’attendent au tournant
mais pour te relever il n’y aura que toi,
Poséidon et les Cyclopes
ne t’arrêteront
si tu ne t’arrêtes pas toi-même.
Hisse le cœur des choses les plus chères
et guéris ta nostalgie :
là où croît le succès et où l’argent pourrit
si ta maladie s’endurcit,
là où brûle le succès et où l’avenir devient fou
se trouve le début d’un autre mensonge.
Chaque jour est un colosse de nuages
de silences, de petites perplexités,
un panier d’excuses,
qui déplacent l’accent
du néant qui nous restera,
un panier de phrases qui portent difficilement
mon visage, sa brièveté.
Si tu tournes ton regard vers Ithaque
sois content de ce que tu as,
ne t’étonne pas si elle est laide ou si elle n’est qu’un mirage
de ce que tu cherchais et de ce que tu veux,
ne t’étonne pas si elle est laide, que ton voyage te suffise
et la gloire de ne pas être des héros.
Et si tu as enfin rejoint Ithaque
que sa pauvreté ne te surprenne pas
ni la grisaille de l’âme qui perd ici
Toute irréalité sotte et absurde
et ne te laisse pas bouleverser si ton visage
ne se reflète pas.
Si tu orientes ton voyage vers Ithaque
fais-le maintenant ou ne le fais jamais plus
Poséidon et les Cyclopes t’attendent au tournant
mais pour te relever il n’y aura que toi,
Poséidon et les Cyclopes
ne t’arrêteront
si tu ne t’arrêtes pas toi-même.
Comme d’autres cantautori, Guccini et Camattini connaissaient la poésie du grand poète grec Constantin Kavifis (1863-1933), Ithaque, de 1911, plusieurs fois traduite en italien, qui est une admirable métaphore de la vie humaine, qui est un long voyage comme celui d’Ulysse, dans son désir d’atteindre Ithaque, métaphore de la connaissance, de la sagesse, à laquelle on n’arrive qu’après toutes ces rencontres et toutes ces aventures, tous les dangers effrayants que symbolisent les Lestrigons, les Cyclopes et Neptune, mais qui ne sont dangereux que si on les accepte, si on les amplifie en nous ; et dans ce voyage nous devons accumuler le maximum de sagesses et de richesses intérieures et matérielles si on veut que le retour à la pauvre Ithaque soit beau et que sa « grisaille » ne nous déçoive pas :
ITACA
ITACA
Poesia di Kostantinos Kavafis
1911
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrìgoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sara` questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
ne' nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga,
Che i mattini d'estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con gioia -
toccherai terra tu per la prima volta :
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ébano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d'ogni sorta, piu' profumi
inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio ;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada : che cos'altro ti aspetti ?
E se la trovi povera, non per questo Itaca
ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza
addosso
gia` tu avrai capito cio` che Itaca vuole significare.
Ithaque
Poésie de Constantin Kavafis
1911
Quand tu te mettras en voyage pour Ithaque
tu dois souhaiter que la route soit longue,
fertile en aventures et en expériences.
Les Lestrigons et les Cyclopes
ou la fureur de Neptune, n’en aie pas peur,
ce ne sera pas le genre de tes rencontres
si ta pensée reste haute et si un sentiment
solide guide ton esprit et ton corps.
Sur des Cyclopes et des Lestrigons, non certainement,
ni sur Neptune en colère tu ne tomberas
si tu ne les portes pas en toi
si ton âme ne les dirige pas contre toi.
Tu dois souhaiter que ta route soit longue,
Que les matins d’été soient nombreux
quand dans les ports – finalement et avec joie –
tu toucheras terre, toi, pour la première fois :
dans les marchés phéniciens attarde-toi et acquiers
de la nacre, des coraux, de l’ébène et de l’ambre
toutes ces marchandises fines, et puis des parfums
pénétrants de toutes sortes, le plus de parfums
enivrants que tu peux,
va dans de nombreuses villes d’Égypte
apprends des sages une quantité de choses.
Toujours tu dois avoir Ithaque dans l’esprit
que ta pensée constante soit de la rejoindre.
Surtout ne te hâte pas dans ton voyage ;
fais qu’il dure longtemps, pendant des années, et que une fois vieux
tu mettes le pied sur ton île, toi, riche
des trésors accumulés en routes
sans attendre des richesses de la part d’Ithaque.
Ithaque t’a donné ton beau voyage,
sans elle tu ne te serais jamais mis
en route : qu’attends-tu d’autre ?
Et si tu la trouves pauvre, ce n’est pas pour cela
qu’elle t’aura déçu.
Désormais devenu sage, avec toute ton expérience
en toi
tu auras déjà compris ce que veut dire Ithaque.
Vinicio Capossela (1965- ) est un de ceux qui ont repris des thèmes mythologiques au XXIe siècle. Il écrit par exemple une belle chanson, Le Sirene, dans un disque plein de références à l’Antiquité, Marinai, Profeti e Balene, de 2011. Les Sirènes viennent évidemment de l’Odyssée d’Homère, où elles attirent les mortels par leurs chants sublimes pour les entraîner avec elles au fond de la mer et dans la mort. Capossela dit qu’il lit l’Odyssée comme « des récits de mes oncles ou de mes grands-parents qui ont vécu dans l’autre siècle » (Cf. www.Note spillate.com/2011/04). Faut-il écouter les sirènes ou se mettre de la cire dans les oreilles, rentrer chez soi et s’attacher au mât de l’habitude ? Les sirènes ne sont pas que mythologie, elles font partie de notre vie quotidienne, comme une « nuit de bière » :
Le Sirene
Le Sirene
Le sirene ti parlano di te
quello che erice
come fosse per sempre
le sirene
non hanno coda nè piume
cantando solo di te
ne parlant que de toi dans leurs chants
l’uomo di ieri
l’uomo che eri
a due passi dal cielo
tutta la vita davanti
tutta la vita intera
e dicono
fermati qua
fermati qua
le sirene ti assalgono di notte
create dalla notte
han conservato tutti i volti
che han amato e che
loro hanno le sirene
se te le cantano in coro
e non sei più solo
e il meglio di te
è un canto di sirene
e si sentono il rimpianto
di quanto è mancato
quello che hai previsto e non avrai
loro te lo danno
solo col cantori
ti cantano di come sei venuto dal niente
niente sarà.
uhhhhhhhhhhhhhhhh
le sirene sono una notte di birra
e non viene più l’alba
sono i fantasmi di strada
che arrivano a folate
e hanno voci di sirene.
limpidi e orecchie di cera
per non sentirle quando è sera
per rimanere saldo
legato all’abitudine
ma se ascolti le sirene
non tornare a casa
perchè la casa è
dove si canta di tele
ascolta le sirene
non smettono il canto
nelle veglie infinite cantano
tutta la tua vita
chi eri tu
chi eri tu
chi eri tu chi eri tu “lemosino” ?
perchè continuare fino a vecchiezza
fino a stare male
già tutto qua
fermati qua
non hai che dove andare
le sirene non cantano il futuro
ti danno quel che è stato
il tempo non è gentile
se ti fermi ad ascoltare
ti lascerai morire
perchè è tanto incessante
d è pieno d’inganni
e ti toglie la vita
non te la scarta no.
uhhhhhhhhhhhhhh
Les Sirènes
Les sirènes te parlent de toi
celui que tu étais
comme si c’était pour toujours
les sirènes
n’ont ni queue ni plumes
ne parlant que de toi dans leurs chants
l’homme d’hier
l’homme que tu étais
à deux pas du ciel
toute ta vie devant toi
toute ta vie entière
et elles disent
arrête-toi là
arrête-toi là
les sirènes t’assaillent de nuit
créées par la nuit
elles ont conservé tous les visages
qu’elles ont aimé et qu’elles ont,
elles ont les sirènes
et elles te les chantent en chœur
et tu n’es plus seul
et le meilleur de toi
c’est un chant de sirènes
et on les entend, le regret
de tout ce qui t’a manqué
ce que tu as prévu et que tu n’auras pas
elles te le donnent
seulement avec leurs chants
elles te chantent comment tu es venu du néant
ce ne sera rien.
uhhhhhhhhhhhhhhhh
les sirènes sont une nuit de bière
et l’aube n’arrive plus
ce sont des fantômes de rue
qui arrivent en rafale
et elles ont des voix de sirènes.
Soyez limpides avec des oreilles de cire
pour ne pas les entendre quand c’est le soir
pour rester solide
lié à l’habitude
mais si tu écoutes les sirènes
ne rentre pas chez toi
parce que la maison est
là où l’on te parle en chantant
écoute les sirènes
elles n’arrêtent pas leur chant
dans leurs veilles elles chantent à l’infini
toute ta vie
qui tu étais
qui tu étais
qui tu étais « toi qui demandes l’aumône » ?
pourquoi continuer jusqu’à la vieillesse
jusqu’à se trouver mal
tout est déjà là
arrête-toi là
tu n’as rien où aller
les sirènes ne chantent pas l’avenir
elles te donnent ce que tu as été
le temps n’est pas aimable
si tu t’arrêtes à les écouter
tu te laisseras mourir
parce qu’il si incessant
et plein de tromperies
et il t’enlève la vie
elles ne te la mettent pas au rebut.
uhhhhhhhhhhhhhh
D’autres encore ont chanté Ulysse et Ithaque : Enrico Ruggeri (Ulisse, dans Fango e stelle de 1996) ou Caparezza (Ulisse, dans Le dimensioni del mio caos, de 2008) qui ne fait qu’utiliser le nom d’Ulysse comme protagoniste du personnage d’Ilaria. Ce n’est que dans d’autres chansons qu’il se référera à des personnages de l’histoire italienne pour écrire des attaques féroces contre les pouvoirs politiques contemporains et contre l’Église d’aujourd’hui, mais ce seront des personnages d’une histoire récente, Galilée, Savonarole, Giordano Bruno et Jeanne d’Arc : nous en reparlerons plus loin à propos de Sogno eretico, 2010. La mythologie est loin.
Par contre, un des textes les plus récents à citer Ulysse est celui d’Articolo 31 (1990- ), en 1998, Nessuno, Personne. Mais Ulysse n’est évoqué que par le nom qu’il avait donné à Polyphème, « Mon nom est Personne », et il devient le symbole de cette humanité anonyme, cette masse de gens qui sont ignorés, privés de nom, dans la société contemporaine, écrasés par les « Polyphèmes », ces pouvoirs qui empêchent les « Personne » d’exister vraiment et d’être reconnus. Mais ce n’est qu’une référence formelle, à l’opposé du récit d’Homère où Ulysse, aristocrate et roi d’Ithaque ne peut en rien s’assimiler à un anonyme dont il est le contraire. C’est cependant une interprétation originale du texte grec ou dantesque, car là aussi, le « Personne » va l’emporter sur le Cyclope, David contre Goliath, héros populaire qui sera vainqueur du système de pouvoirs qui l’opprime. Victoire de la « Révolution » ! Articolo 31 (créé en 1990, actif jusqu’en 2006, et depuis, on ne sait pas trop …) est un des meilleurs représentants des « Posse » d’origine, fidèles jusqu’au bout à ce qu’exprimaient les jeunes noirs du Bronx qui ont stimulé la naissance du hip-hop (Voir notre dossier sur le rap et l’édition du 16 mars 2017 des Nouvelles de ces derniers temps, sur Actu).
Nessuno
Qual'è il tuo nome ? Il mio nome è Nessuno. Come scusa ?
Preferisco essere chiamato Nessuno.
Piacere io sono Nessuno nei miei giorni pesi tu non mi vedevi. Non ero nella lista degli attesi. Vengo da una generazione di disillusi. Dal video lesi educati ad essere ambiziosi e poi scaricati a terra tipo pesi, di zavorra da una mongolfiera, ma ora è la mia era, uscito dall'anonimato con la sensazione di un evaso da galera. Una prigione di ignoranza a cui un tribunale occulto mi diede l'ergastolo, ma io riscrissi il mio capitolo. Ed ora mi conosci. J.Ax, quello degli Articolo.
Io sono Nessuno e rappresento tutti quei Nessuno che mi stanno intorno. Persi in una routine uguale giorno dopo giorno. Sconvolti sul limite estremo. Per tutti i Polifemo, che primo o poi ti accecheremo.
Tu giornalista, che ora mi insegui per lo scoop, ti ricordi ? Quando venni da te a parlarti, eri occupato troppo dal tuo pop. Trovasti solo il modo di screditarmi senza nemmeno prima ascoltarmi e tu musicista, che ora copi il mio sound. Quando prima dicevi che l'hip-hop non era musica. Adesso sembri un imitatore povero clown un pugile che sul mio ring va giù al primo secondo del primo round, mi fa venire il down. Il ricordo di zero possibilità offerte dopo il mio diploma. Vedevo gente fare strada grazie ad un amaro e un bagnoschiuma. Sono solo fatti miei. Ma io sono la prova che non ho fatto strada grazie alla mia faccia, tipo Raoul Bova. Vedevo attori prendere premi, grazie ai cognomi, attrici e vallette presentarci andare avanti a pompini. Io col cognome contadino e zero attitudine al pompino timbravo il cartellino e quale oro, aveva la merda in bocca il mio mattino e adesso che persino ho girato le strade di New York in limo. Chiedimi chi sono e ti risponderò : Nessuno.
Io sono Nessuno e rappresento tutti quei Nessuno che mi stanno intorno. Persi in una routine uguale giorno dopo giorno. Sconvolti sul limite estremo. Per tutti i Polifemo, che primo o poi ti accecheremo.
Mi hanno cresciuto riempiendomi le orecchie di cazzate. Il professore, il televisore, il politico, il prete. Uno per uno tutti a fare in culo, angeli bugiardi, esempi di virtù di 'sta gran fava, ultimi dei servi. Il professore mi diceva di studiare il televisore di comprare il politico di votare il prete di pregare, io ho studiato votato ho persino pregato, non ho potuto comprare e alla fine ho visto premiato solo chi ha comprato. Fanculo. Mi sono fatto una strada solo perché l'alternativa era girare, fatto per strada, e comunque, resto sempre fuori dall'ambiente, preferisco la mia gente, dello Star System sono il latitante, sono stato maltrattato e tra le conseguenze, c'è che ho il rancore, con un danno permanente, che costantemente, cresce anche, quando leggo sui giornali le dichiarazioni, di critici o cabarettisti musicisti che ci danno dei minchioni, il fatto è che sono politicamente non corretto, fuori dal giro di San Remo ma anche dall'ambiente alternativo antipatico ed entrambe le parti con conseguente effetto, anti divo, il danno che mi fanno è nullo, mi considero un reietto, da quando sono vivo, ora voglio divertirmi, fratelli continuate ad amarmi, bastardi continuate ad odiarmi, guardatemi mangiarmi tutto il cibo che non volevate darmi. Nessuno ero Nessuno sono quindi se ti chiedono chi è stato risponderai Nessuno ed io sarò salvato.
Io sono Nessuno e rappresento tutti quei Nessuno che mi stanno intorno. Persi in una routine uguale giorno dopo giorno. Sconvolti sul limite estremo. Per tutti i Polifemo, che primo o poi ti accecheremo.
Tutti gli occhi addosso a Nessuno. Ognuno si sente il diritto di dirci chi siamo, che facciamo, quando e come sbagliamo. Tante voci che mi sembra di uscire pazzo. Volete che mi tolga di qui? 'Sto cazzo. Tutti quelli che sentirai sputarci merda addosso è perché vorrebbero il nostro posto e se non ho risposto è perché piuttosto preferisco studiare per andare più in alto e su questa tesi interagisco tra le rime e il disco tra il vero e il falso tra una carezza e un calcio tra una bestemmia e un salmo tra la strada e il palco e al televisore toccherà comprarmi il professore dovrà studiarmi il politico dovrà temermi prete la mia generazione non è da oratorio per la religione non ci serve intermediario puoi dimenticarmi scattano gli allarmi perché sarò la voce di tutti quei Nessuno che voce non hanno. Cambierò la parte ad ogni ruolo che mi assegneranno, non m'inquadreranno e tanto meno capiranno, e se mi fermeranno, frega un cazzo tanto l'ho già fatto il danno. 600.000 persone mò c'hanno in casa le prove che qualsiasi Nessuno può accecare il suo ciclope.
Io sono Nessuno e rappresento tutti quei Nessuno che mi stanno intorno. Persi in una routine uguale giorno dopo giorno. Sconvolti sul limite estremo. Per tutti i Polifemo, che primo o poi ti accecheremo.
Mi costrinsero a vagare su questa terra da solo. Io sono Nessuno.
Personne
Quel est ton nom ? Mon nom est Personne. Comment, pardon ?
Je préfère qu’on m’appelle Personne.
Très heureux je suis Personne dans la journée, penses-y toi, tu ne me voyais pas. Je n’étais pas sur la liste de ceux qui étaient attendus. Je viens d’une génération de gens déçus. Abîmés par la vidéo éduqués à être ambitieux et puis déchargés à terre comme des poids lourds, génération de choses inutiles jetées d’une mongolfière, mais maintenant voilà mon temps, sorti de l’anonymat avec la sensation d’un évadé des galères. Une prison d’ignorance à laquelle un tribunal secret m’a condamné aux travaux forcés, mais j’ai écrit à nouveau mon chapitre. Édora tu me connais, J.Ax d’Article 31.
Je suis Personne et je représente tous ces Personne qui sont autour de moi. Perdus dans une routine égale jour après jour. Bouleversés à l’extrême limite. Pour tous les Polyphème, vous qu’un jour ou l’autre nous aveuglerons.
Toi journaliste, toi qui me suis maintenant pour le scoop, te souviens-tu ? Quand je suis venu chez toi pour te parler, tu étais trop occupé par ton pop. Tu n’as trouvé que le moyen de me discréditer sans même m’écouter d’abord et toi musicien, toi qui maintenant copies mon sound. Quand auparavant tu disais que le hip-hop n’est pas de la musique. Maintenant tu sembles être un imitateur pauvre clown un boxeur qui tombe à la première seconde du premier round, tu me donnes le down (le cafard). Le souvenir de zéro possibilités après mon diplôme. Je voyais des gens faire leur chemin avec un bitter ou un bain moussant. Ce ne sont que mes affaires. Mais je suis la preuve que je ne me suis pas imposé grâce à mon visage, type Raoul Bova. Je voyais des acteurs avoir des prix, grâce à leur nom, des actrices et des présentatrices aller de l’avant à coups de fellation. Moi avec mon nom paysan et aucune aptitude à la fellation je pointais et comme de l’or, ma matinée avait de la merde dans la bouche, et j’ai même tourné dans les rues de New York en limousine. Demande-moi qui je suis et je te répondrai : Personne.
Je suis Personne et je représente tous ces Personne qui sont autour de moi. Perdus dans une routine égale jour après jour. Bouleversés à l’extrême limite. Pour tous les Polyphème, vous qu’un jour ou l’autre nous aveuglerons.
On m’a fait grandir en me remplissant les oreilles de conneries. Le professeur, le poste de télévision, l’homme politique, le prêtre. Un à un, tous là à te la mettre dans le cul, anges menteurs, exemples de vertus de cette grande fable, les derniers des valets. Le professeur me disait d’apprendre, le poste de télévision d’acheter, l’homme politique de voter, le prêtre de prier, j’ai appris, voté j’ai même prié, je n’ai pas pu acheter et à la fin j’ai vu qu’on ne donnait un prix qu’à celui qui avait acheté. Va te faire foutre. J’ai fait ma route tout seul, parce que l’alternative était de tourner, de rester dans la rue, et de toute façon je reste toujours dehors, je préfère mes gens, du Star System je suis le contumace, j’ai été maltraité et parmi les conséquences, il y a que j’ai de la rancœur, avec un dommage permanent, qui constamment grandit aussi quand je lis sur les journaux les déclarations de critiques ou de musiciens de cabaret qui nous traitent d’abruti, le fait est que je suis politiquement incorrect, hors du tour de Sanremo mais aussi du milieu alternatif antipathique, et les deux ayant comme conséquence que je suis antistar, le dommage qu’ils me font est nul, je me considère comme un paria, depuis que je suis vivant, maintenant je veux m’amuser, frères continuez à m’aimer, bâtards continuez à me détester, regardez-moi manger toute la nourriture que vous ne vouliez pas me donner. Personne j’étais Personne je suis, donc si on te demande qui c’était tu répondras Personne et je serai sauvé.
Je suis Personne et je représente tous ces Personne qui sont autour de moi. Perdus dans une routine égale jour après jour. Bouleversés à l’extrême limite. Pour tous les Polyphème, vous qu’un jour ou l’autre nous aveuglerons.
Tous les yeux sur Personne. Chacun se sent le droit de nous dire qui nous sommes, ce que nous faisons, quand et comment nous nous trompons. Tant de voix qu’il me semble devenir fou. Vous voulez que je me tire de là ? Merde. Tous ceux que tu sentiras nous cracher de la merde dessus, c’est parce qu’ils voudraient notre place, et si je n’ai pas répondu c’est plutôt parce que je préfère étudier pour aller plus haut et sur cette thèse je fais des interactions entre les rimes et le disque entre le vrai et le faux entre une caresse et un coup de pied entre un juron et un psaume entre la rue et la scène et le poste de télévision devra m’acheter le professeur devra m’étudier l’homme politique devra me craindre, prêtre ma génération n’est pas celle d’un oratoire pour la religion pas besoin d’intermédiaire tu peux m’oublier les alarmes se déclenchent parce que je serai la voix de tous ces Personne qui n’ont pas de voix. Je changerai la partie pour chaque rôle qu’ils me donneront, ils ne m’encadreront pas et ils me comprendront encore moins s’ils m’arrêtent, je n’en ai rien à foutre de toute façon le dommage je l’ai déjà fait, 600.000 personnes ont chez elles la preuve que m’importe quel Personne peut aveugler son Cyclope.
Je suis Personne et je représente tous ces Personne qui sont autour de moi. Perdus dans une routine égale jour après jour. Bouleversés à l’extrême limite. Pour tous les Polyphème, vous qu’un jour ou l’autre nous aveuglerons.
On m’a obligé à errer sur cette terre. Je suis Personne.
- Orphée et Eurydice
Des cantautori comme Roberto Vecchioni (1943- ), Francesco Camattini (1969- ), Carmen Consoli (1974- )… reprennent volontiers un autre mythe, celui d’Orphée et Eurydice chacun à sa façon. Orphée, fils d’Apollon (ou du roi de Thrace) et de la muse Calliopé, chante de façon si douce que tous, les hommes, les animaux, les plantes, les rochers, viennent l’écouter dans l’enchantement, et Apollon lui donne la lyre d’Hermès. Il épouse la belle nymphe Eurydice, mais Aristée, lui aussi amoureux d’Eurydice et lui aussi fils d’Apollon, la poursuit pour lui faire violence et elle, en fuyant, heurte un serpent qui la mord et la tue. Alors Orphée se rend dans le Royaume des morts pour demander qu’Eurydice lui soit rendue ; il charme Charon, puis le chien Cerbère qui reste avec ses trois bouches ouvertes en écoutant son chant, puis Hadès et Perséphone qui lui rendent Eurydice (bien qu’elle ait été disputée entre Hadès et Jupiter, cette partie du ciel qui voulait abuser d’elle), à condition qu’il ne se retourne pas vers elle avant d’être arrivé dans la pleine lumière. Mais à peine voit-il un rayon de soleil qu’Orphée se retourne et la perd pour toujours. Il sera ensuite déchiré par les Ménades qui ne lui pardonnent pas de ne pas aimer d’autres femmes. Virgile, puis Ovide ont raconté l’histoire, chantée ensuite par Monteverdi, Gluck, Offenbach, et en poésie par Rilke, Calvino, Dino Campana, Savinio, Bufalino, Buzzati, Pavese, ou en France, Leconte de Lisle, Hugo, Apollinaire, Valéry, Cocteau, etc., et quelques cantautori après que Jung l’eût interprétée à son tour.
Orfeo e Euridice
(Francesco Camattini Ormeggi 2003)
Quando Orfeo si volta di scatto
Euridice non è più con lui
- mi dispiace se ho infranto il mio patto,
ma, sai com’è -
anche Ade mi aveva promesso
che saresti tornata con me
molte anime avevo commosso e il mio canto
commuoveva anche me
è che sono inciampato nel dubbio,
se lasciarti per sempre di là :
come un cigno dal volo ricurvo,
la ragione restava al di qua.
e scendevi sempre più svelta,
e stupita dalla Necessità,
che solleva in alto i tuoi giorni
poi li scaglia con brutalità.
Così ti hanno vista i miei occhi bruciare
e il mio grido correva nel vuoto,
alla fine la carne, è un fatto volgare
che la mente non piega al suo gioco.
Il mio sbaglio è una cosa sicura,
ma volevo salvarti, si sa,
dalla noia che manca all’amore,
dalle prossime trivialità.
Coi miei alberi, danzo in tuo onore,
e ogni giorno balliamo affinché
si ritiri, dal cielo, la parte
che voleva abusare di te.
Ci inondiamo di stelle remote,
e di sguardi che non abbiam più,
solleviamo in alto la ruota
della vita che passa quaggiù.
Quand Orphée se retourne brusquement
Eurydice n’est plus avec lui
– je regrette d’avoir brisé mon pacte,
mais tu sais ce que c’est –
même Adès m’avait promis
que tu serais revenue avec moi
j’avais ému beaucoup d’âmes et mon chant
m’émouvait moi aussi
c’est que j’ai buté dans le doute,
si je devais te laisser pour toujours là-bas :
comme un cygne au vol recourbé,
la raison restait en-deçà.
et tu descendais toujours plus vive,
et stupéfaite par la Nécessité,
qui soulève tes jours vers le haut
et puis les jette avec brutalité.
C’est ainsi que mes yeux t’ont vue brûler
et mon cri courait dans le vide,
à la fin la chair, c’est un fait vulgaire
que l’esprit ne plie pas à son jeu.
Mon erreur est une chose sûre,
mais je voulais te sauver, on le sait,
de l’ennui qui manque à l’amour,
des trivialités prochaines.
Avec mes arbres, je danse en ton honneur,
et tous les jours nous dansons pour que
se retire du ciel, la partie
qui voulait abuser de toi.
Nous nous inondons d’étoiles lointaines,
et de regards que nous n’avons plus,
nous soulevons vers le haut la roue
de la vie qui passe ici-bas.
Pour Camattini, c’est donc délibérément qu’Orphée se retourne en sachant qu’il va renvoyer Eurydice aux Enfers, en proie au désir des dieux : il ne veut pas la ramener à une vie médiocre et ennuyeuse, « normale », tandis que là, même mort et la tête coupée, il pourra continuer à la chanter comme dans les débuts de leur amour. Voilà maintenant Vecchioni :
Euridice
(Roberto Vecchioni Blumun 1993)
Morirò di paura a venire là in fondo,
maledetto padrone del tempo che fugge,
del buio e del freddo ;
ma lei aveva vent’anni e faceva l’amore,
e nei campi di maggio, da quando è partita,
non cresce più un fiore...
E canterò, stasera canterò,
tutte le mie canzoni canterò,
con il cuore in gola canterò :
e canterò la storia delle sue mani
che erano passeri di mare,
gli occhi come incanti d’onde
scivolanti ai bordi delle sere ;
e canterò le madri che
accompagnano i figli
verso i loro sogni,
per non vederli più, la sera,
sulle vele nere dei ritorni ;
e canterò, canterò finchè avrò fiato,
finchè avrò voce di dolcezza e rabbia,
gli uomini, segni dimenticati,
gli uomini, lacrime nella pioggia,
aggrappati alla vita che se ne va
con tutto il furore dell’ultimo bacio
nell’ultimo giorno dell’ultimo amore ;
e canterò finchè tu piangerai,
canterò finchè tu perderai,
canterò finchè tu scoppierai,
e me la ridarai indietro.
Ma non avrò più la forza
di portarla là fuori,
perché lei adesso è morta
e là fuori ci sono la luce e i colori ;
dopo aver vinto il cielo
e battuto l’inferno,
basterà che mi volti
e la lascio alla notte,
la lascio all’inverno...
E mi volterò
le carezze sue di ieri
mi volterò
non saranno mai più quelle
mi volterò
e nel mondo, su, là fuori
mi volterò
s’intravedono le stelle
mi volterò perché ho visto il gelo
che le ha preso la vita,
e io, io adesso, nessun altro,
dico che è finita ;
e ragazze sognanti mi aspettano
a danzarmi il cuore,
perché tutto quello
che si piange non è amore ;
e mi volterò perché tu sfiorirai,
mi volterò perché tu sparirai,
mi volterò perché già non ci sei
e ti addormenterai per sempre.
Je mourrai de peur de venir là au fond,
maudit maître du temps qui fuit
de l’obscurité et du froid ;
mais elle avait vingt ans et elle faisait l’amour,
et dans les champs de mai, depuis qu’elle est partie,
il ne pousse plus une fleur …
Et je chanterai, ce soir je chanterai,
toutes mes chansons je chanterai,
le cœur dans la gorge je chanterai :
et je chanterai l’histoire de ses mains
qui étaient des passereaux de mer,
les yeux comme des vagues enchantées
glissant au bord des soirs ;
et je chanterai les mères qui
accompagnent leurs enfants
vers leurs rêves,
pour ne plus les voir, le soir,
sur les voiles noires des retours ;
et je chanterai, je chanterai tant que j’aurai du souffle,
tant que j’aurai une voix de douceur et de rage,
les hommes, signes oubliés,
les hommes, larmes dans la pluie,
agrippés à la vie qui s’en va
avec toute la fureur du dernier baiser
dans le dernier jour de l’amour ;
et je chanterai jusqu’à ce que tu pleures,
je chanterai jusqu’à ce que tu perdes,
je chanterai jusqu’à ce que tu éclates,
et que tu me permettes de revenir en arrière avec elle.
Mais je n’aurai plus la force
de la ramener là dehors,
parce que maintenant elle est morte
et là dehors il y a la lumière et les couleurs ;
après avoir vaincu le ciel
et battu l’enfer,
il suffira que je me retourne
et je la laisse à la nuit,
je la laisse à l’hiver …
Et je me retournerai
ses caresses d’hier
je me retournerai
ne seront jamais plus les mêmes
je me retournerai
et dans le monde, là haut, là dehors
je me retournerai
on entrevoit les étoiles
je me retournerai parce que j’ai vu le gel
qui lui a pris la vie,
et moi, moi maintenant, aucun autre,
je dis que c’est fini ;
et des filles rêveuses m’attendent
pour faire danser mon cœur,
parce que tout ce que
l’on pleure n’est pas de l’amour ;
et je me retournerai parce que tu te faneras,
je me retournerai parce que tu disparaîtras,
je me retournerai parce que tu n’es déjà plus là
et tu t’endormiras pour toujours.
Chez Vecchioni aussi, Orphée décide de ne pas ramener Eurydice, parce qu’il sait que ce ne sera jamais plus comme avant, parce qu’elle est morte pour toujours, parce qu’elle disparaîtra à nouveau, parce que ses caresses ne seront plus jamais les mêmes : on ne revient pas de la mort, même si les dieux l’ont promis, c’est inéluctable, il faut passer à autre chose, à d’autres amours. Faut-il se retourner, même par amour ?
Carmen Consoli écrit une chanson en faisant parler Eurydice et en laissant la fin ouverte : reviendra-t-elle à la vie ou non ? C’est presque aussi ce que les autres femmes de ses chansons demandent à un homme qu’elles aiment et désirent. Mais dans la tradition, Eurydice est aussi celle qui doit se taire en attendant d’être sauvée, et elle est plutôt marginale jusqu’au XIXe siècle ; ici c’est elle qui parle dans une chanson intitulée pourtant Orfeo :
ORFEO
(Testo e musica : Carmen Consoli (Stato di necessità, Cyclope Records, Universal Music Italia srl, 2000))
Sei venuto a convincermi
o a biasimarmi per ciò che non ho ancora imparato
Sei venuto a riprendermi
Orfeo malato dai forza e coraggio al tuo canto eccelso.
Portami con te non voltarti
conducimi alla luce del giorno
Portami con te non lasciarmi
Io sono bendata ma sento già il calore
E’ il momento di svegliarmi
è tempo di rinascere
Sento addosso le tue mani
e è un caldo richiamo perché
ho bisogno di svegliarmi.
Prendermi cura di te
Ritorno alla vita.
Sei venuto a difendermi
a liberarmi imponendo oltremodo la tua ostinazione
Sei venuto a riprendermi
Eroe distratto da voci che inducono in tentazione
Portami con te non ascoltarle
conducimi alla luce del giorno
Portami con te non lasciarmi
Il varco è vicino ed io sento già il tepore
E’ il momento di svegliarmi
è tempo di rinascere
Sento addosso le tue mani
e è un caldo richiamo perché
ho bisogno di svegliarmi.
E’ il momento di svegliarmi
Ritorno alla vita
Ritorno alla vita
Ritorno alla vita
Ritorno alla vita
Ritorno alla vita.
Tu es venu me convaincre
ou me blâmer pour ce que je n’ai pas encore appris
Tu es venu me reprendre
Orphée malade donne force et courage à ton très haut chant
Emporte-moi avec toi ne te retourne pas
conduis-moi à la lumière du jour
Emporte-moi avec toi ne me laisse pas
J’ai les yeux bandés mais je sens déjà la chaleur.
C’est le moment de me réveiller
c’est le moment de renaître
Je sens tes mains sur moi
et c’est un chaud rappel parce que
j’ai besoin de me réveiller.
De prendre soin de toi
Je reviens à la vie.
Tu es venu me défendre
me libérer en imposant ton obstination de façon folle
Tu es venu me reprendre
Héros distrait par des voix qui induisent en tentation
Emporte-moi avec toi ne les écoute pas
conduis-moi à la lumière du jour
Emporte-moi avec toi ne me laisse pas
Le seuil est proche et je sens déjà la tiédeur.
C’est le moment de me réveiller
c’est le temps de renaître
Je sens tes mains sur moi
et c’est un chaud rappel parce que
j’ai besoin de me réveiller.
C’est le moment de me réveiller
Je reviens à la vie
Je reviens à la vie
Je reviens à la vie
Je reviens à la vie
Je reviens à la vie.
Orphée et Eurydice constituent un autre thème mythologique qui a constamment inspiré les auteurs italiens, particulièrement les musiciens, qui s’inspirent tous des récits anciens, en particulier de celui d’Eschyle (525-456 av.J.C.) (Agamemnon), Euripide (480-406 av.J.C.) (Alceste), Virgile (70-19 av.J.C.) (Géorgiques, Livre IV) qui est le premier à évoquer le regard d’Orphée qui renvoie Eurydice aux Enfers, et celui d’Ovide (43 av.J.C.-18 apr.J.C.) (Métamorphoses, X-XI). Ce n’est pas étonnant, Orphée est un symbole apollinien de la poésie et de la musique par lesquelles il parvient à ouvrir les portes du Royaume des morts. Cela commence par un texte d’Angelo Poliziano (1454-1494) (Fabula di Orfeo, de 1479), mais surtout par l’Euridice d’Ottavio Rinuccini (1562-1621) et Jacopo Peri (1561-1633) en 1600, aussitôt imitée par l’Euridice d’Alessandro Striggio (1540-1592) et Claudio Monteverdi (1567-1643) en 1607, puis par l’Orfeo dolente de Domenico Belli (1590-1627) en 1616 ; en 1619 Alessandro Mattei et Stefano Landi (1547-1639) produisent La morte di Orfeo ; puis ce sont les Orfeo de Luigi Rossi (1597-1643) en 1647 et de Jean-Baptiste Lully (1632-1687) en 1690, suivis de l’Orfeo e Euridice de Christoph Willibald Gluck (1714-1787) en 1762, et des opéras de nombreux musiciens étrangers jusqu’à celui d’Igor Stravinsky (1882-1974) en 1947, pour arriver à celui de Tito Schipa Jr (1948- ) en 1970.
Mais le mythe inspire aussi la littérature italienne, Cesare Pavese (1908-1950) (Dialoghi con Leucò, 1945), Gesualdo Bufalino (1920-1996) (Il ritorno di Euridice, 1986) où Eurydice comprend qu’Orphée a fait exprès de se retourner … Dino Buzzati (1906-1972) l’évoque dans ses Poemi a fumetti.
- De l’Atlantide à Vénus et Ajax et à Alexandre le Grand
Commençons par l’Atlantide de Franco Battiato, de 1993. Platon (428-348 av.J.C.) est le premier auteur connu à raconter ce mythe dans son Timée et son Critias. L’Atlantide aurait été une île située devant les Colonnes d’Hercule, environ 10.000 ans av.J.C. dont le roi Atlas aurait été le fils de Poséidon (Neptune), dieu des mers depuis le partage de l’univers par les occupants de l’Olympe, Zeus (Jupiter) ayant la Terre et Hadès (Pluton) les Enfers ; l’île, plus grande que la Lybie chez Platon, aurait contrôlé une grande partie de l’Afrique jusqu’à l’Égypte et l’Europe jusqu’à l’Italie, mais au moment d’une guerre contre son adversaire principal, Athènes, un cataclysme l’aurait engloutie. Poséidon serait tombé amoureux d’une jeune fille mortelle de l’île alors inaccessible, et ils auraient eu dix enfants dont le premier aurait été Atlas, gouverneur d’un territoire divisé en dix îles, monarchie puissante abondamment riche et dotée de connaissances scientifiques et alchimiques, ayant en son centre un sanctuaire à Poséidon d’argent et d’orischalque, métal mystérieux, et une statue d’or du dieu. Puis après des années de bonheur, le côté humain des habitants l’emporta sur leur nature divine, suscitant la colère de Zeus qui la fit engloutir. Était-ce pour Platon le modèle utopique de la cité parfaite qu’il dessine dans plusieurs de ses œuvres, à l’opposé de la situation grecque entre 360 et 350 av.J.C. ? Il a en tout cas inspiré nombre d’utopies modernes à partir de la Renaissance, de Francis Bacon (1561-1526) au Marquis de Sade (1740-1814). On continue aujourd’hui à discuter de son emplacement, la Crète, l’île grecque de Santorin, la Sardaigne, la Sicile, le Mont Argentario (Toscane) … ?, et de nombreux écrivains la visitent ou en décrivent les descendants, à partir de Jules Verne (1828-1905) dans Vingt mille lieues sous les mers (1870) ; on fait sur le même thème beaucoup de films, émissions vidéo, mangas … et chansons, dont celle de Franco Battiato (1945- ) en Italie, peut-être inspirée par celle de Donovan (1946- ) en 1968, et en tout cas par les textes de Platon, et par les théories philosophiques du philosophe George Ivanovitch Gurdjieff (1866-1949) qui travaillait souvent au « café de la Paix ». Une autre île utopique, Thulé, est chantée entre autres par Francesco Guccini.
L’Atlantide
(Franco Battiato Caffé de la Paix 1993)
E gli dei tirarono a sorte.
Si divisero il mondo :
Zeus la Terra,
Ade gli Inferi,
Poseidon il continente sommerso.
Apparve Atlantide.
Immenso, isole e montagne,
Canali simili ad orbite celesti.
Il suo re Atlante
Conosceva la dottrina della sfera
Gli astri la geometria,
La cabala e l'alchimia.
In alto il tempio.
Sei cavalli alati,
Le statue d'oro, d'avorio e oricalco.
Per generazioni la legge dimorò
Nei principi divini,
I re mai ebbri delle immense ricchezze
E il carattere umano s'insinuò
E non sopportarono la felicità,
Neppure le felicità,
Neppure la felicità.
In un giorno e una notte
La distruzione avvenne.
Tornò nell'acqua.
Sparì Atlantide.
Et les dieux tirèrent au sort.
Ils se partagèrent le monde :
Zeus la Terre,
Hadès les Enfers
Poséidon le continent submergé.
Apparut l’Atlantide.
Immense, îles et montagnes,
Des canaux semblables à des orbites célestes.
Son roi Atlas
Connaissait la doctrine de la sphère
Les astres, la géométrie,
La cabbale et l’alchimie.
En haut le Temple.
Six chevaux ailés,
Les statues d’or, d’ivoire et d’orischalque.
Pendant des générations la loi demeura
Conforme aux principes divins,
Les rois jamais ivres de leurs immenses richesses
Et le caractère humain s’insinua
Et ils ne supportèrent pas le bonheur,
Même pas les bonheurs,
Même pas le bonheur.
En un jour et une nuit
Advint la destruction.
Elle retourna dans l’eau.
L’Atlantide disparut.
Et voilà une autre belle chanson de Roberto Vecchioni sur Alexandre le Grand (356-323 av. J.C.), roi de Macédoine. Roberto Vecchioni fut, parallèlement à sa carrière de cantautore, professeur de grec et de latin dans un Lycée de Milan, et il connaissait bien l’histoire de la Grèce. On constate pourtant que plutôt qu’à la réalité de la Grèce qu’il connaît bien, il préfère se référer à des auteurs modernes comme José Luis Borges (1899-1986).
Alessandro e il mare
(Roberto Vecchioni Milady, 1989)
Il tramonto era pieno di soldati ubriachi di futuro
Fra i dadi le bestemie e il sogno di un letto più sicuro
Ma quando lui usciva dalla tenda non osavano
nemmeno guardare
sapevano che c’era la sua ombra sola davanti al mare.
Poi l’alba era tutta un fumo di cavalli,
gridi e risate nuove ;
dove si va, passato il Gange,
Generale, parla, dicci solo dove :
e lui usciva dalla tenda
bello come la mattina il sole :
come in una lontana leggenda,
perduta chissà dove...
E tornava bambino,
te tornava bambino,
quando stava da solo a giocare nei viali
di un immenso giardino ;
la fontana coi pesci
dai riflessi d’argento,
che poteva soltanto guardarla,
mai buttarcisi dentro.
E mentre si voltava indietro
non aveva niente da vedere ;
e mentre si guardava avanti
niente da voler sapere ;
ma il tempo di tutta una vita
non valeva quel solo momento :
Alessandro, così grande fuori, così piccolo dentro.
E tornava bambino,
te tornava bambino,
quando stava da solo a giocare nei viali
di un immenso giardino ;
la fontana coi pesci
dai riflessi d’argento,
che poteva soltanto guardarla,
mai buttarcisi dentro.
E mentre si voltava indietro
non aveva niente da vedere ;
e mentre si guardava avanti
niente da voler sapere ;
ma il tempo di tutta una vita
non valeva quel solo momento :
Alessandro, così grande fuori, così piccolo dentro.
Le couchant était plein de soldats ivres de futur
Parmi les dés les jurons et le rêve d’un lit plus sûr
Mais quand il sortait de sa tente ils n’osaient
même pas regarder
Ils savaient qu’il y avait son ombre seule devant la mer.
Puis l’aube était toute une fumée de chevaux,
de cris et de rires nouveaux ;
où va-t-on, passé le Gange,
Général, parle, dis-nous seulement où on va :
et lui sortait de sa tente
beau comme le soleil du matin ;
comme dans une ancienne légende,
perdue qui sait où...
Et il redevenait enfant,
tu redevenais enfant,
quand il était tout seul à jouer dans les allées
d’un immense jardin ;
la fontaine avec des poissons
aux reflets d’argent,
qu’il pouvait seulement regarder,
jamais se jeter dedans.
Et tandis qu’il se retournait
il n’avait rien à voir ;
et tandis qu’il regardait devant lui
rien qu’il voulût savoir ;
mais le temps de toute une vie
ne valait pas ce seul moment :
Alexandre, si grand dehors, si petit dedans.
Et il redevenait enfant,
tu redevenais enfant,
quand il était tout seul à jouer dans les allées
d’un immense jardin ;
la fontaine avec des poissons
aux reflets d’argent,
qu’il pouvait seulement regarder,
jamais se jeter dedans.
Et tandis qu’il se retournait
il n’avait rien à voir ;
et tandis qu’il regardait devant lui
rien qu’il voulût savoir ;
mais le temps de toute une vie
ne valait pas ce seul moment :
Alexandre, si grand dehors, si petit dedans.
Roberto Vecchioni a consacré aussi en 1972 une chanson au héros grec Ajax, Aiace, dans le disque Saldi di fine stagione ; il la reprend dans un album de 1997, puis dans son ouvrage de 2014, Il mercante di luce.
Aiace
(Roberto Vecchioni, Saldi di fine stagione, 1972)
E non sembravi
Et tu ne semblais
nemmeno più quello
même plus celuiche dalle porte Scee
qui des portes Scées
guardando il cielo
en regardant le ciel
gridava a Dio
criait vers Dieu
con tutta la sua voce
de toute ta voix
– Sterminaci se vuoi ma nella luce –
– Extermine-nous si tu veux mais dans la lumière –
E il mare è grande
Et la mer est grande
quando vien la sera
quand vient le soir
Dio è lontano
Dieu est loin
per la tua preghiera
pour ta prière
che c’è chi parla troppo
qui il y a ceux qui parlent trop
e c’è chi tace
et ceux qui se taisent,
tu sei ti quei
tu es de ceux-là
e al popolo non piace
et cela ne plaît pas au peuple.
Chi ha vinto è là
Celui qui a vaincu est là
che vomita il suo vino
qui vomit son vin
e quel che conta
et ce qui compte
in fondo è l’intestino
au fond c’est l’intestin.
la la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la la
È il coro degli Achei
C’est le chœur des Achéens
che si diletta
qui se réjouit
hai perso e questo
tu as perdu et cela
è il meno che ti aspetta
est le moins de ce qui t’attend
ti stanno canzonando
Il se moquent de toi
mica male
pas mal
va’ un po’ a spiegare
va un peu expliquer
quando un uomo vale
quand un homme a de la valeur
Dovevi vincer tu
C’est toi qui devais vaincre
lo sanno tutti
tous le savent
tu andavi per nemici
tu allais au milieu des ennemis
e lui per gatti
et lui au milieu des chats
ma il popolo è
mais le peuple est
una pecora che bela
une brebis qui bêle
gli fai passare
tu lui fais passer
per fragola una mela
une pomme pour une fraise.
Chi ha vinto è là
Celui qui a vaincu est là
che vomita il suo vino
qui vomit son vin
e quel che conta
et ce qui compte
in fondo è l’intestino
au fond c’est l’intestin.
la la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la la
Fa grande sulla tenda
Le feu sur la tente
le ombre il fuoco
fait de grandes ombres
ma dai che è stato
mais allez, ce n’a été
solamente un gioco
qu’un jeu.
la la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la lala la la la la la Aiace la la la la la la
C’est le chœur des Achéens
qui se réjouit
tu as perdu et cela
est le moins de ce qui t’attend
Ils se moquent de toi
pas mal
va un peu expliquer
quand un homme a de la valeur
C’est toi qui devais vaincre
tous le savent
tu allais au milieu des ennemis
et lui au milieu des chats
mais le peuple est
une brebis qui bêle
tu lui fais passer
une pomme pour une fraise.
Celui qui a vaincu est là
qui vomit son vin
et ce qui compte
au fond c’est l’intestin.
Le feu sur la tente
fait de grandes ombres
mais allez, ce n’a été
qu’un jeu.
Vecchioni écrira plusieurs autres chansons sur l’antiquité grecque, en particulier sa très belle chanson, Il cielo capovolto (l’ultimo canto di Saffo), en mémoire de la poétesse grecque et peut-être avec quelque souvenir du poème de Giacomo Leopardi :
Il cielo capovolto
(ultimo canto di Saffo)
(dernier chant de Sapho)
(Roberto Vecchioni Il cielo capovolto, 1995)
Il cielo capovolto
Che ne sarà di me e di te,
che ne sarà di noi ?
L'orlo del tuo vestito,
un'unghia di un tuo dito,
l'ora che te ne vai...
Che ne sarà domani, dopodomani
poi per sempre ?
Mi tremerà la mano
passandola sul seno
cifra degli anni miei...
A chi darai la bocca, il fiato,
le piccole ferite,
gli occhi che fanno festa,
la musica che resta
e che non canterai ?
E dove guarderò la notte,
seppellita nel mare ?
Mi sentirò morire
dovendo immaginare
con chi sei...
Gli uomini son come il mare :
l'azzurro capovolto
che riflette il cielo ;
sognano di navigare,
ma non è vero.
Scrivimi da un altro amore,
e per le lacrime
che avrai negli occhi chiusi,
guardami : ti lascio un fiore
d'immaginari sorrisi.
Che ne sarà di me e di te,
che ne sarà di noi ?
Vorrei essere l'ombra,
l'ombra di chi ti guarda
e si addormenta in te ;
da piccola ho sognato un uomo
che mi portava via,
e in quest'isola stretta
lo sognai così in fretta
che era passato già !
Avrei voluto avere grandi mani,
mani da soldato :
stringerti così forte
da sfiorare la morte
poi tornare qui ;
avrei voluto far l'amore
come farebbe un uomo,
ma con la tenerezza,
l'incerta timidezza
che abbiamo solo noi...
Gli uomini, continua attesa,
e disperata rabbia
di copiare il cielo ;
rompere qualunque cosa,
se non è loro !
Scrivimi da un altro amore :
le tue parole
sembreranno nella sera
come l'ultimo bacio
della tua bocca leggera.
Le ciel renversé
Qu’en sera-t-il de moi et de toi,
qu’en sera-t-il de nous ?
Le bord de ton vêtement,
l’ongle d’un de tes doigts,
l’heure où tu t’en vas…
Qu’en sera-t-il demain, après-demain
et puis pour toujours ?
Ma main tremblera
quand je la passe sur mon sein
chiffre de mes années…
À qui donneras-tu ta bouche, ton souffle,
tes petites blessures,
les yeux qui te font fête,
la musique qui reste
et que tu ne chanteras pas ?
Et où regarderai-je la nuit,
ensevelie dans la mer ?
Je me sentirai mourir
quand je devrai imaginer
avec qui tu es…
Les hommes sont comme la mer :
l’azur renversé
qui reflète le ciel ;
ils rêvent de naviguer,
mais ce n’est pas vrai.
Écris-moi depuis un autre amour,
et à travers les larmes
qui seront dans tes yeux fermés,
regarde-moi : je te laisse une fleur
de sourires imaginaires.
Qu’en sera-t-il de moi et de toi,
qu’en sera-t-il de nous ?
Je voudrais être l’ombre,
l’ombre de qui te regarde
et s’endort en toi ;
étant petite j’ai rêvé d’un homme
qui m’emportait,
et dans cette île étroite
je rêvai avec tant de hâte
qu’il était déjà passé !
J’aurais voulu avoir de grandes mains,
des mains de soldat :
te serrer assez fort
pour effleurer la mort
et puis revenir là ;
j’aurais voulu faire l’amour
comme le ferait un homme,
mais avec la tendresse,
la timidité incertaine
que nous sommes seules à avoir…
Les hommes, attente continuelle,
et rage désespérée
de copier le ciel ;
briser toute chose,
s’il ne s’agit pas d’eux !
Écris-moi depuis un autre amour :
tes mots
sembleront dans le soir
comme le dernier baiser
de ta bouche légère.
Sapho n’est pas un mythe, mais un personnage historique devenu mythique, poétesse grecque entre 640 et 570 av.J.C. qui devint le symbole de l’homosexualité féminine, d’où le terme « saphique », tandis que le mot « lesbienne » vient de l’île de Lesbos d’où Sapho était originaire. Cette homosexualité était courante et acceptée dans les mœurs de l’époque. Sapho éduquait des jeunes filles à la musique, à la danse, à la poésie, à la vie sociale, et elle était amoureuse de ses élèves, les initiait à l’érotisme en vue de leur mariage, c’était alors une pratique d’initiation entre adultes et adolescents qui était normale, à partir d’un certain âge : la pédophilie était interdite ! Sapho aurait été mariée et aurait eu une fille.
Il ne nous reste que des fragments de son œuvre considérée dans l’Antiquité comme une des plus élaborées dans le domaine lyrique (la poésie accompagnée d’un instrument à cordes, lire ou cithare), et on la considérait parfois comme une dixième Muse. Vecchioni connaissait bien ces textes, et il en tire sa chanson : les hommes sont comme la mer, et ils ne doivent leur couleur bleue qu’au ciel, les femmes sont comme le ciel. Il se met dans l’image de Sapho qui souffre parce qu’elle est amoureuse d’une de ses élèves qui va se marier. Vecchioni s’inspire peut-être aussi du texte écrit par Giacomo Leopardi (1798-1837) en 1822, L’ultimo canto di Saffo, où elle finit par se suicider de désespoir.
Carmen Consoli écrit encore une chanson intitulée Venere, Vénus (dans Confusa e felice, 1997), mais ce n’est qu’une description de femme séduisante d’aujourd’hui, la référence à Vénus se résume en la citation de son nom. Dans un disque suivant (Stato di necessità, 2000), elle écrit Parole di burro où elle cite Narcisse, mais ce n’est qu’un mot destiné à évoquer un personnage contemporain de séducteur qu’appelle de ses vœux la chanteuse. Les noms mythologiques ne sont qu’un prétexte pour raconter des personnages contemporains, sans plus aucune évocation de leur histoire mythologique, ou pour parler de la vie personnelle du compositeur. Toute dimension sociale et politique a disparu de ces textes, toute allusion à l’histoire de l’Italie. C’est le même phénomène que l’on constate dans la chanson de Vinicio Capossela, Medusa cha cha cha (dans Ovunque proteggi, 2008), où la Méduse n’est plus qu’un nom sans aucun contenu mythologique. L’Antiquité a cessé d’être un miroir permettant de parler de notre époque et des problèmes sociaux et politiques qui furent une référence de la plupart des cantautori contemporains ; elle ne disparaît pas de la chanson mais elle ne subsiste que comme référence extérieure à des noms antiques.
À l’opposé de cet abandon de référence mythologique, Eugenio Finardi (1952, Milan) traduit une chanson du brésilien Chico Buarque de Hollanda, Le donne di Atene. C’est, dit le site, « une chanson ironique et provocatrice qui est un acte d’accusation très fort non seulement contre le machisme mais surtout contre l’ostentation et l’apothéose que du machisme, toujours rampant dans beaucoup de sociétés humaines, arrive toujours à faire tout régime militaire et dictatorial, avec ses rappels obsessifs à des concepts comme Patrie, Drapeau, Honneur, Orgueil, Race, etc. Et où évidemment la femme n’occupe qu’une place résiduelle et toujours douloureuse, comme ventre qui donne des enfants à la nation, ou comme épouse qui attend le retour de l’aimé des champs de bataille, ou comme veuve inconsolable condamnée à la solitude et au silence, ou comme butin de guerre ou putain pour apaiser les désirs de ces impavides guerriers ».
Là encore, le recours à l’Antiquité grecque n’est qu’une façon de dénoncer le fonctionnement de la société d’aujourd’hui.
Le donne di Atene
Dovreste prendere esempio da quelle mogli di Atene
Che vivon per i loro mariti, orgoglio e razza di Atene.
Tutto il giorno si son profumate
Lavate nel latte e pettinate per
Esser amate.
Se fustigate non piangeranno
Ma anzi proprio loro imploreranno
Più dure pene:
Catene.
Cercate di prendere esempio da quelle mogli di Atene
Che soffron per i loro mariti, potere e forza di Atene,
Quando essi partono soldati
Intessono lunghi teli ricamati
Per settimane
E quando tornano affamati
Di baci con violenza strappati e
Carezze piene
Oscene.
Dovreste prendere esempio da quelle mogli di Atene
Che perdonano ai loro mariti, i bravi guerrieri di Atene
Quando si ingozzano di vino per
Trovare il coraggio di aver vicino
Altre falene,
Ma poi alla fine della notte, spossati,
Son quasi sempre ritornati dalle
Loro piccine Elene.
Cercate di prendere esempio da quelle mogli di Atene
che generano ai loro mariti i nuovi figli di Atene;
Non hanno alcun gusto ne volontà
Non han difetti ne qualità
Lo sanno bene
Non hanno sogni ma solo presagi
Per i loro uomini e il mare e i naufragi e
Belle sirene
Morene.
Dovreste prendere esempio da quelle mogli di Atene
Che temon per i moro mariti, gli eroi e gli amanti di Atene
Dalle giovani vedove segnate
E dalle gestanti abbandonate che
Non fanno scene
Vestite del nero di chi é rassegnato
Di chi ha oramai già accettato il Fato
Senza più pene
Sono serene.
Cercate di prendere esempio da quelle mogli di Atene
Che vivono per i loro mariti, orgoglio e razza di Atene.
Les femmes d’Athènes
Vous devriez prendre exemple sur ces femmes d’Athènes
Qui vivent pour leurs maris, fierté et race d’Athènes.
Toute la journée, elles se sont parfumées
Lavées dans le lait et peignées pour
Être aimées.
Si elles sont battues, elles ne pleureront pas
Mais au contraire ce sont elles qui imploreront
De plus dures peines :
Des chaînes.
Cherchez à prendre exemple sur ces femmes d’Athènes
Qui souffrent pour leurs maris, pouvoir et force d’Athènes,
Quand ils partent à l’armée
Elles tissent de longues toiles brodées
Pendant des semaines
Et quand ils reviennent affamés
De baisers arrachés violemment et
De caresses pleines
D’obscénités.
Vous devriez prendre exemple sur ces femmes d’Athènes
Qui pardonnent à leurs maris, les braves guerriers d’Athènes
Quand ils se gorgent de vin pour
Trouver le courage d’avoir à côté d’eux
D’autres papillons,
Mais à la fin de la nuit, épuisés,
Ils sont presque toujours revenus chez
Leurs petites Héllènes.
Cherchez à prendre exemple sur ces femmes d’Athènes
Qui engendrent pour leurs maris de nouveaux fils d’Athènes ;
Elles n’ont aucun goût ni aucune volonté
Elles n’ont ni défauts ni qualités
Elles le savent bien
Elles n’ont pas de rêves mais que des présages
Pour leurs hommes et la mer et les naufrages
Et les belles sirènes
Mauresques.
Vous devriez prendre exemple sur ces femmes d’Athènes
Qui craignent pour leurs maris, les héros et les amants d’Athènes
Aux jeunes veuves marquées
Et aux femmes enceintes abandonnées qui
Ne font pas de scènes
Vêtues du noir de qui est résigné
De qui a désormais déjà accepté le Destin
Sans plus de peines
Elles sont sereines.
Cherchez à prendre exemple sur ces femmes d’Athènes
Qui vivent pour leurs maris, fierté et race d’Athènes.
- Au-delà de la mythologie grecque, l’Italie préromaine dans la chanson dialectale
Enfin, en-dehors de la mythologie grecque, il faudrait chercher dans la chanson dialectale les traces de cette Italie préromaine. Une région du sud est significative de ce que nous cherchons, la Sardaigne, dont Alan Lomax (1915-2002) faisait déjà l’hypothèse que c’était un héritage de la polyvocalité la plus ancienne d’Europe, témoignage le plus riche de la préhistoire (Nuove ipotesi sul canto folcloristico italiano, Nuovi argomenti, n° 17-18, Rome, 1955-56). C’est aussi une expression vocale proclamée comme Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO ; cela est dû en particulier à l’isolement historique de la culture sarde qui reste donc plus proche de ses origines lointaines. La voix humaine rejoint le cri d’un animal familier des sardes, le mouton, comme dans ce Lamentu des Tenores di Bitti (1995- ), c’est un « canto a tenores » de 4 voix dont la voix la plus gutturale reprend le cri du mouton, par une vibration particulière des cordes vocales ; cette musique « primitive » apparaît en même temps d’une grande modernité, tellement qu’un chanteur comme Peter Gabriel (1950, Angleterre, fondateur du groupe de rock Genesis) a participé à un disque des Tenores di Bitti :
Lamentu
Lamentu (Tenores di Bitti S’amore ‘e mama 1996)
Lamentu
Lamentu (Tenores di Bitti S’amore ‘e mama 1996)
Le texte est une lamentation pour de jeunes sardes mis en prison pour un crime dont il se révèle ensuite que ce n’est pas eux qui l’ont commis. Une autre chanson est aussi riche et proche du chant sarde traditionnel, même reprise par une voix de chanteuse professionnelle comme Elena Ledda (1959- ) et des instrumentistes professionnels ; c’est une berceuse, comme celles que de tous temps les mères ou les grands-mères chantaient aux bébés pour les faire dormir en les berçant, un des chants primordiaux de la vie quotidienne de tous les peuples.
ANNINNIA (NINNA NANNA)
Anninnia Anninnoi Anninnia Anninnoi
Dodo, dodo
Anninnio Anninnoi Anninnia Anninnoi
Dodo, dodo
su chi ti cantu oi Quel che io oggi ti canto
uno di as’a cantai un giorno tu canterai
S’Anninnia de Giocundu La ninnananna di Giocondo
o cantai m’iada praxi mi piacerebbe cantare
cantu bellu iadessi su mundu. Quanto sarebbe bello il Mondo
Chi ci fessid amori e paxi. se vi regnassero amore e pace.
ANNINNIA (NINNA NANNA)
Anninnia Anninnoi Anninnia Anninnoi
Dodo, dodo
Anninnio Anninnoi Anninnia Anninnoi
Dodo, dodo
Ce qu’aujourd’hui je te chante
Un jour tu le chanteras
C’est la berceuse de Giocondo
que j’aimerais chanter
Comme le Monde serait beau
Si l’amour et la paix y régnaient.
Et puis il faudrait écouter les chants des Ladins du nord-est, des Albanais du sud, etc. et on s’apercevrait dans toutes les régions de la vitalité de ce patrimoine historique. Nous sommes les héritiers de ces êtres de la préhistoire.
Terminons ce chapitre par quelques chants de Naples, une des sources de la chanson dans toute l’Italie. On sait par les légendes que la musique a toujours été centrale à Naples, depuis la présence de sirènes dont la tradition dit que c’est l’une d’elles qui aurait fondé la ville, Parthénopé, et on parle encore de « civilisation parthénopéenne ». De nombreux chanteurs et groupes maintiennent en vie cette tradition. Écoutons ce « Jesce sole » datant du moyen-âge (probablement de l’époque de Frédéric II (1194-1250), au début du XIIIe s.), mais qui semble reprendre une invocation primitive au soleil créateur de la vie :
Jesce sole
Jesce, jesce sole
scagliente ‘mperatore,
canniello mio d’argiento
che vale quattuciento ;
ciento cinquantacente cinquanta
tutta la notte cantata
canta Viola, lu masto de scola.
Masto masto,
mannancenne priesto
ca scenne masto Tieste
cu’ lanza e cu’ spada
cu l’auciello accumpagnato.
Sona sona zampugnella
ca t’accatto la gonnella,
la gonnella de scarlato ;
si nun suone te rompo la capa.
Nun chiovere
nun chiovere
ca aggia ire a movere
ca scenne lu grano
de masto Giuliano.
Masto Giuliano
manname ‘na lanza
ca aggia ire in Franza
da Franza a Lombardia
dove stà madama Lucia.
Nun chiovere,
nun chiovere,
jesce jesce sole.
Sors, Soleil
Sors, sors, Soleil,
empereur de chaleur
mon médaillon d’argent
qui vaut quatre cents ;
cent cinquante
toute la nuit chante
chante la Violette, le maître d’école.
Maître, maître,
envoie-nous en vite
car maître Thieste descend
avec sa lance et son épée
accompagné d’un oiseau.
Joue, joue petite cornemuse
que j’attrape ta petite jupe,
ta petite jupe écarlate ;
si tu ne joues pas je te brise la tête.
Pas de pluie
pas de pluie
car je dois aller retourner
retourner le blé
de Maître Julien.
Maître Julien
envoie-moi une lance
car je dois aller en France
de France en Lombardie
où se trouve Madame Lucie.
Pas de pluie,
pas de pluie,
sors, sors, Soleil.
Et n’oublions pas que Francesco Guccini, consacrant une chanson à sa fille Teresa, rappelle ses origines anciennes « longobardes, celtes et romaines » :
CULODRITTO
Ma come vorrei avere i tuoi occhi,
spalancati sul mondo come carte assorbenti
se le tue risate pulite e piene, quasi senza rimorsi
o pentimenti,
ma come vorrei avere da guardare
ancora tutto, come i libri da sfogliare
e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare,
Culodritto, che vai via sicura,
trasformando dal vivo cromosomi corsari,
di longobardi, di celti e romani dell’antica pianura,
di montanari,
reginetta dei telecomandi,
di gnosi assolute che asserisci e domandi,
di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi,
anche se non avrai
le mie risse terrose di campi cortili e di strade,
se non saprai
che sapore ha il sapore dell’uva rubata a un filare,
presto ti accorgerai
com’è facile farsi un inutile software di scienza
e vedrai
che confuso problema è adoprare la propria esperienza.
Culodritto, cosa vuoi che ti dica ?
Solo che costa sempre fatica
e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica.
CULODRITTO
Mais comme je voudrais avoir tes yeux
grands ouverts sur le monde comme des papiers buvards
et tes rires propres et pleins, presque sans remords
ou repentirs,
mais comme je voudrais avoir à regarder
encore tout, comme les livres à feuilleter
et avoir encore tout, ou presque tout, à essayer,
Culodritto, toi qui vas avec assurance,
en transformant en direct tes chromosomes corsaires,
de longobards, de celtes et de romains de l’ancienne plaine,
de montagnards,
petite reine des télécommandes,
de gnoses absolues que tu affirmes et que tu demandes,
de suspicion et de confiance dans le monde curieux des grands,
même si tu n’as pas
mes bagarres dans la terre des champs, des cours et des routes,
si tu ne sais pas
quelle saveur est celle du raisin volé dans une vigne,
bientôt tu t’apercevras
comme c’est facile d’assimiler un inutile software de science
et tu verras
quel problème confus c’est d’employer sa propre expérience.
Culodritto, que veux-tu que je te dise ?
Seulement que ça coûte toujours de la peine
et que vivre, c’est toujours ça, mais c’est de l’histoire ancienne.
Guccini explique que « andare via col culo diritto » est une expression de la plaine du Pô qui indique quelqu’un qui s’en va gonflé d’orgueil et vexé, comme cela arrive assez souvent aux enfants qui s’estiment victimes d’injustices (Cf. Francesco Guccini, Stagioni, Einaudi, 2000, pp. 186-7).
II. Rome monarchique, Rome républicaine, Rome impériale
On ne dispose pratiquement d’aucun document sur la musique et le chant que pratiquaient les Romains ; on sait pourtant qu’ils chantaient, et du moins au début qu’ils psalmodiaient leurs poésies et leurs pièces de théâtre. Mais c’est surtout à partir du moment où ils entrent en contact avec les Grecs que leur chant se développe. On en a beaucoup de témoignages littéraires, on sait que Néron (37-68) se produisait en chantant à Naples ; il faudrait aussi se référer à la mythologie grecque : c’est à proximité de l’Italie qu’Ulysse rencontre les sirènes, dont l’une, Parthénopé (= celle qui a une voix de jeune fille), serait la fondatrice et la protectrice de Neapolis, qui en garde un vif souvenir, et montre même dans l’église San Giovanni Maggiore la plaque de son tombeau. Mais la littérature ne remplace pas les partitions et les enregistrements.
Probablement le peuple chantait, comme maintenant, mais on n’en a aucune trace. Comme le souligne Mary Beard (1955- ) dans son excellente histoire de Rome (S.P.Q.R., Histoire de l’ancienne Rome, Perrin, 2015), on dépend des auteurs anciens qui écrivaient leur histoire de Rome à partir des écrits des « grands » hommes, de Scipion l’Émilien (185-129 av.J.C.) à Sylla (138-78 av.J.C.), « Ce qui nous manque, c’est le point de vue de ceux qui ne faisaient pas partie de ce groupe de personnalités hors du commun : les soldats ou électeurs ordinaires, ou encore les femmes – si on excepte les nombreuses fictions qui entourent la figure de Spartacus – et les esclaves (…) Tous restent dans l’ombre, ou, au mieux, jouent les petits rôles (…). Nous ignorons dans quelle mesure le grand nombre continuait de mener une existence plus ou moins ordinaire, pendant que ceux qui occupaient le sommet du pouvoir combattaient à la tête de leurs légions. Ou bien ne faut-il pas plutôt penser que la violence et la désagrégation de l’ordre civil accablaient la plupart du temps la plus grande partie de la population ? » (pp. 253-254).
Référons-nous donc à un témoignage plus récent ; il ne nous donnera aucune idée de la musique romaine, mais de ce qu’écrivaient des hommes, qui étaient hors du « sommet » et souvent réprimés par ce sommet : Horace (Quintus Horatius Flaccus, 65-08 av.J.C.) était fils d’un esclave affranchi et Ovide (Publius Ovidius Naso, 43 av.J.C.-17 apr.J.C.) fut relégué par l’empereur Auguste, qui ne l’aimait pas, sur les bords de la Mer Noire, Properce (Sextus Propertius, 47-16 av.J.C.) était un protégé de Mécène (70-08 av.J.C.), mais ses propriétés furent confisquées au moment de la distribution des terres aux vétérans de la légion, Juvénal (Decimus Junius Juvenalis, vers 60-vers 130 apr.J.C.) était aussi fils d’affranchi enrichi, mais disgracié par l’empereur Hadrien (76-138) ; tous ceux-là étaient des observateurs et des critiques de la vie romaine, d’un point de vue plus populaire ; Caton (234-149 av.J.C.) et l’empereur Marc-Aurèle (121-180) étaient au contraire des hommes politiques très connus ; Gaius Lucillus (148-102 av. J.C.) fut un poète, ami influent des Scipion, mais qui resta toujours loin de la vie politique romaine.
Traduction du texte latin d’Ovide
Où courez-vous, malheureux ? pourquoi armer vos mains criminelles de ces épées remises naguère dans le fourreau ? Trouvez-vous donc que, sur les champs de bataille, sur la mer, ait été répandu trop peu de sang latin ? Et pourquoi ? pour que le soldat romain brûlât les superbes tours de notre rivale Carthage ; pour que le Breton, encore à l'abri de nos armes, descendît, chargé de fers, la voie Sacrée ? Non : pour qu'exauçant les vœux des Parthes, cette ville s'immolât de sa propre main. Mais jamais les loups, les lions n'ont montré contre leur espèce tant de cruauté. Qui vous pousse ? Est-ce fureur aveugle, entraînement fatal, crime à expier ?... répondez !... Ils gardent le silence ; la pâleur blanchit leurs fronts ; leurs âmes semblent interdites. C’est donc vrai ? c'est le courroux du destin qui poursuit sur les Romains le châtiment d'un fratricide, du jour où a coulé sur la terre, pour la malédiction de ses neveux, le sang innocent de Rémus ?
Virgilio Savona (1919-2009) a choisi et traduit ces textes avec des spécialistes de la littérature latine, et les a adaptés à être des chansons, mais en respectant strictement le sens général du passage choisi. Quelle vision de la société romaine ressort de ces chansons ?
D’abord une société qui pratique constamment la guerre, c’est le thème qui donne son titre à la réédition du disque : Dove andate ?, demande Horace, vous qui, depuis le meurtre de Remus, dégainez toujours vos épées et qui assassinez vos semblables comme ne le font jamais les loups et les lions. Et il est vrai que l’empire romain s’est construit dans la guerre et la violence. Vous appelez à la guerre comme Hannibal (247-183 av.J.C.) le faisait, voulant conquérir l’Espagne et l’Italie jusqu’au Trastevere (È già nostro nemico, de Caton, Prova a pesare Annibale, de Juvénal) ; et pourtant, demande Juvénal, que pèse Hannibal maintenant qu’il est réduit en cendres ?
Dove andate
Dove dove andate
perché le vostre spade
sono state sguainate
se nel fodero eran già riposte
Voi credete che sia stato poco
il sangue versato in terra ed in mare
per trascinare il nemico in catene
per causare le vostre rovine ?
Nemmeno i lupi nemmeno i leoni
infieriscono sugli animali
della loro stessa specie.
Che cos’è che spinge voi
che cos’è che vi trascina
a placare il desiderio
della violenza ?
Nessuno viene a darmi risposta
nessuno può sul suo viso
nascondere la paura.
Siete spinti da un tragico destino
e i fratelli uccidono i fratelli
fin da quando la terra fu macchiata
dal sangue di Remo.
Dove dove andate
perché le vostre spade
sono state sguainate
se nel fodero eran già riposte
Voi le avevate soltanto nascoste.
Dove andate
Où allez-vous donc
pourquoi vos épées
ont-elles été dégaînées
si elles étaient déjà remises dans leur fourreau ?
Vous croyez que cela a été peu de choses
le sang versé sur terre et sur mer
pour traîner un ennemi enchaîné
et pour causer vos ruines ?
Même les loups, même les lions
ne s’acharnent pas sur les animaux
de la même espèce.
Qu’est-ce qui vous pousse
qu’est-ce qui vous entraîne
à apaiser votre désir
de violence ?
Personne ne vient me répondre,
personne ne peut sur son visage
cacher sa peur.
Vous êtes poussés par un destin tragique
et les frères tuent les frères
depuis que le terre fut tachée
par le sang de Remus.
Où allez-vous donc
pourquoi vos épées
ont-elles été dégainées
si elles étaient déjà remises dans leur fourreau
Vous n’aviez fait que les cacher.
La violence et la guerre sont donc la pratique commune des Romains depuis Remus, c’est-à-dire depuis les origines légendaires de la ville. Le dernier vers n’existe pas chez Horace, il est ajouté par Savona.
Prova a pesare Annibale
Prova a pesare Annibale ora che è solo cenere
e dimmi quanti grammi la stadera segnerà
prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai
di un grande generale cos’è rimasto ormai.
Eppure l’Africa non gli bastava
dal mare oceano fino all’Egitto
sanniti e siculi lucani e bruzi
volle raggiungere anche la Spagna
scavalcare seppe i Pirenei
infranse rupi disgregò montagne
entrò nel novero dei semidei.
Ma oggi prova a pesare Annibale
ora che è solo cenere
e dimmi quanti grammi la stadera segnerà
prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai
di un grande generale cos’è rimasto ormai.
Se già teneva l’Italia succube
luin non gli bastava quella condizione
voleva giungere fino a Trastevere
con acrobatica penetrazione.
Anche se aveva un occhio inutile
terrorizzava i ricchi ed i plebei
cavalcando sopra un elefante
se ne andava a caccia di trofei.
Ma oggi prova a pesare Annibale
ora che è solo cenere
e dimmi quanti grammi la stadera segnerà
prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai
di un grande generale cos’è rimasto ormai.
Prova a pesare Annibale ora che è solo cenere.
e dimmi quanti grammi la stadera segnerà
prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai
di un grande generale cos’è rimasto ormai.
Prova a pesare Annibale
Essaie de peser Hannibal maintenant qu’il n’est plus que cendres
et dis-moi combien de grammes marquera la balance
essaie de peser Hannibal et tu t’apercevras
de ce qui est resté d’un grand général.
Et pourtant l’Afrique ne lui suffisait pas
de la mer océane jusqu’à l’Égypte
Samnites et Sicules, Lucaniens et Bruces
il voulut atteindre aussi l’Espagne
chevaucher il sut les Pyrénées
briser des roches, désagréger des montagnes
il entra au nombre des demi-dieux.
Mais aujourd’hui essaie de peser Hannibal
maintenant qu’il n’est plus que cendres
et dis-moi combien de grammes marquera la balance
essaie de peser Hannibal et tu t’apercevras
de ce qui est resté d’un grand général.
S’il tenait déjà l’Italie sous lui
cette condition ne lui suffisait pas
il voulait arriver jusqu’au Tibre
dans une pénétration acrobatique.
Même s’il avait un œil inutile
il terrorisait les riches et les plébéiens
en chevauchant sur un éléphant
il s’en allait en chasse de trophées.
Mais aujourd’hui essaie de peser Hannibal
maintenant qu’il n’est plus que cendres
et dis-moi combien de grammes marquera la balance
essaie de peser Hannibal et tu t’apercevras
de ce qui est resté d’un grand général.
Essaie de peser Hannibal maintenant qu’il n’est plus que cendres.
et dis-moi combien de grammes marquera la balance
essaie de peser Hannibal et tu t’apercevras
de ce qui est resté d’un grand général.
La référence à Hannibal (247-183 av.J.C.) est présente dans plusieurs chansons. Ce fut un des plus grands ennemis de Rome, qu’il aurait pu détruire : c’est l’occasion de citer plusieurs peuples préromains, les Samnites, les Lucaniens, les Bruttiens, les Sicules. Pour rejoindre l’Italie, il passa par l’Espagne, déjà en partie reconquise par son frère Hasdrubal (245-207 av.J.C.), et la légende racontée par Tite-Live (55 av.J.C-17 ap.J.C.) disait que pour passer les montagnes des Pyrénées, il brûla d’immenses forêts, puis fit répandre du vinaigre sur les tisons ardents pour faire éclater les rochers. Dans le texte latin, il voulait arriver non jusqu’au lac Trasimène, au nord de Rome, mais jusqu’à la Suburra, le quartier populaire de Rome, donc prendre la ville elle-même, à l’aide de ses éléphants. Mais que reste-t-il de ce « demi-dieu », de ce chasseur acrobatique de trophées ? : tu verras que de lui non plus il ne reste rien aujourd’hui, il n’est plus que cendres et il ne pèse plus rien.
Le groupe napolitain Almamegretta (Anime migranti), formé en 1988, a écrit en 1993 une chanson provocatrice sur l’arrivée et la présence d’Hannibal, « grand général noir » : les Afro-américains restèrent peu de temps en Europe à la fin de la seconde guerre mondiale et ils ont laissé une quantité d’enfants noirs, alors imaginez combien a pu en laisser Hannibal durant ses 15 ans de vie en Italie du Sud. Nous avons tous un peu de sang carthaginois dans les veines, nous sommes tous fils d’Hannibal.
FIGLI DI ANNIBALE
Annibale grande generale nero
Con una schiera di elefanti attraversasti le Alpi
e ne uscisti tutto intero.
A quei tempi gli Europei non riuscivano
neanche a piedi.
Ma tu Annibale grande generale nero,
tu le passasti con un mare di elefanti.
Lo sapete quanto sono grossi e lenti gli elefanti ?
Eppure Annibale gli fece passare le Alpi
con novantamila uomini africani.
Annibale sconfisse i Romani restò in Italia
da padrone per quindici o vent’anni.
Ecco perché molti Italiani hanno la pelle scura
Ecco perché molti Italiani hanno i capelli scuri
Un po’ del sangue di Annibale è rimasto
a tutti quanti nelle vene sì è rimasto
a tutti quanti nelle vene.
Nessuno può dirmi : stai dicendo una menzogna
No, se conosci la tua storia
sai da dove viene il colore del sangue
Che ti scorre nelle vene.
Durante la guerra pochi afroamericani
riempirono l’Europa di bambini neri
Cosa credete potessero mai fare
in venti anni di dominio militare
Un’armata di Africani in Italia meridionale
un’ armata di Africani in Italia meridionale
Ecco perché ecco perché noi siamo figli di Annibale
Meridionali figli di Annibale
sangue mediterraneo figli di Annibale.
FILS D’HANNIBAL
Hannibal, grand général noir
Avec une troupe d’éléphants tu traversas les Alpes
et tu en sortis tout entier.
En ce temps-là les Européens n’arrivaient pas
même à pied.
Mais toi Hannibal, grand général noir,
tu les traversa avec une mer d’éléphants.
Vous savez comme ils sont gros et lents les éléphants ?
Et pourtant Hannibal leur a fait traverser les Alpes
avec quatre-vingt dix mille hommes africains.
Hannibal a vaincu les Romains, il est resté en Italie
en maître pendant quinze ou vingt ans.
Voilà pourquoi beaucoup d’Italiens ont la peau sombre
Voilà pourquoi beaucoup d’Italiens ont les cheveux sombres
Un peu de sang d’Hannibal est resté
à nous tous, oui, il est resté
à nous tous dans nos veines.
Personne ne peut me dire : tu es en train de dire un mensonge
Non, si tu connais ton histoire
tu sais d’où vient la couleur du sang
Qui court dans tes veines.
Pendant la guerre, un petit nombre d’afroaméricains
ont rempli l’Europe d’enfants noirs
Que croyez-vous donc qu’a pu faire
en vingt ans de domination militaire
Une armée d’Africains en Italie du Sud
une armée d’Africains en Italie du Sud
Voilà pourquoi nous sommes des enfants d’Hannibal
Des méridionaux enfants d’Hannibal
De sang méditerranéen, enfants d’Hannibal.
Un autre élément mis en valeur est la division de la société en classes et la domination de la classe des maîtres sur les classes de tous ceux qui en dépendaient, esclaves, femmes, clients, etc. ; les riches se sentaient supérieurs aux pauvres, les méprisaient et les exploitaient au maximum, dès la Monarchie des premiers siècles de la ville ; et Juvénal écrit une satire terrible contre ceux qui ont une table d’ivoire et veulent la montrer, mais chez qui on mange si mal (Il tavolo d’avorio). Savona a écrit un texte nouveau qui cite ou résume diverses parties de la Satire XI de Juvénal.
Il tavolo d’avorio
Se vai nelle case ricche la cena non sa di niente
il pesce non sa di niente la carne non sa di niente
persino profumi e fiori emanano solo puzza
se non ci si siede tutti a un tavolo d’avorio
Un tavolo d’avorio su un leopardo d’avorio
con la bocca spalancata una bocca smisurata
un tavolo comprato alle porte d’Egitto
bel tavolo elegante fatto con denti d’elefante.
A me che non ho d’avorio nemmeno pedine e dadi
mi manici di coltelli son d’osso persino quelli
non è capitato mai di avere pietanze marce
per me non è mai un disastro il sapore di un pollastro.
Non ho il tavolo d’avorio su un leopardo d’avorio
Un tavolo d’avorio …. la bocca spalancata una bocca smisurata
non ho il tavolo comprato alle porte d’Egitto
un bel tavolo elegante fatto con denti d’elefante.
Mi manca persino un servo che squarti montoni e lepri
che squarti manzi e maiali con tecniche speciali
però quando mangio io nell’aria senti un profumo
profumo che si afferra per tutta la Suburra.
Non ho il tavolo d’avorio su un leopardo d’avorio
con la bocca spalancata una bocca smisurata
non ho il tavolo comprato alle porte d’Egitto
un bel tavolo elegante fatto con denti d’elefante.
Non ho il tavolo d’avorio su un leopardo d’avorio
con la bocca spalancata una bocca smisurata
non ho il tavolo comprato alle porte d’Egitto
un bel tavolo elegante fatto con denti d’elefante.
La table d’ivoire
Si tu vas dans les maisons riches, cela n’a pas de goût
le poisson n’a pas de goût, la viande n’a pas de goût
même les parfums et les fleurs n’émanent que puanteur
si on ne s‘asseoit pas tous à une table d’ivoire
Une table d’ivoire sur un léopard d’ivoire
la bouche grande ouverte, bouche démesurée
une table achetée près des portes d’Égypte
belle table élégante faite de dents d’éléphant.
Moi qui n’ai en ivoire pas un pion, pas un dé
ni manches de couteaux, même ceux-ci sont en os,
jamais il ne m’arrive d’avoir des plats moisis.
pour moi n’est pas un désastre la saveur d’un poulet.
Je n’ai pas la table d’ivoire sur un léopard d’ivoire
Une table d’ivoire …. la bouche grande ouverte, bouche démesurée
je n’ai pas la table achetée près des portes d’Égypte
une belle table élégante faite de dents d’éléphant.
Il me manque même un serviteur qui découpe moutons et lièvres
qui découpe bœufs et cochons avec des techniques spéciales
pourtant quand moi je mange je sens dans l’air un parfum
un parfum qui saisit toute la Suburra.
Je n’ai pas la table d’ivoire sur un léopard d’ivoire
la bouche grande ouverte, bouche démesurée
je n’ai pas la table achetée près des portes d’Égypte
une belle table élégante faite de dents d’éléphant.
Je n’ai pas la table d’ivoire sur un léopard d’ivoire
la bouche grande ouverte, bouche démesurée
je n’ai pas la table achetée près des portes d’Égypte
une belle table élégante faite de dents d’éléphant.
Juvénal reproche ici aux riches patriciens de gaspiller leur fortune dans des banquets somptueux pour montrer leur opulence, et ils font installer chez eux des tables coûteuses faites de produits importés d’Égypte, mais le menu est mauvais, n’a aucun goût ; tandis que lui, dont les couteaux n’ont que des manches d’os, il mange modestement du poulet, mais il est bon et quand il mange, on sent chez lui un parfum de « Suburra » : c’était le quartier le plus populaire de Rome.
C’est absurde de se comporter ainsi, disent les poètes, car de toute façon, nous mourrons tous, les riches comme les pauvres, nous serons tous sous terre, et les pleurs des autres ne rouvriront pas les portes de nos tombeaux (È inutile piangere, Ragiona amico mio). Gaius Titius souligne l’incompétence et l’inutilité des magistrats qui font semblant de juger tandis qu’ils se remplissent la panse de bon vin et qu’ils vont uriner au lieu d’écouter les plaignants (I magistrati) ; et Gaius Lucillus se moque de la mode « grecque » qui gagne les riches
Anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano
Anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano
Tu hai sempre voluto
esser chiamato greco
anche se sei romano
anche se sei sabino.
Anche se sei compaesano
di Ponzio e di Tritano
anche se sei compaesano
di Ponzio e di Tritano
Quindi quando t'incontro
se ti saluto in greco
tutta quanta la gente
dice « xaire » in greco.
Anche se sei compaesano
di Ponzio e di Tritano
anche se sei compaesano
di Ponzio e di Tritano
Questa tua malattia
detta esterofilia
ti ha reso poco a poco
il mio più gran nemico.
Anche se sei compaesano
di Ponzio e di Tritano
anche se sei compaesano
di Ponzio e di Tritano.
Même si tu es compatriote de Ponzio et de Tritano
Tu as toujours voulu
être appelé grec
même si tu es romain
même si tu es sabin.
Même si tu es compatriote
de Ponzio et de Tritano
même si tu es compatriote
de Ponzio et de Tritano
Donc quand je te rencontre
je te salue en grec
tous les gens
disent « xaire » en grec.
Cette ta maladie
dite estérophilie
t'a rendu peu à peu
mon plus grand ennemi.
Même si tu es compatriote
de Ponzio et de Tritano
même si tu es compatriote
de Ponzio et de Tritano.
Lucillus reprend un thème très important, les rapports entre Rome et la Grèce. La présence romaine fut effective en Grèce dès le IIIe siècle av.J.C., puis les Romains conquirent la Macédoine et en 146 av.J.C., la péninsule devint protectorat romain, ainsi que les îles de la mer Égée en 133 av.J.C. ; Lucius Cornelius Sylla (138-78 av.J.C.) écrase les dernières cités révoltées, et la Grèce devint possession romaine, tout en gardant une relative indépendance. Mais la littérature et la culture grecques exercèrent une influence fondamentale sur Rome et la mode de l’hellénisme se développa chez les riches, créant une sorte de snobisme, critiqué ici : même qui était romain ou sabin, même qui s’appelait Ponzio ou Tritano, noms clairement romains, voulait être pris pour un grec, et on lui disait « xaire », forme grecque de « salve » (salut) pour le saluer.
Au fond, la seule chose agréable de la vie, c’est l’amour, et Savona nous gratifie de deux poésies d’Ovide, Corinna, dont il arrange un peu le texte latin, mais en respectant parfaitement son sens, et Donne credetemi, qui est un résumé du Livre III de l’Art d’aimer, où Ovide explique aux femmes comment se comporter, quelles positions choisir quand elles reçoivent leur amant, selon la forme, les qualités ou les défauts de leur corps, de leur visage, de leurs flancs ou de leurs seins, et puis il leur conseille de toujours feindre le plaisir, de ne jamais ouvrir grand les fenêtres et de ne jamais demander à leur amant un cadeau de trop grand prix … une recette pour le plus profond plaisir d’amour ! Savona a été encore plus inventif qu’Ovide pour chanter cette Corinne qui suscita une passion chez le jeune poète latin, sans que l’on sache pourtant s’il s’agissait d’une fantaisie littéraire ou d’une femme réelle, une sorte d’anticipation de la Laura de Pétrarque !
Corinna
Viva Corinna che arriva vestita
della sua tunica trasparente
collo coperto da bruni capelli
di fronte a lei Semiramide è niente
Strapparle di dosso la veste
credetemi fu una battaglia
voleva far la difficile
quella soave canaglia
Fingeva di far resistenza
fingeva di essere incerta
lottava divinamente
per rimanere coperta
Viva Corinna che arriva vestita
della sua tunica trasparente
collo coperto da bruni capelli
di fronte a lei Semiramide è niente
E’ chiaro che lei si batteva
col fine di essere vinta
difatti senza fatica
presto rimase discinta
Rimase davanti ai miei occhi
ed io innamorato guardavo
per quanti sforzi facessi
nessun difetto trovavo.
Viva Corinna che arriva vestita
della sua tunica trasparente
collo coperto da bruni capelli
di fronte a lei Semiramide è niente
Vi giuro non è umanamente
possibile la descrizione
non è possibile
una classificazione.
I seni eran come un invito
a farne un sapiente maneggio
le spalle e le floride braccia
chiedevano un dolce massaggio.
Viva Corinna che arriva vestita
della sua tunica trasparente
collo coperto da bruni capelli
di fronte a lei Semiramide è niente
Poi quando giunse la fine
stanchi e felici ci riposammo
e come due innamorati
favole ci raccontammo.
Vi prego se voi volete
farmi un augurio non esitate
ditemi che come questa
avrò centomila giornate.
Viva Corinna che arriva vestita
della sua tunica trasparente
collo coperto da bruni capelli
di fronte a lei Semiramide è niente
Viva Corinna Viva Corinna
Viva Corinna Viva Corinna.
Corinna
Vive Corinne qui arrive vêtue
de sa tunique transparente
cou couvert de cheveux bruns
face à elle Sémiramis n’est rien
Lui arracher son vêtement
croyez-moi, ce fut une bataille
elle voulait faire la difficile
cette douce canaille
Elle feignait de résister
elle feignait d’être incertaine
elle luttait divinement
pour rester couverte
Vive Corinne qui arrive vêtue
de sa tunique transparente
cou couvert de cheveux bruns
face à elle Sémiramis n’est rien
Il est clair qu’elle se battait
dans le but d’être vaincue
de fait sans peine
elle fut bientôt déshabillée
Elle resta devant mes yeux
et moi amoureux je regardais
malgré tous mes efforts
je ne trouvais aucun défaut.
Vive Corinne qui arrive vêtue
de sa tunique transparente
cou couvert de cheveux bruns
face à elle Sémiramis n’est rien
Je vous jure qu’il n’est pas humainement
possible de la décrire
il n’est pas possible
une classification.
Ses seins étaient comme une invite
à en faire un savant maniement
ses épaules et ses bras bien en chair
demandaient un doux massage.
Vive Corinne qui arrive vêtue
de sa tunique transparente
cou couvert de cheveux bruns
face à elle Sémiramis n’est rien
Puis quand arriva la fin
fatigués et heureux, nous nous reposâmes
et comme deux amoureux
des fables nous nous racontâmes.
Je vous en prie si vous voulez
me faire un souhait n’hésitez pas
dites-moi que comme celle-ci
j’aurai cent mille journées.
Vive Corinne qui arrive vêtue
de sa tunique transparente
cou couvert de cheveux bruns
face à elle Sémiramis n’est rien
Vive Corinne Vive Corinne
Vive Corinne Vive Corinne.
Franco Battiato a écrit aussi une belle chanson sur la haine de Rome pour Carthage, à partir d’un texte de Properce traduit par le Professeur Angelo Arioli ; on souligne à propos de ce texte l’antimilitarisme fréquent chez les poètes classiques de l’âge d’Auguste, même quand ils appartenaient au cercle de Mécène, l’ami d’Auguste.
Texte original d’Ovide
Ecce, Corinna venit, tunica velata recincta, candida dividua colla tegente coma— qualiter in thalamos famosa Semiramis isse dicitur, et multis Lais amata viris.
Deripui tunicam—nec multum rara nocebat ; pugnabat tunica sed tamen illa tegi.
quae cum ita pugnaret, tamquam quae vincere nollet victa est non aegre proditione sua.
ut stetit ante oculos posito velamine nostros, in toto nusquam corpore menda fuit.
quos umeros, quales vidi tetigique lacertos ! forma papillarum quam fuit apta premi !
quam castigato planus sub pectore venter ! quantum et quale latus! quam iuvenale femur!
Singula quid referam ? nil non laudabile vidi et nudam pressi corpus ad usque meum.
Cetera quis nescit ? lassi requievimus ambo. proveniant medii sic mihi saepe dies !
Traduction d’Olivier Sers, Ovide, De l’amour (Les Belles Lettres, 2016, p. 43)
Corinne vint voilée, la tunique flottante, Cheveux pendants couvrant son cou d’albâtre,
Telle Sémiramis marchant au lit nuptial, telle Laïs que tant d’hommes aimèrent.
J’arrachai sa tunique, obstacle au vrai diaphane, Elle luttait, voulait rester vêtue,
Luttait mais non comme une femme qui veut vaincre, Et je vainquis sans peine grâce à elle.
Lorsqu’elle se dressa face à moi sans nul voile Je vis un corps en tous points sans défauts.
Quels bras je vis, touchai ! Les superbes épaules ! Que ses beaux seins s’offraient bien aux caresses !
Quel ventre lisse et plat sous sa ferme poitrine ! La jeune cuisse ! Et que de hanche, et quelle cuisse !
À quoi bon détailler ? Rien qui ne fût louable ! Elle était nue, je la serrai sur moi,
On devine le reste, enfin, las, nous dormîmes, Puissent souvent nos siestes être telles !
Delenda Carthago
Per terre ignote vanno le nostre legioni
a fondare colonie a immagine di Roma
«Delenda Carthago»
con le dita colorate di henna su patrizi triclini
si gustano carni speziate d’aromi d’Oriente;
in calici finemente screziati frusciano i vini,
le rose, il miele.
Nei circhi e negli stadi
s’ammassano turbe stravolte
a celebrare riti di sangue.
«....per ammassare ricchezze,
sei tu, denaro, la causa di una vita agitata!
a causa tua prendiamo prima del tempo la strada
della morte;
ai vizi degli uomini fornisci dei crudeli pascoli,
dalla tua testa germogliano i semi degli affanni.»
Delenda Carthago
Sur des terres inconnues vont nos légions
fonder des colonies à l’image de Rome
«Delenda Carthago»
les doigts colorés de henné sur des tricliniums patriciens
on déguste des viandes épicées d’arômes d’Orient ;
dans des calices finement bigarrés bruissent les vins,
les roses, le miel.
Dans les cirques et dans les stades
s’amassent des foules dénaturées
pour célébrer des rites de sang.
«....pour amasser des richesses,
c’est toi, argent, la cause d’une vie agitée !
à cause de toi, nous prenons trop tôt la route
de la mort ;
aux vices des hommes tu fournis de cruels pâturages,
de ta tête germent les semis des malheurs.»
Un autre intérêt de la vie romaine était dans les bains
Un autre intérêt de la vie romaine était dans les bains qui étaient quotidiens pour les Romains. Seuls les riches avaient des bains privés dans leur villa ; pour les autres avaient été créés des quantités de bains publics, les « thermes » : le recensement d’Agrippa (63-12 av.J.C.) de 33 av.J.C. en comptait 170, et plus tard Pline l’Ancien (23-79) a renoncé à les compter ; ils étaient peu chers et parfois gratuits ; les femmes y étaient admises soit dans des bains ou à des heures différentes, soit en commun avec les autres, ce qui provoqua des scandales, l’époque ne connaissant pas le « maillot de bain », on se baignait nus ; mais le coût était souvent double pour les femmes. L’intérêt des Thermes était non seulement le bain, mais aussi les sports, la culture (il y avait souvent des bibliothèques, des expositions de statues, etc.), la promenade, les rencontres sur les portiques. Un des jeux très en vogue était celui de la balle qu’évoque la chanson ; les horaires étaient réglementés par les édiles publics, et la « troisième heure » était souvent celle (moins chaude) où on commençait à pratiquer les jeux. Les Thermes les plus célèbres parmi ceux qui nous restent sont ceux dits de Caracalla, construits au début du IIIe s. apr.J.C., d’une magnificence extraordinaire. Les Thermes sont souvent considérés comme un des plus grands bienfaits apportés au peuple par l’Empire Romain. Le personnage dit ne pas savoir qui est Caracalla (180-217) ; il sait par contre l’importance de ces thermes ; mais y eut-il des poissons dans les piscines ?
ALLE TERME DI CARACALLA
Tutta la storia romana
vicina e lontana, mi par di sognar.
E fra i ruderi che son lì da millenni
la notte e il dì, mi rimetto a fantasticare così.
Alle Terme di Caracalla
i romani giocavano a palla,
dopo il bagno verso le tre
tira, tira a me, che la tiro a te,
o con le mani o coi piè.
Alle Terme di Caracalla
forse i pesci venivano a galla,
ogni notte verso le tre
tira, tira a me, che la tiro a te,
poi si pescavan da se.
Poi ripenso agli Orazi e Curiazi,
ai guerrieri che non ci son più,
a Poppea, a Nerone, ai Patrizi,
ma non so Caracalla chi fu.
Alle Terme di Caracalla
i romani giocavano a palla,
dopo il bagno verso le tre
tira, tira a me, che la tiro a te,
e poi gridavan: Olè!
Dopo il bagno verso le tre
tira, tira a me, che la tiro a te,
Ogni notte verso le tre
tira, tira a me, che la tiro a te.
Oggigiorno però a Caracalla:
«Una furtiva lacrima»
nella notte si sente cantar.
«Una voce poco fa»
come un eco risponde alla folla.
«Chi mi prega in tal momento»
Caracalla si mette a gridar.
Alle Terme di Caracalla,
alla notte la luna è già bella,
al ritorno cantiamo insiem
caro, caro ben, caro, caro ben,
sempre felici sarem.
Sempre felici sarem. Olè!
Aux Thermes de Caracalla
Toute l’histoire romaine
proche ou lointaine, il me semble rêver.
Et dans les ruines qui sont là depuis des siècles
la nuit et le jour, je me remets à fantasmer ainsi.
Aux Thermes de Caracalla
les Romains jouaient à la balle,
après le bain vers trois heures
tire, tire vers moi, et je la tire vers toi,
ou avec les mains ou avec les pieds.
Aux Thermes de Caracalla
peut-être que les poissons venaient à la surface,
toutes les nuits vers trois heures
tire, tire vers moi, et je la tire vers toi,
puis ils se pêchaient eux-mêmes.
Puis je repense aux Horaces et aux Curiaces,
aux guerriers qui ne sont plus là,
à Poppée, à Néron, aux Patriciens,
mais Caracalla, je ne sais pas qui c’était.
Aux Thermes de Caracalla
les Romains jouaient à la balle,
après le bain vers trois heures
tire, tire vers moi, et je la tire vers toi,
et puis ils criaient : Holé !
Après le bain vers trois heures
tire, tire vers moi, et je la tire vers toi,
Toutes les nuits vers trois heures
tire, tire vers moi, et je la tire vers toi.
Au jour d’aujourd’hui pourtant à Caracalla :
«Une furtive larme»
J’entends chanter dans la nuit.
«Une voix il y a peu de temps»
comme un écho répond à la foule.
«Qui me prie dans un tel moment»
Caracalla se met à crier.
Aux Thermes de Caracalla,
à la nuit la lune est déjà belle,
au retour nous chantons ensemble
cher, cher amour, cher, cher amour,
nous serons toujours heureux.
Toujours heureux nous serons. Holé !
«Una furtiva lacrima» est un chant de Gaetano Donizetti (1797-1848) dans l’Elisir d’amore (1832) ; «Una voce poco fa» est de Rossini (1792-1868) dans Le barbier de Séville (1815). Donizetti a écrit dans Lucia di Lammermoor (1835) une réplique d’Edoardo, «Chi me frena in tal momento?». L’auteur de la chanson a mal cité. Ce qui est sûr, c’est que les Thermes de Caracalla sont toujours un des lieux où l’Opéra de Rome a longtemps donné des représentations splendides.
Les jeux étaient enfin une des attractions principales de la vie populaire romaine ; c’était pour les empereurs et les patriciens un moyen de distraire le peuple par des divertissements généralement cruels, combats de gladiateurs qui se terminaient souvent par la mort de l’un des deux, assassinats de condamnés (chrétiens ou autres) par des bêtes féroces affamées préalablement, chasses dans les amphithéâtres, etc. Capossela (1965- ) en fait une description ironique atroce, mais il pense aussi aux jeux d’aujourd’hui, la « legge della curva » dans les matchs de football : « panem et circenses » hier et aujourd’hui ; l’arrangement ne s’appuie que sur les cors et les timbales. Le père de Capossela était un passionné du film Quo Vadis. L’expression « Hoc habet hoc » (il l’a eu) était le cri de la foule avant que l’empereur ne décide du sort du gladiateur battu pour savoir si l’autre devait l’achever (pouce vers le bas) ou le grâcier (pouce vers le haut).
AL COLOSSEO
Sia sbranato al colosseo
Sia spellato al colosseo
Sia scannato al colosseo
Sia squartato al colosseo
Sia incornato al colosseo
Sia sbudellato al colosseo
Sia disossato al colosseo
In fricassea
Sia servito in fricassea
Riceva il ferro al colosseo
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
La legge della curva...
la legge della curvaaa...
Two Rome are fallen
Si assassinin gli assassini al colosseo
Sian sventrati gli innocenti al colosseo
I neonati sian soldati al colosseo
Il Senato sia scuoiato al colosseo
Si divorino le fiere al colosseo
Chi ha predicato sia impalato al colosseo
Al colosseo
Chi ha taciuto
Sia mietuto
Al colosseo
Sia bevuto
Dalla rena al colosseo
Sia crocifisso
Al colosseo
Sia disunghiato al colosseo
In naumachia sia affogato
in naumachia
In allegria
Riceva il ferro al colosseo
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
Sia fracassato al colosseo
Lo si bruci al colosseo
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
A gran spadate al colosseo
Sia fatto a brani al colosseo
La folla salti in aria al colosseo
A brano a brano al colosseo
Hoc habet hoc Hoc habet Hoc
Finchè non arrivino i barbari
Finchè non arrivino i barbari
Hoc habet hoc
Hoc habet Hoc
La legge della curvaa...
la legge della curvaaa
Finchè non arrivino i tartari
Finchè non arrivino i tartari
Al colosseo !
Au Colisée
Qu’il soit mis en pièces au Colisée
Qu’il soit écorché au Colisée
Qu’il soit égorgé au Colisée
Qu’il soit massacré au Colisée
Qu’il soit encorné au Colisée
Qu’il soit étripé au Colisée
Qu’il soit désossé au Colisée
En fricassée
Qu’il soit servi en fricassée
Qu’il reçoive le fer au Colisée
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
La loi de la courbe...
la loi de la courbeaa...
Two Rome are fallen
Que soient assassinés les assassins au Colisée
Que soient éventrés les innocents au Colisée
Que les nouveaux-nés soient soldats au Colisée
Que le Sénat soit écorché au Colisée
Que l’on dévore les bêtes au Colisée
Que celui qui a prêché soit empalé au Colisée
Au Colisée
Que celui qui s’est tu
Soit moissonné
Au Colisée
Qu’il soit bu
Par le sable du Colisée
Qu’il soit crucifié
Au Colisée
Qu’on lui arrache les ongles au Colisée
Dans une naumachie, qu’il soit noyé,
dans une naumachie
Dans la joie
Qu’il reçoive le fer au Colisée
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
Qu’il soit fracassé au Colisée
Qu’on le brûle au Colisée
Hoc habet hoc habet hoc
Hoc habet Hoc habet hoc
À grands coups d’épée au Colisée
Qu’il soit mis en morceaux au Colisée
Que la foule saute en l’air au Colisée
Morceau par morceau au Colisée
Hoc habet hoc Hoc habet Hoc
Jusqu’à ce qu’arrivent les barbares
Jusqu’à ce qu’arrivent les barbares
Hoc habet hoc
Hoc habet Hoc
La loi de la courbe...
la loi de la courbe...
Jusqu’à ce qu’arrivent les tartares
Jusqu’à ce qu’arrivent les tartares
Au Colisée !
L’ère romaine s’achève en 476 après J.C., avec la mort du dernier empereur romain d’Occident, Romulus Augustulus (461-476). Selon la tradition, elle avait commencé en 753 (754 ?) av.J.G. avec le règne de sept rois (mais de 753 à 509, en presque 250 ans, ils ont obligatoirement été plus nombreux) : la République remplace la Monarchie en 509 av.J.C., pour laisser place à l’Empire avec Jules César (100-44 av.J.C.) et Octave Auguste (63 av.J.C.- 14 apr.J.C.), de 27 av.J.C. à 476 apr.J.C., puis jusqu’en 1453 pour l’empire romain d’Orient à Constantinople.
III. L’Ancien Testament et l’histoire de Jésus dans la chanson
Genesi
L’histoire à partir de la vie du Christ est évidemment le sujet privilégié de la chanson chrétienne et de la liturgie. La chanson populaire est surtout fascinée par la vie de la Vierge et du Christ, par la Passion de ce dernier et par la vie des saints, nous y reviendrons plus loin. La chanson liturgique populaire a moins souvent pris l’Ancien Testament pour thème. Par contre il y a quelques textes de cantautori, comme la Genesi de Francesco Guccini (1940- ).
Genesi
Una canzone molto più... più seria e più impegnata,
oserei dire impegnatissima, una canzone che mi è stata
ispirata, a me succede poche volte, però questa
canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto.
Ero lì, nel mio candido lettino... e ho sentito una
voce che diceva « Francesco », dico « socc..., chi è ? »...
dico « eh ? », diceeeeee « svegliati sono il tuo Dio ».
E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di,
di... fare un'opera musicale colossale e mettere in musica
l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto
la Genesi ... che è la vera storia della creazione del mondo...
Per capire la nostra storia
bisogna farsi ad un tempo remoto :
c'era un vecchio con la barba bianca,
lui, la sua barba, ed il resto era vuoto.
Voi capirete che in tale frangente
quel vecchio solo lassù si annoiava,
si aggiunga a questo che, inspiegabilmente,
nessuno aveva la T.V. inventata ...
Beh, poco male, pensò il vecchio un giorno,
a questo affare ci penserò io :
sembra impossibile, ma in roba del genere,
modestia a parte, ci so far da Dio ! »
« Dixit », ma poi toccò un filo scoperto,
prese la scossa, ci fu un gran boato :
come T.V. non valeva un bel niente,
ma l'Universo era stato creato ...
« Come son bravo che, a tempo perso,
ti ho creato l'Universo !
Non mi sembra per niente male,
sono davvero un tipo geniale !
Zitto, Lucifero, non disturbare
non stare sempre qui a criticare !
Beh sì, lo ammetto, sarà un po' buio,
ma non dir più che non si vede un tubo ! ».
« Che sono parolacce che non sopporto ! »,
disse il vecchio a Lucifero.
« E poi se c'è una cosa
e un'altra che non posso sopportare sono i criticoni :
fattelo te l'Universo se sei capace !
Che me at dig un quel... »
Era d'antica origine modenese da parte
di madre il ve...
« Io parlo chiaro: pane al pane,
vino al vino, anzi vin santo al vin santo.
Sono buono
bravo, ma se mi prendono i cinque secoli
me at sbat a l'infern, com'è vero Dio ! »
Ma poi volando sull'acqua stagnante
e sopra i mari di quell'Universo,
mentre pensava se stesso pensantin
mezzo a quel buio si sentì un po' perso.
Sbattè le gambe su un mucchio di ghiaia
dopo una tragica caduta in mare,
il colpo gli fece persino un po' male ...
quando andò a sbattere sull'Himalaya
Fece crollare anche un gran continente
soltanto urtandolo un poco col piede :
si consolò che non c'era ancor gente
e che non gli era venuto poi bene.
Ma quando il buio gli fece impressione,
disse, facendosi in viso un po' truce :
« diavol d'un angelo, avevi ragione !
Si chiami l'Enel, sia fatta la luce ! »
Commutatori, trasformatori,
dighe idroelettriche e isolatori,
turbine, dinamo e transistori
per mille impianti di riflettori
albe ed aurore fin boreali,
giorni e tramonti fin tropicali.
« Fate mo' bene che non bado a spese,
tanto ho lo sconto alla fine del mese... ».
« Te Lucifero non ti devi interessare come faccio ad avere
io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione,
una mano lava l'altra, come si dice ; vuoi che uno
nella mia posizione non conosca nessuno ? Però intanto,
ragazzi, andateci piano perché la bolletta
la portano a me.
M'avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, sei mesi,
no, sei mesi ! Grazie, c'era freddo, i surgelati
li debbo pur tenere da qualche parte !
Adesso la tenete spenta sei mesi come ...
e poi quei ragazzi lì, come si chiamano quei ragazzini
che vanno in giro con quella cosa ? Aureola si chiama ?
No no, am pies menga, no no no, ragazzi quelle cose lì,
io vi invento il peccato di superbia e vi frego tutti eh,
adesso ve lo dico, bisogna guadagnarsele...
a parte il fatto che non mi adorate abbastanza...
no no no Lucifero, è inutile che tu mi chiedi scusa :
adorare significa non dovere mai dire mi dispiace !
Tientelo in mente... Voi, ecco, io vi do ogni dieci atti
di adorazione vi do un buono, ogni dieci buoni
voi mandate la cartolina che il 6 gennaio ...
che poi ci ho tutta un'altra idea in testa per la...
facciamo Aureolissima che è una festa
che mi sembra molto bella. Piuttosto Lucifero,
non sgamare, vieni qua ragazzo ... Com' è,
mi hanno detto che hai stampato un libro...
il Libretto Rosso dei Pensieri di ... oh, bella roba
il libretto rosso dei pensieri di Lucifero !
Ragazzi mi spiace... ma cosa vuol dire di sinistra,
di sinistra... non sono un socialdemocratico anch'io ?
avanti al centro contro gli opposti estremismi ! ...
eh ma, ...no no no, non ci siamo mica qua :
se c'è uno che può pensare anzitutto sono io ...
e non tirare mica in ballo mio figlio, quel capellone,
con tutti i sacrifici che ho fatto ... per me
lui lì finisce male... ah me, me a tal deg ...
finisce male. E attento che te e lui, io ho
delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio !
E non guardarmi male che qui dentro « per Dio »
lo dico come e quando mi pare ! »
Ma fatta la luce ci vide più chiaro :
là nello spazio girava una palla.
Restò pensoso e gli parve un po' strano,
ma scosse il capo : chi non fa non falla.
Rise Lucifero stringendo l'occhio
quando lui e gli angeli furon da soli :
« Guarda che roba ! Si vede che è vecchio :
l'ha fatto tutto schiacciato sui poli ! ».
« Per riempire 'sto bell'ambiente
voglio metterci tante piante.
Forza, Lucifero, datti da fare,
ordina semi, concime e trattore,
voglio un giardino senza uguali,
voglio riempirlo con degli animali !
Ma cosa fa 'sto cane che ho appena creato ?
Boia d'un Giuda, m'ha morsicato ! »
« Piuttosto fallo vedere da un veterinario, che non vorrei
aver creato anche la rabbia, già così ...
cos'è che non ho creato ? Lo sapevo :
l'uomo non ho creato !
Grazie, mi fate sempre fare tutto a me,
mi tocca sempre fare ! Qua se non ci sono io
che penso a tutto ... va beh, nessuno è perfetto...
sì, lo so che sono l'Essere Perfettissimo
Creatore e Signore. Grazie ! Adesso
ti trasformo in serpente così impari, striscia mo' lì !
Viuscia via ! » E portarono al vecchio
quello che c'era rimasto ...
c'era un po' di formaggio e due scatolette di Simmenthal,
cioè lui li mise assieme e poi…
Prese un poco di argilla rossa,
fece la carne, fece le ossa,
ci sputò sopra, ci fu un gran tuono
ed è in quel modo che è nato l'uomo...
Era un venerdì 13 dell'anno zero del Paradiso !
Genèse
Une chanson beaucoup plus... plus sérieuse et plus engagée,
j'oserais dire très engagée, une chanson qui m'a été
inspirée, à moi cela n'arrive pas souvent, mais cette
chanson m'a été inspirée directement d'en-haut.
J'étais là, dans mon petit lit blanc... et j'ai entendu une
voix qui disait « Francesco », je dis « socc... qui est-ce ? »...
je dis « eh ? », elle diiiit « Réveille-toi, je suis ton Dieu ».
Et alors, comme ça, sollicité de cette façon, j'ai pensé à,
à... faire un opéra colossal et à mettre en musique
l'Ancien Testament. Pour le moment je ne suis arrivé qu'à faire
la Genèse... qui est la véritable histoire de la création du monde...
Pour comprendre notre histoire
il faut revenir à un temps lointain :
il y avait un vieux à barbe blanche,
lui, sa barbe, et le reste était vide.
Vous comprenez que dans une telle situation
ce vieux tout seul là-haut s'ennuyait,
ajoutons à cela que, inexplicablement,
personne n'avait inventé la télé...
Beuh, ce n'est pas grave, pensa un jour le vieux,
à cette affaire j'y penserai moi-même :
ça semble impossible, mais dans un truc comme ça,
modestie à part, je sais faire comme un Dieu !
« Dixit », mais ensuite il toucha un fil dénudé,
prit une secousse, il y eut un grand grondement :
comme télé, ça ne valait pas grand-chose,
mais l'univers avait été créé...
« Comme je suis bon, à temps perdu,
je t'ai créé l'univers !
Ça ne me semble vraiment pas mal,
je suis vraiment un type génial !
Silence, Lucifer, ne me dérange pas,
ne reste pas toujours là à critiquer !
Ben, oui, je l'admets, c'est un peu sombre,
mais ne dis plus qu'on n'y voit goutte ! ».
« Ce sont des gros mots que je ne supporte pas ! »,
dit le vieux à Lucifer.
« Et puis il y a une chose
et une autre que je ne peux pas supporter, ce sont les grosses
critiques :
fais-le toi-même l'univers si tu en es capable !
Je te le dis, moi, dit le vioc... »
Il était de vieille ascendance modénaise du côté
de sa mère le vioc...
« Je parle clair : il faut appeler un chat
un chat, mieux le vin santo le vin santo.
Je suis bon
et brave, mais si on me colle cinq siècles
je t'envoie en enfer, aussi vrai qu'est Dieu ! »
Mais ensuite survolant l'eau stagnante
et les mers de cet Univers,
tandis qu'il pensait à lui-même pensantin
au milieu de ce noir il se sentit un peu perdu.
Il se tapa les jambes sur un tas de graviers
après une chute tragique dans la mer,
le coup lui fit aussi un peu mal...
quand il alla taper sur l'Himalaya
Il fit même crouler un grand continent
rien qu'en le heurtant un peu avec son pied :
il se consola du fait qu'il n'y ait encore personne
et que ça n'avait pas été bien fait.
Mais quand le noir lui fit impression,
il dit, en prenant un visage un peu farouche :
« Diable d'ange, tu avais raison !
Qu'on appelle l'Enel, qu'on fasse la lumière ! »
Commutateurs, transformateurs,
barrages hydro-électriques et isolateurs,
turbines, dynamos et transistors
pour mille installations de projecteurs
aubes et aurores même boréales,
jours et crépuscules même tropicaux.
« Faites ça bien, je ne regarde pas à la dépense,
de toute façon, j'ai une réduction à la fin du mois... ».
« Toi, Lucifer, tu ne dois pas savoir comment je fais pour avoir
une réduction à la fin du mois. Mais ça veut dire quoi corruption,
une main lave l'autre, comme on dit ; veux-tu que quelqu'un
dans ma situation ne connaisse personne ? Pourtant entre temps,
les enfants, allez-y doucement parce que la facture
c'est à moi qu'on l'apporte.
Vous avez laissé la lumière allumée au pôle pendant six mois, six mois,
non, six mois ! Merci, il y avait du froid, les surgelés
je dois bien les mettre quelque part !
Maintenant vous la gardez éteinte six mois comme...
et puis ces gars-là, comment on les appelle ces gamins
qui tournent avec cette chose ? Ça s'appelle une auréole ?
Non, non, ça ne me plaît du tout, mes enfants, ces choses-là
je vais vous inventer le péché d'orgueil, et je vous coince tous, eh,
maintenant je vous le dis, il faut se les gagner...
à part le fait que vous ne m'adorez pas assez...
non, non, non Lucifer, il est inutile que tu me présentes des excuses
adorer signifie ne jamais devoir dire je regrette !
Tiens-le toi pour dit... Vous, voilà, je vous donne tous les dix actes
d'adoration je vous donne un bon, tous les dix bons
vous envoyez une carte postale comme le 6 janvier...
et puis j'ai une autre idée en tête pour la...
faisons l'Auréolissime qui est une fête
qui me semble très belle. Plutôt, Lucifer,
ne fais pas le malin, viens ici, mon garçon... Comment est-il,
on m'a dit que tu as imprimé un livre...
le Petit Livre Rouge des Pensées de... oh, c'est chouette
le petit livre rouge des pensées de Lucifer !
Les enfants, ça me déplaît... mais qu'est-ce que ça veut dire de gauche,
de gauche... ne suis-je pas social-démocrate, moi aussi ?
en avant au centre contre les extrémismes opposés !...
ah mais, ...non, non, non, nous n'y sommes pas du tout :
s'il y en a un qui peut penser, avant tout c'est moi...
et ne tirez pas dans la course mon fils, ce hippie,
avec tous les sacrifices que j'ai faits... pour moi
lui, il les achève mal... ah moi, moi à un tel deg...
ça va mal finir. Et attention que toi et lui, moi j'ai
des solutions pour vous que vous n'aimerez pas, par Dieu !
Et ne me regarde pas de travers, car ici « par Dieu »
je parle comme je veux et quand ça me semble bon ! »
Mais quand la lumière fut, il y vit plus clair :
là dans l'espace tournait une boule.
Il resta pensif et ça lui parut un peu étrange,
mais il secoua la tête : qui ne fait rien ne se trompe pas.
Lucifer rit en clignant de l'œil
quand lui et les anges furent seuls :
« Regarde quel truc ! On voit qu'il est vieux :
il l'a fait tout écrasé sur les pôles ! ».
« Pour remplir ce beau décor,
je veux y mettre des tas de plantes.
Allez, Lucifer, mets-toi au boulot,
commande des semis, de l'engrais et un tracteur,
je veux un jardin sans égal,
je veux le remplir d'animaux !
Mais que fait ce chien que je viens de créer ?
Traître de chien, il m'a mordillé ! »
« Fais-le plutôt voir par un vétérinaire, je ne voudrais pas
avoir créé aussi la rage, déjà comme ça...
Qu'est-ce que je n'ai pas encore créé ? Je le savais :
c'est l'homme que je n'ai pas créé !
Merci, vous me faites toujours tout faire à moi,
il me faut toujours faire ! Ici si je ne suis pas là
qui pense à tout... bon, personne n'est parfait...
oui, je sais que je suis l'Être très Parfait
Créateur et Seigneur. Merci ! Maintenant
je te transforme en serpent comme ça tu apprends, maintenant glisse !
Allez, ouste ! » Et ils apportèrent au vieux
ce qui était resté...
il y avait un peu de fromage et deux petites boîtes de Simmental,
c'est-à-dire il les assembla et puis...
Il prit un peu d'argile rouge,
fit la chair, fit les os,
cracha dessus, il y eut un grand coup de tonnerre
et c'est de cette façon qu'est né l'homme...
C'était un vendredi 13 de l'année zéro du Paradis !
Guccini s'est toujours déclaré agnostique, mais très intéressé par le texte de la Bible. Il écrit ici une chanson humoristique sur la création du monde par « Dieu », un Dieu qui a la forme d'un vieux paysan à barbe blanche de la région de Modène qui parle de temps en temps en dialecte et qui voudrait faire aussi de la télévision. C'est évidemment aussi une allusion à la vie contemporaine, de l'ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica, Société Nationale de l'Énergie Électrique), qui avait été créé en 1962, à la corruption, qui est déjà un sujet de débat politique ; ce Dieu est aussi l'inventeur pour les anges du concours télévisé Aureolissima, qui rappelle la création démocrate-chrétienne de Canzonissima en 1958. Dieu dialogue avec son assistant, Lucifer, qui le critique et se moque de lui, jusqu'à ce qu'il le transforme en serpent, n'est-il pas aussi l'auteur du Petit Livre Rouge, comme celui de Mao Tsé-Toung paru en 1964 ? ; et il dit que son Fils, un autre « révolutionnaire » que la gauche préférait au Père n'est qu'un hippie qui finira mal, et lui évidemment est politiquement « au centre », entre les deux « extrémismes », comme le fut la démocratie chrétienne pour tenter de conserver son pouvoir en 1968... Et l'homme est créé un vendredi 13 !
Il existe bien un CD de 7 chansons qui racontent aux enfants l'histoire de la création du monde selon la Genèse (Daniela Cologgi e Domenico Amicozzi, In principio Dio creò, CD), édité par les Sœurs Paolines, chanté par trois enfants qui veulent montrer la grandeur et la bonté de Dieu. Mais à part quelques textes religieux de ce type, il n'existe guère de chansons sur l'Ancien Testament, à l'exception de celle d'Elio e le Storie Tese (créé en 1980), Sveliatevi (sic) - Born to be Abramo, censurée après une plainte des Témoins de Jéhovah, un mois après la publication en 1990 : c'est aujourd'hui un disque difficile à trouver.
Sveliatevi - Born to be Abramo
Abramo non andare, non partire,
non lasciare la tua casa.
Cosa speri di trovar ?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente,
ti è nemica,
Dove credi di arrivar ?
Born, born, born to be Abramo,
born to be Abramo.
Andate e predicate il mio Vangelo :
parola di Jahvé.
Esci dalla tua terra,
vai dove ti mostrerò.
Parola di Jahvé.
Esci dalla tua terra
e vai dove ti mostrerò.
Le reti sulla spiaggia abbandonate
le han lasciate i pescatori.
Son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio a una domanda
sembra ai dodici portar.
Born, born, born to be Abramo,
born to be Abramo.
Quello che lasci tu lo conosci :
il tuo Signore cosa ti dà ?
Un popolo, la terra e la promessa :
parola di Jahvé.
Esci dalla tua terra,
vai dove ti mostrerò.
Parola di Jahvé.
Esci dalla tua terra
e vai dove ti mostrerò.
Parola di Jahvé, parola di Jahvé,
parola di Jahvé, parola di Jahvé.
La parola di Jahvé
è la parola di Jahvé.
Abramo non andare, non partire,
non sono mica Bhagwan,
che è appena morto.
Io sono Jahvé.
Bhagwan était le maître spirituel hindou Bhagwan Shree Rajneesh, mort en janvier 1990, peu de temps avant la publication du disque.
Réveillez-vous - Né pour être Abraham
Abraham, ne t'en va pas, ne pars pas
ne quitte pas ta maison.
Qu'est-ce que tu espères trouver ?
La route est toujours la même,
mais les gens sont différents,
ils te sont hostiles,
Où crois-tu arriver ?
Born, born, born to be Abraham,
born to be Abraham.
Allez et prêchez mon Évangile :
parole de Yahwé.
Sors de ta terre,
va où je te montrerai.
Parole de Yahwé.
Sors de ta terre
et va où je te montrerai.
Les filets sur la plage, les pêcheurs
les ont abandonnés.
Ils sont partis avec Jésus.
La foule qui chantait ses louanges est partie,
mais c'est le silence qui semble répondre
à une question des douze.
Born, born, born to be Abraham,
born to be Abraham.
Ce que tu quittes tu le connais :
ton Seigneur qu'est-ce qu'il te donne ?
Un peuple, la terre et la promesse :
parole de Yahwé.
Sors de ta terre,
va où je te montrerai.
Parole de Yahwé.
Sors de ta terre
et va où je te montrerai.
Parole de Yahwé, parole de Yahwé,
parole de Yahwé, parole de Yahwé.
La parole de Yahwé
est la parole de Yahwé.
Abraham, ne t'en va pas, ne pars pas,
je ne suis pas Bhagwan,
qui vient de mourir.
Je suis Yahwé.
Bhagwan était le maître spirituel hindou Bhagwan Shree Rajneesh, mort en janvier 1990, peu de temps avant la publication du disque.
Citons encore La torre di Babele, d'Edoardo Bennato, dans son disque de 1976. C'est une simple lecture littérale superficielle de l'histoire biblique, qui ne vise qu'à montrer l'impensable orgueil humain prêt à toutes les guerres pour montrer qu'il est supérieur aux autres animaux :
La torre di Babele
Non vi fermate
dovete costruire la vostra torre
la Torre di Babele
sempre più grande
sempre più alta e bella...
Siete o non siete i padroni della terra ? ...
Strappate tutti i segreti alla natura
Arrachez tous ses secrets à la nature
e non ci sarà più niente
che vi farà paura
sarete voi a far girare la terra
con un filo, come una trottola
dall'alto di una stella.
E quella stella sarà il quartier generale
per conquistare
quello che c'è ancora da conquistare
da quella stella
per tutto l'universo
l'uomo si spazia, per superare se stesso.
Non vi fermate
dovete costruire la vostra torre
la torre di Babele
costi quel che costi
anche guerra dopo guerra
siete o non siete i padroni della terra ? ...
Non vi fermate
dovete costruire la vostra torre
la torre di Babele
si deve fare e serve a dimostrare
che l'uomo è superiore
a ogni altro animale !...
La tour de Babel
Ne vous arrêtez pas
vous devez construire votre tour
la Tour de Babel
toujours plus grande
toujours plus haute et belle...
Êtes-vous ou n'êtes-vous pas les maîtres de la terre ? ...
Arrachez tous ses secrets à la nature
et il n'y aura plus rien
qui vous fera peur
vous serez vous à faire tourner la terre
avec un fil, comme une toupie
du haut d'une étoile.
Et cette étoile sera le quartier général
pour conquérir
ce qu'il y a encore à conquérir
de cette étoile
dans tout l'univers
l'homme plane pour se dépasser lui-même.
Ne vous arrêtez pas
vous devez construire votre tour
la tour de Babel
coûte que coûte
même guerre après guerres
êtes-vous ou n'êtes-vous pas les maîtres de la terre ? ...
Ne vous arrêtez pas
vous devez construire votre tour
la tour de Babel
il faut la faire, elle sert à démontrer
que l'homme est supérieur
à tous les autres animaux !...
C'est surtout à l'histoire de Jésus que s'intéressent les cantautori. Un des premiers fut Fabrizio De André (Gênes, 1940-1999) qui écrivit avec Gianpiero Reverberi (Gênes, 1939 - ) en 1967 Si chiamava Gesù, dans le disque Volume 1. Pour l'anarchiste et anticlérical De André, Jésus ne fut qu'un homme, un pauvre, mais un héros fragile qui voulut révolutionner le monde en répondant à la violence par le pardon, dans un amour qui le « divinise », car un tel amour est au-dessus de l'humain. De André est plein de respect et d'admiration pour Jésus, même s'il n'a pas servi à grand-chose car le monde est aussi cruel après lui qu'avant, son hostilité ne va qu'à l'institution ecclésiastique, organe politique de pouvoir et souvent d'oppression sur ceux qui le désapprouvent.
Si chiamava Gesù
Venuto da molto lontano
convertire bestie e gente
non si può dire non sia servito a niente
perché prese la terra per mano
vestito di sabbia e di bianco
alcuni lo dissero santo
per altri ebbe meno virtù
si faceva chiamare Gesù.
Non intendo cantare la gloria
né invocare la grazia o il perdono
di chi penso non fu altri che un uomo
come Dio passato alla storia.
Ma inumano è pur sempre l'amore
di chi rantola senza rancore
perdonando con l'ultima voce
chi lo uccide fra le braccia di una croce.
E per quelli che l'ebbero odiato
nel Getsemani pianse l'addio,
come per chi lo adorò come Dio
che gli disse « Sii sempre lodato »,
per chi gli portò in dono alla fine
una lacrima o una treccia di spine,
accettando ad estremo saluto
la preghiera e l'insulto e lo sputo.
E morì come tutti si muore
Come tutti cambiando colore.
Non si può dire che sia servito a molto
perché il male dalla terra non fu tolto.
Ebbe forse un po' troppe virtù,
ebbe un volto ed un nome : Gesù.
Di Maria dicono fosse il figlio
sulla croce sbiancò come un giglio.
Il s'appelait Jésus
Venu de très loin
pour convertir bêtes et gens
on ne peut pas dire qu'il n'ait servi à rien
parce qu'il prit la terre par la main
vêtu de sable et de blanc
quelques-uns dirent qu'il était saint
pour d'autres il eut moins de vertus
il se faisait appeler Jésus.
Je ne veux pas chanter la gloire
ni invoquer la grâce et le pardon
de celui dont je pense qu'il ne fut qu'un homme
comme Dieu passé à l'histoire.
Mais toujours inhumain est l'amour
de celui qui agonise sans rancœur
en pardonnant dans ses derniers mots
celui qui le tue dans les bras d'une croix.
Et pour ceux qui le haïrent
à Gethsémani il pleura son adieu,
comme pour ceux qui l'adorèrent comme Dieu
qui lui dirent : « Sois loué pour toujours »,
pour ceux qui à la fin lui portèrent en cadeau
une larme ou une couronne d'épines,
acceptant comme dernier salut
la prière et l'insulte et le crachat.
Et il mourut comme nous mourons tous
Comme tous en changeant de couleur.
On ne peut pas dire qu'il ait servi à grand-chose
parce que le mal n'a pas été supprimé de la terre.
Il eut peut-être un peu trop de vertus,
il eut un visage et un nom : Jésus.
De Marie on dit qu'il fut le fils
sur la croix, il devint blanc comme un lys.
De André reviendra plus tard sur l’histoire de Marie. Francesco De Gregori (Rome, 1951 - ) sera un autre cantautore à parler du personnage de Jésus dans son disque de 1979, Viva l’Italia qui contient la chanson Gesù bambino. C’est une prière ironique à l’enfant Jésus (sans doute les enfants comprennent-ils mieux beaucoup de choses ?) pour qu’il hâte la prochaine guerre, qu’elle soit propre, que les gens n’y participent pas et qu’elle ne laisse pas de souvenir : intéressante chanson contre la guerre sous le couvert d’une prière à Jésus, un Jésus malgré tout « acheté à crédit » et « à la dérive » !
Gesù bambino
Gesù piccino picciò Gesù bambino
fa' che venga la guerra prima che si può
fa' che sia pulita come una ferita piccina picciò
fa' che sia breve come un fiocco di neve
fa' che si porti via la mala morte e la malattia
fa' che duri poco e che sia come un gioco.
Tu che conosci la stazione e tutti quelli
che ci vanno a dormire
fagli avere un giorno l'occasione
di potere anche loro partire
partire senza biglietto, senza biglietto volare via
per essere davvero liberi non occorre la ferrovia
e fa' che piova un po' di meno
sopra quelli che non hanno l'ombrello
e fa' che dopo questa guerra il tempo sia più bello.
Gesù piccino picciò
Gesù bambino comprato a rate
chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate
perché sarebbe bello spogliarci tutti
e andare al mare
e avere sotto agli occhi, dentro al cuore
tanti giorni ancora da passare
ad ogni compleanno guardare il cielo
ed essere d'accordo
non avere più paura, la paura
soltanto un ricordo.
Gesù piccino picciò
Gesù bambino alla deriva
se questa guerra deve proprio farsi
fa' che non sia cattiva
tu che le hai viste tutte e sai che tutto
non è ancora niente
se questa guerra deve proprio farsi
fa' che non la faccia la gente
fa' che non la ricordi nessuno ...
Enfant Jésus
Petit Jésus, petit enfant Jésus
fais que la guerre vienne dès que possible
fais qu’elle soit propre comme une toute petite blessure
fais qu’elle soit courte comme un feu de neige
fais qu’elle emporte la mauvaise mort et la maladie
fais qu’elle dure peu et qu’elle soit comme un jeu.
Toi qui connais la gare et tous ceux
qui vont y dormir
fais-leur avoir un jour l’occasion
de pouvoir eux aussi partir
partir sans billet, s’envoler sans billet
pour être vraiment libres il n’y a pas besoin de chemin de fer
et fais qu’il pleuve un peu moins
sur ceux qui n’ont pas de parapluie
et fais qu’après cette guerre le temps soit meilleur.
Petit enfant Jésus
Enfant Jésus acheté à crédit
qui sait si cette guerre finira avant l’été
parce qu’il serait beau de se déshabiller tous
et d’aller à la mer
et d’avoir sous les yeux, dans le cœur
tant de jours encore à passer
à chaque anniversaire regarder le ciel
et être d’accord
n’avoir plus peur, la peur
seulement un souvenir.
Petit enfant Jésus
Enfant Jésus à la dérive
si cette guerre doit vraiment se faire
fais qu’elle ne soit pas méchante
toi qui les as toutes vues et sais que tout
n’est encore rien
si cette guerre doit vraiment se faire
fais que les gens ne la fassent
fais que personne ne s’en souvienne ...
Antonello Venditti (Rome, 1949 - ) écrit en 1974 une chanson intitulée A’Cristo (dans son disque Quando verrà Natale). Elle est en « romanesco », en dialecte de Rome, c’est un dialogue avec Jésus auquel il dit de ne pas rester à Rome parce que c’est trop dangereux et de retourner en Galilée. En réalité, plus qu’à Jésus, Venditti s’intéresse à Rome et à l’actualité de son temps (allusion à Moshé Dayan, 1915-1981, le militaire israélien de plusieurs guerres dont celle du Kippour en 1973, puis aux militaires américains, puis aux travailleurs de tous les jours). Jésus n’est qu’un prétexte pour parler de tout cela, et malgré la condamnation de la chanson pour son langage considéré comme hostile à la religion, Venditti se révélera bientôt comme un admirateur, de Rome bien sûr (il parlera de « la sainteté de la Grande Coupole »), mais aussi du pape Benoît XVI et de Padre Pio.
Fabrizio De André reprend l’histoire de Jésus, de Marie et de Joseph dans son disque de 1970, La buona novella. Il s’inspire non des évangiles canoniques (c’est-à-dire conformes aux « canons », aux règles de l’Église catholique et reconnus par la hiérarchie) fixés par les conciles ecclésiastiques qui figent des personnages mi-humains mi-divins, mais sur les évangiles apocryphes (c’est-à-dire secrets, considérés comme non authentiques par la hiérarchie catholique, mais souvent plus instructifs sur la vie de Jésus et de Marie). Après le film de Pier Paolo Pasolini de 1964, L’Évangile selon saint Matthieu, De André cherche à chanter Jésus, Marie, Joseph, le voleur crucifié sous leur aspect humain, prenant au sérieux les textes dits « apocryphes », que Marcello Craveri venait de publier chez Einaudi en 1969, mais qui étaient connus depuis le Moyen-Âge et utilisés par tous les artistes, peintres en particulier. Pourtant il choisit ce qui lui convient dans ces textes pendant ce long travail d’un an qui aboutit au disque. Travail courageux en cette année 1970, où le mouvement de révolte étudiante et ouvrière, auquel De André participait, critiqua son intérêt pour la passion de Jésus plutôt que pour les problèmes politiques contemporains. De André dira dans une interview de 1998 : « Non avevano capito – almeno la parte meno attenta di loro, la maggioranza – che La Buona Novella è un’allegoria. Paragonavo le istanze migliori e più ragionevoli del movimento sessantottino, cui io stesso ho partecipato, con quelle, molto più vaste spiritualmente, di un uomo di 1968 anni prima, che proprio per contrastare gli abusi del potere, i soprusi dell’autorità si era fatto inchiodare su una croce, in nome di una fratellanza e di un egualitarismo universali. Si chiamava Gesù di Nazaret e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Non ho voluto inoltrarmi in percorsi, in sentieri, per me difficilmente percorribili, come la metafisica o addirittura la teologia, prima di tutto perché non ci capisco niente ; in secondo luogo perché ho sempre pensato che se Dio non esistesse bisognerebbe inventarselo. Il che è esattamente quello che ha fatto l'uomo da quando ha messo i piedi sulla terra. Ho quindi preso spunto dagli evangelisti cosiddetti apocrifi. Apocrifo vuol dire falso, in effetti era gente vissuta : era viva, in carne ed ossa. Solo che la Chiesa mal sopportava, fino a qualche secolo fa, che fossero altre persone non di confessione cristiana ad occuparsi, appunto, di Gesù. Si tratta di scrittori, di storici, arabi, armeni, bizantini, greci, che nell'accostarsi all'argomento, nel parlare della figura di Gesù di Nazaret, lo hanno fatto direi addirittura con deferenza, con grande rispetto. Tant'è vero che ancora oggi proprio il mondo dell'Islam continua a considerare, subito dopo Maometto, e prima ancora di Abramo, Gesù di Nazaret il più grande profeta mai esistito. Laddove invece il mondo cattolico continua a considerare Maometto qualcosa di meno di un cialtrone. E questo direi che è un punto che va a favore dell'Islam. L'Islam quello serio, non facciamoci delle idee sbagliate. » (Ils n’avaient pas compris – du moins la partie la moins attentive d’entre eux, la majorité – que La Bonne nouvelle est une allégorie. Je comparais les instances les meilleures et les plus raisonnables du mouvement de 1968, auquel j’ai moi-même participé, à celles beaucoup plus amples spirituellement d’un homme d’il y a 1968 ans, qui, précisément pour s’opposer aux abus du pouvoir, aux abus de pouvoir de l’autorité s’était fait clouer sur une croix, au nom d’une fraternité et d’un égalitarisme universels. Il s’appelait Jésus de Nazareth et selon moi il a été et il est resté le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Je n’ai pas voulu m’avancer sur des parcours, des sentiers que je ne pourrais parcourir qu’avec difficulté, comme la métaphysique ou justement la théologie, avant tout parce que je n’y comprends rien ; en second lieu parce que j’ai toujours pensé que si Dieu n’existait pas il faudrait l’inventer. Exactement ce qu’a fait l’homme depuis qu’il a mis pied sur terre. Je suis donc parti des évangiles dits apocryphes. Apocryphe veut dire faux, en effet c’étaient des gens ayant vécu : ils étaient vivants en chair et en os. Seulement l’Église supportait mal, jusqu’à il y a quelques siècles, que d’autres personnes qui n’étaient pas de confession chrétienne, s’occupent précisément de Jésus. Il s’agit d’écrivains, d’historiens, arabes, arméniens, byzantins, grecs qui, en s’approchant de la question, en parlant de la figure de Jésus de Nazareth, l’ont fait, je dirais avec déférence, avec grand respect. Tant et si bien qu’encore aujourd’hui c’est précisément le monde de l’Islam qui continue à considérer, toute de suite après Mahomet et encore avant Abraham, Jésus de Nazareth comme le plus grand prophète qui ait jamais existé. Là où au contraire le monde catholique continue à considérer Mahomet comme quelque chose de moins qu’un goujat. Et je dirais que c’est quelque chose qui parle en faveur de l’Islam. De l’Islam sérieux, n’ayons pas des idées fausses ».
En réalité Jésus n’est presque jamais nommé dans ces dix chansons, il est l’arrière-fond de toutes ; Pilate est nommé une fois, les voleurs crucifiés dans deux chansons, et les autres textes parlent de Marie et de Joseph ; seuls les septième et huitième chansons évoquent Jésus et sa crucifixion. Le disque commence par un bref Laudate Dominum de 22 secondes pour se terminer par un Laudate hominem de trois minutes vingt-six, de la louange de Dieu à la louange de l’homme, c’est le sens général du disque de De André ; et le « dominum » peut être interprété de diverses façons, comme « Seigneur » au sens religieux, ou comme « maître, pouvoir », c’est probablement ce que veut dire De André.
Laudate hominem
No, non devo pensarti figlio di Dio
ma figlio dell'uomo, fratello anche mio.
Ma figlio dell'uomo, fratello anche mio.
Laudate hominem.
Louez l'homme
Non, je ne dois pas te penser fils de Dieu
mais fils de l’homme, et aussi mon frère.
Mais fils de l’homme, et aussi mon frère.
Louez l'homme.
Car la seconde chanson, L’infanzia di Maria, empruntée au Protoévangile de Jacques, qui raconte la naissance et la jeunesse de Marie, ainsi que celle d’Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, jusqu’à l’assassinat de Zacharie par les soldats d’Hérode, est aussi l’histoire de la première victime du pouvoir, Marie, expulsée du Temple à 12 ans lorsqu’elle devient impure, c’est-à-dire quand elle a ses premières règles, et mariée contre son gré à un vieillard qui ne la désire pas, Joseph. Puis après Il ritorno di Giuseppe, stupéfait de retrouver Marie enceinte alors qu’il l’a quittée vierge, vient l’explication de Marie dans Il sogno di Maria. Joseph revient dans un décor de désert, une « étendue de sciure », évocation du métier de Joseph, mais aussi « prison sans frontières », symbole de la société injuste dans laquelle vivra Jésus (et dans laquelle nous vivons encore) et contre laquelle il va lutter ; et sa conception symbolise probablement aussi la naissance de la révolte contre cette société : la prière de l’ange annonciateur est aussi la prédiction de la naissance d’une espérance de libération. mais ce n’est pour le moment qu’un beau rêve : le mie braccia divennero ali, Mes bras devinrent des ailes corsi a vedere il colore del vento, je courus voir la couleur du vent volammo davvero sopra le case Nous avons vraiment volé au-dessus des maisons scendemmo là, dove il giorno si perde nous sommes descendus là où le jour se perd a cercarsi da solo, nascosto fra il verde. en se cherchant seul, caché dans le vert. Et Joseph ne répond que par un geste humain affectueux, ses doigts posés légèrement sur le front de Marie. La première partie du disque se termine par l’Ave Maria, hymne à toutes les femmes et à toutes les mères, « femmes un jour et puis mères pour toujours ».
La seconde partie du disque commence par Maria nella bottega d’un falegname, où, entre les commentaires des gens, Marie apprend d’un menuisier (on ne dit pas que c’est Joseph) qu’il taille trois croix dont une pour son fils :
Maria nella bottega di un falegname
«Falegname col martello
perché fai den den ?
Con la pialla su quel legno
perché fai fren fren ?
Costruisci le stampelle
per chi in guerra andò ?
Dalla Nubia sulle mani
a casa ritornò ?"
"Mio martello non colpisce,
pialla mia non taglia
per foggiare gambe nuove
a chi le offrì in battaglia,
ma tre croci, due per chi
disertò per rubare,
la più grande per chi
guerra insegnò a disertare."
"Alle tempie addormentate
di questa città
pulsa il cuore di un martello,
quando smetterà ?
Falegname, su quel legno,
quanti corpi ormai,
quanto ancora con la pialla
lo assottiglierai ?"
"Alle piaghe, alle ferite
che sul legno fai,
falegname su quei tagli
manca il sangue, ormai,
perché spieghino da soli,
con le loro voci,
quali volti sbiancheranno
sopra le tue croci."
"Questi ceppi che han portato
perché il mio sudore
li trasformi nell'immagine
di tre dolori,
vedran lacrime di Dimaco
e di Tito al ciglio
il più grande che tu guardi
abbraccerà tuo figlio".
Marie dans la boutique d'un menuisier
"Menuisier avec ton marteau
pourquoi fais-tu den den ?
Avec ton rabot sur ce bois
pourquoi fais-tu fren fren ?
Fabriques-tu des béquilles
pour ceux qui sont allés à la guerre ?
De Nubie sur les mains
à la maison sont-ils revenus ?"
"Mon marteau ne frappe pas,
mon rabot ne taille pas
pour façonner des jambes neuves
à ceux qui les ont offertes en bataille,
mais trois croix, deux pour ceux
qui ont déserté pour voler,
la plus grande pour celui
qui a enseigné à déserter la guerre."
"Aux tempes endormies
de cette ville
bat le cœur d'un marteau,
quand cessera-t-il ?
Menuisier, sur ce bois,
combien de corps désormais,
combien encore avec ton rabot
l'affineras-tu ?"
"Aux plaies, aux blessures
que tu fais sur ce bois,
menuisier, sur ces coupes
il manque le sang, désormais,
pourquoi s'expliquent-ils seuls,
avec leurs voix,
quels visages pâliront
sur tes croix."
"Ces troncs qu'ils ont portés
pour que ma sueur
les transforme en image
de trois douleurs,
ils verront des larmes de Dimac
et de Titus sur les côtés
le plus grand que tu regardes
embrassera ton fils."
La chanson suivante est Via della Croce, Chemin de croix, où apparaissent tous les personnages de la Passion de Jésus, d’abord ceux qui le haïssent, les parents des enfants innocents tués par Hérode quand il cherchait Jésus, trente ans auparavant, puis les femmes veuves, celles que les Juifs accablèrent et traitèrent en esclaves depuis le début, avant Abraham ; les disciples sont un peu lâches, pris de terreur à l’idée qu’il pourrait leur faire signe et qu’ils pourraient connaître le même supplice que lui. Les hommes de pouvoir sont là aussi, mais ils ne font qu’épier les pauvres pour s’assurer qu’ils ne se révoltent pas, et parmi ces derniers les deux voleurs qui n’ont que leur mère pour les pleurer, eux qui ne sont même pas promis à une vie éternelle comme le disent leurs mères à Marie qui, elle, a la chance d’avoir un fils qui est “fils de Dieu” (Tre madri).
Via della Croce
Poterti smembrare coi denti e le mani
sapere i tuoi occhi bevuti dai cani,
di morire in croce puoi essere grato
a un brav'uomo di nome Pilato.
Ben più della morte che oggi ti vuole,
ti uccide il veleno di queste parole
le voci dei padri di quei neonati,
da Erode, per te, trucidati.
Nel lugubre scherno degli abiti nuovi
misurano a gocce il dolore che provi :
trent'anni hanno atteso col fegato in mano,
i rantoli d'un ciarlatano.
Si muovono, curve, le vedove in testa,
per loro non è un pomeriggio di festa ;
si serran le vesti sugli occhi e sul cuore,
ma filtra dai veli il dolore.
Fedeli umiliate da un credo inumano,
che le volle schiave già prima di Abramo,
con riconoscenza ora soffron la pena
di chi perdonò a Maddalena ;
di chi con un gesto, soltanto fraterno,
una nuova indulgenza insegnò al Padreterno,
e guardano in alto, trafitte dal sole,
gli spasimi d'un redentore.
Confusi alla folla ti seguono muti,
sgomenti al pensiero che tu li saluti :
-A redimere il mondo- gli serve pensare,
il tuo sangue può certo bastare-.
La semineranno per mare e per terra
tra boschi e città, la tua buona novella,
ma questo domani, con fede migliore,
stasera è più forte il terrore.
Nessuno di loro ti grida un addio
per esser scoperto cugino di Dio :
gli apostoli han chiuso le gole alla voce,
fratello che sanguini in croce.
Han volti distesi, già inclini al perdono,
ormai che han veduto il tuo sangue di uomo
fregiarti le membra di rivoli viola,
incapace di nuocere ancora.
Il potere vestito d'umana sembianza,
ormai ti considera morto abbastanza
già volge lo sguardo a spiar le intenzioni
degli umili, degli straccioni ;
ma gli occhi dei poveri, piangono altrove,
non sono venuti a esibire un dolore
che alla via della croce
ha proibito l'ingresso
a chi ti ama come se stesso.
Son pallidi al volto, scavati al torace
non hanno la faccia di chi si compiace
dei gesti che ormai ti propone il dolore
eppure hanno un posto d'onore.
Non hanno negli occhi scintille di pena
non sono stupiti a vederti la schiena
piegata dal legno che a stento trascini
eppure ti stanno vicini.
Perdona loro se non ti lasciano solo,
se sanno morir sulla croce anche loro ;
a piangerli sotto non han che le madri,
in fondo son solo due ladri.
Chemin de Croix
Pouvoir te démembrer avec les dents et les mains
savoir tes yeux bus par des chiens,
de mourir sur la croix tu peux être reconnaissant
envers un brave homme nommé Pilate.
Bien plus encore que la mort qui te veut aujourd'hui,
c'est le venin de ces mots qui te tue
les voix des pères de ces nouveaux-nés,
massacrés par Hérode à cause de toi.
Dans le lugubre sarcasme des habits neufs
ils mesurent goutte par goutte la souffrance que tu éprouves :
trente ans ont attendu, la main sur le foie,
les râles d'un charlatan.
Ils se déplacent, courbés, les veuves en tête,
pour elles ce n'est pas un après-midi de fête ;
elles serrent leurs vêtements sur leurs yeux et leur cœur,
mais à travers leurs voiles filtre la douleur.
Fidèles humiliées par un credo inhumain,
qui les voulut esclaves déjà avant Abraham,
avec reconnaissance elles souffrent maintenant la peine
de celui qui pardonna à Madeleine ;
de celui qui d'un geste, seulement fraternel,
enseigna une nouvelle indulgence à Dieu le Père,
et elles regardent en haut, transpercées par le soleil,
les spasmes d'un rédempteur.
Confus dans la foule, ils te suivent muets,
effrayés à l'idée que tu les salues :
-Pour délivrer le monde- il leur sert de penser,
ton sang peut sûrement suffire-.
Ils la répandront sur terre et sur mer
dans les bois et les villes, ta bonne nouvelle,
mais seulement demain, avec une foi meilleure,
ce soir la terreur est plus forte.
Aucun d'eux ne te crie un adieu
pour être découvert cousin de Dieu :
les apôtres ont fermé leur gorge à leur voix,
frère, toi qui saignes sur la croix.
Ils ont des visages détendus, déjà enclins au pardon,
maintenant qu'ils ont vu ton sang d'homme
décorer tes membres de ruisseaux violets,
incapable de nuire encore.
Le pouvoir revêtu d'apparence humaine,
maintenant te considère suffisamment morte
déjà son regard se tourne pour épier les intentions
des humbles, des miséreux ;
mais les yeux des pauvres pleurent ailleurs,
ils ne sont pas venus exhiber leur douleur
qui a interdit l'entrée du chemin de la croix
à ceux qui t'aiment comme eux-mêmes.
Ils ont le visage pâle, le torse creux
ils n'ont pas le visage de quelqu'un qui se réjouit
des gestes que désormais t'arrachent la souffrance
et pourtant ils occupent une place d'honneur.
Ils n'ont pas dans leurs yeux d'étincelles de peine
ils ne sont pas étonnés de te voir le dos
plié par le bois que tu traines à grand-peine
et pourtant ce sont tes voisins.
Pardonne-leur de ne pas te laisser seul,
s'ils savent qu'ils vont mourir sur la croix eux aussi ;
à les pleurer en bas il n'y a que leurs mères,
dans le fond ce ne sont que deux voleurs.
La dernière chanson du disque de De André avant le Laudate hominem final est intitulée Il testamento di Tito, le Testament de Titus : c’est le nom d’un des deux voleurs qui seront crucifiés à droite et à gauche de Jésus, annoncé dans l’apocryphe intitulé La vie de Jésus en arabe ou L’Évangile arabe de l’enfance, Titus et Dumachus (Cf. Écrits apocryphes chrétiens, Pléiade, op. cit. p. 221). Titus énumère les dix commandements de Dieu : lui les a violés en son propre nom, mais les prêtres et les hommes de pouvoir les ont violés au nom de Dieu, c’est encore plus grave, et la preuve qu’ils ont violé le dernier « tu ne tueras point », ce sont précisément ces trois croix, qui suggèrent à Titus de dire à sa mère qu’elles ont suscité en lui l’amour de Jésus, de façon presque inattendue par rapport au reste de la chanson.
Francesco De Gregori, L’agnello di Dio, se trouve dans son disque de 1996, Prendere o lasciare. Il se réfère à l’image sacrificielle de Jésus, « l’Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde », et il décrit toutes les formes, bourreaux et victimes, sous lesquelles on le trouve aujourd’hui, la jeune prostituée slave ou africaine, le vendeur de drogue à la sortie de l’école, le soldat aux jambes fracassées après avoir tué (il a une tête entre les mains), le prisonnier, le suspect recherché qui ne sait où se cacher, celui qui a faim, le nomade perdu dans le désert :
L’agnello di Dio
Ecco l'agnello di Dio
che toglie peccati del mondo.
Disse la ragazza slava venuta allo sprofondo.
Disse la ragazza africana sul raccordo anulare.
Ecco l'agnello di Dio
che viene a pascolare.
E scende dall'automobile per contrattare.
Ecco l'agnello di Dio
all'uscita dalla scuola.
Ha gli occhi come due monete,
il sorriso come una tagliola.
Ti dice che cosa ti costa,
ti dice che cosa ti piace.
Prima ancora della tua risposta
ti dà un segno di pace.
E intanto due poliziotti
fanno finta di non vedere.
Oh, aiutami a fare come si può,
prenditi tutto quello che ho.
Insegnami le cose che ancora
non so, non so.
E dimmi quante maschere avrai
e quante maschere avrò.
Ecco l'agnello di Dio
vestito da soldato,
con le gambe fracassate,
con il naso insaguinato.
Si nasconde dentro la terra,
tra le mani ha la testa di un uomo.
Ecco l'agnello di Dio
venuto a chiedere perdono.
Si ferma ad annusare il vento
ma nel vento sente odore di piombo.
Percosso e benedetto
ai piedi di una montagna.
Chiuso dentro una prigione,
braccato per la campagna.
Nascosto dentro a un treno,
legato sopra un altare.
Ecco l'agnello che nessuno lo può salvare.
Perduto nel deserto,
che nessuno lo può trovare.
Ecco l'agnello di Dio senza un posto dove stare.
Ecco l'agnello di Dio senza un posto dove stare.
Oh, aiutami a stare dove si può
e prenditi tutto quello che ho.
Insegnami le cose che ancora non so, non so.
E dimmi quante maschere avrai,
regalami i trucchi che fai,
insegnami ad andare dovunque sarai, sarò.
E dimmi quante maschere avrò.
Se mi riconoscerai, dovunque sarò, sarai.
L’agneau de Dieu
Voilà l’agneau de Dieu
celui qui enlève les péchés du monde.
C’est ce que dit la jeune slave venue à la catastrophe.
C’est ce que dit la jeune africaine sur le boulevard de ceinture.
Voilà l’agneau de Dieu
qui vient à sa pâture.
Et descend de sa voiture pour discuter le prix.
Voilà l’agneau de Dieu
à la sortie de l’école.
Il a les yeux comme deux pièces de monnaie,
le sourire comme un piège.
Il te dit combien ça te coûte,
Il te dit qu’est-ce que tu aimes.
Avant même ta réponse
il te donne un signe de paix.
Et pendant ce temps deux policiers
font semblant de ne pas voir.
Oh, aide-moi à faire comme on peut,
prends-moi tout ce que j’ai.
Apprends-moi tout ce je ne sais pas encore,
ce que je ne sais pas.
Et dis-moi combien de masques tu auras
et combien de masques j’aurai.
Voilà l’agneau de Dieu
habillé en soldat,
les jambes fracassées,
le nez ensanglanté.
Il se cache dans la terre,
Il a une tête d’homme dans ses mains.
Voilà l’agneau de Dieu
venu demander pardon.
Il s’arrête pour sentir le vent
mais dans le vent il sent une odeur de plomb.
Frappé et bienheureux
au pied d’une montagne.
Enfermé dans une prison,
braqué à travers la campagne.
Caché dans un train,
ligoté sur un autel.
Voilà l’agneau de Dieu que personne ne peut sauver.
Perdu dans le désert,
où personne ne peut le trouver.
Voilà l’agneau de Dieu sans un lieu où aller.
Voilà l’agneau de Dieu sans un lieu où aller.
Oh, aide-moi à rester où c’est possible
et prends tout ce que j’ai.
Apprends-moi les choses que je ne sais pas, je ne sais pas.
Et dis-moi combien de masques tu auras,
fais-moi cadeau des trucs que tu fais,
apprends-moi à aller où tu seras, j’y serai.
Et dis-moi combien de masques j’aurai.
Si tu me reconnais, partout où je serai, tu seras.
De nombreux textes de chansons portent le titre de Giuda, pas toujours en rapport direct avec le personnage biblique, citons par exemple celles de Caparezza, Giuda me, le single extrait de son second album, Verità supposte, qui n’est qu’un jeu de mots à partir de « giù » (= en bas, c’est-à-dire le Sud de l’Italie) et de la préposition « da », dans cette chanson qui se moque du « cavaliere », Berlusconi. Citons encore Giuda du groupe La fame di Camilla, dans Storia di una favola, 2009, qui ne semble rien avoir en commun avec Judas. Par contre, on peut écouter la chanson de Cecco Signa, Tutta colpa di Giuda, colonne sonore du film homonyme de Davide Ferraris de 2009, histoire d’un « brigand », trafiquant de marijuana, qui se compare à Jésus, car il est là à cause d’un « judas » qui l’a dénoncé. Mais au moins deux chansons sont consacrées au Judas de la Bible, celle d’Antonello Venditti et celle de Roberto Vecchioni. La chanson de Venditti traite Judas comme « le traître absolu » et le seul à ne pas avoir obtenu de pardon, qui s’adresse à Jésus depuis l’enfer. Rien de bien nouveau. Vecchioni réévalue Judas comme le premier homme qui se sera suicidé pour faire de Jésus un « roi », « un homme à utiliser et à jeter » : il fait donc l’hypothèse que Judas a été indispensable à Jésus, il fallait qu’il le trahisse pour qu’il soit crucifié et que l’humanité soit sauvée. Serait-ce une annonce des recherches actuelles ou du roman d’Amos Oz de 2014, Judas, où Shmuel affirme que Judas est « l'auteur, l'impresario, le metteur en scène et le producteur du spectacle de la crucifixion ». Déjà L’Évangile de Judas (entre 130 et 170) faisait de la dénonciation de Jésus un acte d’obéissance nécessaire pour assurer la rédemption. Judas serait-il une victime de la nécessité ? Vecchioni procède presque à sa réhabilitation, était-il prédestiné à ce rôle ou agit-il librement ?, vieux débat théologique du christianisme ! Et Vecchioni sort lui aussi de la culture religieuse dominante, préférant chanter ce personnage obscur mais essentiel, et exprimant sa critique de Jésus qui utilise Judas pour sa réussite.
Giuda (Se non hai capito...)
È bello avere i tuoi trentatre anni
e accarezzare il capo di Giovanni
e dire a Pietro : « Queste son le chiavi
e ti perdono il monte degli Ulivi ».
Manca soltanto lui e ben gli sta
come ci insegnano si impiccherà.
Ma il primo a uccidersi
per farti re è stato quello che non salverai
se ti serviva un uomo da usare e gettar via
appeso ai nostri buoni « Così sia ».
Judas (Si tu n’as pas compris...)
C’est beau d’avoir trente ans comme toi
et de caresser la tête de Jean
et de dire à Pierre : « Voilà les clés
et je te pardonne pour le Mont des Oliviers ».
Il ne manque que lui et ça lui va bien
comme on nous l’apprend, il se pendra.
Mais le premier à se tuer
pour te faire roi a été celui que tu ne sauveras pas
et il te servait d’homme à utiliser et à jeter
pendu à nos bons « Ainsi soit-il ».
On peut écouter aussi la Maddalena du cantautore romain Alessandro Mannarino (1979- ), dans son second disque de 2011, Supersantos, où Judas est recueilli par Madeleine avant d’être emprisonné et de dénoncer Jésus comme celui qui avait apporté d’Orient de l’opium !
Virgilio Savona a raconté dans une chanson une scène de martyre, Il proconsole Dione e il fante Massimiliano. Le “signe” dont il parle était le drapeau symbole de chaque cohorte, porté par le “signifer” : c’était une lance avec au sommet une pointe ornamentale ou une main levée en bronze doré ou blanche décoré de ghirlandes et de disques indiquant les centuries. Cela peut être aussi le bracelet que les légionnaires avaient à la cheville portant leurs données personnelles pour qu’on puisse reconnaître leur cadavre.
L’épisode de Maximilien (274-295), né à Tebessa (Théveste) en Numidie (Algérie de l’Est), est raconté dans une Passio Sancti Massimiliani, procès-verbal de l’interrogatoire du légionnaire par le Proconsul Dion Cassius, et qui datait sa mort du 12 mars 295. Il posait tout le problème des rapports entre les Chrétiens et l’État romains : fallait-il en particulier effectuer le service militaire ? Les cas de refus n’étaient pas rares à cette époque, et le proconsul semble hésiter et faire preuve de patience, mais il ne peut laisser contester un des principes de base de l’empire. Maximilien est convaincu que le service militaire est négatif, parce qu’il comporte une violence contraire aux valeurs chrétiennes, dans ce monde romain qui ne connaît que la paix imposée par la force. Il est donc condamné non parce que “chrétien”, bien qu’on soit au temps des persécutions religieuses de Dioclétien, mais parce qu’il refuse le service militaire impérial. Maximilien est le premier objecteur de conscience de l’histoire, et pendant la guerre du Vietnam, un groupe de clercs américains hostiles à la guerre se référa à Sanctus Maximilianus.
Ceci est une histoire vraie, arrivée il y a 1670 ans à Théveste en Numidie. Elle a été tirée de documents historiques recueillis par le manuscrit « Actes sincères des premiers martyrs ».
Il proconsole Dione e il fante Massimiliano
Dione proconsole romano
fece condurre in catene al suo cospetto
il 12 di marzo del 300 d.C.
il fante Massimiliano.
Gli chiese cos’era quella storia
che gli era stata dai capi riferita,
se era una menzogna, o se era cosa vera.
Rispose Massimiliano :
« È vero, proconsole Dione,
non prendo il Segno (1), non prendo la daga :
Io, Massimiliano, sono cristiano
e non combatterò per la coorte,
Porto la pace non porto la morte ».
Dione gli disse : « Scellerato
chi ti ha condotto a questa conclusione
Se non accetti il Segno, se rifiuti la milizia
sarai decapitato.
Rinnega il gretto ciarlatano
che ti ha ispirato stupide teorie.
Avrai salva la vita e sarai riabilitato ».
Rispose Massimiliano :
« La vita, proconsole Dione,
non è nel Segno, non è nella daga :
Io, Massimiliano, sono cristiano
e accetto con amore la mia sorte
e, con amore, accetto la morte ».
Massimiliano data la risposta,
cadde in ginocchio – ed abbassò la testa.
Le proconsul Dion et le fantassin Maximilien
Dion proconsul romain
fit conduire devant lui dans les chaînes
le 12 mars 300 après Jésus-Christ
le fantassin Maximilien.
Il lui demanda ce qu’était cette histoire
qui lui avait été référée par ses chefs,
si c’était un mensonge, ou si c’était vrai.
Maximilien répondit :
« C’est vrai, proconsul Dion,
je ne prends pas le Signe (1), je ne prends pas la dague :
Moi, Maximilien, je suis chrétien
et je ne combattrai pas pour la cohorte,
Je porte la paix je ne porte pas la mort ».
Dion lui dit : « Scélérat
qui t’a conduit à cette conclusion
Si tu n’acceptes pas le Signe, si tu refuses le combat
tu seras décapité.
Renie le petit charlatan
qui t’a inspiré ces théories stupides.
Tu auras la vie sauve et tu seras réhabilité ».
Maximilien répondit :
« La vie, proconsul Dion,
n’est pas dans le Signe, n’est pas dans la dague :
Moi, Maximilien, je suis chrétien
et j’accepte mon sort avec amour
et, avec amour, j’accepte la mort ».
Maximilien, ayant donné sa réponse,
tomba à genoux – et il baissa la tête.
Conclusions provisoires :
1) Autrefois, les peintres et les poètes ont souvent fait référence à la mythologie, à l’histoire gréco-romaine et à la Bible pour comparer des contemporains qu’ils admiraient à des héros de l’Antiquité, mythologiques ou historiques. Les chanteurs italiens contemporains se servent plutôt de l’antiquité comme d’un miroir négatif du présent, la cruauté des jeux dans les stades de football comparée à la cruauté des jeux du cirque romain, Ulysse exploitant ses marins comparé à un patron moderne qui exploite ses ouvriers, Orphée qui se retourne délibérément pour qu’Eurydice reste aux Enfers comme symbole d’un amour malheureux ou impossible d’aujourd’hui. L’Antiquité a cessé d’être une référence positive pour devenir souvent une illustration des maux de la société capitaliste d’aujourd’hui : c’était déjà comme ça au moment de la guerre de Troie ! Et la venue du Christ, « ce grand révolutionnaire », dit-on souvent dans ce dernier tiers du XXe siècle, n’a pas servi à grand-chose, car les hommes sont aussi mauvais après qu’avant.
2) Quels éléments choisissent les « cantautori » ? Un nombre relativement limité de dieux, héros, empereurs, etc. sont retenus dans leurs chansons, Ulysse, Orphée et Eurydice, Ajax, Sapho, Alexandre le Grand, Néron, Héliogabale, très peu de personnages de l’Ancien Testament, le Christ et la Vierge Marie. Nous n’avons pas trouvé de chansons sur Achille, Priam, Hector et autres héros de la guerre de Troie, ni sur Jules César, Auguste et autres empereurs. Par contre la chanson populaire se concentrera sur les saints locaux ou internationaux, et la Vierge. Qu’est-ce qui commande ces choix ? D’abord la tradition : même Héliogabale n’est chanté qu’à partir d’un ouvrage antérieur d’Antonin Artaud (1896-1948) ; ou bien la permanence d’un nom de la mythologie dans le langage contemporain, comme le « Narcisse » de Giorgio Gaber. Ce peut être aussi l’intérêt personnel du chanteur, comme cela arrive chez Vecchioni, professeur de latin et de grec, spécialiste de l’Antiquité. Mais dans l’ensemble, il n’y a rien qui ne soit déjà présent dans la littérature ou dans l’opéra lyrique : les cantautori entretiennent la tradition, ne faisant que l’interpréter à nouveau et de façon nouvelle en fonction de la pensée et de la pratique de la société contemporaine.
3) Il reste ce besoin permanent de nous regarder dans le miroir de la société grecque ou romaine, soit pour traiter nos problèmes sociaux et politiques, soit pour parler de nos difficultés psychologiques privées et individuelles. Héritage d’une culture « classique », que l’on retrouve moins dans la culture populaire, plus marquée soit par d’autres références mythologiques, Dionysos plus qu’Apollon, comme dans la « tarentelle » méridionale soit par la culture chrétienne dans ses aspects les plus proches de la vie quotidienne du peuple, comme le culte des saints, protecteurs de l’agriculture, de la ville, etc. ou de la Vierge, proche de la vie de toutes les mères. Un groupe rock récent du Trentin Haut-Adige se nomme cependant en 2003 The Bastard Sons of Dioniso ! Pourquoi cette permanence de la culture grecque et la mythologie dans notre société marquée par les idéologies héritées du christianisme ? Autant de questions à approfondir.
NOTES
-
Après Hérodote, cf. Strabon (64 av.J.C. - 25 ap. J.C.), Géographie, Livre 5, chap. 1 :
« 1. L'Italie actuelle commence au pied des Alpes : [je dis l'Italie actuelle], car ce nom ne désigna d'abord que l'ancienne Oenotrie, c'est-à-dire la contrée limitée entre le détroit de Sicile et les golfes de Tarente et de Posidonie; mais, ayant pris avec le temps une sorte de prédominance, ce nom finit par s'étendre jusqu'au pied de la chaîne des Alpes, embrassant même, d'un côté, toute la Ligystique jusqu'au Var et naturellement aussi les parages de la Ligystique depuis la frontière de Tyrrhénie, et, de l'autre côté, toute l'Istrie jusqu'à Pola. Il est présumable que la prospérité des peuples, qui, les premiers, portèrent le nom d'Italiens, invita leurs voisins à le prendre également et que ce nom continua de la sorte à gagner de proche en proche jusqu'à l'époque de la domination romaine. Puis vint un moment où les Romains, qui avaient fini par accorder aux Italiens le droit de cité, jugèrent à propos de faire participer au même privilège les Gaulois et les Hénètes de la Cisalpine et commencèrent à comprendre sous la dénomination commune d'Italiens et de Romains ces étrangers au milieu desquels ils avaient fondé tant de colonies, parvenues toutes, les plus récentes comme les plus anciennes, à une incomparable prospérité. »
(Texte accessible sur Internet).
-
Comme le note l’historienne Nazarena Valenza Mele, on ne créait rien à l’époque pour des raisons simplement « artistiques », même un vase décoré était un « objet d’usage ». « Seule une vision d’ensemble des productions et des objets manufacturés, des maisons comme des temples, des casseroles de cuisine comme du vase en bronze, peut nous aider à pénétrer dans une réalité historique qui n’a rien créé à de simples fins artistiques ». Les archéologues ont négligé la « culture matérielle » collective et productive, comme la céramique « d’usage » quotidien, qui se prête moins à être exposée dans une vitrine de musée (Storia d’Italia, Bompiani, 1989, n° 39, pp.49-50). Nous nous référerons souvent à cette Storia d’Italia qui a tenté de sortir du conformisme de l’histoire dominante.
On aurait eu chez les Osques une forme « Vitellu », le veau, d’où serait venu le nom d’Italia ; les Osques adoraient en effet le veau et avaient une monnaie où était représenté un veau.
-
Voir,
- Les ouvrages de Giovanni Semerano, en particulier sa grande œuvre Le origini della cultura europea, Olschki, Firenze, 1984, 1994, et son dernier petit livre, La favola dell’indoeuropeo, a cura di Maria Felicia Iarossi, Paravia Bruno Mondadori, 2005, 118 p.
- Le livre de Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indoeuropéens ? - Le mythe d’origine de l’Occident, La Librairie du XXIe siècle, Éd. du Seuil, 2014, 742 p. Il montre de façon très précise que le concept d’ « indoeuropéen » est la construction intellectuelle d’un mythe d’origine, « celui des Européens, qui les dispenserait de devoir emprunter le leur aux Juifs, à la Bible ». L’archéologie la plus récente ne valide aucune hypothèse de ce type, ni la linguistique, la biologie, la mythologie. Son livre est fondamental ; on regrette seulement qu’il ne cite jamais le nom de Semerano, non plus que d’aucun autre chercheur italien : ignore-t-il cette culture ?
-
Écouter les chants de David Van de Sfroos, et ses commentaires sur la tradition des bords du lac de Côme.
-
Lire leur histoire complexe dans Storia d’Italia, op. cit., 42, pp.121-144.
-
Sur toute cette époque il est intéressant de lire les auteurs grecs et latins, en particulier :
- Hérodote
- Strabon, Géographie, Livres V et VI sur l’Italie et la Sicile
- Denis d’Halicarnasse
- Tite-Live, Histoire romaine
Voir l’abondante littérature ancienne sur les bains, et pour l’histoire, Jérôme Carcopino, La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire, Hachette, 1939, pp. 293- 304, et sur les Thermes de Caracalla, Filippo Coarelli, Guide archéologique de Rome, Hachette, 1994, pp. 228-231.
On trouvera les textes apocryphes dans l’édition de la Pléiade, Écrits apocryphes chrétiens, 1997, 1782 pages ; en italien, Marcello Craveri, I vangeli apocridi, Torino, Einaudi, 1969
Deuxième partie
I. Les invasions barbares des Goths à Charlemagne
Mais dès le début du IVe siècle, après plus d’un siècle de crise de pouvoir, l’empire commence à se désagréger sous le choc des « Barbares ». Les « invasions barbares » sont en réalité d’abord un phénomène de grandes migrations d’est en ouest qui, parallèlement à la dégradation interne de l’empire romain, vont bouleverser l’organisation de tout le monde européen. Ce ne sont pas plus des « invasions » que les envahisseurs n’étaient des « barbares ». Relevons brièvement quelques caractéristiques de cette époque :
1) Écartons d’abord une interprétation théologique très répandue qui affirmait que les invasions étaient voulues par Dieu comme punition de la corruption de l’empire païen, selon la vision biblique du prophète Daniel pour laquelle cette période d’invasions serait le prélude de l’arrivée de l’Antéchrist puis de l’Apocalypse. Cette interprétation n’explique malheureusement rien de l’histoire des premiers siècles de l’ère chrétienne.
2) Derrière ce mot de « barbare », il y a le concept d’opposition entre peuples « civilisés » (du mot « cives », le citoyen d’une société organisée en villes) et peuples « barbares » étrangers à la société urbaine et incapables de comprendre et de parler la langue des civilisés, le grec ou le latin, des êtres « balbutiants ». Cette distinction évolua ensuite vers une opposition entre des peuples « évolués » et supérieurs – on parlera même de « races » supérieures – et des peuples dits « sauvages » et cruels, comme si les Romains avaient été un peuple pacifique et non-violent. En réalité, il y avait une opposition entre deux conceptions de l’homme, celle des peuples méditerranéens privilégiait l’homme « citoyen » qui mettait ses armes (car il était aussi un soldat) « au service d’un modèle civil fondé sur la ville, sur la res publica et d’un système politique fondé sur la stabilité et la circulation à l’intérieur de la stabilité (l’expansion même de l’Empire était une dilatation de la stabilité) » (Storia d’Italia, Bompiani, 1989, vol. 68, p. 340). Pour les « barbares », les peuples germaniques, la guerre était une nécessité vitale, car leur organisation économique les conduisait au nomadisme qui les obligeait à chercher constamment de nouveaux espaces ; ils étaient donc des « guerriers ».
3) C’est souvent pour se défendre des attaques des autres peuples que les Latins (urbanisés et devenus « romains ») ont dû « pacifier » ces territoires italiens puis européens et méditerranéens. Souvenons-nous qu’en 390 av. J.C. des mercenaires gaulois Boïens (i Boii) attaquent Rome et menacent son existence. Dès l’origine il fallut que Rome se défende contre les peuples voisins, à commencer par les Sabins. Et bien avant l’Empire et l’avancée des Romains vers l’est européen, Rome avait eu affaire avec les « barbares » : s’ils décidèrent de « détruire Carthage », ce fut pour éviter le retour d’une offensive aussi destructrice que celle d’Hannibal. Puis, dès 113 av. J.C., les Cimbres (i Cimbri) d’origine celte ou germanique envahissent la Norique (le centre de l’Autriche), alliés aux Teutons (i Teutoni) et aux Ambrons (gli Ambroni). (Voir l’Histoire romaine de Jules Michelet, vol. I, consultable sur Internet). Ils sont battus par Caius Marius en 102 av. J.C. à la bataille d’Aix-en-Provence. Ils envahissent aussi la Gaule et le nord de l’Espagne, puis le nord de l’Italie où ils sont battus définitivement et pratiquement exterminés à la bataille de Vercelli en 101 av. J.C. Plus tard, les Suèves (I Suebi) venus des rives de la mer Baltique, guidés par leur roi Arioviste (101-54 av. J.C.), furent battus par Jules César en 58 av. J.C. et peu à peu intégrés dans la légion romaine ; on les retrouvera plus tard comme alliés des Vandales. Ce sont toutes ces invasions qui détermineront la poussée des Romains vers la Gaule, la Grande-Bretagne et l’Allemagne : César alla même plus loin et il estima que pour arrêter les incursions extérieures, il fallait semer la terreur parmi ces populations. C’est pour les mêmes raisons que la conquête s’étendit à la Gaule, à l’Espagne, au Moyen-Orient. Mais il faut ajouter une autre raison : c’est aussi pour régler des problèmes intérieurs que s’affirme le pouvoir impérial. César puis Octavien Auguste occupent la Grèce et l’Égypte pour confirmer leur pouvoir sur Pompée puis sur Marc-Antoine.
4) Ainsi l’armée est un élément essentiel de toute l’histoire de Rome, et c’est souvent elle qui déterminera l’élection d’un général comme empereur. Or, surtout à partir de l’édit de Caracalla (198-217) qui accorde le titre de « citoyen romain » à tous les habitants de l’Empire – alors que cette dignité était la récompense des légionnaires après leurs 20 ans de service – les Latins se désintéressent de l’armée et n’effectuent plus de service militaire pour lequel ils se font remplacer par un mercenaire : et ces troupes auxiliaires sont surtout composées de « barbares », qui prennent une importance décisive, leur fonction étant devenue héréditaire. Et deux empereurs furent affublés de titres « barbares », Maximin (265-268), dit « le Thrace » et Claude II (268-270) dit « le Gothique ». Dans cet état de crise de l’Empire, l’empereur Constantin le Grand (306-337) transfère la capitale de l’empire à Byzance qui devient Constantinople, en 330 ; Rome est pratiquement abandonnée, devient une ville « symbole » où le chef de l’Église chrétienne va bientôt reprendre les pouvoirs et le titre de l’empereur « Souverain Pontife » à partir de 642, affaiblissant d’autant la religion romaine qui ne tardera pas à être interdite. Les « invasions » ne vont pas tarder.
5) À quoi sont dus ces mouvements migratoires ? probablement d’abord à une dégradation climatique qui dure du IIIe au Xe siècle qui pousse les populations de l’est européen vers l’ouest et le sud moins touchés au niveau du climat et de la productivité agricole. Mais aussi à la place qu’elles occupaient maintenant dans l’Empire qui les avait assimilées et gratifiés par les avantages matériels de la vie urbaine, et à l’affaiblissement et à la corruption du pouvoir impérial.
Les Goths furent les premiers à envahir l’Italie ; ils avaient été intégrés dans l’organisation impériale, mais estimaient que leur place était trop réduite, et ils étaient attirés par la richesse de Rome. Sous la direction de Stilicon (365-408, « semi barbare » d’origine vandale et marié à la nièce de l’empereur Théodose), l’armée romaine les vainquit à Pollenzo en 402, grâce à une concentration de soldats qui laissa dégarnies les provinces septentrionales de l’empire, et favorisa l’invasion des Vandales, des Burgondes et d’autres peuples. Mais, après avoir refusé toute négociation, le roi des Goths, Alaric (370-410), mit à sac la ville de Rome en 410, ce qui suscite la réflexion d’Augustin d’Hippone (354-430) sur la fin de la « cité de l’homme » à laquelle pourrait succéder la « cité de Dieu ».
Puis, après les Burgondes, arrivèrent les Huns, le « fléau de Dieu » de souche probablement mongole, qui étaient frappés par une crise agricole qui les laissait dépourvus de nourriture suffisante. Ils se lancent d’abord sur les steppes de l’Asie centrale, puis sur l’Italie, mais leur absence de culture urbaine fait qu’ils ne cherchent que des esclaves, des chevaux et du butin ; les Romains leur opposèrent leurs légions commandées par Flavius Aetius (395-454), qui, après s’être allié avec les Huns contre les Burgondes, les combat et les défait à la bataille des champs Catalauniques aux alentours de Châlons-en-Champagne en 451. Les Huns durent se retirer et disparurent pour les Romains. Mais en 455 arrivèrent les Vandales (i vandali), venus de Scandinavie, sous la direction de leur roi Genséric (389-477). Ils avaient été intégrés par l’empereur Aurélien en 271, moyennant la fourniture de 2000 cavaliers formant une troupe auxiliaire des légions, et on leur avait fourni des terres abandonnées, ce qui explique la présence d’un général vandale comme Stilicon, exécuté cependant par les Sénateurs antigermaniques en 408. Mais au début du Ve siècle, ils sont chassés par les Huns, passent le Rhin, envahissent la Gaule puis l’Espagne entre 409 et 429, puis l’Afrique romaine entre 429 et 439, prennent Hippone et Carthage dont ils font leur capitale, et en 455, ils remontent jusqu’à Rome qu’ils « saccagent » pendant 15 jours : en réalité, ils s’entendent avec le pape Léon I (390-440-461), partagent Rome en secteurs dont ils se contentent d’emporter les richesses sans violence ni destructions ; c’était un peuple très civilisé et organisé, qui connaissait le latin, et qui avait une littérature. Ils ne disparaissent qu’en 533, défaits par l’armée byzantine et son général Bélisaire (500-565), et ceux qui restent se fondent avec les Berbères d’Afrique du Nord.
C’est l’occasion de rappeler que c’est l’empire byzantin, encore installé dans une partie de l’Italie, qui combat le mieux les « barbares ». Théodose I dit le « Grand » (379-395) fut pratiquement le dernier empereur d’un empire formellement unifié ; c’est lui qui instaure le christianisme comme religion officielle de l’Empire par l’Édit de Thessalonique le 28 février 380, faisant triompher la foi trinitaire catholique sur les théories d’Arius (250-336) (Concile de Constantinople de 381) ; la religion païenne sous toutes ses formes est interdite et réprimée ; les jeux de gladiateurs sont définitivement interdits en 439. C’est après Théodose qu’existe vraiment l’Empire byzantin, ce dernier empereur ayant partagé son héritage entre ses fils Honorius (empire d’Occident, 384-423) et Arcadius (empire d’Orient, 377-408). Après une période de luttes entre les deux empires qui s’appuient à tour de rôle sur l’un ou l’autre des peuples germaniques qui ont pris maintenant une place centrale dans les institutions et l’armée impériales, l’empire d’Occident tombe aux mains d’empereurs faibles, et en 475, Flavius Oreste (420-476), ancien secrétaire d’Attila et chef des troupes romaines confédérées qui constituaient l’armée impériale d’Italie, dépose l’empereur Julius Népos (430-480) et impose comme empereur son propre fils, Romulus Augustule. Mais Oreste est désavoué par ses troupes, et c’est le chef barbare Flavius Odoacre (433-493), chef des Hérules (gli Eruli), qui, sous l’inspiration de l’empereur d’Orient, fait assassiner Oreste et dépose Romulus qui sera donc le dernier empereur d’Occident. Mais l’empereur d’Orient Zénon (425-491) envoie Théodoric (465-526), roi des Ostrogoths, combattre Odoacre qui se révélait de plus en plus indépendant de l’empereur ; Odoacre est vaincu, se réfugie à Vérone puis à Ravenne où il est tué par Théodoric, et ce dernier se fait nommer roi d’Italie par les Goths sans l’accord de l’empereur d’Orient. Pendant trente ans, il fait régner la paix en Italie, respectant les Romains et leurs traditions, mais les laissant strictement séparés des Goths (les mariages mixtes sont par exemple interdits, de même que l’usage des couteaux !) ; bien qu’arien, il gouverne en accord avec le pape Symmaque (450-514) contre l’antipape Laurent (460-506), et avec le philosophe Anicius Manilus Severinus Boethius (Boèce, 480-524) ; mais celui-ci, qui luttait contre l’arianisme, est finalement accusé de communiquer avec l’empereur d’Orient et tué par Théodoric en 524. De même, Théodoric finit par combattre l’église catholique et il fait assassiner le pape Jean 1er en 526. C’en était fini de l’empire d’Occident que les « barbares » contrôlaient désormais en grande partie, et c’était le début de la rupture entre Occident et Orient, entre l’évêque de Rome et le patriarche de Constantinople, future scission entre Catholiques et Orthodoxes. C’était aussi l’orée d’une civilisation chrétienne qui supplanta peu à peu la civilisation romaine, convertissant les « barbares » tout en luttant avec l’aide de l’empereur Justinien (483-565) contre les « hérésies » auxquelles ils adhéraient souvent (sur la nature du Christ, entre les monophysites qui affirmaient qu’il n’avait qu’une seule nature divine, les ariens qui affirmaient au contraire sa nature humaine, et les catholiques qui défendaient la double nature et l’incarnation), et assimilant la culture classique romaine, dont la langue, jusqu’à revendiquer l’indépendance de l’Église face à l’Empire. Une nouvelle ère humaine commence.
On peut donc moins parler d’invasion que de migration, et de prise de pouvoir de peuples colonisés par les Latins puis intégrés dans l’armée romaine et désirant s’approprier les richesses et la puissance de leur ancien maître. Barbares, ces peuples ? Non, simplement organisés selon d’autres critères que celui des Romains, rendus guerriers de par leur organisation sociale même. Rappelons que tous les peuples premiers de l’Italie, venaient plus ou moins du nord ou de l’est, à commencer par les Latins.
L’empereur d’Orient Justinien (483-565) tenta de réunifier l’empire en envoyant ses généraux Bélisaire (500-565) puis Narsès (478-573) reconquérir le royaume vandale d’Afrique du Nord, Sardaigne et Corse puis l’Italie (535-553), d’où les 300.000 Ostrogoths des origines disparurent, semblant ne laisser aucun souvenir.
Pourtant une grave épidémie de peste bubonique, sous Antonin le Pieux (86-161) et Marc-Aurèle (121-180), vient encore aggraver les dissensions et les mouvements de révolte à l’intérieur de l’empire ; l’idéologie du nouvel ordre bénédictin prend la relève, et bientôt arrive en Italie une nouvelle force venue de Pannonie (la Hongrie et une partie de la Croatie) par les Alpes occidentales, les Longobards (de l’expression « long bart » = qui a une longue barbe … ou une longue hache ; cf. le mot hallebarde), acceptés par les Byzantins (ils étaient depuis longtemps fédérés dans la légion romaine). C’était le roi Alboïn (vers 530-572) qui avait mené son peuple vers l’Italie du Nord en 568 (Voir ci-dessus la carte des terres qu’il occupa) ; il était marié à Rosemonde (Rosmunda), fille du roi gépide Cunimond (milieu du VIe siècle). Puis les Longobards assiègent Pavie en 572, d’où ils furent repoussés par l’armée byzantine ; leur roi Alboïn est tué la même année par Rosemonde, dit la légende. En 584, c’est Authari (roi de 584 à 590) qui devient leur roi, suivi de Agilulf (590-616). En 626, la capitale est transférée de Monza à Pavie, Monza devient résidence estivale des rois et fut enrichie par la reine Théodelinde. C’est la reine Théodelinde (573-627), « bouclier du peuple » en germain, épouse du roi Agilulf, qui poussa son mari à traiter avec l’Église, sous le pape Grégoire le Grand (590-604). Sous le règne d’Aripert (653-661) les Lombards se convertissent au christianisme et mettent en place les bases du régime féodal. Liutprand règne de 713 à 744 et renforce le pouvoir politique du pape en donnant Sutri à Grégoire II. Mais le roi Aistolf (749-756) tenta d’unifier l’Italie, s’empara de l’exarchat byzantin de Ravenne et voulut intégrer aussi le patrimoine de Saint Pierre pour réunifier les territoires lombards du Nord et les Duchés lombards de Spoleto et Bénévent au sud. Son successeur fut Didier (710-774), il attaque les territoires pontificaux mais est repoussé par le roi franc Pépin le Bref (714-768), fils de Charles Martel, qui donne l’exarchat de Ravenne au pape, créant ainsi les bases de l’État pontifical. Didier donne ensuite sa fille Désirée en mariage à Charlemagne (742-814), espérant obtenir son alliance. C’est Charlemagne, devenu roi des Francs en 771, qui, ayant répudié la fille du roi Didier, descend en Italie à l’appel du pape Adrien Ier (pape de 772 à 795) et défait les Lombards en 774, devenant « Gratia Dei rex Francorum et Langobardorum ».
Les « invasions barbares » – qui durent aussi longtemps que l’histoire de Rome elle-même – furent donc d’une part des migrations de peuples du nord vers le sud et de l’est vers l’ouest, mais elles contribuèrent de façon déterminante à la décomposition d’un empire millénaire, déjà corrompu de l’intérieur, par l’usage des esclaves qui furent finalement un frein à la croissance, le refus du service militaire, l’appauvrissement démographique par une limitation volontaire des naissances, une santé ravagée par l’usage du plomb dans les aliments (l’eau), la vaisselle et les instruments de cuisine, la faiblesse de l’administration romaine dans les « provinces », etc. ; la diffusion du christianisme, venu lui aussi d’Orient, peut-être accélérée par la peste, contribua aussi à cette décadence, mais seulement à partir du IVe siècle, de l’édit de Constantin (313) à ceux de Théodose (380 et 391) : il mettait le salut dans une métaphysique non historique, et non dans une lutte politique, mettant encore plus en doute la foi dans les capacités de l’empire, que le christianisme voulut remplacer, effacer, changer dans ses valeurs les plus profondes. Et finalement ce furent les « barbares » installés à la tête d’un empire transformé (le « Saint Empire Romain Germanique ») qui repoussèrent les nouvelles tentatives d’invasion venues du nord (Vikings, Danois, Suédois …), de l’est (Slaves, Magyars …) ou du sud (Arabes). Mais l’unité augustéenne de la Méditerranée était brisée, et nous héritons aujourd’hui de cette période de 8 siècles. Ne sommes-nous pas dans un autre temps d’invasions « barbares » (des barbares porteurs en réalité d’une autre civilisation, comme ceux d’il y a presque 2000 ans) ? De ce passage à un autre monde avons-nous une conscience plus claire que celle qu’en eurent les Romains, lorsque nous continuons à nous battre contre les « barbares » migrants ?
On n’a pas vraiment de musique de cette époque, mais il nous reste deux traités sur la musique, qui sont hérités de l’expérience grecque et romaine, d’une part le De Musica de Saint Augustin, commencé en 387, et d’autre part le De institutione musica de Boèce, écrit vers 510 et que l’on n’a pas cessé de reprendre par la suite. Et quelques personnages ont continué à inspirer des auteurs italiens.
Une chanson a été considérée par Costantino Nigra (1828-1907) comme un souvenir de l’époque lombarde, Donna lombarda. Il donne 16 versions de la chanson, et les fait suivre d’un commentaire où il rappelle et critique les interprétations précédentes pour proposer la sienne, basée sur l’étude historique de Paul Diacre (vers 720-799), moine bénédictin lombard du Frioul, puis homme de lettres de Charlemagne, auteur notamment avant 774 d’une Histoire de Rome (Historia romana), des origines au règne de Justinien, et d’une Histoire des Lombards (Historia gentis Langobardorum) entre 787 et 789, qui va des origines à 744. Nigra cite un autre historien, Agnello di Ravenna (Vers 800-850) qui écrit en 834 un Liber pontificalis ecclesiae ravennatis (Histoire pontificale de l’Église de Ravenne). Nigra en déduit que la « dame lombarde » est la reine Rosmunda qui, après avoir contribué à l’assassinat de son mari Albuïn par Elmichi, épouse ce dernier, puis elle cède aux sollicitations du Préfet de Ravenne qui lui conseille d’empoisonner son nouveau mari, mais celui-ci, s’apercevant, grâce à un enfant, que le vin qu’elle lui sert est empoisonné, l’oblige avant de mourir à boire le reste de la coupe, ou la tue avec son épée. La chanson est passée en France sous le titre de Dame lombarde, où elle commence par ce vers « Allons au bois, charmante brune ».
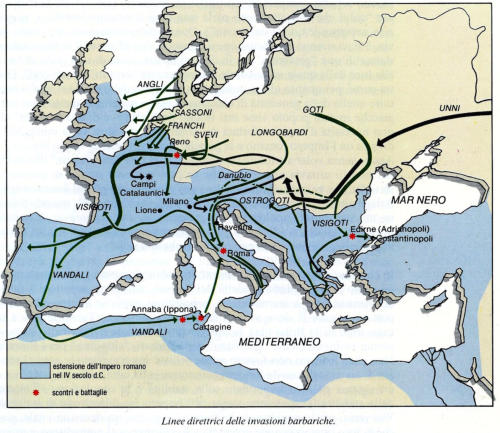
DONNA LOMBARDA
Versione premanese del più famoso canto narrativo italiano (Nigra 1) Cantori di Premana, Regione Lombardia 9, LP, Disco Albatros, VPA 8372/RL
Donna Lombarda
Donnà lombàrda perchè non mi àmi
perchè gh’o ‘l marì perchè gh’o ‘l marì
si ài ‘l marìto fallo morire
si ài ‘l marìto fallo morire
t’inségnero mì t’inségnero mì
va nèl giardino del sìgnor pàdre
va nèl giardino del sìgnor pàdre
che c’è la ‘n serpént
taglià la tèsta di quèl serpénte
taglià la tèsta di quèl serpénte
poi pèstela bén poi pèstela bén
e quàndo pòi l’ì ben pestàta
e quàndo pòi l’ì ben pestàta
mettìla nel vìn mettìla nel vìn
no nò bevéte o pàdre mio
no nò bevéte o pàdre moi
che c’è del velén
levò la spàda che téngo al fiànco
ti vòglio mazàr ti vòglio mazàr
|
Dame lombarde, pourquoi tu ne m’aimes pas
parce que j’ai un mari, parce que j’ai un mari
Si tu as un mari, fais-le mourir
Si tu as un mari, fais-le mourir
Je t’apprendrai moi, je t’apprendra
Va dans le jardin de monsieur ton père
Va dans le jardin de monsieur ton père
car il y a là un serpent
Coupe la tête à ce serpent
Coupe la tête à ce serpent
puis écrase-la bien, écrase-la bien
Et quand tu l’auras bien écrasée
Et quand tu l’auras bien écrasé
mets-la dans le vin, mets-la dans le vin
Non ne buvez pas, oh mon père
Non ne buvez pas, oh mon père
car il y a du poison
Je lève l’épée que j’ai à mon côté
je veux te tuer, je veux te tuer.
|
Une autre chanson raconte une histoire (ou légende ?) antérieure concernant Rosmunda : après une nuit de bombance à Vérone, dans le palais royal qui fut celui de Théodoric, Albuïn but du vin dans une coupe creusée dans le crâne du père de Rosemonde qu’il avait tué, et il obligea sa femme à boire aussi. Pour se venger, cette dernière aurait attaché l’épée de son mari à son fourreau ; et quand les conjurés guidés par Elmichi arrivèrent il ne put se défendre qu’avec sa chaise ; c’est du moins ce que racontent Paul Diacre et Agnello de Vérone. La chanson est du groupe des Gufi (1964-1981) :
Va Longobardo
Va longobardo lungo il corso dell’Adda
porta con te il papà di Rosmunda
dorme la figlia non può urlar dal terrore
così almeno potrai il suo cuor pugnalar e la testa staccar.
O longobardo della selva fatale
riporta al campo la testa ed il pugnale
poi col cucchiaio vuota per bene il cranio
perché almeno così una coppa farai dove bere potrai.
Bevi Rosmunda, bevi nel cranio vuoto del tuo papà
non esitare sciocca, ti mostro io come si fa.
Bevi Rosmunda bevi, la schizzinosa non devi far
se te lo dice Alboino che ti vuoi bene lo puoi ben far
suvvia dai retta al maritino se no la testa ti fa staccar
|
Va Lombard, le long du cours de l’Adda
emmène avec toi le papa de Rosemonde
sa fille dort et ne peut pas hurler de terreur
Ainsi tu pourras poignarder son cœur et détacher sa tête.
Oh Lombard de la forêt fatale
ramène au camp la tête et le poignard
puis avec une cuillère vide bien le crâne
Parce qu’au moins comme ça tu feras une coupe où tu pourras bien boire.
Bois Rosemonde, bois dans le crâne vide de ton papa
N’hésite pas, sotte, je te montre comment on fait.
bois Rosemonde bois, ne fais pas la difficile
c’est Alboïn qui te le dit, il t’aime, tu peux bien le faire
allez, écoute ce que te dit ton petit mari, sinon je te fais couper la tête
|
Par contre un personnage a laissé une trace différente : le roi Théodoric ; il était arien, donc hérétique, et les catholiques ont inventé ensuite le récit de son enlèvement en enfer par Belzebuth lui-même transfiguré en destrier noir. On le retrouve sur la façade de la Basilique San Zeno de Vérone (voir ci-contre), dans une sculpture de la première moitié du XIIe siècle ; et un cantautore de Vérone, Massimo Bubola (1954- ) a chanté en 1999 ce récit de la chasse infernale du roi.
Signalons que le groupe Mercanti di liquore (créé en 1995) a cité aussi la reine longobarde Teodolinda dans sa chanson Lombardia (dans La musica dei poveri, 2002) :
Lombardia
Atterrati su in Brianza
Atterrati su in Brianza come un 747
Siam cresciuti di nascosto, come le castagne matte
La regina Teodolinda ci faceva l’occhiolino
ma noi irriconoscenti, non gli abbiam fatto l’inchino.
Ayat atterri en Brianza
Ayant atterri en Brianza comme un 747
nous avons grandi en cachette, comme des châtaignes folles
La reine Théodolinde nous faisait des clins d’oeil
mais nous, irrévérencieux, nous ne lui avons pas fait de salut.
Il blues di Re Teodorico
Un giorno re Teodorico sentì suonare - bang! bang! -
era il segnale di caccia degli scudieri del re
il più bel cervo del mondo stava passando di lì
ma non aveva un cavallo per inseguirlo e così
- povero re, povero re, povero re Teodorico ! -
E poi gli apparve un destriero nero più nero non c’è
aveva gli occhi di fuoco, gli disse - Vieni con me !
Cattureremo la bestia e le sue corna io ti darò
su svelto saltami in groppa e tieni forte sennò -
- povero re, povero re, povero re Teodorico ! -
Tua moglie, i tuoi figli, tua madre
saluta bene perchè
quei regni, i fiumi, le strade
ora appartengono a me !
- povero re, povero re, povero re Teodorico ! -
E da Verona a Messina ci mise un attimo o poco più
capì quand'era ormai tardi che quel cavallo era Belzebù
dall'alto azzurro del cielo, dentro il vulcano si fiondò giù
dove comincia l'inferno e dove indietro non torni più
- povero re, povero re, povero re Teodorico ! -
Tua moglie, i tuoi figli, tua madre saluta bene perchè i regni, i fiumi, le strade ora appartengono a me! - povero re, povero re, povero re Teodorico ! - - Povero re, povero re, povero re Teodorico !
Le blues du roi Théodoric
Un jour le roi Théodoric entendit jouer - bang ! bang !
c’était le signal de chasse des écuyers du roi
le plus beau cerf du monde passait par là
mais il n’avait pas de cheval pour le poursuivre et ainsi
– pauvre roi Théodoric, pauvre roi Théodoric ! –
Et puis lui apparut un destrier noir, il n’y a pas plus noir
Il avait des yeux de feu, il lui dit – Viens avec moi !
Nous prendrons la bête et je te donnerai ses cornes
Allons vite saute-moi sur la croupe et tiens-toi fort, sinon –
– pauvre roi Théodoric, pauvre roi Théodoric ! –
Ta femme, tes enfants, ta mère
salue-les bien parce que
les royaumes, les fleuves, les routes
maintenant c’est à moi qu’ils appartiennent !
– pauvre roi Théodoric, pauvre roi Théodoric ! –
Et de Vérone à Messine il mit un instant, pas beaucoup plus
Il comprit quand c’était trop tard, que ce cheval était Belzébuth
Du haut du ciel bleu, il plongea dans le volcan
où commence l’enfer et d’où on ne revient plus
– pauvre roi Théodoric, pauvre roi Théodoric ! –
Ta femme, tes enfants, ta mère salue-les bien parce que les royaumes, les fleuves, les routes maintenant c’est à moi qu’ils appartiennent ! – pauvre roi Théodoric, pauvre roi Théodoric ! – – Pobre roi, pauvre roi, pauvre roi Théodoric !
Attila e la Stella
Barbara luna rosso scudo
il re degli Unni guardava Roma
uomo di poca fantasia
lui la scambiò per una stella.
Quando gli uomini giunsero in collina
aveva sciolto l’armatura
e fu per ignoranza o per sfortuna
che perse il treno, il treno per la luna.
Quando il « Leone » gli prese la mano
lui alzò il pugno chiuso e il suo coltello
forse mentiva l’uomo bianco
ma lui era proprio suo fratello
flagellum, flagellum Dei
flagellum, flagellum Dei
flagellum, flagellum Agnus Dei.
Quando i carri volsero le spalle
Leone levò il calice al cielo
e fu per ignoranza o per sfortuna
che questa stella figlio è ancora a Roma.
che questa stella figlio è ancora a Roma...
Attila et l'Étoile
Lune barbare d’un rouge écu
le roi des Huns regardait Rome
homme de peu d’imagination
Il la prit pour une étoile.
Quand les hommes arrivèrent sur la colline
il avait défait son armure
et ce fut par ignorance ou par malheur
Qu’il perdit le train, le train pour la lune.
Quand le « Lion » lui prit la main
il leva son poing fermé et son couteau
peut-être que l’homme blanc mentait
mais il était vraiment son frère
flagellum, flagellum Dei
flagellum, flagellum Dei
Flagellum, flagellum Agnus Dei.
Quand les chars tournèrent le dos
Léon leva son calice vers le ciel
et ce fut par ignorance ou par malheur
Que cette étoile, mon fils, est encore à Rome.
Que cette étoile, mon fils, est encore à Rome...
Déjà entre 1861 et 1887, dans ses Rime nuove, Giosuè Carducci (1835-1907) avait écrit une Leggenda di Teodorico, s‘inspirant aussi des textes des poètes allemands du Moyen-Âge.
Bisanzio
Anche questa sera la luna è sorta
affogata in un colore troppo rosso e vago,
Vespero non si vede, si è offuscata,
la punta dello stilo si è spezzata.
Che oroscopo puoi trarre questa sera, Mago?
Io Filemazio, protomedico, matematico, astronomo,
forse saggio,
ridotto come un cieco a brancicare attorno,
non ho la conoscenza od il coraggio
per fare quest’oroscopo, per divinar responso,
e resto qui a aspettare che ritorni giorno.
e devo dire, devo dire, che sono forse troppo vecchio
per capire,
che ho perso la mia mente in chissà quale abuso, od ozio,
ma stan mutando gli astri nelle notti d’ equinozio.
O forse io, forse io, ho sottovalutato questo nuovo dio.
Lo leggo in me e nei segni che qualcosa sta cambiando,
ma è un debole presagio che non dice come e quando...
Me ne andavo l’ altra sera, quasi inconsciamente,
giù al porto a Bosphoreion là dove si perde
la terra dentro al mare fino quasi al niente
poi ritorna terra e non è più occidente :
che importa a questo mare essere azzurro o verde ?
Sentivo i canti osceni degli avvinazzati,
di gente dallo sguardo pitturato e vuoto...
ippodromo, bordello e nordici soldati,
Romani e Greci urlate dove siete andati...
Sentivo bestemmiare in Alamanno e in Goto...
Città assurda, città strana di questo imperatore sposo di puttana,
di plebi smisurate, labirinti ed empietà,
di barbari che forse sanno già la verità,
di filosofi e di eteree, sospesa tra due mondi, e tra due ere..
Fortuna e età han deciso per un giorno non lontano,
o il fato chiederebbe che scegliesse la mia mano, ma...
Bisanzio è forse solo un simbolo insondabile,
segreto e ambiguo come questa vita,
Bisanzio è un mito che non mi è consueto,
Bisanzio è un sogno che si fa incompleto,
Bisanzio forse non è mai esistita
e ancora ignoro e un’ altra notte è andata,
Lucifero è già sorto, e si alza un po’ di vento,
c’è freddo sulla torre o è l’ età mia malata,
confondo vita e morte e non so chi è passata...
mi copro col mantello il capo e più non sento,
e mi addormento, mi addormento, mi addormento...
Byzance
Ce soir aussi, la lune est sortie
Enveloppée d’une couleur trop rouge et vague
L’Étoile du soir ne se voit pas, elle s’est offusquée
La pointe de la plume s’est brisée.
Mage, quel horoscope peux-tu faire ce soir ?
Moi, Philémace, protomédecin, mathématicien, astronome
peut-être sage
réduit comme un aveugle à tâtonner partout,
Je n’ai pas la connaissance ou le courage
pour faire cet horoscope, pour deviner une réponse,
Et je reste ici à attendre que revienne le jour.
Et je dois dire, je dois dire, que je suis peut-être trop vieux
pour comprendre,
que j’ai perdu mon esprit dans qui sait quel abus, ou quelle oisiveté,
mais les astres changent dans les nuits d’équinoxe.
Ou peut-être que moi, moi, j’ai sous-évalué ce nouveau dieu.
Je le lis en moi et dans les signes que quelque chose est en train de changer,
mais c’est un faible présage qui ne dit ni comment, ni quand...
Je m’en allais l’autre soir, presque inconsciemment,
Descendant vers le port de Bosphoreïon là où se perd
la terre dans la mer presque jusqu’au néant
et puis redevient terre et ce n’est plus l’occident :
Qu’importe à cette mer d’être bleue ou verte ?
J’entendais les chants obscènes de gens avinés,
De gens au regard maquillé et vide...
Hippodrome, bordel et soldats nordiques,
Romains et Grecs, hurlez, où êtes-vous allés... ?
J’entendais jurer en allemand et en goth...
Ville absurde, cité étrange de cet empereur marié à une putain,
de foules innombrables, de labyrinthes et d’impiétés,
de barbares qui peut-être savent déjà la vérité,
de philosophes et d’hétaïres, suspendue entre deux mondes, entre deux ères...
La Fortune et l’âge ont décidé pour un jour pas lointain,
ou le destin voudrait que ma main choisisse, mais...
Byzance est peut-être seulement un symbole insondable,
secret et ambigu, comme cette vie,
Byzance est un mythe qui ne m’est pas familier,
Byzance est un rêve qui devient incomplet,
Byzance peut-être n’a jamais existé
et j’ignore encore et une autre nuit s’en est allée.
Lucifer est déjà sorti, et un peu de vent se lève,
Il fait froid sur la tour ou c’est mon âge malade,
je confonds vie et mort, je ne sais laquelle est passée...
je me couvre la tête de mon manteau et je n’entends plus,
Et je m’endors, je m’endors, je m’endors...
Poème difficile ! Il reprend d’abord l’opposition ancienne entre les deux apparitions de la planète Vénus, après le coucher du soleil et à l’aube ; mais les anciens croyaient que c’étaient deux étoiles, « Vespero » ou « Espero », l’étoile du couchant et « Lucifero » l’étoile du matin ; c’est Pythagore (580-495 av.J.C.) qui les identifia le premier comme la planète Vénus. Le début annonce donc un mauvais présage par trois signes : la lune qui devient rouge, l’absence de Vespero, l’Étoile du soir, et la plume qui se brise. On est donc entre un soir et un matin, dans un grand changement d’époque, où l’emporte une nouvelle religion, le christianisme, une nouvelle civilisation, et le vieux mage (ou sage, diseur d’horoscopes qui pourtant devait dire l’avenir) de Constantinople ne comprend pas bien ce qui se passe. Le christianisme a remplacé le polythéisme et les sages de l’Antiquité sont persécutés par les empereurs, dont Justinien ; on ne sait pas où sont allés les Romains et les Grecs, remplacés par les Goths et autres « barbares » avinés, soldats venus du nord. Quant à Filemazio (= celui qui aime apprendre), il représente probablement Guccini lui-même. Et du haut de sa tour, dans la nuit froide au nord di Bosphore, il scrute les étoiles pour essayer de comprendre ce qui se passe, alors que la religion nouvelle s’affirme aux dépens des sciences que Filemazio a cultivées toute sa vie.Le nouvel empereur aurait pu être Constantin Ier, qui eut pour seconde épouse Fausta Flavia Maxima, la fille de Maximien Hercule, dont on disait qu’elle était restée païenne, et qu’elle était tombée amoureuse de Crispus, un fils du premier lit de l’empereur, et que devant son refus, elle l’aurait dénoncé à Constantin comme ayant attenté à sa pudeur, ce qui amena l’empereur à exécuter son fils, d’où sa réputation de « putain ». Mais il s’agit plutôt de l’empereur Justinien et de son épouse Théodora, ancienne actrice fille d’un dresseur d’ours de l’hippodrome pour la faction des Verts et d’une danseuse et pour cela considérée comme une courtisane : c’est en tout cas ce qu’a affirmé Guccini qui dit s’être inspiré de L’Histoire secrète (Les choses non publiées) de Procope de Césarée (vers 500-565), l’historien de Justinien ; il dit dans ce livre le plus grand mal de l’empereur et de Théodora, dénonçant le plaisir qu’il prenait à massacrer les hérétiques et la ruine qu’il provoqua dans l’empire (Voir : Procope de Césarée, Histoire secrète suivi d’« Anekdotica » par Ernst Renan, Les Belles Lettres, 2009).La mer est insondable et infinie, et peu lui importent le vert ou le bleu, couleurs des deux équipes de l’hippodrome de Constantinople. Ce sont peut-être les « barbares », nouveaux habitants de l’empire et de cette nouvelle ville de Byzance-Constantinople – et non plus les anciens mages – qui connaissent la « vérité » de l’avenir, c’est-à-dire que l’empire romain d’Occident va s’écrouler (où sont allés les Grecs et les Romains ?) et être remplacé pour un temps par l’empire d’Orient dont la capitale est cette incompréhensible Byzance : on est entre l’Occident et l’Orient ((le « Bosphoréïon » est le détroit du Bosphore, entre est et ouest). Mais ce caractère insondable n’est-il pas celui de toute vie ? Et cela fait de cette chanson sur l’antiquité de Byzance un symbole de notre vie actuelle où nous semblons être pris sans rien comprendre par l’arrivée d’un nouveau monde, cette « stanca civiltà », civilisation fatiguée que Guccini condamnait dans Dio è morto (1965). Mais c’est aussi une chanson qui dit beaucoup de la transformation historique que fut la chute de Rome et l’arrivée de l’empire byzantin ; elle est historiquement correcte, à la différence de certaines chansons de Venditti.
II. De Charlemagne au XIIe siècle
On en arrive donc aux Francs et à Charlemagne, car ils ont eu une importance décisive dans l’histoire de l’Italie. C’est en quelque sorte la dernière « invasion » d’un peuple germanique en Italie. Leur nom proviendrait d’un mot germanique signifiant « le javelot, la lance », ou d‘un autre signifiant « audacieux, hardi » ; c’est en tout cas un peuple guerrier. Ces peuples constituent dès le début du IIIe siècle des Ligues pour résister à la pression d’autres peuples, la Ligue des Alamans (« alle man » = de tous les hommes) d’une part et la Ligue Franque d’autre part, le long du Rhin en Germanie inférieure, constituée de plusieurs peuples germaniques ; les Romains distinguaient donc l’Alamannia et la Francia ; cette dernière occupant la rive inférieure droite du Rhin, hors de l’Empire romain.
En 254, une montée de la mer du Nord provoque l’appauvrissement de la population, et les Francs commencent à envahir les terres de l’Empire, et ils sont battus par le général romain-gaulois Postumus, qui prend le titre d’empereur de 260 à 269, il est massacré par ses soldats en 268 ou 269, ce qui laisse le champ libre aux Francs, qui continueront leurs invasions jusqu’au IVe siècle, date à laquelle beaucoup seront intégrés dans l’armée romaine ; ils sont donc entre intégration et offensive. Les hivers de 405 et 406 sont très rigoureux, le Rhin est pris par les glaces et le francs peuvent le traverser. Les Francs Saliens ont alors pour chef Clodion le Chevelu (390-450), qui obtient des Romains la remise de terres dans la région de Tournai, et Clovis (466-511) devient en 481 le roi des Francs. C’est le début de la lignée des Mérovingiens, Clovis est l’ancêtre légendaire et presque un dieu ; le roi devient aussi proconsul de Rome pour cette région. Clovis, conseillé par sa femme Clotilde (474-545) et par Rémi (437-533), l’évêque de Reims, bat un général romain à Soissons et les Alamans à Tolbiac, reçoit le baptême chrétien à Reims entre 496 et 500, c’est un des premiers rois germaniques à adopter la foi chrétienne : jusque-là les Francs étaient polythéistes et adoraient les dieux Wotan, son épouse Frikka et son fils Donar ; ils vénéraient aussi la nature, les sources, les arbres, les astres ; les Germains convertis étaient souvent ariens, religion plus proche de la leur ; au contraire Clovis adhéra au christianisme romain, et obtint ainsi l’appui du clergé gallo-romain. Parmi les successeurs de Clovis, la reine Brunehilde (566-613) et Dagobert Ier (629-639), puis des descendants insignifiants, des rois « fainéants » jusqu’au dernier, Childéric III (714-755). Les crises économiques et les querelles internes font qu’une nouvelle famille commence son ascension, celle des Carolingiens. L’arrière petit-fils du premier, Pépin de Landen, va bientôt se faire passer pour roi de 737 à 741 : c’est Charles Martel (690-741), vainqueur des armées arabes musulmanes en 732 à Poitiers. Son fils est Pépin le Bref (714-768), qui fait confirmer sa royauté par les évêques puis par le pape Zacharie (751) et son successeur Étienne II en 754 ; c’est donc le début d’une nouvelle tradition, où le roi est investi par la papauté, au lieu de devenir roi par appartenance familiale et par consécration impériale. Le fils de Pépin est Charlemagne (748-814) qui devient roi des francs en 768, roi des Lombards en 774 et empereur le 25 décembre 800, couronné par le pape Léon III (750-795-816) dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pouvoir se partage désormais en Italie pour un temps entre la papauté et la monarchie franque. Les administrateurs et officiers lombards restés en place se soumettent au nouveau souverain, y-compris en adoptant des vêtements francs, une coupe de cheveux ou de barbes et des prénoms à la mode franque, et non plus byzantine ou romaine.
En échange de son acte de consécration, le pape avait demandé à Pépin le Bref son aide contre les Lombards qui menaçaient Rome ; il ne peut plus compter en effet sur l’appui de l’empereur d’Orient, trop affaibli par sa lutte contre l’empire musulman et dont il est séparé par la querelle des images. Pépin vient donc combattre les Lombards, et il remet au Pape en 754 les territoires conquis, Ravenne, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia, Ancône, Urbino, Cagli, Jesi, Gubbio et Fossombrone, dont beaucoup appartenaient pourtant à l’empire d’Orient. C’est la rupture avec l’Orient et la création des États pontificaux.
À son tour, Charlemagne, qui avait épousé Désirée, la fille du roi lombard Didier, reprend la guerre contre les Lombards, abat Pavie en 774, conquiert le Frioul en 781. C’est un renversement complet de l’histoire précédente : Rome avait conquis le nord de l’Europe, elle devenait maintenant une conquête d’un peuple venu de ce nord ; mais c’est la Rome des papes qui a décidé de cela, faisant en sorte que les carolingiens interviennent à son profit contre les Lombards. L’Église est maintenant débarrassée de la tutelle de l’empire Byzantin, et c’est elle qui va désormais exercer son pouvoir sur l’Europe ; et l’Empire Romain d’Occident se reconstitue en 800 sous son égide : l’empereur carolingien devient le successeur des empereurs romains d’autrefois ; c’en est fini de la présence byzantine en Italie, et en 812, l’Empire d’Orient reconnaît l’empire carolingien, qui renonce en échange à Venise et à la Dalmatie. Les Duchés de Spoleto et de Bénévent se soumettent bientôt aussi à l’autorité carolingienne, qui reçoit le titre de « patricien des Romains », c’est-à-dire protecteur de la totalité des Chrétiens, « la France fille aînée de l’Église » …
Charlemagne réorganise l’empire : les anciens « duchés », centrés sur les villes, deviennent des « comtés » dirigés par des « comtes » dépendants du roi mais qui sont à la tête de tous les fonctionnaires locaux ; les régions frontières deviennent des « marches » qui protègent l’empire contre les invasions étrangères, la Marche de Spoleto (Marches, Ombrie, Abruzzes) contre les Byzantins et les Sarrasins, la Marche de Toscane (Toscane, Ligurie, Corse) contre les Sarrasins, la Marche du Frioul contre les Slaves. Charlemagne est un personnage central dans la culture italienne et en particulier dans les représentations de marionnettes siciliennes et méridionales centrées sur Roland, Olivier, l’empereur, Tupin, etc 9 ; l’Opera dei Pupi de Sicile fait partie depuis 2008 de la Liste du Patrimoine Immatériel de l’Humanité ; sur ces chevaliers carolingiens sont données encore aux enfants des comptines ; dans la peinture et la sculpture, les représentations de Charlemagne et des paladins sont très abondantes ; dans la chanson probablement aussi, mais la documentation est très peu abondante, et on doit se référer à des reprises plus contemporaines, significatives mais qui n’illustrent pas les textes et musiques de chansons plus anciennes.
Sur Charles Martel, on connaît la chanson de Paolo Villaggio (1932-2017) et Fabrizio De André (1940-1999), Carlo Martello torna dalla battaglia di Poitiers, écrite en 1962 suivant la mode des ballades chevaleresques du Moyen-Âge français, qui parlaient des rencontres entre les chevaliers et les jeunes femmes du peuple. Deux passages en furent censurés par le préfet de Catania : le premier « È mai possibile, o porco di un cane, / che le avventure in codesto reame / debban risolversi tutte con grandi puttane », et le second « frustando il cavallo come un mulo, / quella gran faccia da coglione … », qui devint « frustando il cavallo come un ciuco, / tra il glicine e il sambuco ».
Carlo Martello torna dalla battaglia di Poitiers
Re Carlo tornava dalla guerra
« Se ansia di gloria, sete d’onore
spegne la guerra al vincitore
non ti concede un momento per fare all’amore.
Chi poi impone alla sposa soave
di castità la cintura, ahimé, è grave
in battaglia può correre il rischio di perder la chiave ».
Così si lamenta il re cristiano
s’inchina intorno il grano, gli son corona i fior.
Lo specchio di chiara fontanella
riflette fiero in sella dei Mori il vincitor.
Quand’ecco nell’acqua si compone
mirabile visione il simbolo d’amor
nel folto di lunghe trecce bionde
il seno si confonde ignudo in pieno sol.
« Mai non fu vista cosa più bella
mai io non colsi siffatta pulzella »,
disse re Carlo scendendo veloce di sell.
« Deh, cavaliere, non v’accostate
già d’altri è gaudio quel che cercate
ad altra più facile fonte la sete calmate ».
Sorpreso da un dire sì deciso
sentendosi deriso re Carlo s’arrestò ;
ma più dell’onor poté il digiuno,
fremente l’elmo bruno il sire si levò.
Codesta era l’arma sua segreta
da Carlo spesso usata in gran difficoltà ;
alla donna apparve un gran nasone
un volto da caprone, ma era Sua Maestà.
« Se voi non foste il mio sovrano »
- Carlo si sfila il pesante spadone -
« non celerei il disio di fuggirvi lontano ;
ma poiché siete il mio signore »
- Carlo si toglie l’intero gabbione -
« debbo concedermi spoglia d’ogni pudore ».
Cavaliere egli era assai valente
d anche in quel frangente d’onor si ricoprì ;
e giunto alla fin della tenzone
incerto sull’arcione tentò di risalir.
Veloce lo arpiona la pulzella
repente una parcella presenta al suo signor :
« Deh, proprio perché voi siete il sire
fan cinquemila lire, è un prezzo di favor ».
« E’ mai possibile, porco d’un cane,
che le avventure in codesto reame
debban risolversi tutte con grandi puttane !
Anche sul prezzo c’è poi da ridire
ben mi ricordo che pria di partire
v’eran tariffe inferiori alle tremila lire ».
Ciò detto, agì da gran cialtrone
con balzo da leone in sella si lanciò ;
frustando il cavallo come un ciuco
tra i glicini e il sambuco il re si dileguò.
Re Carlo tornava dalla guerra
lo accoglie la sua terra cingendolo d’allor.
Al sol della calda primavera
lampeggia l’armatura del sire vincitor.
Le Roi Charles revenait de la guerre
« Si l’anxiété de la gloire
éteint chez le vainqueur la soif de l’honneur
Elle ne te concède pas un moment pour faire l’amour.
Celui qui impose à sa douce épouse
une ceinture de chasteté, hélas, c’est grave,
peut courir dans la bataille le risque de perdre la clé ».
Ainsi se lamente le roi chrétien
Le blé s’incline autour de lui, les fleurs le couronnent.
Le miroir de la claire petite fontaine
Reflète sur sa selle le fier vainqueur des Maures.
Quand voici que dans l’eau se compose,
Admirable vision, le symbole de l’amour.
Au cœur de longues tresses blondes
se confond son sein nu en plein soleil.
« On n’a jamais vu de chose plus belle
Jamais je ne cueillis une telle pucelle »,
dit le roi en descendant rapidement de sa selle.
« Hé, chevalier, ne vous approchez pas,
D’autres déjà jouissent de ce que vous cherchez,
À une autre fontaine plus facile, apaisez votre soif ».
Surpris par une langue si décidée
s’entendant pris en dérision Charles s’arrêta.
Mais plus que l’honneur put le jeûne
en frémissant le sire ôta son casque brun.
C’était là son arme secrète
souvent utilisée par Charles dans les grandes difficultés ;
À la dame apparut un grand nez
un visage de bouc, mais c’était Sa Majesté.
« Si vous n’étiez pas mon souverain »
– Charles dégagea sa grande rapière –
« Je ne cacherais pas mon désir de vous fuir au loin
Mais puisque vous êtes mon seigneur »
– Charles enlève toute sa cuirasse –
« Je dois me donner dépouillée de toute pudeur ».
C’était un cavalier très vaillant
et dans cette situation aussi d’honneur il se couvrit ;
et arrivé à la fin du duel
incertain il tenta de remonter sur l’arçon.
Rapide, la pucelle le harponne
et soudain ses honoraires elle présente à son seigneur :
« Ah, c’est bien parce que vous êtes le roi,
que je ne prends que cinq mille, c’est un prix de faveur ».
« C’est pas Dieu possible, nom d’un chien,
Qu’en ce royaume, les aventures
doivent toutes se résoudre avec de grandes putains !
Même sur le prix, il y a à redire
Je me souviens bien qu’avant mon départ,
Les tarifs étaient inférieurs à trois mille lires ».
Cela dit, comme un grand goujat
D’un bond de lion, en selle il s’élança.
Fouettant son cheval comme un bourricot
Dans les glycines et le sureau, le roi disparut.
Le Roi Charles revient de la guerre
sa terre l’accueille le ceignant de laurier.
Au soleil du chaud printemps
Scintille l’armure du Sire vainqueur.
Tonino e Carlomagno
Tonino e Carlomagno
Tonino aveva quindici anni come noi
ma era già capace di stringere una donna
perché lui lavorava nel cantiere con suo nonno
e di mattina a scuola aveva sempre sonno.
E mostrava fiero i muscoli scoprendo forte il braccio
quando insieme sulle scale si parlava di coraggio.
Portaci Tonino ancora alla cantina
sentiremo gli ubriachi ricordare
e parleranno delle guerre che non han mai perso
se di medaglie d’oro rifiutate.
Ma le guerre giù da noi son perse tutte
dentro ai vicoli e alle case c’è odore di morte.
Carlo Magno re di Spagna
va nel lago e non si bagna
va nel fuoco e non si brucia
Carlo Magno inventa la luce.
Vecchia dolce cantilena
non so chi me l’ha insegnata
qui la guerra ai Saraceni
non è ancora terminata.
C’erano soltanto donne intorno
al grande letto della vecchia pazza moribonda.
Le han messo quel vestito ricamato, già da tempo
preparato per le nozze del ritorno.
Per salire la collina certo scarpe belle avrai
e ti vestiranno a nuovo ma non te ne accorgerai.
Mancava l’acqua da tre giorni, le donne alla finestra.
Era uno sciopero, tu credevi che fosse festa :
una festa senza gli abiti e i sorrisi
solo un fazzoletto rosso al collo dei più accesi.
Quanti scioperi, Tonino, che abbiamo fatto qui per l’acqua
ma non è cambiato nulla: si porta sempre la stessa giacca.
Carlo Magno re di Spagna
va nel lago e non si bagna
va nel fuoco e non si brucia
Carlo Magno inventa la luce.
Vecchia dolce cantilena
non so chi me l’ha insegnata
qui la guerra ai Saraceni
non è ancora terminata.
C’è stato il terremoto e lassù al borgo del castello
copre l’erba adesso quello che è distrutto.
Lo visita soltanto il vento o chi si dà un appuntamento
Seuls le visitent l’amoureux, le vento quelli che lassù han lasciato tutto.
Chiudi gli occhi Tonino e non cercare oltre la sera :
anche là dietro a quei monti non si è vista la primavera.
Raccontaci se è vero che l’hai vista
la malombra senza testa di un barone giustiziato.
Si muove a mezzanotte tra i cespugli e nelle grotte
Là où il y a plus de cent ans, il fut pendu.
Solo fumo è la paura che nasconde il tuo orizzonte
ricordati che i padroni son soltanto malombre.
Tonin avait quinze ans comme nous autres.
Mais lui, il savait déjà embrasser une femme.
Car il travaillait au chantier avec son grand-père,
Et le matin il avait toujours sommeil à école.
Il montrait ses muscles, en découvrant son bras, tout fier,
Quand ensemble sur l’escalier, on parlait de courage.
Tonin mène-nous encore au bistrot.
Nous entendrons les ivrognes, les héros,
Ils parleront des guerres qu’ils n’ont jamais perdues.
Et des médailles d’or refusées.
Mais les guerres chez nous ont toutes été perdues.
Il y a une odeur de mort dans nos maisons et dans nos rues.
Charlemagne, roi d’Espagne,
va dans le lac et ne se mouille pas ;
va dans le feu et ne se brûle pas.
Charlemagne invente la lumière.
Vieille et douce cantilène,
Je ne sais qui me l’a enseignée
Ici la guerre aux Sarrasins
N’est pas encore terminée.
Il y avait seulement des femmes autour
du lit de la vieille folle moribonde.
Elles lui ont mis ce vêtement, depuis longtemps déjà
préparé pour les noces du retour.
Pour monter la colline, tu auras sûrement
de belles chaussures
Et elles te vêtiront de neuf, mais tu ne t’en apercevras pas.
L’eau manquait depuis trois jours, les femmes à la fenêtre.
C’était une grève, tu croyais que c’était la fête :
une fête sans les costumes et sans les sourires
avec au cou un mouchoir rouge des plus ardents.
Combien de grèves pour l’eau, Tonin, avons-nous faites ?
Mais rien n’a changé : on porte toujours le même vêtement.
Charlemagne, roi d’Espagne,
va dans le lac et ne se mouille pas ;
va dans le feu et ne se brûle pas.
Charlemagne invente la lumière.
Vieille et douce cantilène,
Je ne sais qui me l’a enseignée.
Ici la guerre aux Sarrasins
N’est pas encore terminée.
Il y a eu un tremblement de terre et au bourg du château
L’herbe recouvre maintenant ce qui est détruit.
Seuls le visitent l’amoureux, le vento
Ou ceux qui ont tout laissé là-haut.
Ferme les yeux Tonin et ne cherche pas par delà la nuit :
Même derrière ces montagnes, on n’a pas vu le printemps.
Raconte-nous s’il est vrai que tu l’as vu
L’ombre sans tête d’un baron exécuté.
Elle danse à minuit entre les buissons et dans les grottes
Souviens-toi que les maîtres sont seulement des ombres.
C’est une chanson de l’Orchestra, l’étiquette musicale du groupe Stormy Six ; les deux auteurs venaient de la Commission Culturelle du Movimento Studentesco, et ils utilisèrent des musiciens venus de groupes de jazz. Deux personnages s’opposent : Tonin est un pauvre qui travaille sur les chantiers comme son grand-père mais n’aime pas l’école (celle dont on dit qu’elle fut créée par Charlemagne) ; c’est un de ceux pour qui toutes les guerres sont des défaites, ceux qui doivent se battre pour avoir de l’eau, ceux qui ne voient jamais quand arrive le printemps ; l’autre personnage est Charlemagne, évoqué à travers une comptine populaire chantée par les enfants, et qui est présenté de façon ridicule (il va dans le feu mais ne se brûle pas, etc.), lui pour qui la guerre est une cantilène, lui qui ne perd jamais de bataille et grâce à qui les soldats boivent du vin et s’enivrent… mais la guerre contre les Sarrasins n’est pas encore finie ; c’est presque un dieu, il invente la lumière ! On évoquera Roland plutôt dans les poèmes chevaleresques.
Un des personnages qui ont le plus inspiré les italiens dans leur histoire culturelle fut en effet celui de Roland (Orlando ou Rolando), que l’on retrouve dans la littérature chevaleresque, des poèmes chevaleresques du XIVe siècle à Andrea da Barberino (1370-1431) (I Reali di Francia), puis à Matteo Maria Boiardo (1440-1494) et à Lodovico Ariosto (1474-1533) (Le Roland amoureux et le Roland furieux), et les cantastorie du sud continuent la tradition. La Chanson de Roland est régulièrement rééditée en traduction ou en bilingue. À notre époque, L’un de ceux qui reprennent ce thème est Sergio Endrigo (1933-2005) dans sa chanson Lorlando de 1970, rééditée en 2005 et reprise par le groupe Il Parto delle nuvole pesanti (créé en 1991) en 2002 ; Endrigo connaissait évidemment bien Boiardo et l’Arioste.
Lorlando
[Ascoltate brava gente cosa dicono
i Cristiani dei feroci Musulmani]
Ecco sono arrivati i Mori, avanza già la mezzaluna
E sulle mura di Palermo, di Granada e Barcellona
Non parlano latino
(la pelle la hanno scura)
Han fatto a pezzi un frate,
(il Papa ne ha paura)
Non sanno il Paternoster,
distruggono le vigne,
non mangiano il maiale,
hanno mogli cento e mille,
Guerra, guerra nel nome del Signore
dalla Francia all’Inghilterra
Per la fede e per l’onore
aspettano la spada nel terrore dell’Islam,
L’Orlando.
[Or diciamo senza offesa i fedeli di Maometto,
dei Cristiani cosa han detto]
Ecco sono partiti i matti
con i pennacchi e i gonfaloni
C’è un vescovo a cavallo
e dietro gli straccioni
Bestemmiano in latino
(in sassone ed in franco)
Si schiacciano i pidocchi
(sul mento rosso e bianco)
Si bevono le vigne, si rubano il maiale,
han cento concubine
ma la moglie è chiusa a chiave.
Guerra, guerra nel nome del profeta
Dalla Mecca a Gibilterra
tutti pronti a dar la vita
E la testa taglieremo al nemico dell’Islam
L’Orlando.
Era un terremoto l’Orlando,
il cavalier senza paura,
con la spada durlindana, una forza di natura
Ha rotto mille teste
(in mille guerre sante)
Salvò regine bionde
(dal drago e dal gigante)
Ma da quando Carlo Magno
l’ha fatto il paladino
Dimentica gli amici
per le femmine ed il vino
Guerra guerra ma l’Orlando è innamorato
Solo Angelica la bella
dritto al cuore l’ha ferito,
La forza ormai gli manca
e più non guarirà
L’Orlando.
Era innamorato L’Orlando
e nel dolcissimo duello
Anche un grande capitano
può rimetterci il cervello.
L’hanno visto mezzo nudo
(ormai è proprio matto)
Ormai il suo nemico
(lo porta in mezzo al petto)
E i Mori a cento e a mille
conservano la testa.
Se in casa non c’è il gatto
tutti i topi fanno festa.
Guerra, guerra ma l’Orlando non ci viene :
C’è chi dice che è un vigliacco,
e chi dice che fa bene
Ma c’è un solo uomo al mondo
che sa la verità,
L’Orlando.
Oyez, bonnes gens, ce que disent
les Chrétiens des féroces Musulmans
Voilà que les Maures sont arrivés, le croissant avance déjà
Et sur les murs de Palerme, de Grenade et de Barcelone
Ils ne parlent pas latin
(Ils ont la peau sombre)
Ils ont coupé un Frère en morceaux,
(le Pape en a peur)
Ils ne savent pas le Notre Père,
ils détruisent les vignobles,
ils ne mangent pas de cochon,
ils ont des femmes par cent et par mille,
Guerre, guerre ! au nom du Seigneur
de la France à l’Angleterre,
Pour la foi et pour l’honneur
ils attendent l’épée dans la terreur de l’Islam,
le Roland.
[Maintenant, sans offense, qu’ont dit des Chrétiens
les fidèles de Mahomet ?]
Voilà que les fous sont partis
avec leurs panaches et leurs étendards
Il y a un évêque à cheval
et derrière les va-nu-pieds
Ils jurent en latin
(en saxon et en franc)
Ils écrasent leurs poux
(sur leur menton rouge et blanc)
Ils boivent les vignes, ils volent les cochons,
ils ont cent concubines
mais leur femme est ferme à clé.
Guerre, guerre ! au nom du Prophète
De La Mecque à Gibraltar
tous prêts à donner notre vie
Et nous couperons la tête à l’ennemi de l’Islam
le Roland.
C’était un tremblement de terre, le Roland,
le chevalier sans peur,
avec son épée Durandal, une force de la nature
Il a cassé mille têtes
(dans mille guerres saintes)
il a sauvé des reines blondes
(du dragon et du géant)
Mais depuis que Charlemagne
l’a fait Paladin
Il oublie ses amis
pour les femmes et le vin
Guerre, guerre ! mais le Roland est amoureux
Seule la belle Angélique
l’a blessé en plein coeur,
Désormais la force lui manque
et il ne guérira plus
le Roland.
Il était amoureux le Roland
et dans le très doux duel
Même un grand capitaine
peut perdre la tête.
On l’a vu à moitié nu
(maintenant il est vraiment fou)
Désormais son ennemi
(il le porte au milieu de la poitrine)
Et les Maures par cent et par mille
conservent sa tête.
Si dans la maison il n’y a pas de chat
tous les rats font la fête.
Guerre, guerre ! mais le Roland n’y vient pas :
Il y en a qui disent que c’est un lâche,
et d’autres qui disent qu’il fait bien.
Mais il y a un seul homme au monde
qui sait la vérité,
le Roland.
Roberto Roversi (1923-2012) et Lucio Dalla (1943-2012) ont écrit en 1973 une Canzone d’Orlando dans le disque Il giorno aveva cinque teste. Mais ils semblent se référer plus au roman de Virginia Woolf (1882-1941), Orlando (1923) qu’au paladin de Charlemagne : le dernier vers de chaque strophe, « Anser anser che va » renvoie en effet au dernier mot du roman : « C’est l’oie, c’est l’oie sauvage », une oie dont le nom dans la langue de Woolf est précisément « anser anser ».
Par contre, c’est dans l’Italie méridionale que les personnages de l’épopée carolingienne sont restés le sujet préféré des récits racontés par les cantastorie, ou par les vieux paysans qui se retrouvaient sur les bancs de la place publique. Aujourd’hui, L’Opera dei Pupi continue à faire des représentations sur ce même thème ; c’est un théâtre de marionnettes créé vers la fin du XIXe siècle à Naples et au début du XXe siècle en Sicile, placé en 2008 par l’UNESCO dans les Patrimoines Oraux et Immatériels de l’Humanité. Il se sont inspirés de la littérature chevaleresque, de la Chanson de Roland au Roland furieux de l’Arioste et à la Storia dei Paladini di Francia, ce long roman chevaleresque de Giusto Lodico écrit entre 1858 et 1860 (13 volumes dans les rééditions de 1971-72 et de 2000), qui reprend tous les épisodes du Cycle carolingien français et italien. Le mot « pupi » vient du latin « pupus » = l’enfant, et c’est le nom qui fut donné aux marionnettes.
Voici une histoire racontée par l’Opera dei Pupi, celle d’un duel entre Roland et Olivier, tous deux amoureux de la belle princesse Angélique. Une des sources du récit est peut-être aussi le poème de Victor Hugo (18002-1885) dans la Légende des siècles (1859 et 1877), qui ne parle cependant pas d’Angélique ; le texte de Merlino est donc probablement une création à partir de toutes ces sources, que le théâtre de marionnettes sicilien avait déjà traitées :
Vinnita e Durlindana
Vinnita e Durlindana
Giganti da muntagna
diavulu di ferru
cadisti 'nta na ragna
frisca di nu serru.
Na bedda principessa
divinni a patrunessa
di Carlu 'mpiraturi
cavaleri di lu ciuri.
Vinnitta e Durlindana
Sonati la campana
Vinnitta e Durlindana
Sonati la campana.
Rinaldu e pois Orlandu
furunu amici e poi nemici
nta foresta di la "fogghia".
Ma l’angelu Gabrieli vigghia
E ‘nzonnu a Carlu parra : “Va a sarvari
Li to figghia si no morti si li pigghia”
Du jorna lunghi jorna
notti lunghi notti
durau lu duellu
signuri chi macellu !
La bedda principessa
santo cori lu serpenti
vivia alla funtana
di du poviri 'nnucenti.
Vinnitta e Durlindana
Sonati la campana
Vinnitta e Durlindana
Sonati la campana.
Ma Carlu arriva prestu :
“Chi fati svinturati ?
Alli porti di Parigi
Africani morti infliggi !
Nginichia si jttaruli
prodi cavaleri
cu gesti tutti veri
Perdono Maestà, vinnitta si farà."
Vinnitta e Durlindana
Sonati la campana
Vinnitta e Durlindana
Les deux États, L’Église et l’EmpireBénédictins et monachisme
Toute l’histoire de la christianisation de l’Occident intéresse de près l’histoire de l’Italie. Dans un premier temps, la nouvelle religion venue de Palestine s’implante lentement et avec difficulté du fait en particulier des « hérésies », c’est-à-dire des diverses interprétations du message évangélique ; elle est combattue par l’autorité impériale et connaît le martyre, parce qu’elle ne reconnaissait pas le pouvoir absolu et « divin » de l’empereur, apparaissant ainsi comme un acte de désobéissance en même temps qu’une forme d’athéisme. À la tête des groupes organisés par les Chrétiens il y avait le personnage de l’évêque, qui entretenait la vérité nouvelle : une vie menée avec les autres hommes mais ayant comme objectif la vie en Dieu, le « monde » étant une terre étrangère.
Après son installation par Constantin (272-306-337), l’Église chrétienne apparaît autrement, comme un nouveau pouvoir s’opposant au pouvoir politique : ce sont deux autorités qui se reconnaissent dans les mêmes valeurs religieuses mais qui s’opposent pour savoir qui sera le maître de la chrétienté. Tout le Moyen-Âge va se référer à la pensée d’Augustin, évêque d’Hippone, formulée surtout dans son ouvrage De civitate Dei (413-426), où il distingue la cité de Dieu et la cité terrestre des hommes. Dans l’héritage de ce développement idéologique et de cette théorie des deux cités, vont apparaître deux visions opposées des rapports entre la nouvelle Église et l’empire.
La première avait pour origine l’évêque palestinien Eusèbe de Césarée (265-339.
formé dans un milieu arien, il maintenait que le Fils et le Saint Esprit étaient de nature diverse et inférieure à celle du Père ; il était en rapport étroit avec l’empereur Constantin et avait été réhabilité en 325 par le Concile de Nicée dont il avait accepté la conclusion. Il défend le primat de l’empereur chrétien sur toute l’humanité, au-dessus de l’Église et de l’État, et en ce sens l’empereur se sert de l’une et de l’autre pour guider l’humanité vers le Christ ; l’empereur est donc assimilé au Père, supérieur même au pape, qui n’est que le successeur du Fils. On imagine mal combien ce débat théologique qui peut nous apparaître lointain fut important politiquement, faisant de l’empereur celui qui devait guider l’humanité vers Dieu par tous les moyens, y-compris militaires ; cela commanda toute la théocratie orientale, où l’Église a certes son rôle doctrinal et liturgique, mais ne peut l’exercer que par la médiation de l’empereur.
À l’opposé s’affirmait la théologie d’Ambroise (340-397), évêque de Milan, repris et développé par le pape Gélase I (492-496 - Ci-contre son emblème pontifical) : l’Église a un rôle de guide de l’humanité dans son chemin vers Dieu et n’a besoin d’aucune médiation politique, elle impose son primat spirituel sur le pouvoir temporel ; les deux sont autonomes, certes, mais le temporel est soumis au spirituel qui peut intervenir sur toute question politique et juridique. Les empereurs Constantin et Théodose représentaient la conception « eusébienne » suivis par les empereurs d’Orient jusqu’en 1453 (chute de Constantinople, vaincue par l’armée des Turcs musulmans), date à laquelle elle se transfère à Moscou dans l’empire orthodoxe.
Cette vision « eusébienne » marque aussi la partie de l’Italie restée sous le pouvoir de l’empire byzantin, toute l’Italie méridionale et la Sicile, où l’occupation arabe soutenait la même position, un État sacralisé dans lequel coïncident les pouvoirs politique et religieux. Par la suite, le pouvoir de l’empereur Frédéric II (1194-1220-1250), « empereur des Romains », reprend cette conception théocratique, lui qui connaissait aussi la pensée de l’Islam.
Quand arrivent les Longobards, il n’y a pas encore d’État de l’Église, et ce qu’on appelle « patrimoine de Saint-Pierre » est encore inclus dans les territoires contrôlés par l’empire byzantin, qui a récupéré sous Justinien (527-565) ses terres italiennes (avec l’aide des grands propriétaires terriens), africaines et espagnoles. Les Vandales annulleront tout cela, provoquant la dégradation des communications, des routes, des canaux de drainage, des aqueducs, l’abandon des plaines (les habitants se réfugient sur les hauteurs pour raisons de sécurité et d’hygiène) ; la misère augmente considérablement.
Mais quand les Longobards veulent s’emparer des terres byzantines, le pape fait appel aux Francs qui créent donc les « États de l’Église » en remettant au pape les terres byzantines reprises aux Longobards. Byzance est désormais trop loin et trop affaiblie. L’Europe est alors entrée pour deux siècles, entre le VIe et le VIIIe siècles, dans une de ses périodes les plus sombres ; elle décline depuis le Ve siècle, malgré les tentatives de reprise de l’ostrogoth Théodoric (493-526). La première « peste noire » (bubbonique) de 543, qui dure jusqu’au VIIIe siècle, aggrave encore les choses, diminuant de moitié la population européenne, réduite probablement (on manque de documents écrits) à 4 ou 5 millions au lieu des 8 ou 9 du IIIe siècle. Les Francs de Clodovée ont encore une conception sacrale de leur pouvoir, bien que convertis à un christianisme non arien, et c’est lentement que la papauté pourra affirmer sa primauté selon la théorie « gélasienne » et « agostinienne ». Charlemagne lui-même a aussi une conception « eusébienne » de son pouvoir, le pape devant simplement prier pour la victoire du roi dans sa lutte contre les ennemis de la chrétienté : il convoque par exemple lui-même et dirige lui-même avec l’aide de théologiens comme Alcuin (730-804) le Concile de Francfort en 794, où il prendra position contre l’empire byzantin iconoclaste sur le problème des images, lui est iconodule (partisan des images) : le Concile se prononce pour la pratique des images, au nom de l’incarnation du Christ, et elles deviennent pour Charlemagne un instrument d’éducation d’un peuple analphabète, Bible des pauvres, cathéchèse en images.
Il faudra attendre le pape Grégoire VII (1073-1085) pour que la lente évolution aboutisse à la formation d’un pouvoir ecclésiastique autonome, où l’Église, société eschatologiquement parfaite, « devait être aussi une société historique différente de la société politique, une société historique dans la plénitude de sa signification : avec une hiérarchie, un droit, une individualité d’État » (Claudio Leonardi, Storia d’Italia, p. 143, Bompiani, op. cit.) : le dualisme entre les deux pouvoirs, inconnu des mondes romain, oriental, juif et musulman, est maintenant reconnu ; l’État pourra se libérer de toute sacralité religieuse et marcher vers sa laïcité ; l’Église cesse d’être un service d’État, et elle prend aussi son autonomie spirituelle, étatique et politique. Le contraste entre les deux pouvoirs deviendra aussi une réalité historique. Et Grégoire VII récupère Gélase (le pape est supérieur à l’empereur) et Augustin (l’histoire est la lutte entre deux cités) : il peut porter les insignes de l’empire, il peut déposer l’empereur, il ne peut être jugé par personne, il est nécessairement saint, qui n’est pas d’accord avec l’Église ne peut se dire catholique (Voir son Dictatus) ; c’est un véritable pouvoir monarchique qui se met en place, au sommet de tous les autres pouvoirs politiques. C’est la Bulle Unam sanctam de Boniface VIII (1294-1303) qui confirmera ces principes, au moment des luttes italiennes entre Guelfes et Gibelins, qui affirmaient au contraire que les deux glaives provenaient directement de Dieu sur un plan de parité (Voir aussi le chapitre sur Dante sur le site ww.italie-infos.fr). Dans un autre sens s’affirment et le roi de France, Philippe le Bel (1285-1314) qui humiliera Boniface VIII, et les Seigneuries dans les villes italiennes ; et bientôt, le pape devra s’exiler à Avignon, sous la protection du roi de France : une autre époque va commencer.
Déjà avant la domination franque, de nombreux Francs étaient venus s’installer en Italie, en particulier dans les monastères. Avec la réforme de Charlemagne, le haut-clergé (évêques et abbés) devient déterminant dans la gestion administrative de l’Italie, à côté des administrateurs laïcs, comtes et autres. Tous composent aussi les groupes de « missi dominici », les envoyés du Seigneur qui contrôlaient le fonctionnement des régions avec lesquelles ils n’avaient pas de relations personnelles, faisaient voter les lois, faisaient faire aux sujets un serment de fidélité active. Et pendant un temps, le pouvoir civil de l’évêque est le seul à pouvoir s’opposer dans les villes à l’autorité impériale germanique ; en Italie, pays de très nombreuses villes, les évêques sont des centaines ; parmi ceux-ci, l’évêque de Rome prend de plus en plus d’importance, apparaissant comme l’héritier principal de l’empire romain, face au pouvoir politique de l’empereur byzantin ou de l’empereur germanique ; il est aussi le gardien de la culture écrite romaine (on vénère Cicéron, Virgile ou Ovide, et Charlemagne imposera la restauration d’une langue latine inspirée de Cicéron), contre la culture orale des Germains. Sur un autre plan, ce pouvoir des évêques contribue au développement autonome des villes-États qui déboucheront plus tard dans la nouvelle civilisation des communes.
Dans les campagnes, se développent au contraire les monastères, pouvoir parallèle à celui des cathédrales et des basiliques dans les villes ; ils profitent largement des contradictions, des évolutions et des difficultés de l’époque, stimulant la pratique de l’artisanat paysan. Les monastères augmentent leurs propriétés à partir de donations et d’héritages.


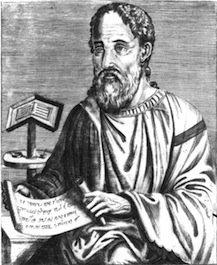


C’est Benoît de Norcia (480/490-543/547 ?), ville d’Ombrie, qui structure ces nouvelles structures ecclésiastiques, à côté du primat des évêques dans les villes. Il fonde les monastères du Mont Cassin et de Terracina (Latium). Sa Règle bénédictine exerça une influence considérable dans toute l’Europe, partageant la vie des moines entre prière, lecture et travail manuel, et les abbayes (Benoît parle de « monastères ») bénédictines se multiplient en particulier en Italie. Elles sont des lieux de rassemblement des communautés paysannes, de formation religieuse et intellectuelle, d’aide aux miséreux. La valorisation du travail fit aussi que les abbayes devinrent des centres de vie économique qui furent une des bases de la reprise économique que connut l’Italie entre le VIIIe et le Xe siècle, bonifiant les sols, développant de nouvelles cultures, de l’apiculture pour obtenir la cire pour l’éclairage des églises à l’élevage d’animaux pour les vêtements, les parchemins, les graisses, plantant des vignes et des oliveraies, développant les échanges commerciaux, construisant des moulins, des ateliers de produits alimentaires, etc.
Sur un autre plan, les abbayes sont d’importants centres de vie culturelle ; c’est là que se conservent et sont recopiés de nombreux manuscrits de littérature grecque et romaine et de littérature chrétienne ancienne : les moines copistes copiaient de 10 à 12 pages par jour, et recopier une Bible entière pouvait prendre presque un an. On illustrait aussi ces manuscrits, et ils étaient utilisés dans les nombreuses écoles créées par les Bénédictins pour former les moines, mais souvent aussi des étudiants laïques, avec un programme de « trivium » (grammaire, dialectique, rhétorique) suivi d’un « quadrivium » (arithmétique, géométrie, musique, astronomie).
L’église de Rome reste la plus riche, ayant des propriétés en Italie, Gaule, Dalmatie, Afrique, que Rome contrôle efficacement ; elle se libère des taxes qu’elle doit payer au patriarche de Constantinople, en abandonnant peu à peu l’appartenance à l’empire byzantin et en s’alliant aux « barbares » francs.
Cette époque a sans doute beaucoup chanté, mais on n’en possède pratiquement aucune trace, sinon dans les chants religieux qui se sont perpétués longtemps dans l’Église catholique, en italien ou en dialecte, et dont voici quelques exemples. Nous disposons en particulier de deux publications importantes, la première de Roberto De Simone (1933- ), La tradizione in Campania, un coffret de 7 disques 33T réalisé en collaboration avec la Région et publié en 1979 par EMI, repris en 2010 par l’éditeur Squilibri en 6 CD avec quelques ajouts sous le titre Son sette sorelle, Rituali e canti della tradizione in Campania, avec un beau volume comportant les textes et les commentaires. L’autre est publié par Albatros en 1985, Canti liturgici di tradizione orale, préparé par Piero Arcangeli, Roberto Leydi, Renato Morelli, Pietro Sassu et Carlo Oltolina ; c’est un coffret de 4 disques 33T réalisé par l’Université de Bologne ; il concerne toute l’Italie, et 2 des 4 disques sont consacrés à la Sardaigne.
Du premier recueil, citons un chant de procession, Canto per Montevergine, une introduction qui explique le sens des 6 sœurs, 6 Vierges autour de Naples qui sont l’objet d’un pèlerinage ; elle est suivie d’un chant « a ffigliola » qui mêle des strophes à la Vierge, des comptines populaires (filastrocche), une intéressante « tammurriata », une tarantelle, dans un ensemble où la louange de la Vierge va de pair avec le rite traditionnel de l’accouplement sexuel dans un champ d’oliviers, de tomates, de poivrons, d’aubergines, avec l’idée que cela favoriserait et l’abondance des fruits et légumes et la fertilité de la femme ; on célèbre aussi « Nanasse », l’ananas, fruit exotique très doux qui accompagne symboliquement les jeux érotiques. C’est une ritualité religieuse à l’opposé de ce que demandait l’Église officielle.
Longobards et Byzantins sous Rhotari
Abbaye bénédictine de Casamari (XIe s.), Veroli (Frosinone) - reconstruite par les Cisterciens au XIIe s.
Abbaye de Montecassino (530) entre Rome et Naples
1) CANTO PER MONTEVERGINE
Introduzione, canto e danza per Montevergine
Introduction, chant et danse pour Montevergine
Nell'introduzione Maria Boccia D'Aquino (contadina di Boscoreale - Salerno), racconta il mito delle Sette Madonne della Campania. Esse erano sette sorelle, sei belle ed una brutta e nera. La brutta se ne andò sulla montagna di Montevergine e così ebbe inizio il culto a quest'ultima sorella brutta che invece è la più bella. Dopo tale introduzione dialogata ha inizio il canto e la danza per Montevergine.
Zona: S. Sebastiano al Vesuvio Esecutori: Armando Gallo (canto e tamburo) - Giuseppe Simeoli (putipù) - Antonio Scarpato (castagnette). L'esecuzione ha inizio con un tradizionale canto di tipo « a ffìgliola » al quale segue poi una « tammurriata ». Da sottolineare in questa seconda parte la quantitativa presenza di filastrocche ottonarie o "barzellette", aggiunte alla normale scansione degli endecasillabi. Notevole anche la bravura di Armando Gallo nella estemporanea esecuzione di tali filastrocche. Infine la « tammurriata » si conclude con una ripresa di canto a distesa sulle strutture dei canti detti « a vvoce 'e Napule» (secondo lo stile delle voci dei venditori di Napoli).
Dans l’introduction Maria Boccia d’Aquino (paysanne de Boscoreale–Salerno) raconte le mythe des Sept Vierges de la Campanie. Elles étaient sept sœurs, six belles et une laide et noire. La laide s’en alla sur la montagne de Montevergine et ainsi commença le culte de cette dernière sœur laide qui au contraire était la plus belle. Après cette introduction dialoguée commence le chant et la danse pour Montevergine.
Zone : S. Sebastiano al Vesuvio. Exécutants : Armando Gallo (chant et tambour), Giuseppe Simeoli (putipù), Antonio Scarpato (castagnettes). L’exécution commence par un chant traditionnel de type « a ffigliola » suivi par une « tammurriata ». Il faut souligner dans cette seconde partie la présence quantitative de cantilènes (filastrocche) de 8 pieds ou « barzellette » ajoutées à la scansion normale des hendécasyllabes. Noter aussi l’exceptionnelle qualité d’Armando Gallo dans l’exécution simultanée de ces comptines. Enfin la « tammurriata » se conclut par une reprise de chant à pleine voix (a distesa) sur la structure des chants dits « a vvoce ‘e Napoli » (selon le style de voix des vendeurs de Naples).
Introduzione
– Cumm'è che ddicen"o fatto r' 'e ... Maronne che ssongosei' sòre? – A Maronn"e Muntevergine ... 'a Maronn"e Pumpei' ... 'a Maronn' 'e Mugnano ... 'e santa Filumena ... 'a Maronn' ‘o'’ Càrmene ... 'a Maronn' 'e Vagne .. : a che stammo? ... 'A cchiù brutta se ne jette a Muntevergene ... er’ ‘a Maronn’ ‘e Muntevergene. – Pecché era nera ... – Eh ... 'a Maronn' ‘o chiano ... – E pecché signo' se ne jette a Muntevergene? – E se ne jette pecché chell'er’ ‘a cchiù brutta, rice : - l' so' 'a cchiù brutt' 'e tutt' 'e ssòre meie, me n'aggi' 'a j' tanto luntano ca m'hanno 'a veni' a truva' tutt' o prùbbeco. – Se jette a mettere ncopp'a nu pizz' 'e muntagna... i – Ncopp'a nu pizz' 'e muntagna ...’o gghianco. – Era 'a settima. – Eh 'a settima, 'a l'urdema sòra. – 'A l'urdema sòra ... ricette: - l' so' cchiù brutta 'e tutt' 'e ssòre meie, me n'aggi' 'a j' tanto luntano ca m'hann' 'a veni' a truva'. – Pecché era nera ... – Invece chell'er' 'a cchiù bella! – Chell'er' 'a cchiù bella! – Ma pecché è nera? – Era nera. – Allora so' sett' 'e ssòre! – Eh ... sette sòre. – So' sei' belle e una brutta. – Sei' belle e una ... un' 'a chiammano brutta, però chellabrutta è cchiù bella! – Chella cchiù brutta è cchiù bella!– È'a Maronn"e Muntevergine. – È'a Maronn"e Muntevergine !
– Comment on dit, le récit des ... Madones qui sont six sœurs ? – La Vierge de Montevergine ... la Vierge de Pompéi ... la Vierge de Mugnano ... de sainte Philomène ... la Vierge des Carmes ... la Vierge des Bains ... Où on en est ? La plus laide s’en alla à Montevergine, c’était la Vierge de Montevergine – Parce qu’elle était noire ... – Oui ... la Vierge de la plaine ... – Et pourquoi elle est partie à Montevergine ? – Elle est partie parce que c’était la plus laide ... Elle dit : Je suis la plus laide de toutes mes sœurs, je veux m’en aller si loin que les gens devront marcher pour venir me trouver. – Elle est allée s’installer en haut d’une montagne ... – En haut d’une montagne ... sur le blanc. – C’était ... la septième. – Oui... la septième ... la dernière sœur. – La dernière sœur ... elle dit : je suis la plus laide de toutes mes sœurs, je dois m’en aller si loin qu’ils doivent venir me trouver. – Parce qu’elle était noire... – Au contraire elle était la plus belle ! – C’est elle qui était la plus belle ! – Mais parce qu’elle est noire ! – Elle était noire. – Alors il y a sept sœurs ! – Oui ... sept sœurs – Six belles et une laide – Six belles et une ... qu’on dit laide, pourtant cette laide est plus belle. – La plus laide est plus belle ! – Oui c’est la Vierge de Montevergine !
Canto e danza per Montevergine (affigliola)
Ah ... chi vo' 'ràzzia 'a chesta Vergene ca sagliesseno a Muntevergine Susivete 'uagliune 'a int'a stu lietto ca a Muntevergine nun se vène pe' durmi' se vène pe' dda' onore a Mamma Schiavona. Affacciateve figliole asti ffeneste hanno venut' 'e guagliun' 'e passione Acalàtece nu sciore 'a int'a sti tteste ammore cu wuie vulimmo fa' (a "tammurriata")Uh bella figliola ca te chiamme Rosa uh bella figliola ca te chiamme Rosa e che bellu nomme màmmeta t'ha miso che bellu nomme màmmeta t'ha misoe t'ha mis' '0 nomme bello relli rrose '0 meglio sciore ca sta 'mparaviso Uh bella figliola ca chiagne a selluzzo bella figliola ca chiagne a selluzzo - 'O nnammurato mio ca m'ha lassato '0 nnammurato mio ca m'ha lassato na pugnalata '0 core me nce ha miso na pugnalata '0 core me nce ha miso Quanto si' bella cu sti trezze appese come si' bella cu sti trezze appese cu chisti buccole arravugliate cu chisti buccole arravugliate bellu mare a bbiv'a ccòre 'a pent' 'e màmmeta nun fa Il'ove 'a penta mia e'a penta toia stéveno 'ntis' 'e via nova se rumpette 'o panaro cu Il'ove se spezzaino 'e bbalanzòle ménate 'nterra facimmo 'a prova e chi maie s' 'o ccrereva sotto a tte comme ce steva e ce sta na cosa bella comme riavulo sona bello '0 siscariello e 'a trummettella 'o tricchitracco int' 'a vunnella si nun fa Pulicenella aro' t'arrivo te sbatto 'nterra tarantella napulitana pigliame a mme ca so' pacchiana so' pacchiana e tengo onore '0 pappavallo rint' 'a caìola tira tira ca se ne vène se ne vène'a ponta r' 'o pesce chillo jera '0 baccalà si muglièrema jesce prena cumme riavulo avimm' 'a fa' ce ne jammo c' 'o marchetiello c' 'a tenaglia c' 'o martiello ce mettimmo a martellà ncopp' 'o campo r' 'aulive io te rallevo e tu te stive uh mannaggia chi t'è mmuorto aro' t'arrivo te schiaffo 'ncuorpo '0 murtal'e '0 pesaturo Il'èvera'e muro p' 'a sdignaturaSapite ch'è succieso a 'Uttaìano neh nu monaco ha vasato a na figliola faceva a mmente ca la cunfessavaquann'è stato int"a nuttata l'ha stracciato tutt' 'a suttana mamma mia c'ha cumbinato comme se sté se sté se sta chella vo' fa' chella vo' fa' chella vo' fa' comme se sté se sté se sta
Ah ... que celui qui veut des grâces de cette Vierge / monte donc à Montevergine / Levez-vous de votre lit, mes enfants / car à Montevergine on ne vient pas pour dormir / On vient pour faire honneur à Mamma Schiavona / Les filles, mettez-vous aux fenêtres / les garçons sont venus pleins de passion / Jetez-nous une fleur de ces vases / Nous voulons faire l’amour avec vous. (Tammurriata)Belle jeune fille qui t’appelles Rose / Quel beau nom t’a donné ta mère / Elle t’a donné le beau nom des roses / la plus belle fleur du paradis // Ah belle fille qui pleures et sanglotes / belle fille qui pleures et sanglotes / Mon amoureux m’a quittée / Mon amoureux m’a quittée / Il m’a donné un coup de poignard au cœur / Il m’a donné un coup de poignard au cœur // Comme tu es belle avec ces tresses accrochées / avec ces boucles enroulées / Beaux sont la mer et ton cœur / Le sexe de ta mère ne fait pas d’œufs / mon sexe et le tien / ils avaient convenu de se retrouver sur la route / Le panier s’est brisé avec les œufs / les balances se sont cassées / jetés par terre faisons l’essai // Et qui aurait jamais cru / sous toi comme on était bien / et c’est une belle chose / comme ça marche bien / le sifflet et la trompette / un feu d’artifice sous ta jupe / si Polichinelle ne le fait pas / où je t’attrape je te jette par terre // Tarentelle napolitaine / prends-moi moi qui suis une paysanne / je suis une paysanne et une femme d’honneur / le perroquet dans la cage / il tire il tire tant qu’il s’en vient / il s’en vient le bout du poisson / c’était une morue / Si ma femme reste enceinte / que diable ferons-nous ? Nous nous en allons avec le train / avec les tenailles et le marteau / et nous nous mettons à marteler // Sur le champ d’oliviers / je te serrais et tu étais d’accord / Ah maudit celui qui est mort pour toi / Là où je te rejoins, je t’enfile dans le corps / le mortier et le pilon / l’herbe du mur pour ton pied foulé // Savez-vous ce qui est arrivé à Ottaviano ? (village près de Naples) / un moine a embrassé une fille / il faisait semblant de la confesser // Et il est resté toute la nuit / il lui a arraché toute sa jupe / Ma mère qu’est-ce qu’il a combiné / Comme elle est d’accord, comme elle est d’accord / Elle veut le faire / Elle veut le faire / Elle veut le faire / Comme elle est d’accord.
Écoutons dans le deuxième recueil un chant religieux de Piano d’Arta, près d’Udine (Frioul), Puer natus est. C’est un chant de la période de Noël qui se caractérise par une alternance entre une strophe en latin et de brèves strophes en dialecte frioulan, fait assez rare qui révèle aussi un chant très archaïque, où on entend des voix aigues de femmes et des voix d’hommes. Le chant, dit Pietro Arcangeli (op. cit. p. 57) était exécuté du premier dimanche après Noël jusqu’à l’Épiphanie, et il était lié à des chants de quête, c’est-à-dire de « questua », où la procession demandait des dons en nature ou en argent pour les pauvres, pour les enfants, pour la confrérie, etc. Puis les voix d’adultes furent remplacées par des voix d’enfants jusqu’à ce que le chant disparaisse, avant d’être « ressuscité » vers le début des années 1970 par Francesco Del Colle.
C’était donc un chant de fête, où la communauté se retrouvait, après des semaines de dur travail des champs, peut-être sous l’impulsion de la confrérie locale (la confratèrnita), autre réalité qui a pratiquement disparu, mais qui exista depuis le haut Moyen-Âge, association laïque la plus importante qui imposait son autonomie par rapport à la hiérarchie ecclésiastique qui combattit cette forme d’organisation, surtout à partir du Concile de Trente qui renforce le contrôle bureaucratique des évêques et des prêtres sur les communautés de fidèles. On craignait aussi dans la hiérarchie que ces confréries ne deviennent une base de contestation du pouvoir central ; ce phénomène de méfiance s’accrut à partir de l’Unité Italienne de 1861, où le pouvoir exécutif national voulut aussi affirmer son pouvoir et réduire les confréries à un rôle d’assistance.
PUER NATUS EST
Puer natus est in Bethlemin Bethlem
Unde gaudet Jerusalem
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Christus est natus hodie
Christus est natus hodie
Lusive la luna come ‘n biel dì
Come ‘n biel dì
Quant’ che Maria parturì
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Christus est natus hodie
Christus est natus hodie
Lusivin i monz i cjamps e i pràsi cjamps e i pràsi
pareve d‘istàt in ogni luc
parevi d’istàt in ogni luc
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Christus est natus hodie
Christus est natus hodie
L’Enfant est né à Bethléem
c’est pourquoi Jérusalem se réjouit
Alleluia, Alleluia, Alleluia
Le Christ est né aujourd’hui
La lune resplendissait comme en plein jour
quand Marie accoucha
Les monts, les champs et les prés resplendissaient
On aurait dit l’été en tous lieux.
Mais ceci n’est que l’histoire des classes dominantes, car la majorité de la population, les paysans et les habitants de la campagne, ne connaissait pratiquement pas l’histoire des rois et des empereurs, ils ne savaient pas l’histoire des événements européens, des luttes et des successions dynastiques, ils ne faisaient que les subir à travers les guerres qui détruisaient leurs fermes et leurs champs, ou à travers la fiscalité et les droits qui leur étaient imposés. La vie dans les campagnes restait précaire et misérable, l’Italie était encore couverte de forêts et de marais, où on pratiquait un élevage sauvage, quelques vaches, quelques cochons, et plus près de la maison, des poules qui apportaient un peu plus de richesse et de variété à l’alimentation quotidienne. Que le propriétaire des terres soit romain, goth, lombard, franc, ne changeait pas grand chose, l’exploitation était la même. Dans les villas romaines puis dans les « curtes » médiévales, jusqu’au XIe siècle, la production se partageait entre la « pars domenica », la partie réservée au seigneur, cultivée par les esclaves puis par les serfs et la « pars massaricia » donnée en concessions à des fermiers (les « massari ») qui payaient en remettant une partie de leur récolte au propriétaire. Par ailleurs la dispersion de plus en plus grande des propriétés éloignait toujours plus le « massaro » du propriétaire, permettant le développement d’une agriculture moins fermée et plus dynamique. Mais les conditions de vie restaient médiocres, on se nourrissait avec un peu de pain, une soupe de fèves enrichie d’un peu de lard ou de viande, accompagnée d’un peu de vin, dans une économie dont les techniques changeaient peu, basée sur la triade méditerranéenne, blé, vigne, olivier, où l’une des rares nouveautés fut, vers 1100, le moulin à eau.

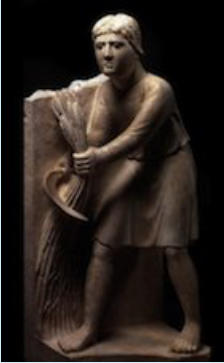
C’est pourquoi, « l’histoire » vécue par les paysans se déroulait surtout au rythme de la nature, des saisons, des travaux des mois : c’est ce qu’on trouvait parfois représenté sur les façades des églises plus que les portraits des rois et des empereurs. La littérature avait aussi chanté ces représentations du travail des mois, sous l’inspiration des Fastes d’Ovide ou des Géorgiques de Virgile, puis des Carmina mensium de l’époque carolingienne : Bonvesin de la Riva (1240-1315) vers 1313 (Disputatio mensis), les sonnets des mois des poètes florentins Folgore di San Gimignano (1270-1332) et Cenno della Chitarra (? -1338) (vers 1310-1320) et beaucoup d’autres (Voir des détails sur : ww.treccani.it/enciclopedia/mesi)). Plusieurs cantaurori, en particulier Roberto Tombesi (avec le groupe Calicanto né en 1981) et Francesco Guccini, très attaché aux traditions locales, ont repris ce thème des mois.
I dodese mesi de l’ano
Mi che son genaro forte,
Moi qui suis le fort mois de janvier
tute le vècie s’ingura la morte,
toutes les vieilles souhaitent la mort
le giovani se gode,
et les jeunes jouissent
drento e fora de le porte :
à l’intérieur et hors des portes :
mi che son genaro forte.
Moi qui suis le fort mois de janvier
Mi che son febraro curto
Moi qui suis le court mois de février
che l’è un mese cussì fino,
qui est l’un des mois si fins
che ‘l va via col brustolino,
qu’il s’en va avec le givre
po’ el vien casa co’ ‘na carga :
et qu’il revient chargé de froid ;
de febraro no se parla.
de février on ne parle pas.
Mi che son marzo dal vento,
Moi qui suis le venteux mois de mars
‘na pelliza l’ò comprata,
j’ai acheté une pelisse
e me mama me l’ha data,
et ma maman me l’a donnée
che la porta in ogni tempo :
car elle la porte par tous les temps :
mi che son marzo dal vento.
Moi qui suis le venteux mois de mars
Mi che son april pulito,
Moi qui suis le propre mois d’avril
quel che fa fiorir le tere,
celui qui fait fleurir la terre
salatina e erbe bele,
de la petite salade et de petites herbes de printemps,
de ogni albaro fiorito :
des fleurs sur chaque arbre :
mi che son aprii pulito.
Moi qui suis le propre mois d’avril
Mi che son màgio dei fiori,
Moi qui suis le mois de mai des fleurs
quel che porta la ghirlanda
celui qui porte la guirlande
se e bòcoli d’ogni bande
et boutons de toute sorte
e che sa di mille odori :
et qui a mille odeurs ;
mi che son màgio dei fiori
Moi qui suis le mois de mai des fleurs
Mi che son giugno che tàjo,
Moi qui suis le mois de juin qui coupe
perché tàjo ogni coltura,
parce que je coupe toutes les cultures
el formento e la pastura,
le blé et le foin
che son mejio de màgio :
et qui suis mieux que le mois de mai ;
mi che son giugno che tàjo.
Moi qui suis le mois de juin qui coupe
Mi che son lujo che bato,
Moi qui suis le mois de juillet qui bat,
tuto el giorno su le are,
toute la journée sur les aires,
el formento e le segale,
le froment et le seigle
con quel sol devento mato :
avec ce soleil je deviens fou :
mi che son lujo che bato.
Moi qui suis le mois de juillet qui bat.
Mi che son ‘gosto che pesca,
Moi qui suis le mois d’août qui pêche
a la pesca mi son ‘ndà,
et à la pêche je suis allé,
un bel luzzo go ciapà,
j’ai pris un beau brochet,
una scarua e ‘na tenca :
un poisson d’eau douce et une tanche :
mi che son gosto che pesca.
Moi qui suis le mois d’août qui pêche
Mi che son settembre uese,
Moi qui suis le mois de septembre porteur de fruits
quel che fa boir i tini,
celui qui fait bouillir les cuves
merlò, clinto e marzemini,
merlot, Clinto et Marzemini
per dar sbagolo a chi beve :
pour donner de l’euphorie à celui qui boit :
mi che son settembre uese.
Moi qui suis le mois de septembre porteur de fruits
Mi che son ottobre straco,
Moi qui suis le mois d’octobre fatigué
a la caza mi son ‘ndà
je suis allé à la maison
ciapo in lievore inco,
chasser le lièvre caché
me ‘o meto drento al saco :
et je l’ai mis dans mon sac :
mi che son ottobre straco.
Moi qui suis le mois d’octobre fatigué.
Mi che son novembre in pene,
Moi qui suis le mois de novembre en peine,
quel che fa scampare i osei,
celui qui fait fuir les oiseaux,
i osei e le rondanele,
les oiseaux et les hirondelles,
perché in gabia no i se tiene :
parce qu’en cage on ne les garde pas :
mi che son novembre in pene.
Moi qui suis le mois de novembre en peine,
Mi che son dezembre fredo,
Moi qui suis le mois de décembre froid
porto neve e la fumana,
j’apporte la neige et le brouillard,
co la piova se impantana,
avec la pluie on s’embourbe,
serco scarpe e no le vedo :
je cherche des souliers et je ne les vois pas :
mi che son dezembre fredo.
Moi qui suis le mois de décembre froid.
I dodici mesi dell’anno
Les douze mois de l’année
Mi che son genaro forte,
Moi qui suis le fort mois de janvier
tute le vècie s’ingura la morte,
toutes les vieilles souhaitent la mort
le giovani se gode,
et les jeunes jouissent
drento e fora de le porte :
à l’intérieur et hors des portes :
mi che son genaro forte.
Moi qui suis le fort mois de janvier
Mi che son febraro curto
Moi qui suis le court mois de février
che l’è un mese cussì fino,
qui est l’un des mois si fins
che ‘l va via col brustolino,
qu’il s’en va avec le givre
po’ el vien casa co’ ‘na carga :
et qu’il revient chargé de froid ;
de febraro no se parla.
de février on ne parle pas.
Mi che son marzo dal vento,
Moi qui suis le venteux mois de mars
‘na pelliza l’ò comprata,
j’ai acheté une pelisse
e me mama me l’ha data,
et ma maman me l’a donnée
che la porta in ogni tempo :
car elle la porte par tous les temps :
mi che son marzo dal vento.
Moi qui suis le venteux mois de mars
Mi che son april pulito,
Moi qui suis le propre mois d’avril
quel che fa fiorir le tere,
celui qui fait fleurir la terre
salatina e erbe bele,
de la petite salade et de petites herbes de printemps,
de ogni albaro fiorito :
des fleurs sur chaque arbre :
mi che son aprii pulito.
Moi qui suis le propre mois d’avril
Mi che son màgio dei fiori,
Moi qui suis le mois de mai des fleurs
quel che porta la ghirlanda
celui qui porte la guirlande
se e bòcoli d’ogni bande
et boutons de toute sorte
e che sa di mille odori :
et qui a mille odeurs ;
mi che son màgio dei fiori
Moi qui suis le mois de mai des fleurs
Mi che son giugno che tàjo,
Moi qui suis le mois de juin qui coupe
perché tàjo ogni coltura,
parce que je coupe toutes les cultures
el formento e la pastura,
le blé et le foin
che son mejio de màgio :
et qui suis mieux que le mois de mai ;
mi che son giugno che tàjo.
Moi qui suis le mois de juin qui coupe
Mi che son lujo che bato,
Moi qui suis le mois de juillet qui bat,
tuto el giorno su le are,
toute la journée sur les aires,
el formento e le segale,
le froment et le seigle
con quel sol devento mato :
avec ce soleil je deviens fou :
mi che son lujo che bato.
Moi qui suis le mois de juillet qui bat.
Mi che son ‘gosto che pesca,
Moi qui suis le mois d’août qui pêche
a la pesca mi son ‘ndà,
et à la pêche je suis allé,
un bel luzzo go ciapà,
j’ai pris un beau brochet,
una scarua e ‘na tenca :
un poisson d’eau douce et une tanche :
mi che son gosto che pesca.
Moi qui suis le mois d’août qui pêche
Mi che son settembre uese,
Moi qui suis le mois de septembre porteur de fruits
quel che fa boir i tini,
celui qui fait bouillir les cuves
merlò, clinto e marzemini,
merlot, Clinto et Marzemini
per dar sbagolo a chi beve :
pour donner de l’euphorie à celui qui boit :
mi che son settembre uese.
Moi qui suis le mois de septembre porteur de fruits
Mi che son ottobre straco,
Moi qui suis le mois d’octobre fatigué
a la caza mi son ‘ndà
je suis allé à la maison
ciapo in lievore inco,
chasser le lièvre caché
me ‘o meto drento al saco :
et je l’ai mis dans mon sac :
mi che son ottobre straco.
Moi qui suis le mois d’octobre fatigué.
Mi che son novembre in pene,
Moi qui suis le mois de novembre en peine,
quel che fa scampare i osei,
celui qui fait fuir les oiseaux,
i osei e le rondanele,
les oiseaux et les hirondelles,
perché in gabia no i se tiene :
parce qu’en cage on ne les garde pas :
mi che son novembre in pene.
Moi qui suis le mois de novembre en peine,
Mi che son dezembre fredo,
Moi qui suis le mois de décembre froid
porto neve e la fumana,
j’apporte la neige et le brouillard,
co la piova se impantana,
avec la pluie on s’embourbe,
serco scarpe e no le vedo :
je cherche des souliers et je ne les vois pas :
mi che son dezembre fredo.
Moi qui suis le mois de décembre froid.
CANZONE DEI DODICI MESI
Viene Gennaio silenzioso e lieve
Voilà Janvier silencieux et léger
un fiume addormentato
un fleuve endormi
fra le cui rive giace come neve
entre ses rivages repose telle la neige
il mio corpo malato.
mon corps malade.
Sono distese lungo la pianura
De blanches files de champs
bianche file di campi
son comme amanti dopo l'avventura,
sont étendues le long de la plaine
neri alberi stanchi.
ils sont comme des amants après l'aventure, des arbres noirs et las.
Viene Febbraio, e il mondo è a capo chino
Voilà Février et le monde va tête basse
ma nei conviti e in piazza
mais dans les festins et dans la rue
lascia i dolori e vesti da Arlecchino
quitte tes douleurs et habille-toi en Arlequin
il carnevale impazza.
le carnaval bat son plein.
L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore
L'hiver est long encore, mais dans nos coeurs
appare la speranza
apparaît l’espérance
nei primi giorni di malato sole
dans les premiers jours de soleil malade
la primavera danza.
le printemps danse.
Cantando Marzo porta le sue piogge
Mars en chantant apporte ses pluies
la nebbia squarcia il velo,
la brume déchire son voile,
porta la neve sciolta nelle rogge
le sourire du dégel
il riso del disgelo.
conduit dans les canaux la neige fondue.
Riempi il bicchiere, e con l'inverno butta
Emplis ton verre et jette avec l'hiver
la penitenza vana
la vaine pénitence
l'ala del tempo batte troppo in fretta
trop vite bat l'aile du temps
la guardi, è già lontana.
tu la regardes et déjà elle est loin.
O giorni, o mesi, che...
O jours, o mois qui...
sempre simile a voi
toujours elle vous ressemble
è questa vita mia ;
cette vie qui est la mienne ;
diverso tutti gli anni
chaque année différent
ma tutti gli anni uguali
mais chaque année égale
la mano di tarocchi
une main de tarots
che non sai mai giocare.
que tu ne sais pas prendre.
Con giorni lunghi al sonno dedicati
Avec ses longues journées consacrées au
il dolce Aprile viene
sommeil, voilà le doux Avril
quali segreti scoprì in te il poeta
quels secrets découvrit en toi le poète
che ti chiamò crudele ?
qui t'appela cruel ?
Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi
Mais c'est durant tes jours qu'il fait bon
po fatto l'amore
s'endormir en ayant fait l'amour
come la terra dorme nella notte
comme durant la nuit la terre
dopo un giorno di sole.
dort après une journée de soleil.
Ben venga Maggio e il gonfaloniere amico
Que soit bien venu Mai et son gonfalon ami
ben venga primavera
que soit bien venu le printemps
il nuovo amore getti via l'antico
que le nouvel amour rejette l'ancien
nell'ombra della sera ;
dans l'ombre du soir ;
ben venga Maggio, ben venga la rosa
que soit bien venu Mai, bienvenue à la rose
che è dei poeti il fiore,
qui des poètes est la fleur,
mentre la canto con la mia chitarra
tandis que je la chante avec ma guitare
brindo a Cenne e a Folgore.
je trinque en l'honneur de Cenne et Folgore.
Giugno, che sei maturità dell'anno
Juin, toi qui es la maturité de l'année
di te ringrazio Dio
je remercie Dieu de ta présence
in un tuo giorno, sotto al sole caldo
c'est dans un de tes jours sous un soleil
ci sono nato io ;
chaud que je suis né moi-même;
e con le messi che hai fra le tue mani
et avec les moissons que tu as dans les mains
ci porti il tuo tesoro,
tu nous apportes ton trésor,
con le tue spighe doni all'uome il pane
avec tes épis tu donnes à l'homme le pain
alle femmine l'oro.
et aux femmes l'or.
O giorni, o mesi che...
O jours, o mois qui ...
Con giorni lunghi di colori chiari
Avec de longues journées aux couleurs claires
ecco Luglio il Leone,
voici Juillet le Lion
riposa e bevi, e il mondo attorno appare
repose-toi et bois : autour de toi le monde
come in una visione.
apparaît comme dans une vision.
Non si lavora, Agosto, nelle stanche
On ne travaille pas, Août, dans tes longues
tue lunghe oziose ore,
heures d'oisive lassitude,
mai come adesso è bello inebriarsi
jamais comme à présent il n'est bon
di vino e di calore.
de s'enivrer de vin et de chaleur.
Settembre è il mese dei ripensamenti
Septembre est le mois des retours en arrière
sugli anni e sull'età
sur les ans et sur l'âge
dopo l'estate porta il dono usato
après l'été il apporte le don usagé
della perplessità.
de la perplexité.
Ti siedi e pensi e ricominci il gioco
Tu t'assieds et tu penses et tu recommences
della tua identità
le jeu de ton identité
come scintille brucian nel tuo fuoco
comme des étincelles brûlent dans ton feu
le possibilità.
tes possibilités.
Non so se tutti hanno capito, Ottobre,
je ne sais pas s’ils ont tous compris, Octobre
la tua grande bellezza,
ta grande beauté,
nei tini grassi come pance piene
dans les cuves grasses comme des ventres pleins
prepari mosto e ebbrezza.
tu prépares le moût et l'ivresse.
Lungo i miei monti, come uccelli tristi,
Le long de mes montagnes, comme des oiseaux tristes
fuggono nubi pazze,
fuient des nuages fous,
lungo i miei monti, colorati in rame
le long de mes montagnes aux couleurs de cuivre
fumano nubi basse.
de cuivre fument des nuages bas.
O giorni, o mesi che...
O jours, o mois qui …
Cala Novembre, e le inquietanti nebbie
Tombe Novembre et ses brumes inquiétantes
gravi coprono gli orti
et lourdes couvrent les potagers
lungo i giardini consacrati al pianto
le long des jardins consacrés aux pleurs
si festeggiano i morti.
on fête les morts.
Cade la pioggia, ed il tuo viso bagna
Tombe la pluie qui baigne ton visage
di gocce di rugiada,
de gouttes de rosée,
te pure, un giorno, cambierà la sorte
toi aussi un jour le sort te changera
nel fango della strada.
en boue de la route.
E mi addormento come in un letargo
Et je m'endors comme pris de léthargie,
Dicembre, alle tue porte
Décembre, à tes portes
lungo i tuoi giorni con le mente spargo
le long de tes jours je disperse en esprit
tristi semi di morte.
de tristes semences de mort.
Uomini e cose lasciano per terra
Hommes et choses laissent à terre
esili ombre pigre
de fines ombres paresseuses
ma nei tuoi giorni, dai profeti detti
mais c'est durant tes jours qu'annoncèrent les prophètes
nasce Cristo la Tigre.
que naît Jésus le Tigre.
Viene Gennaio silenzioso e lieve
Voilà Janvier silencieux et léger
un fiume addormentato
un fleuve endormi
fra le cui rive giace come neve
entre ses rivages repose telle la neige
il mio corpo malato.
mon corps malade.
Sono distese lungo la pianura
De blanches files de champs
bianche file di campi
son comme amanti dopo l'avventura,
sont étendues le long de la plaine
neri alberi stanchi.
ils sont comme des amants après l'aventure, des arbres noirs et las.
Viene Febbraio, e il mondo è a capo chino
Voilà Février et le monde va tête basse
ma nei conviti e in piazza
mais dans les festins et dans la rue
lascia i dolori e vesti da Arlecchino
quitte tes douleurs et habille-toi en Arlequin
il carnevale impazza.
le carnaval bat son plein.
L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore
L'hiver est long encore, mais dans nos coeurs
appare la speranza
apparaît l’espérance
nei primi giorni di malato sole
dans les premiers jours de soleil malade
la primavera danza.
le printemps danse.
Cantando Marzo porta le sue piogge
Mars en chantant apporte ses pluies
la nebbia squarcia il velo,
la brume déchire son voile,
porta la neve sciolta nelle rogge
le sourire du dégel
il riso del disgelo.
conduit dans les canaux la neige fondue.
Riempi il bicchiere, e con l'inverno butta
Emplis ton verre et jette avec l'hiver
la penitenza vana
la vaine pénitence
l'ala del tempo batte troppo in fretta
trop vite bat l'aile du temps
la guardi, è già lontana.
tu la regardes et déjà elle est loin.
O giorni, o mesi, che...
O jours, o mois qui...
sempre simile a voi
toujours elle vous ressemble
è questa vita mia ;
cette vie qui est la mienne ;
diverso tutti gli anni
chaque année différent
ma tutti gli anni uguali
mais chaque année égale
la mano di tarocchi
une main de tarots
che non sai mai giocare.
que tu ne sais pas prendre.
Con giorni lunghi al sonno dedicati
Avec ses longues journées consacrées au
il dolce Aprile viene
sommeil, voilà le doux Avril
quali segreti scoprì in te il poeta
quels secrets découvrit en toi le poète
che ti chiamò crudele ?
qui t'appela cruel ?
Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi
Mais c'est durant tes jours qu'il fait bon
po fatto l'amore
s'endormir en ayant fait l'amour
come la terra dorme nella notte
comme durant la nuit la terre
dopo un giorno di sole.
dort après une journée de soleil.
Ben venga Maggio e il gonfaloniere amico
Que soit bien venu Mai et son gonfalon ami
ben venga primavera
que soit bien venu le printemps
il nuovo amore getti via l'antico
que le nouvel amour rejette l'ancien
nell'ombra della sera ;
dans l'ombre du soir ;
ben venga Maggio, ben venga la rosa
que soit bien venu Mai, bienvenue à la rose
che è dei poeti il fiore,
qui des poètes est la fleur,
mentre la canto con la mia chitarra
tandis que je la chante avec ma guitare
brindo a Cenne e a Folgore.
je trinque en l'honneur de Cenne et Folgore.
Giugno, che sei maturità dell'anno
Juin, toi qui es la maturité de l'année
di te ringrazio Dio
je remercie Dieu de ta présence
in un tuo giorno, sotto al sole caldo
c'est dans un de tes jours sous un soleil
ci sono nato io ;
chaud que je suis né moi-même;
e con le messi che hai fra le tue mani
et avec les moissons que tu as dans les mains
ci porti il tuo tesoro,
tu nous apportes ton trésor,
con le tue spighe doni all'uome il pane
avec tes épis tu donnes à l'homme le pain
alle femmine l'oro.
et aux femmes l'or.
O giorni, o mesi che...
O jours, o mois qui ...
Con giorni lunghi di colori chiari
Avec de longues journées aux couleurs claires
ecco Luglio il Leone,
voici Juillet le Lion
riposa e bevi, e il mondo attorno appare
repose-toi et bois : autour de toi le monde
come in una visione.
apparaît comme dans une vision.
Non si lavora, Agosto, nelle stanche
On ne travaille pas, Août, dans tes longues
tue lunghe oziose ore,
heures d'oisive lassitude,
mai come adesso è bello inebriarsi
jamais comme à présent il n'est bon
di vino e di calore.
de s'enivrer de vin et de chaleur.
Settembre è il mese dei ripensamenti
Septembre est le mois des retours en arrière
sugli anni e sull'età
sur les ans et sur l'âge
dopo l'estate porta il dono usato
après l'été il apporte le don usagé
della perplessità.
de la perplexité.
Ti siedi e pensi e ricominci il gioco
Tu t'assieds et tu penses et tu recommences
della tua identità
le jeu de ton identité
come scintille brucian nel tuo fuoco
comme des étincelles brûlent dans ton feu
le possibilità.
tes possibilités.
Non so se tutti hanno capito, Ottobre,
je ne sais pas s’ils ont tous compris, Octobre
la tua grande bellezza,
ta grande beauté,
nei tini grassi come pance piene
dans les cuves grasses comme des ventres pleins
prepari mosto e ebbrezza.
tu prépares le moût et l'ivresse.
Lungo i miei monti, come uccelli tristi,
Le long de mes montagnes, comme des oiseaux tristes
fuggono nubi pazze,
fuient des nuages fous,
lungo i miei monti, colorati in rame
le long de mes montagnes aux couleurs de cuivre
fumano nubi basse.
de cuivre fument des nuages bas.
O giorni, o mesi che...
O jours, o mois qui …
Cala Novembre, e le inquietanti nebbie
Tombe Novembre et ses brumes inquiétantes
gravi coprono gli orti
et lourdes couvrent les potagers
lungo i giardini consacrati al pianto
le long des jardins consacrés aux pleurs
si festeggiano i morti.
on fête les morts.
Cade la pioggia, ed il tuo viso bagna
Tombe la pluie qui baigne ton visage
di gocce di rugiada,
de gouttes de rosée,
te pure, un giorno, cambierà la sorte
toi aussi un jour le sort te changera
nel fango della strada.
en boue de la route.
E mi addormento come in un letargo
Et je m'endors comme pris de léthargie,
Dicembre, alle tue porte
Décembre, à tes portes
lungo i tuoi giorni con le mente spargo
le long de tes jours je disperse en esprit
tristi semi di morte.
de tristes semences de mort.
Uomini e cose lasciano per terra
Hommes et choses laissent à terre
esili ombre pigre
de fines ombres paresseuses
ma nei tuoi giorni, dai profeti detti
mais c'est durant tes jours qu'annoncèrent les prophètes
nasce Cristo la Tigre.
que naît Jésus le Tigre.
On voit combien les activités et les images de paysages sont différentes, de la Vénétie à l’Émilie. Quant à l’image finale, « Christ le Tigre », que personne n’expliquait, on en trouve une explication dans un blog de l’écrivain Adriano Ercolani sur Il Fatto Quotidiano du 29 décembre 2015, Natale : ‘E venne Cristo la Tigre’. Il commente la signification de la fête de Noël et sa valeur universelle, qui réside dans la Résurrection, et à la fin de son article, il explique quelques expressions, terminant par le « Cristo la Tigre » de Guccini. Il réfère l’expression à une poésie de Thomas Stearns Eliot (1888-1965), Gerontion, de 1919 : In the juvescence of the year En la jouvence de l’année Came Christ the tiger. Vint Christ le tigre. (Voir la poésie de T. S. Eliot et sa traduction par Pierre Leyris dans : fr.scribd.com).
III. La féodalité s’installe, et subsiste même dans le modèle communal
L'Italie a donc connu une période où s'est développée une économie féodale, entre le VIIIe et le XIe siècle, en commençant par les Longobards, mais surtout après l'éclatement de l'empire carolingien.
Qu'est-ce que la féodalité ?
Ruggiero Romano (1923-2002) a très bien résumé cette question. Il en définit trois caractéristiques :
Un bénéfice (il beneficio)
La concession à usage précaire (sans propriété) d'un bien, une terre, un droit, une fonction, et cela existait déjà dans le bas-empire romain. Mais ce qui est nouveau, c'est que celui qui reçoit le bénéfice devient le « vassus », le vassal, du gaulois « uassos » devenu en latin médiéval « vassus » = « serviteur », puis « homme en arme », qui donne « vassal » comme adjectif puis comme substantif dans le sens de « noble dépendant d'un seigneur dont il tient un « fief » (il fèudo), mot d'origine discutée, probablement germanique venu par les Longobards. La nouveauté du vassal est qu'il est solennellement « investi » dans une cérémonie au cours de laquelle le seigneur le touche avec un symbole de son autorité (son sceptre par exemple), c'était ce qu'on appelait « l'inféodation ». Le vassal est le « feudataire » (il feudatario).
La fidélité au seigneur
Cela obligeait le vassal à la fidélité au seigneur (senior, dominus), principe de vassalité (il vassallaggio), éthique et religieux plus que juridique, un vassal peut par exemple divorcer si sa femme ne veut pas le suivre lorsqu'il doit accompagner le seigneur à la guerre. La nature de « l'hommage » (l'omaggio) peut être différente. Le vassal peut aussi concéder une partie de son bien à un sous-vassal appelé « vavasseur » (il valvassore), qui s'engage à son tour à lui prêter fidélité, et cela va peu à peu désagréger l'autorité du seigneur. Car le vavasseur peut à son tour diviser son bien en le remettant, dans les mêmes conditions, à un arrière-vassal (il valvassino) qui n'a pas les mêmes droits juridictionnels.
L'immunité du bénéficiaire
D'autant plus que le bénéficiaire dispose d'une immunité, par laquelle le seigneur renonce à son propre droit de justice et de fiscalité. Ainsi le feudataire peut empêcher des fonctionnaires du seigneur d'inspecter son territoire ; c'est une véritable capitulation du pouvoir central devant les droits du feudataire, alors que l'hommage féodal visait à renforcer le contrôle du roi ou de l'empereur sur tous ses sujets à travers cette pyramide féodale.
Bientôt, vue la faiblesse des héritiers de Charlemagne, la société féodale est conduite à la multiplication des duchés, des comtés (comes, comitis), des grands seigneurs qui se rendent indépendants de l'empereur, et ce sera souvent le conflit entre eux. (Voir : www.herodote.net/histoire).
Ainsi on peut dire qu'il n'y a pas de féodalité « pure », mais qu'il y eut dès l'origine une corruption du principe et que ce qui prévalut, ce fut l'usage (la consuetudine). Or les usages étaient multiples selon les régions féodalisées, de la Marche du Frioul au Marquisat d'Ivrée, du Marquisat de Toscane au Duché de Bénévent, chaque région étant elle-même divisée en plusieurs petits Marquisats dominés par autant de dynasties : la fragmentation se développe dans le tissu féodal, et deux juridictions s'y affrontent, le droit franc et le droit lombard.
Le premier, qui s'affirme dans l'Italie méridionale et en Sicile, établissait que le patrimoine n'est transmissible qu'à l'aîné des fils et il est indivisible ; le second, dominant dans l'Italie du centre et du nord, dit au contraire que le patrimoine est divisible entre les enfants. Cela explique la permanence des fiefs en Italie du Sud et la fragmentation en Italie centrale et septentrionale, qui se traduit par un développement du particularisme provincial du centre et du nord, une sorte d'anarchie, qui va à l'encontre de ce grand projet impérial où les féodaux devaient former une courroie de transmission entre le sommet de la pyramide de l'État et l'ensemble du peuple, et ce faisant assurer l'unité générale, la justice et la paix.
Seul Frédéric II (ci-contre Frédéric II et son faucon, image de son De arte venandi cum avibus) tenta d'imposer cette vision de l'État à ses féodaux, avec cet idéal de justice et de paix, qui incluait aussi l'utilisation de la force militaire et une violence parfois immense. Après lui, on retrouva cette situation où les féodaux rivalisaient, s'accordaient, se combattaient, selon les moments historiques. L'anarchie fut la même dans l'aristocratie religieuse : les évêques des villes et les abbés des monastères se comportent de plus en plus comme n'importe quel seigneur féodal laïque.
Cela va conduire à l'élection par les féodaux d'un roi d'Italie toujours plus faible face à leur importance économique et sociale. La liste des rois d'Italie entre 813 et 973 (voir ci-dessous) manifeste très bien cette faiblesse face aux féodaux qui les élisent ; Hugues de Provence sera un des rares à résister un peu à la pression des Grands. Puis la dynastie des Othons s'opposa à la grande féodalité au profit des évêques et des feudataires mineurs. Et plus tard, c'est Arduin (965-1014), le marquis de la Marche d'Ivrée, qui fut élu roi d'Italie par la grande féodalité laïque contre l'empereur germanique Henri II de Saxe (976-1014-1024), mais il dut se retirer quand Henri descendit en Italie en 1004 puis en 1013. Ce sont des exemples de cette anarchie qui règne alors en Italie, et qui, de la même façon, influence l'élection des papes romains.
L'accentuation de l'anarchie contribua peu à peu à affaiblir les Grands au profit des petits feudataires et des évêques, à qui les Souverains concèdent de plus en plus de privilèges pour affaiblir les Grands féodaux. La féodalité ne disparaît pas, mais elle change de forme, et sombre dans un désordre incroyable d'alliances, puis de conflit entre évêques, rois d'Italie, empereur, pape, comtes, bourgeoisie, etc. Et de là sort souvent l'apparition des premières Communes libres, comme à Milan (Voir dans le texte de Romano l'histoire des conflits entre le roi Conrad II et l'évêque de Milan Ariberto (970-1018-1045). C'est souvent dans les interstices de l'histoire que se forgent des éléments nouveaux.
En effet la bourgeoisie prend de l'ampleur, et le « modèle communal » se crée peu à peu. Celui-ci n'investit cependant qu'une partie des villes italiennes : de 200 à 300 villes forment des communes à la fin du XIIe siècle, mais au moins 80% de la population vit dans les campagnes, atteignant au total 6,5 millions de personnes en 1100 et 11 millions en 1300. Et dans toutes les communes qui se forment (Pise en 1081, Asti en 1095, Milan en 1097, Arezzo en 1098, Gênes en 1099, etc.), le gouvernement est certes autonome et constitué dans une sorte de démocratie, mais il faut comprendre aussi que le lien reste fort avec la féodalité qui s'est infiltrée dans la commune et continue à contrôler l'armée et une partie de la Justice.
Certes les communes luttent contre les féodaux et souvent détruisent leurs châteaux, les obligeant à venir habiter en ville, mais les hommes qui dépendaient du seigneur du château continuent d'être sous sa dépendance. La limite est donc floue entre féodalité et commune, les petits féodaux s'intègrent dans la gestion de la commune, se rapprochent de la grande bourgeoisie ; on arrivera ainsi à une évolution vers les « seigneuries » dans presque toutes les communes à partir du XVe siècle : voir déjà la domination des « Noirs » (le « popolo grasso ») dans la Florence de Dante Alighieri (1265-1321), exilé et condamné à mort parce qu'il était « blanc » (petite bourgeoisie).
C'est pourquoi Giambattista Vico parle dans sa Scienza Nuova (1724 et 1742) de « nature éternelle des fiefs » (Chap. XXXI). De nouveaux châteaux se construisent à côté des villas (le château reste le symbole de la puissance de la noblesse de sang), et il faut attendre la Révolution Française et les suites de l'Unité Italienne (fin XIXe s.) pour voir véritablement affaiblie la féodalité : bien au-delà de la Sicile et de l'Italie du Sud, les grands fiefs continueront à exister. Bien sûr, les « purs » rapports personnels définis au début de ce texte ne se maintiendront plus, il ne restera que les « abus » du système, comme dit Romano (pp. 116 sq). Un exemple est celui de la pratique de ce qu'on appelle souvent le jus primae noctis, selon lequel le seigneur aurait eu le droit (jus) de passer la nuit de noces (la première nuit = primae noctis) avec la jeune mariée et de la déflorer. Or ce « droit » n'a jamais existé, c'était simplement une pratique (une fruitio = une jouissance) déviante de beaucoup de seigneurs, qui n'avaient le droit que de percevoir de leurs vassaux une taxe de mariage.
Ainsi David Winspeare (1775-1847) a pu établir une liste de ces abus pour le Royaume de Naples (Storia degli abusi feudali, Naples, 1883) ; ainsi, on pratique la torture dans les interrogatoires de justice alors que les statuts officiels ne l'autorisent pas, etc. Les droits réels du citoyen deviennent donc flous, parce que non appliqués par les gouvernants qui ne font que ce qui leur plaît, ce qui fait peser une menace permanente pour tout le peuple. Si à Florence, qui n'est déjà plus une république communale, le duc Francesco de Médicis (1574-1587) a pu « reféodaliser » la ville et son gouvernement, c'est probablement aussi parce que, dans la commune modèle qu'était Florence, la féodalité n'avait jamais disparu entre le XIIe et le XVIe siècle, et cela représente une forme d'esprit, un mode de vie, qui pèsent sur la vie quotidienne des plus faibles, et qui persisteront jusqu'au XIXe siècle, et, qui sait ?, jusqu'à l'Italie devenue bourgeoise et capitaliste...


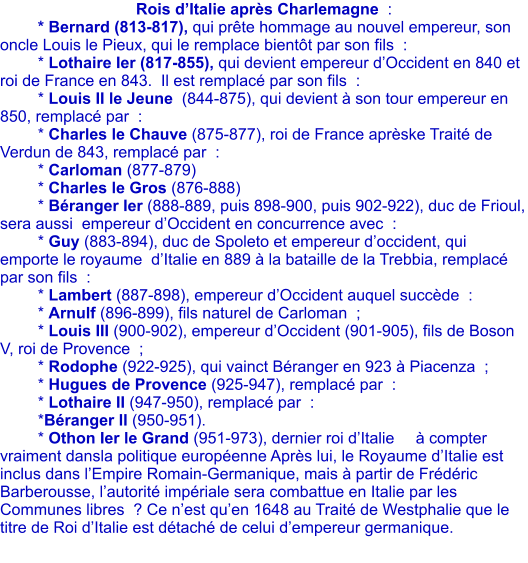
Les dynasties des Othons (Ottoni) de Saxe, des Saliens, des Hohensataufen :
- – Enrico I (919-936), dit « l’uccellatore » (l‘oiseleur) pour sa passion de la chasse au faucon, grand vainqueur des envahisseurs hongrois
- – Ottone I (962-973), dit « le Grand », son fils, couronné empereur en 962 et roi d’Italie
- – Ottone II (973-983), son fils, vaincu dans sa lutte contre les musulmans en Sicile
- – Ottone III (983-1004), son fils fasciné par la Rome impériale mais décédé trop jeune
- – Enrico II (Henri II) (1002-1024), dit « le Saint », cousin d’Othon III. Meurt sans héritier.
C’est la dynastie Salienne de Franconie, avec Corrado II Salico (le Salique) qui succéda aux Othons :
- – Conrad II (1027-1039) le Salique, petit-fils d’Othon III. Roi d’Italie en 1026, empereur en 1027.
- – Henri III (1046-1056) dit Le Noir
- – Henri IV (1084-1108), fils du précédent. Querelle des investitures avec le pape Grégoire VII, à qui il se soumet à Canossa en 1077.
- – Henri V (1105-1125), fils du précédent qu’il détrône.
Après un intermède féodal, ce sont les Hohenstaufen de Souabe qui reprennent l’empire :
- – Conrad III (1138-1152)
- – Frédéric I Barberousse (1152-1190)
- – Henri VI (1190-1197), son fils, époux de Constance d’Altavilla, père de :
- – Frédéric II (1220-1250)
- – Conrad IV (1250-1254)
L'Italie a été incontestablement le pays d'Europe, avec les Flandres, où il y eut le plus grand développement du régime « communal ». Encore faut-il s'entendre sur ce qu'il représentait.
D'abord, comme on l'a dit, la féodalité italienne n'atteignit jamais son épanouissement total : elle se développa relativement tard, et on ne peut pas dire que la commune se substitue à la féodalité, alors qu'en réalité, les deux régimes coexistent et coexisteront longtemps. Inversement, l'Italie a été dès l'an Mille une civilisation urbaine qui, de plus, héritait de la civilisation romaine, elle-même très urbanisée face aux Germains qui représentaient une civilisation plus nomade et guerrière ; et c'est à partir des villes que se développa le nouveau régime socio-économique des communes dans l'Italie du centre et du nord.
Les villes du sud (Naples, Sorrente, Amalfi, Gaète, etc.) avaient anticipé le développement du nord, et avaient acquis leur autonomie communale, mais les rois normands puis les Hohenstaufen suffoquent très vite ces autonomies pour renforcer le pouvoir central de l'Empire tandis qu'au centre et au nord, les communes étaient déjà assez fortes pour s'affirmer contre la volonté de Frédéric Ier Hohenstaifen Barberousse (1122-1152-1190) et de Frédéric II (1194-1250), finalement vaincu, par sa mort et par la défaite et la mort de son fils Manfred (1232-1266) en 1266. Les communes purent donc prendre de plus en plus d'extension sur le « contado », c'est-à-dire les circonscriptions agricoles qui les entourent (de là le mot de « contadino » = le paysan, face au « cittadino », = le citadin et le citoyen).
Inversement, les communes, qui atteignent leur plus grande splendeur après la mort de Frédéric II, ne sont jamais l'équivalent d'« États » libres au sens moderne du terme, car elles ne sortent jamais du respect de l'autorité impériale ou pontificale : c'est déjà de Frédéric Barberousse que les communes obtiennent des privilèges économiques, fiscaux, juridictionnels, dans le cadre de la loi impériale, après la défaite de l'empereur en 1176 à Legnano et les paix de Venise en 1177 et de Constance en 1183, mais cela ne supprime pas l'autorité impériale. Simplement celle-ci devient plus lointaine, elle est affaiblie, tandis que l'autorité pontificale doit aussi s'éloigner en se transférant à Avignon, et cela permet aux communes de consolider leur liberté et leur puissance et de constituer des entités politiques et juridiques qui peuvent avoir leur propre indépendance de politique intérieure et extérieure. De ce point de vue, l'Italie fut pendant trois siècles à l'avant-garde de toute l'Europe.
Mais, de même qu'il n'y a pas eu de régime féodal « pur », il n'y a pas eu de communes « à l'état pur ». D'abord parce qu'il y a une grande diversité de communes : à part la plaine du Pô et l'Italie centrale, les régions périphériques comme le Frioul, le Trentin, le Piémont, le Val d'Aoste ou les régions du sud n'ont connu qu'un système communal réduit. Ensuite parce que la nouvelle classe « bourgeoise » communale a toujours dû passer des compromis avec l'aristocratie des grands propriétaires fonciers et avec l'aristocratie urbaine. Le seul élément dominant dans toute l'Italie est l'affirmation de l'indépendance de la ville, sous la gestion collective d'une classe dominante oligarchique qui étend toujours plus son pouvoir sur les territoires environnants. L'existence d'une monnaie d'or communale en est le meilleur symptôme, le « zecchino » de Venise, le « fiorino » de Florence, le « genoino » ou ducat de Gênes. C'est une société « marchande », d'un nouveau type, mais où le mot « marchand » inclut avec les bourgeois les couches aristocratiques qui se sont insérées dans la production préindustrielle et dans la transformation et commercialisation des produits, d'abord et surtout des produits agricoles.
Au départ, les hommes « libres » de la ville vont former peu à peu une classe de notables (i maggiorenti) qui gouvernent avec l'évêque et avec les détenteurs de pouvoirs publics désignés par l'empereur ou le roi, et c'est l'évêque qui domine : il a été le protecteur de la ville dans les périodes de crise, il est souvent devenu le saint patron pour avoir sauvé sa ville ; il a aidé au développement des nouvelles activités industrielles, commerciales, bancaires, il a construit et entretenu les murailles de la ville, fait construire des cathédrales d'autant plus grandes que la ville voulait marquer sa grandeur, il a souvent exercé l'ensemble des pouvoirs publics, y compris militaires.
Mais quand le développement économique et démographique des villes devient assez important, les notables vont lutter pour diminuer le rôle de l'évêque et pour gérer eux-mêmes leurs affaires, formant un corps politique homogène qui élargit le groupe des dirigeants mais le limite toujours aux notables propriétaires enrichis, et ne ressemble en rien à une « démocratie » au sens propre du mot : les révoltes des ouvriers des différentes corporations, comme celle des « ciompi » (les ouvriers cardeurs les plus pauvres de l'industrie textile) à Florence en 1378, sous la direction de Michele di Lando (1343- ? ) (Cf. image ci-contre à la Loggia del mercato Nuovo de Florence) en seront la meilleure preuve. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit entre les divers éléments de la classe dirigeante, en particulier avec l'aristocratie féodale qui continuait toujours à assurer la défense militaire de la ville (les « milites »), et contre l'empereur à qui on réclame toujours plus de libertés sans remettre en cause son autorité.
Dans un premier temps, à partir du XIe siècle, se crée une magistrature qui gouvernera la ville : les « consuls », élus par l'assemblée des citoyens qui lui donnent tous les pouvoirs de justice, d'administration et de défense, au nombre de deux ou trois et jusqu'à 20, pour une durée maximale d'un an. En même temps, la commune se donne des statuts, et toute une administration de spécialistes se développe, où s'intègrent les aristocrates féodaux du « contado » que l'on oblige à venir habiter en ville, où la tour de leur palais devient le symbole de leur puissance ; les luttes politiques se déroulent en général entre différentes factions nobiliaires qui se disputent le pouvoir (voir les histoires de Romeo Montechi et Giulietta Capuleti à Vérone, lutte entre les Montaigus et les Capulets, à la tête des factions guelfe et gibeline). La commune consulaire est attaquée d'une part depuis le haut par les clans nobiliaires, d'autre part depuis le bas par la bourgeoisie (notaires, juges, marchands …) et les petits aristocrates exclus du pouvoir, tous ceux qui se constituent en corporations (le « arti »), c'est-à-dire le « popolo », le peuple, qui ne fait partie ni des milites, les « soldats » ni des nobles, mais qui va bientôt s'organiser lui-même en « società delle armi » dans les quartiers ou les paroisses, en accord avec les associations économiques des corporations : deux conceptions de la commune s'opposent, et les conflits se font vite jour dès la victoire extérieure sur Frédéric Barberousse.
À Milan apparaît la « Credenza di Sant'Ambrogio » représentant le peuple avec celle qu'on appelle déjà la « Motta » représentant l'aristocratie foncière, les grandes familles marchandes, contre les nobles et le clergé, et la violence et le désordre augmentent de façon insupportable.
C'est alors qu'apparaît une nouvelle forme de pouvoir communal, celle du « podestat ». Dans un premier temps, il alterne avec les consuls, puis vers le milieu du XIIIe siècle on passe à un podestat étranger, extérieur et supérieur aux factions, qui correspond aussi aux attentes de la religiosité populaire et des Ordres mendiants dont les manifestations se multiplient (les « flagellants » de 1260), mais aussi des marchands, des banquiers, des grands artisans qui ont besoin de paix pour travailler et qui appuient le « popolo grasso » contre leurs adversaires, les « magnati », les grands aristocrates fonciers et les restes de la féodalité, affaiblis par l'institution d'impôts directs selon le cadastre (la grandeur de la propriété foncière) et « l'allibramento » (l'allivrement = fixation du revenu net imposable selon le cadastre et la classification des parcelles). Le podestat est un professionnel, venu généralement de l'aristocratie, mieux formée à tous les niveaux, militaire, juridique, économique : cela fait aussitôt apparaître un certain nombre de grandes familles qui donneront naissance à une bureaucratie professionnelle qui se déplace avec toutes ses composantes, juges, administrateurs, hommes d'armes, etc., et la fonction devient souvent héréditaire à partir du XIVe siècle.
Si bien que peu à peu, le « peuple mineur » s'organise parallèlement avec son capitaine du peuple, équivalent populaire du podestat, mais qui, pour des raisons de compétence vient souvent aussi de l'aristocratie urbaine mieux formée ou de la vieille féodalité ; cela sera la base de « seigneuries », exemptes d'impôts et bénéficiant de privilèges en échange de leur service militaire. Ainsi se crée une fusion entre l'ancienne aristocratie et la nouvelle classe dirigeante communale du « popolo grasso ». C'est alors que les villes accroissent leur pouvoir sur le « contado », la campagne environnante dont les châtelains sont de plus en plus contraints de venir habiter en ville.
Les « communes » sont donc une organisation évolutive dans laquelle, même dans celles où les corporations marchandes sont les plus développées, ce sont les « Arts majeurs » qui l'emportent, s'opposant et se substituant peu à peu à l'ancienne classe dominante féodale, dans un conflit qui est moins d'intérêts de classe que de vision de la vie sociale :
- d'un côté, le modèle de vie nobiliaire chevaleresque, fondé sur les armes, la vengeance privée, le luxe, dans les châteaux ;
- de l'autre, un modèle de comportement « bourgeois » selon la « vita civile », « consciemment fondé sur une tradition de goût du travail (« laboriosità »), d'accumulation et de réinvestissement des capitaux, d'ordre public confié à des lois ayant valeur territoriale avant tout.
Les pivots centraux de ce nouveau modèle de comportement sont constitués par la substitution de la justice publique à la représaille ou à la vengeance privée, par la lutte pour une plus grande équité fiscale, par l'extension de l'autorité politique et juridictionnelle de la ville sur toute la campagne, avec l'affirmation de la pleine propriété allodiale (exempte de droits féodaux) et avec le déclin du pouvoir territorial des seigneurs de la campagne et de l'aristocratie urbaine. Enfin, surtout à partir du XIVe siècle, ce nouveau modèle de comportement joue sur la démilitarisation de la société communale : en effet, les marchands, banquiers, entrepreneurs préfèrent payer des troupes mercenaires plutôt que de tolérer la présence agitée des soldats (« milites ») urbains (Storia d'Italia, Bompiani, op. cit., p. 215). D'où les « Ordonnances de Justice » de Florence ou de Bologne.
Mais pratiquement partout, ce nouveau modèle se développe au profit d'une nouvelle oligarchie marchande qui va résister tant aux tentatives de retour à un pouvoir seigneurial comme celle du Duc d'Athènes à Florence en 1343 qu'aux tentatives d'insurrection populaire comme la révolte des « Ciompi » en 1378. Et c'est la ville qui continue à être l'élément dominant de l'histoire italienne, au moins dans le centre-nord. Les habitants de la campagne restent l'immense majorité de la population dominée par la ville : les paysans furent esclaves sous l'empire romain, mais, toujours moins nombreux, devinrent des serfs de la glèbe, attachés à la terre de leurs seigneurs, et même devenus formellement « indépendants », ils sont soumis à la loi de leurs propriétaires ; et la ville dépend de la campagne d'abord pour son alimentation, qui se commercialise peu à peu (voir l'importance des marchés et des foires), pour son industrie textile (la laine des moutons, le lin et le coton, la culture du mûrier pour les vers à soie), pour de nombreux artisans (le cuir des animaux, le bois des forêts …). La paysannerie reste la classe dominée souvent sans beaucoup de droits, livrée parfois à des révoltes sans succès possible.
Écoutons ce « contrasto » entre le paysan et le citadin : le contrasto est un des genres les plus traditionnels de représentation populaire, souvent improvisé par les cantastorie sur un thème convenu, et qui avait un large auditoire, du fait de ses termes simples qui évoquaient des conflits de la vie quotidienne, richesse-pauvreté, bon-méchant, justice-prévarication ; le contrasto était toujours écrit en hendécasyllabes et en strophes de 8 vers (« l'ottava rima »), et le dernier vers de la strophe devait rimer avec le premier de la strophe suivante. Ici le contrasto se termine par le triomphe du paysan, évocation non du présent mais d'un avenir possible. Il est difficile de dater cette chanson, traditionnelle en Toscane et dans d'autres régions, on la retrouve jusqu'à Cuba. Celle-ci a été recueillie par Leoncarlo Settimelli (1937-2001) en 1972.
Elle rappelle dans la présentation que le Christ était mort « fra la gentaccia », parmi les vilaines gens, c'est-à-dire les paysans ; on oppose donc Florence à « Signa », une localité de l'ouest de Florence, entre plaine et colline, au bord de l'Arno ; les « stropicci » (les frottements) évoquent avec ironie les efforts des classes moyennes les plus aisées pour se rapprocher des classes les plus élevées par le soin de leurs corps, en se frottant avec du savon et du son, en se parfumant, mais ça ne te servira à rien, tu vieillis et tu n'es plus capable de tenir ta canne ; le citadin préférerait jeter à la mer toute cette populace, mais alors, dit le paysan, notre travail (« le opre ») ne te nourrirait plus ; je ne discute pas avec toi, dit le citadin, tu es un ignorant et tu as des parasites : tu oublies que Giotto était un petit berger qui se mit à peindre sans que personne ne le lui ait enseigné (et c'est là une affirmation de ce qu'était la culture populaire florentine, qui connaissait et admirait ses grands artistes, Dante, Giotto, etc.). Finalement le paysan rappelle que c'est dans ses champs que pousse tout ce que mange le citadin, tandis que sur les belles dalles des rues de Florence, rien ne pousse, et tu n'auras qu'à mourir de faim en n'ayant plus que les dalles à manger : la ville est certes plus confortable, mais elle est stérile et suffocante, et ne peut pas se passer des paysans, allusion « écologique », dirait-on aujourd'hui.

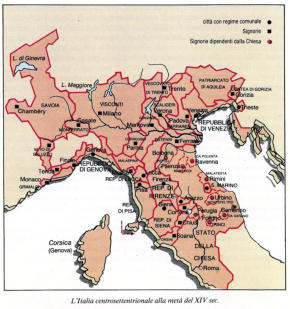
Contrasto tra cittadino e contadino
Cristo volle morì fra la gentaccia
La maggior parte gl’eran contadini
quando se n’avvide gli cascò le braccia
disse: son nella man degli assassini.
DECLAMATO:
« Gentilissimo pubblico / prestate
Attenzione / Assisterete adesso allo
storico contrasto che oppone, in
pubblica disfida, il cittadino di
Firenze al campagnolo delle Signe …
CITTADINO:
Come tu puzzi disse i’ fiorentino
tu se’ più lercio te d’una latrina
fai ritornare a gola i’ pane e i’ vino
la zuppa la braciola e la tacchina.
CONTADINO:
Te con tutti gli stropicci che ti fai
con quell’acqua di crusca e saponetta
con tutti quegli odori che ti dai
dai fondamenti per infino in vetta,
presto la vita tua terminerai
‘un sei più bono a regger la gianetta
ti resta solo il fiato per parlare
dimmi cosa ti conta i’ tu lavare.
CITTADINO:
Se fussi la giustizia vorrei fare
de’ contadini tutti una brancata
e po’ a Livorno gli vorrei portare,
a i’ porto dove giunge ogni fregata.
Poi gli vorrei buttar dentro ni mare
pe’ levar questa setta tribolata
e buttar giù finché il mar non è pieno
senza rimorso nè coscienza in seno.
CONTADINO:
Per pietà fiorentino parla meno
lo vedo ben che t’hai perso i’ cervello
i contadin lavora i’ terreno
costudisce la pecora e l’agnello.
Poi raccoglie frumento paglia e fieno
costudisce la pecora e i’ vitello
l’opre di contadin son gran talento.
bastano a prepararti i’ nutrimento.
CITTADINO:
Contadini io non mi ci cimento
i’ contadino quando parla e becca
guardalo con la mano sotto i’ mento
in quella po’ di barba ci ha una zecca …
Dà più fastidio che l’inverno l’vento
guardalo con la lingua i’ piatto lecca
a quella mensa ove mangiate voi
ci mangiano maiali vacche e buoi.
CONTADINO:
E contadini biasimar tu vuoi
sai dalla spina viene un be’ rosaio
se leggi i’ libro degli antichi eroi
troverai Giotto gl’era un pecoraio
che pascolava gli animaletti suoi
senza dinanzi di tizzone o caio
prese una lastra (14) bella e poi
in quella ci pitturava l’effige di una agnella.
CITTADINO:
Guarda qui grullo cosa mi favella
sa ragionar di Giotto un ti conviene
quello che fece lui un si cancella
quello che fece lui sta tutto bene
lascialo stare parlarne un ti conviene
se unn’era un mammalucco come tene
te cosa ne ragioni o montanaro
tu ‘n sai nemmen dar bere a i’ tu’ somaro.
CONTADINO:
Certo io non so e non imparo
perchè un somaro unnê mi compagnia
l’ho trovato oggidì pe’ caso raro
a desinare in questa trattoria.
Oste la venga qua prenda i’ denaro
gli lascio i’ posto libero e vo via
che molte miglia ci ho da far di strada
do bere a i’ ciuco una mezzetta di biada.
Débat entre citadin et paysan
Le Christ a voulu mourir dans la racaille
la plus grande partie, c’étaient des paysans
quand il s’en aperçut, les bras lui en tombèrent
il dit : je suis dans la main des assassins.
DÉCLAMÉ :
« Très noble public / Prêtez
Attention / Vous assisterez maintenant à
l’historique débat qui oppose, dans
un défi public, le citadin de
Florence au paysan de Signa …
CITADIN :
Comme tu pues dit le florentin
tu es plus crasseux qu’une latrine
tu fais remonter dans la gorge le pain et le vin
La soupe, la côtelette et la dinde.
PAYSAN :
Toi, avec tous les frottements que tu te fais
avec cette eau de son et de savonnette
avec toutes ces odeurs que tu te donnes
De ton derrière jusqu’à ta tête,
tu finiras vite ta vie
tu n’es plus capable de tenir ta canne
il ne te reste que le souffle pour parler
Dis-moi à quoi ça te sert de tant te laver ?
CITADIN :
Si j’étais la justice, je voudrais faire
des paysans une seule poignée
et je voudrais les emmener à Livourne,
au port où arrivent toutes les frégates.
Puis je voudrais tous les jeter à la mer
pour éliminer cette secte tourmentée
et les jeter jusqu’à ce que la mer soit pleine
sans remords ni crise de conscience.
PAYSAN :
Par pitié, Florentin parle moins
je vois bien que t’as perdu la tête
les paysans travaillent la terre
ils gardent la brebis et l’agneau.
Puis ils récoltent le blé et le foin
ils gardent la brebis et le veau
les fatigues du paysan sont un grand talent
Elles suffisent à préparer ta nourriture.
CITADIN :
Paysans, je ne m’abaisse pas à vous parler
le paysan, quand il parle il ennuie
regarde-le la main sous le menton
dans sa petite barbe, il a des parasites …
Il dérange plus que le vent en hiver
regarde-le qui lèche l’assiette avec sa langue,
dans cette cantine où vous mangez
Les bœufs et les vaches y mangent.
PAYSAN :
Et tu veux critiquer les paysans
tu sais que dans les épines pousse un beau rosier
si tu lis le livre des anciens héros
tu trouveras que Giotto était un berger
qui faisait paître ses petits animaux
sans avoir eu personne pour lui apprendre
il prit une belle dalle et sur celle-ci
il peignait l’image d’une agnelle.
CITADIN :
Regarde là, nigaud, ce que tu me racontes
il ne faut pas que tu parles de Giotto
ce qu’il a fait ne s’efface pas
tout ce qu’il a fait va bien
laisse-le tranquille, il ne faut pas que tu en parles
ce n’était pas un idiot comme toi,
qu’est-ce tu peux en dire, oh montagnard
tu ne sais même pas faire boire ton âne.
PAYSAN :
Certes moi, je ne sais pas et je n’apprends pas
parce que l’âne n’est pas ma compagnie
je l’ai trouvé aujourd’hui par une cas rare
en train de déjeuner dans cette auberge.
Hôtelier, viens ici, prends l’argent
je lui laisse la place libre et je m’en vais
j’ai plusieurs milles de route à faire
je donne à l’âne sa part d’avoine.
Angelo Branduardi (1950- ) a écrit en 2000 une série de 11 chansons tirées des Sources franciscaines, quelques-unes sont des résumés des Fioretti, entre autres l’histoire du loup de Gubbio. On peut la lire de plusieurs façons, mais l’une des interprétations intéressantes dit qu’elle évoque la période communale, et la lutte entre les seigneurs des campagnes héritiers des pouvoirs féodaux et qui effraient encore aussi bien les paysans que les habitants des communes et la nouvelle vie communale qui pourrait intégrer et entretenir les seigneurs, en échange de la remise de leurs terres à la commune. Le loup est donc le méchant seigneur, invité par François – représentant la vie communale – à rejoindre la ville et à respecter la discipline « civile », auquel cas il sera protégé, n’aura plus faim et n’aura plus besoin d’exploiter les paysans et les citadins. Cela représente l’évolution des rapports sociaux de cette époque où les communes durent limer peu à peu les pouvoirs des féodaux en les intégrant dans les pouvoirs communaux. Certes François d’Assise ne se limite pas à ce type d’intervention mais c’est un aspect probable de son action charitable, que l’on retrouve dans cette xylographie reproduite dans la première édition illustrée des Fioretti au XVIIe siècle, avec le loup entouré de membres déchiquetés, qui tend la patte à François, et au fond les murs de la ville communale, ayant à droite une partie noire ornée de hautes tours, celles de palais urbains où se sont installés les féodaux, la tout étant le symbole de leur puissance, et à gauche la ville blanche à l’intérieur de ses murailles.
Il Lupo di Gubbio
Francesco a quel tempo in Gubbio viveva
e sulle vie del contado
apparve un lupo feroce
che uomini e bestie straziava
che di affrontarlo nessuno più ardiva.
Di quella gente Francesco ebbe pena,
della umana paura,
prese il cammino cercando
il luogo dove il lupo viveva
ed arma con sé lui non portava.
Quando alla fine il lupo trovò
quello incontro si fece, minaccioso,
Francesco lo fermò e levando la mano:
« Tu frate Lupo, sei ladro e assassino,
su questa terra portasti paura.
Fra te e questa gente io metterò pace,
il male sarà perdonato
da loro per sempre avrai cibo
e mai più nella vita avrai fame
che più del lupo fa l’Inferno paura ! »
Raccontano che così Francesco parlò
e su quella terra mise pace
e negli anni a venire del lupo
più nessuno patì.
« Tu Frate Lupo, sei ladro e assassino
ma più del lupo fa paura l’Inferno ! »
François en ce temps-là vivait à Gubbio
et sur les route de la campagne
apparut un loup féroce
qui déchirait hommes et bêtes
et personne n’osait plus l’affronter.
De ces gens François eut de la peine,
de leur peur humaine,
il prit le chemin en cherchant
le lieu où vivait le loup
et avec lui aucune arme ne portait.
Quand à la fin il trouva le loup
celui-ci s’avança, menaçant,
François l’arrêta et levant la main :
« Toi, Frère Loup, tu es voleur et assassin,
tu as apporté la peur sur cette terre.
Entre toi et ces gens je ferai la paix,
le mal sera pardonné
d’eux tu auras toujours de la nourriture
et plus jamais dans ta vie tu n’auras faim
car plus que le loup l’Enfer fait peur ! »
On raconte que François parla ainsi
et qu’il mit la paix sur cette terre
et dans les années à venir du loup
plus personne ne souffrit.
« Toi, Frère Loup, tu es voleur et assassin
mais plus que le loup l’Enfer fait peur ! »

Les nouveaux maîtres, les « marchands-banquiers »
Ce qui est vrai c’est que les communes représentent l’essor de nouveaux maîtres, les marchands et banquiers qui se développent entre le XIIe et le XIVe siècles. Ce n’est pas pour autant la mise en place d’une république démocratique, et si les paysans obtiennent plus d’indépendance par rapport aux seigneurs féodaux, ce n’est pas par « humanisme », mais d’abord pour affaiblir les seigneurs féodaux en leur ôtant leur main d’œuvre, sans laquelle leurs terres ne rapportent plus rien. Ce n’est pas pour autant que les « seigneurs » disparaissent ; les plus entreprenants s’intègrent dans la « commune », s’assimilent à l’aristocratie urbaine et aux « magnats » (i magnati) de la ville pour former avec eux une nouvelle classe dirigeante qui s’orientera bientôt vers une nouvelle aristocratie terrienne et vers des « seigneuries ».
« Pays des villes », l’Italie devient aussi le « pays des marchands » ; on disait : « Génois donc marchand », ce serait valable pour toutes les villes importantes où avaient pris de la force les « Lombards », comme on appelait les marchands-banquiers italiens dans toute l’Europe. Leur force est bien sûr économique, mais aussi politique, sociale, et culturelle, car ils relèvent d’autres valeurs, d’autres modèles sociaux, et l’argent, la finance, est pour eux l’objectif suprême, le véritable nerf de la guerre ; ce sont les banquiers guelfes florentins qui financeront l’entreprise de Charles d’Anjou (1226-1285) contre Manfred, l’héritier de Frédéric II en 1266-1267, première opération de conquête du sud de l’Italie financée par des banquiers ; derrière la lutte entre les Anjou et la famille d’Aragon (1282-1302), il y a le conflit économique entre Florence et Gênes ; et la quatrième croisade de 1004, et le pillage de la ville chrétienne de Constantinople par les navires vénitiens est significative de la supériorité des marchands sur les religieux. À l’occasion des Croisades, les marchands s’ouvrent de nouvelles routes commerciales vers l’Orient.
Et ce qui est dominant par rapport à la production, c’est le commerce : les marchands-banquiers fabriquent ce qui va se vendre sur les marchés européens et orientaux, passant s’il le faut, de la laine à la soie, d’un produit à un autre, on est banquier et marchand avant d’être producteur. Ce sont ainsi les marchands italiens qui dominent l’Europe et l’Orient du XIe au XIVe siècle ; ils deviennent les créditeurs des grands feudataires civils ou ecclésiastiques (les ducs de Bourgogne, les comtes de Flandre), des nouvelles monarchies (France et Angleterre) et de la Curie pontificale. C’est aussi ce qui provoquera leurs faillites par manque de paiement lors des crises économiques, politiques ou militaires : les Bonsignori à Sienne en 1298, les Riccardi à Lucques en 1300, les Frescobaldi en 1311 à Florence, et toujours à Florence entre 1341 et 1347 les Buonaccorsi, les Bardi, les Peruzzi, les Acciaiuoli par la perte des prêts aux rois de France et d’Angleterre (Guerre de cent ans entre la France et l’Angleterre de 1337 à 1453).
C’est aussi l’époque où les marchands italiens mettent au point de nouvelles techniques commerciales et bancaires dans la pratique du crédit qui devient peu à peu leur activité principale, à côté du transport des marchandises le long des côtes de la Méditerranée. Les compagnies développent la « commenda » à Gênes, la « colleganza » à Venise etc. La « commenda » était à Gênes un grand édifice, point de référence durant tout le Moyen-Âge de tous ceux, marchands, chevaliers, soldats, pèlerins, etc. qui allaient de l’Europe du Nord au Moyen-Orient, à l’Afrique du Nord, à la Terre Sainte, elle servait à la fois de station maritime et d’hôpital ; à Venise la « colleganza » était une forme d’accord particulière, où un financier confiait son capital à un marchand qui le lui restituait à son retour, tandis qu’ils partageaient les profits, ou bien les deux tiers du capital, le marchand fournissait un tiers plus son travail et au retour ils partageaient les bénéfices. Même des doges comme Sebastiano Ziani (1102-1178), Orio Mastropiero (1178-1192) et d’autres, faisaient déjà d’énormes bénéfices grâce à ces pratiques, dans le commerce du poivre, des tissus précieux, des soies, des cotons, des pierres précieuses, des produits tinctoriaux, de l’or, de l’argent, du riz, des fèves, des dattes, des plumes d’autruche, des dents d’éléphant, sans oublier les esclaves noirs, etc. ou plus tard l’alun, le corail, le mercure, ou encore les draps des Pays-Bas, la laine, le plomb, l’étain d’Angleterre. C’est ainsi que Venise et Gênes dominèrent pendant plusieurs siècles le commerce européen grâce à leurs flottes, les plus puissantes de la Méditerranée : les galères vénitiennes pouvaient porter jusqu’à 200 et 250 tonnes ; même après la fin de la chrétienté au Moyen-Orient (perte de Saint-Jean-d’Acre en 1291), les marchands italiens continuent à acheter les produits orientaux, car pour les marchands orientaux, la mer reste peu accessible ; ils fréquentent donc toutes les grandes villes côtières de Gibraltar à l’Égypte et à la Syrie ; ils poussent même à l’intérieur des terres : en 1447, le marchand génois Antonio Malfante ( ? -1450) va jusqu’à Touat en direction de l’or du Soudan. Mais ils pratiquent aussi la direction du Nord par l’Atlantique pour le commerce avec les Flandres : on connaît le portrait du marchand de Lucques, Giovanni Arnolfini (1400-1472), peint à Bruges avec sa femme par Jan van Eyck vers 1434. C’est à travers ces échanges entre nord et sud que se prépare la Renaissance culturelle à partir du XVe siècle.
Mais les marchands italiens dominent aussi les voies terrestres, vers l’Allemagne par le Brenner, Cologne, Nuremberg, Bâle, Augsbourg, tandis que les Allemands s’installent à Venise (l’énorme magasin du XIIIe siècle qu’est le Fondaco dei Tedeschi). Le commerce italien est parfois comparé à une sorte de pieuvre dont les bras enserrent toute l’Europe.
Et le développement de cette nouvelle économie pousse aussi à la création de grands États ; comme écrit Fernand Braudel (1902-1985), « C’est une poussée générale qui, en privilégiant l’économie monétaire, précipite les rapports, multiplie les échanges, rend fragiles les formations politiques trop restreintes et fabrique, pour des succès comme marqués à l’avance, d’universelles aragnes », c’est-à-dire les nouvelles grandes monarchies de France (Louis XI, 1461-1483), l’Espagne (les Rois catholiques, Isabelle, 1474-1504 et Ferdinand, 1479-1516), d’Angleterre (Henri VIII, 1486-1509). Les villes-États italiennes vont croître de la même façon, en Italie ou en Allemagne, mais elles rendront impossible la formation de grands États unifiés, sauf là où elles ne sont pas assez développées, comme au Piémont-Savoie, dans l’État pontifical et dans le Royaume de Naples conquis par la famille d’Aragon en 1442 ; au Nord au contraire, les villes développées s’étendent peu à peu, Venise conquiert Padoue, Vicence, Vérone, Brescia, Bergame, Udine, Gênes conquiert Savone, Milan tout le Milanais, Florence s’empare de Pise en 1406, son premier accès à la mer. Tout en restant des cités, ces villes deviennent en fait des petits États, toujours aussi dynamiques et dominants, par leurs navires de plus en plus énormes : les galères génoises du XIVe siècle atteignent de 1200 à 1500 tonnes, et on ne fera guère mieux pendant encore 4 siècles. Mais ils ne seront ni assez grands ni assez peuplés pour aller vers une véritable révolution industrielle et une véritable « démocratie », et ils redeviendront bientôt des États aristocratiques et princiers, dont la classe dominante vit à nouveau de la terre.
La réalité essentielle pour comprendre l’évolution de l’Italie est l’apparition de cette nouvelle classe dirigeante formée par les grands industriels-banquiers-commerçants qui, une fois au pouvoir en ayant éventuellement lutté contre l’aristocratie féodale, tend de plus en plus à s’assimiler aux magnats, patriciens issus de cette ancienne aristocratie : dans le domaine économique, ils investissent dans les terres et l’agriculture, et dans le domaine culturel, ils se convertissent à un mode de vie « chevaleresque », se font construire de splendides palais ornés par les meilleurs artistes, recherchent des mariages qui les ennoblissent et augmentent leur puissance, tout en n’abandonnant pas l’activité mercantile, le commerce et la finance. Le riche marchand de Prato, Francesco di Marco Datini (1335-1410) (Voir à gauche sa statue à Prato), continue à ouvrir ses lettres par ces mots : « Au nom de Dieu et du profit … » (In nome di Dio e del guadagno…). L’Église continue certes à condamner le profit comme « usure », mais les grands banquiers sont aussi les percepteurs des impôts recueillis par la Curie Pontificale, soit ils prêtent aux évêques (autres grands seigneurs de la classe dominante) soit ils font fructifier l’obole de Saint-Pierre avant de le livrer à Rome.
Cette nouvelle culture « humaniste » (le terme ne sera inventé que beaucoup plus tard) est exigée par cette classe de marchands, dont les fils doivent apprendre à lire, écrire, compter, ils doivent connaître l’arithmétique et son application aux opérations commerciales ; le Liber abaci (1202) de Leonardo Fibonacci (1175-1250 - Cf à droite sa statue à Pise) est une des bases des nouvelles écoles, il introduit le nouveau mode de calcul indo-arabe dans notre civilisation alors que l’on utilise encore la notation romaine, beaucoup plus lente et difficile, et il aborde tous les problèmes concrets de comptabilité commerciale ; cela permet de réaliser de nouveaux livres de comptes et d’inventer de nouvelles techniques financières, le chèque, la lettre de change, l’assurance, la comptabilité en partie double, le calcul des changes sur les places méditerranéennes, les prêts (dont certains, excessifs, coûteront la faillite de quelques grandes banques). Et tout cela suppose une gestion du temps pris par chaque opération, « Ne perds jamais une heure de temps » dit Leon-Battista Alberti (1404-1472). Les manuels de commerce italiens sont utilisés dans toute l’Europe, comme La pratica della mercatura (1335-1343) du banquier florentin Francesco di Balducci Pegolotti (1290-1347). Ces marchands sont en même temps friands de lettres et d’art, ils encouragent le développement de la « novellistica » à la manière du Décaméron (1349-1353) de Giovanni Boccaccio (1313-1375) ou des Contes de Canterbury (vers 1387) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), puis l’écriture de poèmes chevaleresques, ils pratiquent une abondante correspondance commerciale et littéraire.
Contre eux se dresseront les mouvements populaires de pauvres, au nom de l’Évangile, qui combattent l’avidité des marchands, leur goût de l’argent et du luxe ; ils sont considérés souvent comme hérétiques par une Église dont les responsables sont eux-mêmes de riches et puissants seigneurs, qui condamne l’usure, mais en arrivera à vendre les « indulgences » : on connaît l’histoire de Pierre Valdo (1140-1218) de Lyon et des dits « Vaudois », ou celle de François d’Assise (1181-1226), fils de l’un de ces grands marchands. La religiosité se transforme donc et les marchands compensent leur usure par la construction d’églises, d’hôpitaux, par des donations aux Ordres religieux lorsqu’ils sont à l’article de la mort. La mentalité des marchands évolue vers une conscience que l’économie et la politique sont liés, mais que l’économie n’a rien à voir avec l’éthique, ni la politique avec la morale. Un peu plus tard, Niccolò Machiavelli (1469-1527) théorisera cela.



On connaît peu de choses de la musique populaire d’alors : que chantaient les ouvriers du textile, les artisans, les membres des arts mineurs, les femmes qui élevaient leurs enfants ou qui effectuaient chez elles un travail artisanal ? Par contre cette poussée du monde nouveau des marchands, industriels, banquiers génère aussi une musique nouvelle, qui vient à la fois de France, à travers Marchetto de Padoue (1275-après 1318) qui semble avoir importé les théories et la polyphonie de l’École de Notre Dame de Paris (vers 1160-1250), mais qui est sûrement aussi influencée par la chanson populaire et sa polyphonie, antérieure à la celle du chant grégorien. Sont alors apparus des musiciens professionnels, généralement des religieux mais dont les œuvres étaient profanes, comme Francesco Landini (1325-1397), Giovanni da Firenze (XIVe siècle), Donato da Firenze (seconde moitié du XIVe siècle), Lorenzo Masi ( ? -1372), etc. qui imposent « l’ars nova » en opposition à la seule polyphonie religieuse et préparent le temps du madrigal, des « cacce », des « chansons », des ballades.
Et celles-ci reprennent souvent des thèmes de la vie populaire, peut-être déjà exprimés dans des poésies comme celles du mal identifié Puccio di Aldrovandesco Bellondi (fin XIIIe siècle), par exemple celle-ci, sur un texte anonyme, qui évoque l’activité de lessive, si importante dans la vie des femmes :
Non posso far bucato che non piova. (Ballata anonima del secolo XIVLandini e la musica fiorentina del secolo XIVEnsemble Micrologus, 1994)
Non posso far bucato che non piova.
S'è '1 tempo bello, subito si turba,
Balena, tuona, e l'aria si raturba
Perch'io non possa vincer la mia prova.
Cosl sança ragion m' è fatto torto
Ch'io servo ogni uomo
e ciascun mi vuol morto ;
Di che la vita mi' viver non giova.
Si je lave mon linge il se met à pleuvoir.
Si le temps est au beau, aussitôt il se couvre,
il tonne, il fait du vent, l'air de nouveau se trouble,
afin de me gâter ce que j'ai entrepris.
C'est ainsi sans raison que l'on me fait du tort,
je sers tout un chacun,
et chacun veut ma mort ;
Ce pourquoi vivre cette vie n’est pas agréable.
On peut citer à ce propos ce chant populaire, Il canto delle lavandaie del Vomero, qui date environ de l’époque de Frédéric II, du XIIIe siècle, c’est-à-dire d’un temps où la colline qui surplombe Naples, le Vomero, était encore couverte de forêts de châtaigniers, avec quelques maisons rustiques occupées par des lavandières qui descendaient ensuite dans la ville pour rapporter aux palais aristocratiques le linge qu’elles avaient lavé, remontant avec le linge à laver dans les nombreuses sources du lieu. Ce chant, considéré comme le plus ancien chant napolitain connu, devint ensuite un chant de protestation contre la domination aragonaise et de revendication de la terre : la « moccatora » est soit un mouchoir soit un morceau de terre :
Canto delle lavandaie del Vomero
Tu m’aje prommiso quatto moccatora
io so’ benuto se, io so’ benuto
se me lo vuo’ dare, me lo vuo’ dare !
E si no quatto embe’, dammenne ddoje
chillo ch’è ‘ncuollo a tte nn’e’ rroba toja
me lo vuo’ dare !
Tu m’as promis quatre mouchoirs
je suis venue si, je suis venue
si tu veux me les donner, me les donner !
Et sinon quatre, eh bien, donne m’en deux
celui qui est à ton cou n’est pas à toi
tu veux me le donner !
On trouve aussi cette « chasse » de Gherardello da Firenze (1320-1360) qui est un thème souvent traité dans la chanson populaire, chasse d’amour, chantée par conséquent en canon (fugue), que la tradition italienne reprend de la France et de l’Angleterre avec beaucoup plus de vie et de tension émotive, parce que, derrière le genre musical, apparaît aussi la recherche de rapports amoureux, dans des allusions souvent érotiques :
Così pensoso
Così pensoso corn' amor mi guida
Per la verde rivera passo, passo,
Senti', « Leva quel 'sasso.
Ve'l granchio, ve', ve'l pesee, piglia, piglia.
Cominciò Isabella, con istrida,
« 0 me ! O me ! »
Perdu dans mes pensées, avec l’amour pour guide,
Au long de la verte berge, j'allais, j'allais.
J'entendis : « Soulève cette pierre.
Vois le crabe, vois le poisson ! Attrape, attrape !
Isabelle commença par des cris :
« 0 me ! O me ! »
Et voilà un texte populaire traditionnel de chasses d’amour chanté par le Canzoniere del Lazio :
Se tu ti fai monaca
Se tu ti fai monaca,
io mi faccio prete,
mi vengo a confessa'.
Se tu ti fai prete,
mi vieni a confessà,
io mi faccio stella,
nel cielo me ne vado.
Si tu te fais nonne,
je me fais prêtre,
je viens te confesser.
Si tu te fais prêtre,
viens me confesser,
je me fais étoile,
je m’en vais dans le ciel.
Le peuple semble peu s’intéresser à la vie des marchands ; même un personnage comme Marco Polo est peu chanté. Il existe une chanson de Flavio Giurato, et une de Jovanotti de 1995, intitulée aussi Marco Polo (Lorenzo, 1990-1995) mais il s’agit d’une chanson sur le voyage où les allusions au personnage sont bien minces. Par contre, Francesco Guccini consacre un belle chanson à Marco Polo sur les routes de la Chine, Asia :
Asia
Fra i fiori tropicali, fra grida di dolcezza
La lenta lieve brezza scivolava.
E piano poi portava fischiando fra la rete
L'odore delle sete e della spezia.
Le vesti dei mercanti trasudano di ori,
Sì affacciano alle rive le colorate vele,
Fragranti di garofano e di pepe.
Trasudano le schiene, schiantate dal lavoro
Son per la terra mirra, l'oro e incenso.
Sembra che sia nel vento su fra la palma somma
Il grido del sudore e della gomma.
E l'Asia par che dorma, ma sta sospesa in aria
L'immensa millenaria sua cultura.
I bianchi e la natura non possono schiacciare
I Buddah, i Chela, gli uomini ed il mare.
Leone di S. Marco, leone del profeta,
Ad est di Creta corre il tuo Vangelo.
Si staglia contro il cielo il tuo simbolo strano
La spada, e non il libro hai nella mano.
Terra di meraviglie, terra di grazie e mali
Di mitici animali da « bestiari ».
Arriva dai santuari fin sopra all'alta plancia
Il fumo della ganja e dell'incenso.
E quel profumo intenso, è rotta di gabbiani :
Segno di vani simboli divini.
E gli uccelli marini additano col volo
La strada del Katai per Marco Polo.
Dans les fleurs tropicales et les cris de douceur
Glissait lentement la brise légère.
Et puis portait doucement, sifflant dans le filet,
L’odeur des soies et des épices.
Les vêtements des marchands sont pleins de sueurs d’or,
Les voiles colorées se montrent sur les rives,
Fragrantes d’œillet et de poivre.
Les dos sont en sueur, écrasés par le travail,
Ils sont pour la terre la myrrhe, l’or et l’encens.
Il semble que dans le vent à la plus haute palme
On entende le cri de la sueur, du caoutchouc.
Et l’Asie, il semble qu’elle dorme, mais est suspendue en l’air
Son immense culture millénaire.
Les blancs et la nature ne peuvent écraser
Les Bouddhas, les Chelas, les hommes et la mer.
Lion de Saint Marc, lion du prophète,
A l’est de la Crète court ton Évangile.
Se détachant contre le ciel, ton symbole étrange,
L’épée, et non le livre, tu as dans la main.
Terre de merveilles, terre de grâces et de maux,
De mythiques animaux des "bestiaries".
Des sanctuaires arrivent jusque sur la haute passerelle
La fumée du haschich et de l’encens.
Et ce parfum intense, c’est la route des mouettes :
Signe de vains symboles divins.
Et les oiseaux marins indiquent par leur vol
La route du Katai pour Marco Polo.
« Katai » (Cathay en français) est le nom que Marco Polo popularise en Occident pour parler de la Chine ; le mot vient de « Kitai », nom d’un peuple nomade qui, entre le XIe et le XIIe siècle fonda un État puissant dans le nord de la Chine. À travers Marco Polo, Guccini parle aussi de la fascination de l’Orient, avec sa culture particulière que l’on n’effacera pas par les armes comme tentent parfois de le faire les « blancs » qui viennent avec des armes à la main, alors que l’on attend de saint Marc qu’il porte le Livre. Et ses richesses nous attirent et font l’objet de notre commerce, mais c’est bien au-delà de l’argent qu’elles sont pour nous fascinantes, car elles sont aussi le « signe de vains symboles divins»
IV. La Renaissance
1. - La Renaissance, fruit de cette nouvelle société communale et de sa nouvelle classe dominante
L’Italie s’approche donc de sa « Renaissance » (il Rinascimento). Le terme n’est adopté qu’à partir du XIXe siècle, par l’historien Jacob Burckhardt (1818-1897) dans son ouvrage de 1860 La civilisation de la Renaissance en Italie. Il y analyse non seulement l’art et la littérature mais la totalité de la société italienne à partir du XIVe siècle, en commençant par la structure économique et politique ; la deuxième partie s’intitule « développement de l’individu » et la troisième « la résurrection de l’Antiquité ». C’est souvent à ça qu’on résume la « Renaissance » : la redécouverte de l’Antiquité classique gréco-romaine.
Il est vrai que l’Italie avait perdu la mémoire intellectuelle de cette Antiquité entre le Ve et le XIe siècles, en particulier sous la pression de l’idéologie chrétienne qui fit tout pour effacer ce souvenir d’un passé de péché que Dieu aurait puni en faisant tomber l’empire romain en 473, et pour imposer la domination de la pensée chrétienne à partir d’Augustin d’Hippone (354-430) : on transforme les temples païens en églises chrétiennes si on ne peut pas les faire tomber (on voit encore à Rome sur le haut des colonnes du Temple d’Antonin et Faustine, à l’entrée du Forum Romain, la trace des cordes par lesquelles les chrétiens avaient tenté en vain d’abattre le Temple), et le temps romain laisse place au temps rituel et non-historique des chrétiens centré sur le retour annuel des grands moments de l’histoire du Christ et du culte des saints, Noël, le Carême, Pâques, l’Ascension, les apparitions, la fête du saint patron local, etc.
Pour ces sociétés agraires du Moyen-Âge, il n’y a pas d’« histoire », mais un cycle du temps fermé sur lui-même et répétitif comme le rythme des saisons et de la lune. Mais il faut penser aussi que les habitants des villes avaient continué à vivre à l’intérieur des ruines de l’empire romain, par exemple il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que les arcades extérieures du Théâtre de Marcellus ne soient plus occupées par les petits commerces alimentaires, et les étages par la famille Orsini (Cf. ci-dessus gravure du XVIe siècle). C’est dire que dans la vie quotidienne la présence de la Rome antique n’a jamais cessé.
Les explications des origines de la Renaissance sont nombreuses (voir sur Wikipedia le site : Renaissance italienne), mais ce qui est fondamental c’est le lien avec les transformations économiques et politiques des siècles antérieurs, et l’apparition d’une nouvelle classe dominante, cette « bourgeoisie » formée des principaux industriels-banquiers-commerçants alliée à une partie de l’ancienne aristocratie, qui affirme une nouvelle idéologie et s’intéresse plus au luxe (alimenté par le commerce de la soie avec l’Orient), à la culture et à l’esthétique. Par ailleurs c’est une civilisation urbaine, et non plus rurale, et son intérêt se développe pour la connaissance de son histoire passée (dont celle de Rome et de la Grèce, augmentée encore par l’arrivée des savants byzantins exilés en Italie après la conquête ottomane de l’empire byzantin).
Peu à peu, reprend l’historiographie locale dans chaque ville
Agnello di Ravenna (805-846) à Ravenne, Amato di Montecassino (1010-1090) en Campanie, Guglielmo di Puglia (fin XIe-début XIIe siècles) pour l’histoire sicilienne, Caffaro di Rustico da Caschifellone (1099-1163), et Bartolomeo Scriba (fin XIIe-1248) à Gênes, Ogerio Alfieri (1236-1294) à Asti continué par Guglielmo Ventura (1250-1325), Perusio da Cereta à Vérone, et beaucoup d’autres dans plusieurs villes, comme Martin da Canale (XIIIe siècle) à Venise, premier auteur en langue vulgaire et non en latin (c’est-à-dire qu’il est soucieux d’être aussi compris par un plus grand nombre de laïcs), le moine franciscain Salimbene da Parma (1221-1290), le moine dominicain Jacopo da Varazze (Jacques de Voragine, 1228-1298), dont les textes inspireront tous les peintres de la Renaissance, Bonvesin de la Riva (1240-1315) à Milan.
On connaît mieux des auteurs comme Dino Compagni (1225-1324) pour ses chroniques florentines (il fut plusieurs fois gonfalonier et exilé de Florence parce que guelfe « blanc »), Giovanni Villani (1280-1348) pour son histoire de Florence des origines à son époque (écrite à partir de 1333), tous deux marchands avant d’être chroniqueurs, de nombreux historiens des papes à Rome, ou Bartolomeo Caracciolo (1300-1362) à Naples et Buccio di Ranallo (1294-1363) à l’Aquila, ou Opicino de Canistris (1296-1353) à Pavie. C’est plus que dans n’importe quel autre pays européen, et c’est plus le fait de l’Italie du Nord et du Centre que de l’Italie du Sud qui est plus sensible aux histoires dynastiques qu’aux histoires collectives des villes et des régions. Notons aussi que beaucoup tiennent à souligner que l’origine de leur ville est romaine ou troyenne et on loue la liberté retrouvée des villes en se référant à l’antique République romaine et à ses vertus, comme le fait Leonardo Bruni (1370-1444) dans ses Louanges de la ville de Florence (1403).
Et les nouveaux philologues vont veiller à ce qu’on retrouve les textes anciens avec le maximum d’exactitude
Comme Coluccio Salutati (1331-1406) et surtout Lorenzo Valla (1407-1457) qui a le courage de corriger même les textes théologiques ou de montrer que la fameuse « donation de Constantin » (un don de biens territoriaux à l’Église par l’empereur) était un faux écrit postérieurement par des scribes chrétiens au service du Vatican.
Ajoutons enfin que de nombreux marchands, surtout florentins, commencent à écrire les mémoires de leur famille, ou leur autobiographie dont la Vita Nuova (1295) et le Convivio (1304-1307) de Dante seront parmi les premiers exemples, suivis par Donato Velluti (1313-1370) avec sa Cronica domestica (à partir de 1367) et bien sûr par Francesco Petrarca dans ses lettres, son Secretum ou son Canzoniere.
Concluons donc sur ce point :
La base de la Renaissance est l’apparition de cette nouvelle structure économique dite « communale » particulièrement développée dans le Nord et dans le Centre de l’Italie, et de sa nouvelle classe dominante, la « bourgeoisie », nouvelle aristocratie post féodale. La démographie a considérablement augmenté la population, et par conséquent l’étendue des villes, le commerce et les marchés y sont florissants, faisant des villes italiennes les plus riches d’Europe, un nouvel urbanisme fait apparaître dans les murs, des rues et autour de maisons plus propres, de somptueux palais seigneuriaux et de grandes églises (en 1324, Florence a une enceinte de 8,5 km épaisse de 2 mètres et haute de 10, dotée d’un fossé de 17 mètres de largeur, couronnée de créneaux guelfes et défendue par 63 tours - Cf. plan ci-dessus), le luxe privé se développe et augmente le goût de la décoration et de l’art, la richesse et la joie de vivre se manifestent partout, tellement que plusieurs villes doivent adopter des « lois somptuaires » qui limitent la possible corruption morale afférente. Les fresques d’Ambrogio Lorenzetti à Sienne (1337-1339) sur les effets du bon et du mauvais gouvernement rendent bien compte de cette réalité de richesse, de bien-être et de joie de vivre. Voir aussi la description des mois faite par Folgòre di San Gimignano (voir chapitre précédent), appel à une vie où chacun obéit à ses désirs et se livre à une joie de vivre très païenne.
Un dernier aspect essentiel doit enfin être souligné :
Cette nouvelle vision du monde va aussi de pair avec un progrès de la science et de la technologie, nécessaire à ce nouveau monde de banquiers et de commerçants. Il n’est certes pas le seul fait de l’Italie, l’Europe du Nord y tient une grande place. Mais de ce point de vue, on peut dire que Galileo Galilei (1584-1642) est l’héritier de la Renaissance, il a changé radicalement notre façon de penser, de nous voir nous-mêmes, nos origines, notre histoire. Les théologiens qui l’ont condamné alors ne s’y sont pas trompés. En ce sens, on peut dire que la « Renaissance » est bien une transition vers un autre monde, qui va peu à peu se créer avec d’autres valeurs.



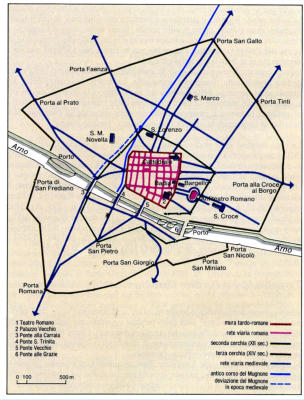
2. - Dates de la Renaissance
Quand commence donc la « Renaissance » ? Le mot apparaît tard, dans le Dictionnaire de l’Académie Française en 1718, Balzac le reprend en 1830 dans Le Bal de Sceaux, Michelet en 1855 dans son Histoire de France à propos du XVIe siècle, mais surtout Burckhardt en 1860 dans La culture de la Renaissance en Italie, et c’est le Dictionnaire universel de Pierre Larousse qui le généralise en 1875. À travers eux se crée le mythe de la Renaissance comme le début de la modernité, nouvelle époque qui débouchera plus tard dans la Révolution Française.
Par contre, beaucoup d’historiens voudront réviser cette idée : pour eux la véritable Renaissance commence par le passage du paganisme romain antique au christianisme, et certains compteront par exemple François d’Assise comme le premier écrivain « renaissant » ; d’autres, comme Étienne Gilson (1884-1978) considéreront que la « Renaissance » n’est que la continuation d’un Moyen-Âge devenu sans Dieu, c’est-à-dire aussi une perte de l’homme ; on parla d’humanisme chrétien et de renaissance carolingienne.
Ce confusionnisme fait oublier qu’il y eut vraiment une rupture de continuité entre le Moyen-Âge et la Renaissance
Dans le domaine littéraire et artistique, mais surtout dans le mode de pensée, dans les modes de vie, dans les rapports sociaux. La seule classe qui y resta indifférente fut celle des paysans, c’est-à-dire une énorme majorité de la population : que le maître soit romain, lombard, carolingien ou bourgeois des villes, son exploitation reste la même, ses conditions de vie restent les mêmes, il est toujours un « paysan », être soumis, inférieur, réprimé s’il se révolte.


3) Chantons la Renaissance
Ce sont d’abord les principaux intéressés qui ont chanté eux-mêmes leur nouvelle vision du monde, Lorenzo dei Medici (1449-1492) et un poète comme Angelo Poliziano (1454-1494).
Chi non è innamorato
Chi non è innamorato
esca di questo ballo,
ché faria fallo a stare in sí bel lato.
Se alcuno è qui, che non conosca amore,
parta di questo loco;
perch’esser non potria mai gentil core
chi non sente quel foco.
Se alcun ne sente poco,
peusi le sue fiamme accenda,
che ognun lo intenda;
e non sará iscacciato.
Amor in mezzo a questo ballo stia,
chi gli è servo, intorno.
Que celui qui n’est pas amoureux
sorte de ce bal,
car il ferait erreur de rester dans un si belle compagnie.
Si quelqu’un est ici et qu’il ne connaisse pas l’amour
qu’il parte de ce lieu :
car il ne pourrait jamais être un cœur noble
celui qui ne sent pas ce feu.
Si quelqu’un le sent peu,
qu’il allume ses flammes,
afin que chacun le comprenne ; et il ne sera pas chassé.
Que l’amour soit au milieu de ce bal
et ses serviteurs autour de lui.
L’invitation de Laurent de Médicis est claire : pas de honte (mot répétéplusieurs fois) ni de peur, aucune dame ne doit refuser de céder à celui qui est amoureux d’elle, c’est une question de raison (« si elle y pense bien », répété deux fois) et de Nature. À quoi servirait la beauté si ce n’était pour inciter à l’amour. On est à l’opposé de Dante à qui la raison éclairée par la foi disait au contraire de ne pas céder à un amour interdit (Voir Francesca da Rimini, Enfer chant V). Aucune allusion à la source divine de l’amour, ce n’est qu’une question de « nature ».Le poète préféré de Laurent de Médicis était Angelo Poliziano (1454-1494) qui meurt peu après lui. Il nous chante ici le mois de mai et nous invite à le célébrer, car c’est le mois de l’amour qui veut que les hommes et les jeunes filles tombent amoureux, comme les bêtes sauvages et les fleurs, question de nature, là aussi. Certes l’amour est un « petit ange », mais il ressemble plus au petit Cupidon de l’Antiquité qu’à un ange chrétien. Le gonfalon selvaggio du début est le bouquet de fleurs des bois que les amoureux déposaient en mai devant la porte de leur aimée, de même que lors des combats, elle-même donnera des guirlandes à son amoureux, car l’amour est comparé à la guerre ou à son substitut, le jeu guerrier des joutes et des tournois dont la femme est le prix. Ces poèmes dits « chansons » étaient évidemment accompagnés de musique, joués et dansés, mais malheureusement on n’en a souvent plus aucune partition. C’est aussi le cas de la suivante, de Franco Sacchetti.
Ben venga maggio
Ben venga maggio
E 'l gonfalon selvaggio !
Ben venga primavera
Che vuol l'uom s'innamori ;
E voi, donzelle, a schiera
Con li vostri amadori
Che di rose e di fiori
Vi fate belle ìl maggio,
Venite alla frescura
Delli verdi arbuscelli.
Ogni bella è sicura
Fra tanti damigelli ;
Che le fiere e gli uccelli
Ardon d'amore ìl maggio.
Chi è giovane e bella
Deh ! non sie punto acerba,
Ché non si rinnovella
L'età come fa l'erba :
Nessuna stia superba
All'amadore il maggio.
Ciascuna balli e canti
Di questa schiera nostra.
Ecco che i dolci amanti
Van per voi belle in giostra :
Qual dura a lor si mostra
farà sfiorire il maggio.
Per prender le donzelle
Si son gli amanti armati.
Arrendetevi, belle,
A' vostri innamorati ;
Rendete e' cuor furati,
Non fate guerra il maggio.
Que vienne le mois de mai
et l’enseigne sauvage !
Que vienne le printemps
qui veut que l’homme tombe amoureux ;
Et vous, jeunes filles, en troupe
avec vos amoureux,
vous qui de roses et de fleurs
faites belles en mai,
venez à l’ombre fraîche
des petits arbres verts.
Toutes les belles sont sûres
au milieu de tant de damoiseaux ;
Que les bêtes fauves et les oiseaux
brûlent d’amour en mai.
Et si quelqu’un est jeune et belle,
qu’elle ne soit pas cruelle,
car l’âge ne se renouvelle pas,
comme l’herbe :
qu’aucune ne soit orgueilleuse
envers son amant en mai.
Que chacune danse et chante
dans notre troupe.
Voilà que vos doux amants
entrent pour vous dans l’arène :
qui se montre dure envers eux
fera faner le mois de mai.
Pour prendre les jeunes filles
les amants se sont armés.
Rendez-vous, belles,
à vos amoureux ;
rendez les cœurs volés,
ne faites pas la guerre en mai.
Nous avons vu que la « Renaissance » n’avait concerné que l’élite de la société bourgeoise, mais il faut penser aussi que les grands bourgeois et les nouveaux seigneurs investissaient de plus en plus dans la terre et l’agriculture et s’intéressaient donc aux paysans, et aussi aux petites paysannes. Il se forme donc toute une tradition poétique qui chante la beauté des pastourelles. Voici par exemple une chanson de Franco Sacchetti (1332-1400), fils d’un marchand florentin, né à Ragusa (aujourd’hui Dubrovnik), devenu aussi homme politique en Toscane et célèbre, outre ses nombreuses poésies, pour ses Trois cents nouvelles. « Biondella » et « Martino » sont les noms de deux animaux du troupeau. Là encore apparaît l’image du petit ange et tout est petit, les bergères, leur lit, leur cabane, le bosquet de leur pré, leurs brebis, leurs guirlandes …
O vaghe montanine pasturelle
O vaghe montanine pasturelle,
D’onde venite sì leggiadre e belle ?
Qual è il paese dove nate sete,
Che sì bel frutto più che gli altri adduce ?
Creature d’Amor vo’ mi parete,
Tanto la vostra vista adorna luce !
Nè oro ne argento in voi riluce,
E mal vestite parete angiolelle.
— Noi stiamo in alpe presso ad un boschetto
Povera capannetta è ’l nostro sito :
Col padre e con la madre in picciol letto
Torniam la sera dal prato fiorito ;
Dove natura ci ha sempre nodrito,
Guardando il dì le nostre pecorelle.
— Assai si de’ doler vostra bellezza,
Quando tra monti e valle la mostrate ;
Che non è terra di sì grande altezza
Dove non foste degne e onorate.
Deh, ditemi se voi vi contentate
Di star ne’ boschi così poverelle.
Più si contenta ciascuna di noi
Andar dietro alle mandre alla pastura,
Che non farebbe qual fosse di voi
D’andare a feste dentro vostre mura.
Ricchezze non cerchiam nè più ventura
Che balli canti e fiori e ghirlandelle.
Ballata, s’i’ fosse come già fui,
Diventerei pastore e montanino ;
E prima che io il dicesse altrui.
Sarei al loco di costor vicino ;
Ed or direi Biondella et or Martino,
Seguendo sempre dov’andasson elle.
Oh charmantes pastourelles de la montagne,
d’où venez-vous donc, si gracieuses et si belles ?
Quel est le pays où vous êtes nées
qui, plus que les autres, produit de si beaux fruits ?
Vous me paraissez des créatures d’amour,
tant votre forme est ornée de lumière !
En vous ne brille ni l’or ni l’argent,
et même mal habillées, vous paraissez de petits anges.
— Nous sommes dans la montagne près d’un bosquet
Une pauvre cabane est notre logis :
Avec notre père et notre mère dans un petit lit
nous revenons le soir de notre pré en fleur ;
où la nature nous a toujours nourris
en gardant le jour nos petites brebis.
— Votre beauté doit beaucoup souffrir,
car vous ne la montrez qu’entre mont et vallée ;
il n’est pas de ville d’une si grande noblesse
où vous ne seriez dignement honorées.
Allez, dites-moi si vous vous contentez
de rester dans les bois dans une telle pauvreté.
Chacune de nous est plus contente
d’aller en pâturage derrière nos troupeaux,
que ne le serait n’importe lequel d’entre vous
d’aller à des fêtes à l’intérieur de vos murailles.
Nous ne cherchons ni richesses ni plus de fortune
que des bals, des chants, des fleurs et des guirlandes.
Ballade, si j’étais encore jeune comme je le fus
je deviendrais berger dans la montagne ;
Et sans le dire à personne.
Je serais dans ce lieu à côté d’elles ;
Et je dirais tantôt « Biondella », tantôt « Martino »,
en les suivant toujours là où elles seraient allées.
Pendant que les bourgeois se livraient ainsi à la fête et à la joie de vivre, que faisaient les paysans et que chantaient-ils ? Ils ne l’écrivaient certainement pas, mais se le transmettaient oralement d’une génération à l’autre. Dario Fo (1926-2016), le Nuovo Canzoniere Italiano et l’Istituto Ernesto De Martino avaient tenté de prolonger cette tradition dans leur spectacle Ci ragiono e canto de 1966. C’est un ensemble de chansons dont la source et l’histoire sont toujours indiquées dans le livret et dont certaines sont très anciennes. Les textes disent la vie quotidienne du peuple, ses peines, son travail, son exploitation, ses souffrances, ses mythes, sa foi religieuse comme son hostilité aux prêtres qui lui demandent de l’argent ; mais ils disent aussi ses modes de pensée, ses « paroles de vérité » qui expriment son ordre des choses, et même sa connaissance des changement scientifiques (une chanson dit ironiquement : « Je suis content d’être au monde / depuis que je sais qu’il est rond », et elle ajoute que l’on marche toujours pieds-nus alors que les « Signori » ne font rien : le progrès de la pensée ne change rien à la situation des paysans). Citons quelques chansons.Une première est une berceuse dont Roberto Leydi reprend le texte dans I canti popolari italiani, Mondadori, 1973, pp. 46-47. Elle raconte la triste vie réelle des parents, avant de dire que sa mère est une reine et son père un comte
Nana bobò
Nana bobò, nana bobò,
tutti i bambini dorme e Guido no.
Nana bobò, nana bobò,
tuti i bambini dorme e Guido no.
Dormi dormi dormi per un ano,
la sanità to padre e poi guadagno.
E dormi dormi dormi bambin de cuna,
auto mama no la gh'ela, a xe 'ndà via,
ela xe 'ndà via, la xe 'ndà a Sant'Ana,
ela xe 'ndà prendar l'acqua nela fontana
E la fontana non è minga mia,
la xe dei preti de Santa Lucia.
Nana, bambin, nana bambin,
dormi dormi piú di una contesa
auto mama la regina
to padre il conte
to madre la regina dela tera
to padre il conte dela primavera.
Fais dodo, fais dodo,
tous les enfants dorment et pas Guido,
Fais dodo, fais dodo,
tous les enfants dorment et pas Guido.
Dors, dors pendant un an,
la santé à ton père et puis un peu de gain.
Et dors, dors, enfant du berceau,
ta maman n’est pas là, elle s’en est allée,
elle s’en est allée, s’en est allée à Sainte Anne,
elle s’en est allée prendre de l’eau à la fontaine
Et la fontaine n’est pas à moi,
elle est aux prêtres de Sainte Lucie.
Dors mon enfant, dors mon enfant,
dors plus qu’une comtesse,
ta maman est la reine,
ton père est le comte,
ta mère est la reine de la terre,
ton père est le comte du printemps.
À la fin de la vie, on pleure la mort des proches, et les paysans pratiquent le « lamento funebre », et font appel pour cela à des femmes du village qui se spécialisent dans la représentation de la douleur de la famille. Ce sont les « pleureuses ». C’était une vieille pratique en particulier des pays du Nord de l’Europe, et autour de la Méditerranée, on la connaît depuis l’Égypte ancienne. Celle-ci est de provenance slave, passée dans les Abruzzes avec les migrations de la fin du XVIe siècle suite à l’invasion turque, elle est reprise par Giovanna Marini et a été étudiée par un auteur comme Ernesto de Martino :
Mare maje
Mare maje, e scure maje
tu si morte e io che fazze
ma me sciatt'e trecce 'n fazze
ma m'accede 'n coll'e taje
E mare ma' mare ma' mare maje
e scure ma' scure ma' scure maje
ma m'acce' mo m'acce' ma m'accede ‘ncoll’ e ta’
So na pachera spirgiute,
lo muntoni m’ha lassateles moutons m’ont laissé seule
lo guaggiuoni sembr’abbajele
pe la fame mo s’arraje
O mare ma’ ecc.
Je a tiné na casarielle
ma songhe senza recette
senza foche esenza lette,
senza pane e companaje.
Je souffre, je sombre
tu es mort et moi qu’est-ce que je fais
Maintenant je frappe mes tresses sur mon visage
Je vais me tuer sur ton corps
Je souffre, je sombre…
Je suis une brebis perdue,
les moutons m’ont laissée seule
le chien aboie sans arrêt
la faim il se met en colère.
Et je suis une petite maison
mais maintenant me manque même une tanière
sans feu, sans lit, sans pain, sans rien pour mettre dessus.
Entre le berceau que l’on balance et le cercueil final, il y a une vie de travail dont on chante les rythmes, comme dans ce chant vénitien, Canto dei battipali, ceux qui enfonçaient les pieux dans les canaux et la lagune de Venise : de six à huit hommes étaient rassemblés autour d’un pieu sur lequel ils tapaient à tour de rôle avec leur masse ; l’un d’entre eux entonnait le premier vers de la chanson et tous les autres lui faisaient écho en abattant leur masse. Ainsi le chant de travail n’était pas un spectacle, mais un moment nécessaire de l’acte de travail :
Canto dei battipali
E leveremo
la bandiera bianca ooh !
Bandiera bianca
ma segno di pace ooh !
E leveremo
la bandiera rossa ooh !
Bandiera rossa
ma sègno di sangue ooh !
E-leveremo
la bandiera nera ooh !
Bandiera nera
ma segno di morte ooh !
Et nous lèverons
le drapeau blanc ooh !
le drapeau blanc
mais signe de paix ooh !
Et nous lèverons
le drapeau rouge ooh !
le drapeau rouge
mais signe de sang ooh !
Et nous lèverons
le drapeau noir ooh !
le drapeau noir
mais signe de mort ooh !
Un autre chant dit par exemple simplement la dureté du travail et le retour d’exil, enregistré dans le Latium, et très probablement ancien. Montesicuro est un village proche d’Ancona dans les Marches, donc assez loin du Latium. Le « paolo » (ou « giulio ») valait 10 « baiocchi » et un « scudo » valait 100 « baiocchi », il avait donc gagné 6 « paoli », une bien maigre somme.
So stato a lavorà a Montesicuro
So stato a lavorà a Montesicuro
ce manca quattro pavele a uno scudo.
Non posso di però quanto ho sudato
so mezzo morto me se schianta il core
1'anama me va per conto suo.
Mannaggia allora a quanno ci ho pensato
d'annatte a laorà ma a quel diserto
che p'arricchi 'n brigante so crepato.
Je suis allé travailler à Montesicuro
il ne manque que 4 « paoli » à un écu.
Mais je ne peux pas dire tout ce que j’ai sué
je suis à moitié mort et mon cœur va éclater
et mon âme s’en va de son côté.
merde au moment où j’ai pensé
à aller travailler dans ce désert
car je vais crever pour enrichir un brigand.
Avec les chants de travail, les communautés paysannes pratiquent beaucoup les chants d’amour, par lesquels les garçons déclarent leur amour à une fille en venant chanter des sérénades sous son balcon, avec leurs frères ou leurs amis. Et puis on chante les problèmes nouveaux posés par l’évolution de la société, les ravages provoqués par les nobles lorsqu’ils viennent chasser sur les terres agricoles, les famines, les épidémies de peste, la nécessité de s’exiler pour faire vivre la famille, la guerre qui va de plus en plus obliger les paysans à se battre pour leur seigneur puis pour leur nation, ce qui fait d’eux les principales victimes des combats, ceux dont on ne parlera jamais, qui ne seront jamais des héros, et auxquels on n’offrira plus tard que des monuments aux morts sur la place du village. Et puis les corvées, les injustices infligées par la justice ou par les abus de droits, la misère.
Ils chantent aussi leurs fantasmes, leurs croyances, et leur vie n’est souvent rythmée que par le cycle des fêtes religieuses chrétiennes qui racontent la vie du Christ ou celle du saint protecteur local. L’objet de ces fêtes n’est pas « Dieu », rarement le « Père », mais les souffrances de Jésus sur la Croix, en qui les paysans se reconnaissent, ou celles de sa mère, Marie, image de ce que souffrent tous les jours les mères qui voient souffrir ou mourir leurs enfants. On invoque aussi le « saint », héritier chrétien des « dieux » protecteurs spécialisés du polythéisme ancien, pour être guéris d’une maladie, pour enrayer une sécheresse source de famine, pour éviter une épidémie, pour être sauvés d’un naufrage, etc. ; l’ex-voto est l’une des expressions importantes de cette religion populaire, qui est loin de la religion officielle dominante, car il y a bien deux religions chrétiennes, celle du peuple, celle des classes dominantes qui fait le maximum pour faire taire ou réprimer la première.Le peuple chante aussi pour se divertir, dans ses soirées, ses fêtes de village : à l’occasion d’un mariage, d’un baptême, d’une cérémonie civile ou religieuse, on raconte des histoires de rois, de princes, de fées ou de dragons, on s’oppose dans des « contrasti » sur les thèmes de la vie (voir plus haut), etc.C’est tout cela « l’histoire », pour le peuple, bien loin de celle que l’on raconte, qui n’est que celle des rois, des nobles, des « grands », des batailles, des guerres. La « renaissance » n’existe pas pour le peuple, c’est une réalité de cour et d’église, de princes, de banquiers, de cardinaux ; tout au plus, le peuple viendra admirer les belles images que les pouvoirs financent dans les églises, pour compenser par ces dons leurs péchés d’usure et de luxure et gagner malgré tout une chance d’aller au paradis.
Les chansons critiques de cette « Renaissance » ne viendront donc que de l’intérieur de la classe dominante, les chansons dites « goliardiche », c’est-à-dire écrites par des étudiants venus généralement de cette classe, intelligents, riches, qui pouvaient se moquer de leurs ancêtres. Une de ces chansons est restée célèbre, Il barone Fanfulla da Lodi. Ce baron Bartolomeo Tito Alon est connu sous le nom de Fanfulla da Lodi, c’était un « condottiero », un chef de guerre né à Basiasco le 1er septembre 1499 et mort à Pavie le 24 février 1525 (Voir ci-contre sa statue sur la place Raimondello Orsini de Lecce). En somme un de ces grands mercenaires au service des puissances européennes, que l’on va mythifier comme des héros de la vaillance italienne ; il aurait entre autres participé avec Ettore Fieramosca (1476-1515) à la fameuse Disfida di Barletta de 1503, dans les Pouilles.
Comme la chanson de Paolo Villaggio et Fabrizio de André citée plus haut sur Charles Martel qui revient de la bataille de Poitiers, celle-ci évoque Fanfulla aux prises avec une fille facile qui veut le faire payer après lui avoir transmis une étrange maladie :
Il barone Fanfulla da Lodi
Il barone Fanfulla da Lodi
condottiero di gran rinomanza
fu condotto una sera in istanza
da una donna di facile amor.
Era nuova ai certami d'amore
di Fanfulla la casta alabarda
ma alla vista di tanta bernarda
prese il brando e si mise a pugnar.
E cavalca, cavalca, cavalca
alla fine Fanfulla si accascia
al risveglio la turpe bagascia
“Cento scudi mi devi tu dar”
Vaffancul, vaffancul, vaffanculo
le risponde Fanfulla incazzato
venti scudi già ieri ti ho dato
ed il resto lo prendi nel cul.
Passa un giorno, due giorni, tre giorni
e a Fanfulla gli prude l'uccello
cos'è mai questo male novello
che natura ci vuole donar ?
Fu chiamato un famoso dottore
quello venne e poi disse : "Fanfulla
qui bisogna amputare una palla
se di scolo non vuoi tu morir"
Di Fanfulla l'uccello reciso
fu deposto in un'orrida bara
mille vergin facevano a gara
per cantargli codesta canzon :
« Facesti il fol, facesti il fol
chiaviasti senza guanto, il guanto, il guanto
facesti il fol, facesti il fol,
chiaviasti senza guanto e beccasti lo scol ! »
La morale di questa vicenda
si riduce alla legge del menga :
chi l'ha preso nel cul se lo tenga
ed impari ad usare il golden !
Però oltre alla legge del menga
ci sta pure la legge del Volga :
chi l'ha preso nel cul se lo tolga
e lo metta nel cul del vicin !
Le baron Fanfulla da Lodi,
Condottière de grand renom,
Fut conduit un soir sur sa demande
Chez une dame d’amour facile.
Elle était novice aux duels d'amour
La chaste hallebarde de Fanfulla
Mais à la vue d'un si bel atour,
Il prit son épée et se mit à combattre.
Et il cavale, cavale, cavale
Enfin Fanfulla s’écroule.
Au réveil, l'abjecte putain
Lui dit: « Cent écus, tu dois me donner ».
Va te faire foutre, va te faire foutre
Lui répond Fanfulla en colère
Je t'ai déjà donné vingt écus hier
Et le reste, tu te le mets dans le cul.
Un jour passe, deux jours, trois jours
et l’oiseau de Fanfulla le démange
quel est donc ce mal nouveau
Que la nature veut nous donner ?
On appela un célèbre docteur
Il vint, et puis il dit : « Fanfulla
Il faut amputer une couille,
si tu ne veux pas mourir de la vérole »
De Fanfulla l'oiseau coupé
Fut déposé dans une horrible bière
Mille vierges firent une compétition
Pour lui chanter cette chanson :
« Tu fis le fol, tu fis le fol,
Tu baisas sans gant, sans gant, sans gant
Tu fis le fol, tu fis le fol,
Tu baisas sans gant et tu attrapas la vérole ! »
La morale de cette histoire
Se réduit à la loi de la menga :
Qui l'a dans le cul se le garde
Et apprenne à se servir de capote !
Mais au-delà de cette loi,
Il y a aussi la loi de la Volga :
Qui l'a dans le cul l'ôte du sien
Et le mette dans le cul du voisin !
Une satire sans pitié qui sera reprise à plusieurs reprises, dont une imitation récente sur Silvio Berlusconi, Il Ducetto Silviuccio d’Arcore (Voir le texte sur Internet : ww.antiwarsongs-il barone fanfulladalodi), qui raconte ses démêlés avec Noémi et en conséquence le divorce de sa femme Véronique. La chanson reprend des expressions citées dans des films (la legge del menga et la legge della Volga) à partir d’une chanson très connue Il Processo di Sculacciabuchi, peut-être de Giovanni Rosadi (1869-1925), histoire du procès d’un prêtre pédophile : déjà à la fin du XIXe siècle, on savait les choses, on les évoquait en chanson, mais on n’en parlait pas trop en public.Une autre chanson plus récente sur la Renaissance est L’ammucchiata de Riccardo Marasco (1938-2015). Marasco était un important cantautore florentin, auteur et interprète de chansons populaires surtout toscanes, du Moyen-êge à nos jours et dans la pure tradition de l’humour et de la satire de la région. L’Ammucchiata, de 1976, est une chanson satirique sur les mœurs des nobles florentins et des artistes de la Renaissance. C’est un auteur intéressant, reçu aussi en France, populaire à Florence mais resté marginal aux médias.La première strophe est une citation de Laurent de Médicis, au début de son Lamento di Bacco e Arianna. Giuliano était le frère de Laurent, tué en 1478 lors de la révolte des Pazzi. Le jeu de mots de la 3e strophe est difficile à traduire : « l’uccello » est à la fois l’oiseau et le sexe masculin, on l’attrape à la chasse (acchiappare) ou on le prend dans les fesses (chiappa). L’Impruneta est une commune à quelques kilomètres de Florence, longue à atteindre à pied. Carosello fut une émission publicitaire des années 1960/1970, jusqu’en 1977, à l’heure limite où les enfants devaient aller se coucher après l’avoir regardée. L’emblème des Médicis comportait alors six boules (« sei palle ») et on appelait les partisans des Médicis les « palleschi » contre ceux de Savonarole qui étaient les « piagnoni » (les pleurnicheurs). Les Ciompi étaient les cardeurs de laine de Florence qui se révoltent contre leur statut d’infériorité en 1378. Le « Gruppo degli Otto » ou « gli Otto di guardia e di Balìa » étaient les huit personnes du Conseil chargé de la police et de l’ordre public jusqu’au XVIII siècle, dont on voit encore aujourd’hui quelques plaques sur les murs de Florence. La strophe 11 parle de Angelo Poliziano, le poète préféré de Laurent le Magnifique. Dans la strophe 12, Marasco parle de l’architecte Leon Battista Alberti (1404-1472), du grand humaniste restaurateur du platonisme Marsile Ficin (1433-1499), cependant peu amateur de Plotin (205-270), et Lucrezia, n’est probablement pas Lucrezia Borgia, qui n’a rien à voir avec Florence mais la poétesse florentine Lucrezia Tornabuoni (1427-1482), la mère de Laurent le Magnifique ; mais le texte parle de la « tante » de Laurent (la zia de la strophe 6) et on ne connaît pas de tante de Laurent qui se soit appelée Lucrezia ; il Buonarroti est évidemment Michelange (1475-1564). Le personnage de la strophe 13 est le grand organiste Antonio Squarcialupi (1418-1480) qui inventa un petit orgue portable considéré comme l’ancêtre de l’accordéon, comme l’indique une note parlée (ces notes sont toutes les phrases entre parenthèses) de Marasco qui joue aussi sur l’òrgano, à la fois l’orgue et l’organe (le sexe) ; Andrea del Castagno (1423-1457) est le peintre célèbre. Dans la strophe 14, l’Ammanati est Bartolomeo Ammanati (1511-1592), sculpteur et architecte ; « Il Biancone » est la statue de Neptune de Piazza della Signoria, sculptée par Ammanati, peu aimée des Florentin et souvent objet d’actes de vandalisme ; « Il Settebello » est le préservatif le plus connu en Italie, fabriqué par Hatù, usine proche de la Giordani … qui produit des voitures d’enfants. Le Pier Capponi (1440-1496) de la strophe 17 est le héros guerrier lors de l’assaut de Florence en 1530 par les Impériaux à qui il dit que s’ils faisaient sonner leurs trompettes, lui ferait sonner ses cloches. La strophe 17 cite Galileo Galilei (1564-1642) et Benvenuto Cellini (1500-1571), le grand joailler et sculpteur dont on disait que l’autobiographie était un ensemble de mensonges et d’inventions. Pier Soderini (1452-1522 -Strophe 19) fut le gonfalonier de la République qui dut s‘enfuir en 1512 lorsque rentrent les Médicis. Gautier de Brienne, le duc d’Athènes (strophe 20) fut en 1342 le tyran de Florence, chassé par des nobles de la campagne du Mugello, parmi lesquels les Médicis ; après quoi Marasco cite Petrarca (1304-1374) et Boccaccio (1313-1375), et dans la strophe 21, le céramiste Andrea della Robbia (1435-1525), le peintre Filippo Lippi (1406-1469) et Filippo Brunelleschi (1377-1446), l’architecte de la coupole de Florence, avec les lansquenets allemands qui occupèrent et pillèrent Florence en 1530, suivis dans la strophe 22 de Cimabue (1240-1302) et son élève Giotto (1238-1337)), dans la 23e le poète du Dolce Stil Nuovo, Guido Cavalcanti (1255-1300), dans la 24, Pietro Aretino (1492-1558), dont les Ragionamenti et les Sonnets luxurieux étaient une satire féroce des mœurs en particulier sexuelles racontées par une prostituée ; puis dans la 25e les peintres Masaccio (1401-1428) et Giorgio Vasari (1511-1574), suivis de Piero della Francesca (1416-1492) et de Giuliano da Sangallo (1433-1516) dans la strophe 27. Voilà enfin Dante Alighieri (1265-1321) « au regard de griffon » qui téléphone via delle Burella, une très ancienne rue de Florence (le « burella » étaient des caves profondes qui servaient de glacières) et qui demande à Béatrice d’appeler Paolo Casella (vers 1250-1300), le grand musicien de Florence qui apparaît dans la Divine Comédie, après que Dante ait retrouvé le concept central de « bolgia », les fosses de son Enfer. Fra Angelico (1395-1455) peint en rouge les fesses des dames et des damoiseaux. On passe ensuite à Bernardo Rucellari (1448-1514), descendant d’un noble qui, en revenant d’une Croisade, inventa une teinte pourpre ou violette à partir d’un lichen arrosé d’urine, ce qu’explique Marasco dans un commentaire parlé de sa chanson. Andrea Verrocchio (1435-1488), le grand sculpteur, apparaît dans la strophe 31. Puis après une attaque à Leonardo da Vinci (1452-1519), vient le Maestro Isacco (Isaac van Schereberge), le grand musicien d’origine hollandaise qui fut nommé Maître de Chapelle après avoir composé pour les Médicis une ode qui commençait par « Palle, palle ». On va vers la fin de cette longue chanson avec Paolo Uccello (1397-1475), source d’un nouveau jeu de mots sur « l’uccello », et Luchino Visconti (1906-1976) qui travailla à Spoleto pour le célèbre Festival de notre époque. Et tout se termine par l’évocation de la révolte des Pazzi en 1478, qui mit en cause la domination des Médicis, et par la condamnation de Laurent le Magnifique par Jérôme Savonarole (1453-1498) et la mise au bûcher de ce dernier par les pouvoirs florentins. C’est en effet la fin d’une époque et le début de la fin de la Renaissance après la mort de Laurent le Magnifique en 1492. Après, commencent les guerres d’Italie, la Réforme luthérienne, et on sera bientôt entrés dans une nouvelle ère, qui prendra le nom de « baroque ».La chanson est intéressante parce qu’elle inclut avec précision dans cette orgie médicéenne tous les grands noms de l’histoire de Florence, utile pour les non-florentins que nous sommes. Presque tous les noms : on est frappé de constater l’absence de Sandro Botticelli (1445-1510). La langue populaire est plus réaliste et verte que la nôtre… et elle peut nous paraître vulgaire si on oublie que c’est une « chanson » et pas ce qu’on appelle un texte « littéraire » : les paroles doivent être écoutées en musique, et on l’entendra alors comme une tentative d’évoquer les modules musicaux de l’époque. Il n’y a d’ailleurs en réalité que peu de mots vulgaires (« culetto del paggetto » …), et tout est dit à travers des images d’orgie sexuelle, où les rapprochements sont parfois possibles avec le film de 1973, La grande abbuffata, réalisé par Marco Ferreri (1928-1997).Probablement, si les Médicis avaient une sexualité libre avec leurs servantes et avec les dames de leur cour, ils n’ont jamais organisé de grandes orgies sexuelles comme celle-ci, pas plus que tous ces grands artistes n’y auraient participé. Mais la fin de la chanson nous donne certainement une clé d’interprétation : la joie de vivre et le goût de la beauté de la Renaissance ne furent le fait que d’un groupe restreint de la cour des Médicis et disparurent avec eux dès la fin du siècle dans le bûcher de Savonarole. Cela relativise en temps et en profondeur cette « renaissance » dont, depuis le romantisme, on a parfois fait et dit n’importe quoi ; cette limitation n’empêche pas qu’elle ait créé des œuvres admirables et universelles qu’on admire toujours. Cela termine aussi notre propos sur la question.
L'ammucchiata
Quant'è bella giovinezza
che si fugge tuttavia
chi vuol'esser lieto, sia
di doman non v'è certezza.
Udite, udite, madonne e messeri
l'istoria facèta che accadde l'altr'ieri.
Due freschi virgulti di nobil casata
per vincer la noia t'inventonno l'ammucchiata
A nord di Firenze, in quel di Mugello
gli è sport diffuso chiappare l'uccello
(c'era molta selvaggina a' que' tempi)
e i bimbi d'i' Medici, gaudenti per schiattare
correvano i' rischio di chiapparlo, sì,
ma nella chiappa.
Que la jeunesse est belle
qui s’enfuit pourtant
Que celui qui veut être heureux le soit
pour demain il n’y a pas de certitude.
Écoutez, écoutez, dames et seigneurs
l’histoire facétieuse qui est arrivée avant-hier.
Deux frais rejetons d’une noble maison
pour vaincre l’ennui ont inventé pour toi le sexe de groupe
Au nord de Florence, dans le Mugello
c’est un sport répandu que d’attraper les oiseaux
(il y avait beaucoup de gibier en ce temps-là)
et les enfants des Médicis, jouisseurs de famille
couraient le risque de le prendre ou
mais dans les fesses.
Fratello Giuliano, diceva Lorenzo,
"su, diàmci da fare co' un po' di buon senso
bisogna trovare de' modi ben scaltri
per metterlo in locum
ma... in un locum che sia d'altri"
"Allora bisogna, perché il gioco riesca,
che sia contorta, confusa la tresca
così chi lo prende, ossia il ricevente
non possa dir niente, quod ignorat offerentem"
"Che cosa geniale, che grande trovata
ma questo, fratello, lo sai, è l'ammucchiata
i' babbo è a Firenze, pe' far mercanzia
facciamo la prova, si chiama bimbi"
La cosa doveva restare segreta
e invece si seppe anche all'Impruneta
perché babbo Piero pe' 'un perdere' i' Carosello
fe' prima ritorno, e, aperto l'uscio, ritrovossi
in bordello.
"Frère Julien", disait Laurent,
"Allons, commençons avec un peu de bon sens
il faut trouver des moyens bien astucieux
pour le mettre in locum
mais dans un locum qui appartienne à un autre"
"Alors pour que le jeu réussisse,
il faut que l’intrigue soit tordue et confuse,
de sorte que celui qui le prend,
ne puisse rien dire parce qu’il ignore qui la lui a offerte"
"Quelle chose géniale, quelle grande trouvaille,
mais tu sais, mon frère, c’est cela l’ammucchiata,
notre papa est à Florence, pour faire des affaires,
faisons l’essai, on appelle les petits garçons."
La chose devait rester secrète,
mais on l’apprit même à l’Impruneta,
car papa Piero, pour ne pas perdre Carosello,
revint plus tôt, et en ouvrant la porte, il se retrouva
dans un bordel.
Madonne, a Ser Piero per quella visione
gli venne un'idea, e in più un coccolone
e disse spirando: "Schiaf.. schiaf... schiaf...
Schiaffatemi sei palle in su i' blasone"
Osanna, trionfi, onori ad oltranza
ai bimbi d'i' Medici offerse Fiorenza
da Piazza del Duomo alla Signoria
si andava berciando : "a i' mucchio...
a i' mucchio... sia icchè sia..."
I Ciompi, le Arti, maggiori, minori
i nobili tutti, i saggi, i priori
e poi i' gonfalone co' i' gruppo degli otto
correvano pensando "io sopra, te sotto"
Lorenzo da un lato palpava un paggetto
che intanto al Giuliano porgeva il culetto
Dall'altro, solingo, il buon Poliziano
se lo trastullava con sua lesta mano.
L'Alberti palpava Marsilio Ficino
seppur come chierico odiasse Plotino
e donna Lucrezia il bel Buonarroti
diceva : "Va meglio se prima lo scuoti".
Sainte Vierge, au Sieur Piero pour cette vision
il lui vint une idée et en plus un coup d’apoplexie
et il dit en expirant : « Fou … Fou … Fou
foutez-moi six boules sur ce blason »
Des Osannah, des triomphes, des honneurs à outrance
aux enfants des Médicis offrit Florence
de la Place du Dôme à la Seigneurie
on allait en braillant : « Je suis dans la mêlée…
quoi qu’il en soit… »
Les Ciompi, les Corporations, grandes et petites
tous les nobles, les sages, les prières
et les gonfaloniers avec le groupe des Huit
couraient en pensant : « Moi dessus, toi dessous »
Laurent d’un côté pelotait un petit page
qui en attendant tendait son petit cul à Julien
D’un autre, solitaire, le bon Politien
s’amusait de sa petite main leste.
L’Alberti pelotait Marsile Ficino
bien qu’en tant que clerc il haïsse Plotin
et à dame Lucrèce le beau Buonarroti
disait : « Ça va mieux si tu le secoues avant ».
Citons pourtant avant de conclure la partie centrale de la chanson de Caparezza, Sono il tuo sogno eretico (2011), entre la première sur Jeanne d’Arc (1412-143) et la troisième sur Giordano Bruno (1548-1600). Au vers 4, il joue sur le sens de « mettere a fuoco » qui signifie en photographie mettre au point :
Sono il tuo sogno eretico
Invece io sono domenicano
ma non chiedermi come mi chiamo,
qua è sicuro che non me la cavo,
mi mettono a fuoco non come la Canon,
detesto i potenti della città
detesto Sua Santità,
un uomo carico d'avidità
che vende cariche come babbà.
La tratta dei bimbi come geishe
cresce in tutto il clero
ma nessuno ne parla e il millequattro
non è anno zero
ed ora mi impiccano, mi appiccano come un
bengala a capodanno,
di me rimarrà un pugno di cenere
da gettare in Arno!
Au contraire moi je suis dominicain
mais ne me demande pas comment je m’appelle,
ici, il est sûr que je ne m’en tire pas,
on me met au feu comme un Canon,
je déteste les puissants de la ville
je déteste Sa Sainteté,
un homme plein d’avidité
qui vend des charges comme des babas au rhum.
La traite des enfants comme des geishas
augmente dans tout le clergé
mais personne n’en parle et l’an 1400
n’est pas l’année zéro
et maintenant on me pend, on me pend comme un
feu de Bengale pour le jour de l’an,
de moi il restera une poignée de cendres
à jeter dans l’Arno !
Accendevi i falò laggiù,
bruciavi i libri di belzebù,
hera meglio mettere su i
carboni del barbecue!
Tu allumais des feux là-bas
tu brûlais les livres de Belzebù,
il aurait mieux valu installer
les charbons du barbecue !
Mi bruci per ciò che predico,
è una fine che non mi merito,
mandi in cenere la verità
perchè sono il tuo sogno eretico,
io sono il tuo sogno eretico
io sono il tuo sogno eretico
io sono il tuo sogno eretico ammettilo
sono il tuo sogno eretico.
Tu me brûles pour ce que je prêche,
c’est une fin que je ne mérite pas,
tu mets en cendres la vérité
parce que je suis ton rêve hérétique,
je suis ton rêve hérétique
je suis ton rêve hérétique
je suis ton rêve hérétique, admets-le
je suis ton rêve hérétique.
« Hérétique », c’est ainsi que l’Église catholique a appelé ceux qui, à l’intérieur et à l’extérieur, pensaient différemment d’elle ou contestaient son pouvoir. De ce point de vue, la « Renaissance » avait beaucoup d’aspects hérétiques, et à partir du Concile de Trente, l’Église rétablira sa domination idéologique et sur le clergé et sur les fidèles, pour tenter de compenser les victoires des « hérésies » vaudoise, luthérienne, calviniste et autres … et les armes de l’inquisition, militaires et idéologiques, déjà existantes depuis trois siècles, vont se renforcer.
Troisième partie
De la Renaissance à la Révolution française
« La storia che impariamo nelle scuole istituzionali è la storia delle dominazioni, del potere da esercitare su popolazioni assoggettate, è la storia delle signorie, delle dinastie regnanti, di accaparramenti di ricchezze, dunque storia dei destini delle ricchezze che passano da una mano all’altra. La forza motrice di ogni guerra è la volontà di possedere, di tenere (…) Nella guerra vince il più forte cioè colui che è più ricco. Nella grande storia il vero protagonista non è l’uomo bensì le ricchezze dell’uomo. I motivi principali di ogni guerra, di ogni azione bellica sono l’accaparrarsi di beni materiali che appartengono agli altri. Questa è la storia che impariamo nelle scuole. La retorica come la logica di questa grande Storia è la giustificazione della guerra che nel grande mondo della piccola gente è portatrice di miseria, di degrado e di morte. E’ quel piccolo mondo di quella grande gente che opera e dirige i destini di quel grande mondo che è la piccola gente. »
« L’histoire que nous apprenons dans les écoles institutionnelles est l’histoire des dominations, du pouvoir à exercer sur des populations sujettes, c’est l’histoire des seigneuries, des dynasties régnantes, d’accaparement de richesses, donc histoire des destins des richesses qui passent d’une main à l’autre. La force motrice de toute guerre est la volonté de posséder, d’avoir (…). Dans la guerre gagne le plus fort c’est-à-dire celui qui est le plus riche. Dans la Grande histoire, le vrai protagoniste n’est pas l’homme, mais bien les richesses de l’homme. Les motifs principaux de toute guerre, de toute action guerrière sont l’accaparement de biens matériels qui appartiennent aux autres. Telle est l’histoire que nous apprenons à l’école. La rhétorique comme la logique de cette grande Histoire est la justification de la guerre qui dans le grand monde des petites gens est porteuse de misère, de dégradation et de mort. C’est ce petit monde de ces grands personnages qui fait et dirige les destins de ce grand monde que sont les petites gens. » (Onorato Bonic’, La piccola storia di un paese qualsiasi, www.uispmarghera.org/Onorato.Pdf)
La Renaissance n’a pas été cette orgie que décrit l’Ammucchiata. Mais ce qui est certain c’est qu’elle ne fut que le fait d’une élite de la société, dont la masse du peuple ne fut tout au plus que spectateur extérieur. À partir du beau livre trop peu connu de Frédéric Antal, Fernand Braudel écrit : « Le beau livre catégorique de Frederick Antal (1947) pose le problème et propose une réponse. Pour lui, la dialectique autoritaire artiste-client se résout au bénéfice de ce dernier. C'est le client qui commande, choisit, impose ses goûts – le client, c'est-à-dire le haut d'une société étroite : une noblesse résiduelle, mais qui souvent donne le ton, enviée et, le cas échéant, ostentatoire ; une haute bourgeoisie, à l'échelle du temps fabuleusement riche, celle des sept arts majeurs, enfoncés dans cet inextricable « polypier » de sociétés mercantiles qui est, au vrai, le cœur marchand de la gigantesque entreprise urbaine ; une moyenne bourgeoisie, enfin, qui ferme la marche, celle des quatorze arts moyens et mineurs. Le reste de la population, le popolo, est hors jeu. »
« Traditionnellement, tout le monde se mêlant de tout à Florence », ce petit peuple bavarde, étale ses querelles, affiche ses préférences. Mais autant en emporte le vent, car il n'entre pas dans les cadres d'une civilisation qu'il peut voir et juger à la rigueur – du dehors – lorsqu'il s'agit, au cœur de sa ville, de l'achèvement de la coupole de Santa Maria del Fiore, ou du Baptistère, mais qu'il ne voit pas, ou mieux n'entend pas lorsqu'il s'agit des cheminements qui, par exemple, mettent en cause Platon et la Caballe, ou même les normes, antiques ou non, qui président à la construction de la chapelle des Pazzi, par Brunelleschi. »
« C'est même précisément à cette époque, celle de Masaccio et de Donatello, peut-être même déjà au temps de Giotto ( … ), c'est à cette époque qu'il y a eu cette cassure profonde de la société florentine en deux, entre le très petit groupe qui participe à la culture raffinée et la masse, rejetée dans les rangs obscurs des spectateurs à qui l'on ne demande pas trop leur avis. Sans doute ont-ils des yeux pour voir, des oreilles pour entendre (ne serait-ce que les prêches de l'église ou que les farces et brocards des poeti di piazza) mais jusqu'où portent, et qui se préoccupe de savoir jusqu'où portent les vers facétieux et anti-humanistes d'un Burchiello, par exemple, que nous avons tant de peine à comprendre tant ils sont contournés et compliqués dans leur vivacité ? »
« Ce petit peuple que nous recherchons, à peine l'apercevrons-nous au cours des fêtes populaires. Aussi éveillé, aussi prompt à la riposte qu'il est illettré, le voilà sensible sans doute à des parties de la Divine Comédie qu'on lui récite, à des historiettes tirées des vieux romans de chevalerie, ou frappé par une chanson piquante, un lamento sentimental, ou les bouffonneries de Gonnella... Mais nous ne l'atteignons pas, et c'est dommage. Cette culture d'en bas ne fait guère surface, nous pouvons tout au plus essayer de l'imaginer. »
Et il est possible que le succès de Savonarole après la mort de Laurent de Médicis en 1492 soit dû aussi à la rancune des Florentins contre cette culture aristocratique fermée, pour eux inaccessible, de la cour des Médicis. Après octobre 1434, quand Cosme de Médicis revient d’exil et prend tout le pouvoir, toutes les œuvres architecturales, picturales et littéraires ne dépendent plus que des goûts d’un groupe très restreint qui devient une cour princière. Toute la construction culturelle de la Renaissance repose sur une société où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. L’année 1492 est pour l’Italie celle de la mort de Laurent le Magnifique, la fin d’une période de paix et d’équilibre entre les États ; les découvertes géographiques, Christophe Colomb et beaucoup d’autres, passent presque inaperçues et on n’en voit guère les conséquences sur la situation de la Méditerranée. Et l’Italie entre pour plus de deux siècles dans une période de grave crise et souvent de régression, d’enrichissement d’une petite minorité et de misère d’une majorité de la population.
1- La guerre permanente
L’Italie est ravagée par les « guerres d’Italie » de 1494 (entrée en guerre ce Charles VIII qui veut reconquérir le Royaume de Naples) à 1559 (Traité du Cateau-Cambrésis entre la France, l’Angleterre, l’Espagne et le Saint Empire romain germanique, où la France abandonne sa politique d’ingérence en Italie). En France, ces guerres seront suivies des guerres de religion entre protestants et catholiques, qui commencent sous le règne de Catherine de Médicis qui ouvre la Régence en 1560 et jusqu’à l’Édit de Nantes signé en 1598. Et c’est la fin de l’indépendance italienne : la plupart des États italiens passent sous la domination d’un des grands États nationaux qui se sont constitués en Europe, la France, l’Espagne qui fait partie de l’Empire romain germanique dominé par Charles Quint, l’Angleterre.
La guerre est presque permanente dans toute l’Europe, l’Espagne contre les Pays-Bas (1548-1648), la France et l’Angleterre, la guerre de Trente Ans (1618-1648) avec ses conséquences dans la Valtellina (Valteline, au Nord de l’Italie catholique contre les Grisons protestants de 1620 à 1626) et dans le Montferrat (de 1627 à 1631), l’Espagne contre la France entre 1640 et 1659 (Paix des Pyrénées), la guerre de dévolution (1667-68) entre l’Espagne et Louis XIV dans les Flandres, la guerre de Hollande entre 1672 et 1678, la guerre de neuf ans, où s’affrontèrent la France et le Piémont (1688-1697), sans parler des guerres permanentes entre Venise et l‘Empire Ottoman, par exemple celle de 1698. Toutes ces guerres affaiblirent l’État espagnol qui chercha donc à obtenir le plus d’argent possible de ses possessions italiennes, augmenta les impôts et provoqua de nombreuses révoltes populaires.

Traité de Cateau Cambrésis - Œuvre française Palais Public de Sienne.
Les « guerres d’Italie »
Le 25 janvier 1494, Charles VIII, qui se considère comme héritier du royaume des Alpes part à sa conquête et y entre déguisé en empereur byzantin ; après lui, son cousin et successeur Louis XII repart en 1498 à la conquête du Milanais (il s’en estime héritier par sa grand-mère paternelle) et du Royaume de Naples. Il réussit, aidé par le roi d’Aragon, mais il doit quitter le Royaume en 1504, et y renoncer par le Traité de Blois. La même année, il part à nouveau à Gênes pour réprimer une révolte contre les Français ; il est finalement battu en 1513 par les mercenaires suisses ; il meurt en 1515, remplacé par François Ier.
Celui-ci franchit les Alpes dès août 1515 et remporte la bataille de Marignan, grâce à l’aide de l’armée vénitienne ; il garde le Milanais jusqu’en 1525, et doit abandonner le Royaume de Naples à Charles Quint, nouveau roi d’Espagne et empereur du Saint-Empire, après avoir perdu la bataille de Pavie le 24 février 1525. En mai 1527, pour punir l’alliance du pape avec la France (et pour payer ses soldats), Charles de Bourbon, chef de l’armée impériale, fait piller Rome par ses lansquenets.
En 1536, François Ier envahit à nouveau la Savoie et le Piémont qui resteront possession française jusqu’en 1559, et il signe un Traité avec le Sultan ottoman. Une neuvième guerre reprend de 1542 à 1546, après des changements d’alliances entre la France, l’Angleterre, le pape, l’empereur, les Ottomans jusqu’à une dixième guerre qui se termine en 1556, et reste marquée par la défaite de Sienne, défendue par le Français Blaise de Monluc (vers 1500-1577) et donnée à Florence.
Un dixième guerre s’acheva par le Traité de Cateau-Cambrésis le 3 avril 1559.
2- Il est faux que la découverte de l'Amérique en 1492 ait pour conséquence la décadence de l'Italie
L’Italie est donc traversée par les guerres de 1494 à 1559, entre les Français, les Espagnols et les troupes impériales, avec participation de l’Angleterre et de l’empire Ottoman. C’est une guerre de type nouveau, qui utilise l’artillerie et se traduit par des massacres sauvages, celui de Brescia en 1511 par les Français, celui de Rome par les lansquenets allemands en 1527, celui de Pavie par les Français en 1528, le sac de Gênes par les Espagnols en 1532. Mais ces épreuves ne sont pas permanentes et n’affectent pas toutes les régions d’Italie ; elles n’empêchent pas non plus le développement de Rome sous Jules II (1503-1513) et Léon X (1513-1521), ni les pèlerins de s’y rendre pour les jubilés. Venise aussi participe aux guerres et elle prospère, le grand escalier du Palais des Doges est construit par Sansovino en 1559, Giulio Romano construit le Palazzo Tè de Mantoue entre 1525 et 1535 ; d’autres cours restent vivantes et riches, celle des Montefeltro à Urbino, pour qui Baldassare Castiglione écrit Il Cortigiano en 1528, celle des Este à Ferrare, celle des Gonzaga à Mantoue, etc. Ce ne sont pas les villes-États qui subissent les conséquences des guerres et qui s’appauvrissent, les seuls à les subir et à s’appauvrir, sont les pauvres, les paysans en particulier.
La crise des guerres n’affaiblit pas l’Italie, les témoignages des marchands l’attestent : le modèle marchand développé par l’Italie reste dominant, fondé sur la domination de la mer Méditerranée et sur la possession d’îles et de ports dans la mer Noire et la Méditerranée orientale (Tripoli ou Alexandrie d’Égypte) ou de quartiers dans une ville comme Damas, où les Italiens vendaient leurs produits et en achetaient d’autres qu’ils exportaient jusque dans le nord de l’Europe (par les ports de la Baltique, et par l’intermédiaire de Bruges, Londres et Southampton).
Certes l’Italie avait connu au XIVe siècle une période difficile, à cause des épidémies de peste qui augmentaient le malaise social, de l’expansion turque contre l’empire mongol qui fit crouler la route de la soie entre le Moyen-Orient et l’Asie, de la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre, de la faillite de plusieurs banques florentines en 1345 (les Bardi, les Peruzzi, les Acciaiuoli, etc.), de la guerre entre Venise et Gênes … Mais le XVe siècle redevint un siècle florissant sous la direction des villes du centre et du nord de l’Italie (voir la carte ci-contre, prise dans Storia d’Italia, op. cit. Bompiani, 1989, 104, p. 3).
Venezia, Fondaco dei Turchi nel ‘700 - Milano, Raccolta Bertarelli. Grâce à sa flotte et à sa domination de l’Adriatique, Venise continuait à contrôler le commerce des épices avec les Arabes, du poivre, du genièvre, de la laque, de l’indigo, du coton, des colorants, de l’ambre, de la soie, du corail. La Sérénissime s’était dotée d’une flotte puissante de galères de marché, copie marchande de la galère longue de guerre, qui facilitait son commerce avec l’Orient, tandis qu’elle étendait son empire terrestre vers l’Ouest et son commerce avec le nord de l’Europe. Son organisation commerciale et militaire d’État ou privée lui permit de maintenir cette domination au moins jusqu’à la bataille de Lépante en 1571, contre la concurrence de la flotte anglaise.
Quant à Florence, elle continuait à se développer, obtenant enfin un accès à la mer par la conquête de Pise en 1406, mais ne pouvant concurrencer la flotte vénitienne, elle se tourna plutôt vers le commerce avec le nord, installant ses banquiers à Londres (les Médicis, les Cavalcanti, les Ridolfi…), par les ports de l’Espagne et de l’Atlantique. Lucques développa pour sa part l’industrie de la soie.
Si Venise avait le monopole du commerce des épices, Gênes transportait des matières plus volumineuses et de moindre valeur, le blé, le vin, l’alun, sur des navires marchands plus grands dotés de voiles de grande dimension, les caraques, gérées par des entreprises privées, et naviguant de la mer Noire et de l’île de Chio à Majorque, Malaga, Cadix, Gibraltar. Gênes ne perdit Chio qu’en 1566, Venise avait perdu Rhodes en 1522, Chypre tombe en 1572, la Crète en 1669 ; en Méditerranée, la flotte anglaise augmenta de plus en plus sa présence, ajoutant sa concurrence à celle des flottes turque et espagnole ; cette dernière contrôlait alors politiquement presque tout le sud de l’Italie.
Rappelons enfin la présence des Italiens dans la découverte des nouvelles routes commerciales de l’Atlantique, après la découverte de la Chine par Marco Polo, un génois, Christophe Colomb, découvre l’Amérique au profit des souverains espagnols, financé par un Italien de Séville, Francesco Pinelli. Ce sont aussi les Génois, installés depuis longtemps à Séville et en Aragon, qui soutiennent Sebastiano Caboto aux Moluques en 1526, Antonio da Noli pour les Portugais aux îles du Cap Vert en 1460. C’est financé par les Italiens que Pedro Alvarez Cabral doubla pour la première fois le Cap de Bonne Espérance et rejoignit le Brésil en 1500. Il faudrait aussi évoquer Vespucci, Verrazzano et beaucoup d’autres.
Les Génois furent aussi engagés dans le commerce des esclaves noirs qu’ils envoyaient dans le Nouveau Monde cultiver la canne à sucre, ils l’exploitaient depuis le Moyen-Âge (esclaves du Caucase et de l’Angola). Ce n’est pas par hasard que les Florentins créent au XVIe siècle le port de Livourne, pour compenser l’enlisement de celui de Pise, et que tous les grands ports italiens se développent de nouveau à la même époque.
Ridolfo Ghirlandaio (1483-1561), Portrait de Christophe Colomb, Gênes. Les Génois deviendront aussi les banquiers du gouvernement espagnol à la place des Fugger et des banquiers flamands, après la banqueroute de la couronne d’Espagne en 1557. La supériorité de leurs techniques financières valut aussi aux banquiers italiens (vénitiens, génois, lombards, amalfitains, napolitains, florentins…) de pouvoir s’installer en force dans le nouveau port d’Anvers.
Ruggero Romano a fait remarquer qu’il y avait d’ailleurs tant d’Italiens en Espagne et au Portugal, toujours en rapport avec leurs familles italiennes, qu’ils faisaient profiter indirectement l’Italie de l’or venu d’Amérique (Storia d’Italia, Bompiani, 1989, n°106, Vol. V, pp. 27-48 ; voir aussi Gigliola Pagano de Devitiis, L’arrivo dei Nordici in Mediterraneo, n° 107, p. 55).
Ce sont les Génois qui gèrent une partie importante des finances publiques espagnoles, permettant l’arrivée en Italie d’une partie de l’or et de l’argent espagnols. Outre le commerce de l’or et des épices, les Génois et les Vénitiens ont su aussi s’assurer le contrôle du sucre, non seulement en Sicile et en Calabre, mais aux îles Canaries.
Il faudra donc attendre le XVIIe siècle pour que l’Italie commence à ressentir les effets des nouvelles routes commerciales, et pour que ce soient les marines anglaise et hollandaise qui prennent le dessus. Le premier navire anglais arrive à Livourne le 25 juin 1573, suivi par la suite de très nombreux navires flamands, hollandais, allemands et même russes, en particulier pour répondre aux besoins en blé de l’Italie, touchée par de graves pénuries.
Il n’y a pas eu de déclin de l’Italie à cause de la découverte de l’Amérique et des routes de l’Atlantique, ni à cause de l’avancée de l’empire Ottoman, ni la circumnavigation de l’Afrique à partir de 1496, c’est probablement à cause de son organisation politique de classe que l’Italie a connu un déclin relatif. Car il faut voir avec Braudel que ce développement triomphal de Gênes est lié à un passage de l’activité productive et commerciale à l’activité bancaire. Or cette domination de la finance ne profite qu’à un petit nombre de familles qui l’exercent, pas à l’ensemble d’un peuple d’ouvriers, de paysans et d’artisans.
Comme dit Ruggero Romano, là est le « ver » qui se développe dans le fruit (op. cit. p.43). Et cela est encore aggravé par l’absence de stratégie économique des États et de volonté politique claire ; seule Venise résistera plus longtemps à l’offensive anglaise et hollandaise. Mais le déclin ne devint irréversible qu’à partir de la moitié du XVIIe siècle.
Un autre phénomène vint encore aggraver la crise, outre l’affaiblissement des marines italiennes et l’arrivée des marines nordiques : de plus en plus, la classe marchande italienne va chercher le maximum de profits dans les investissements immobiliers et fonciers, plus rentables et moins risqués que les activités commerciales maritimes qui subissaient les risques de piraterie et de tempêtes. Ainsi le commerce va augmenter son emprise sur la production, le rôle des producteurs (ouvriers, artisans, paysans) diminue peu à peu dans la vie politique italienne.
Cela est visible dans l’évolution des corporations (le arti e i mestieri). Alors que jusqu’au XIVe siècle, elles avaient non seulement une fonction d’organisation du travail, elles étaient à la base (du moins les corporations majeures, art de la laine, de Calimala, de la soie, des notaires, des médecins, etc.) du fonctionnement politique, elles perdent peu à peu cette importance politique dans des régimes dominés à nouveau par une nouvelle aristocratie bancaire et foncière. Les nouvelles manufactures préfèrent avoir de plus en plus des travailleurs indépendants, non dépendants des corporations qui se spécialisent par ailleurs en Italie dans la production de produits de luxe (la soie plutôt que la laine), momentanément plus rentable mais de commercialisation plus réduite et plus soumise aux crises économiques.
Ainsi, les travailleurs pèsent de moins en moins sur le pouvoir politique (à Lucques, dès le début du XVIe siècle, les corporations furent interdites de toute activité politique et de toute participation au gouvernement) qui exerce un contrôle bureaucratique de plus en plus grand sur le travail productif.
À partir de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, la transformation économique et l’augmentation de la population sont à la source de crises agraires et de carences alimentaires qui favorisent le développement de grandes épidémies de peste (1591-92, 1630-31, 1656-57) qui augmentent la misère de la masse du peuple paysan et urbain, d’où la création des Monts de Piété et des « Scuole » (associations à la fois professionnelles et caritatives, en particulier à Venise) et la construction de nombreux hôpitaux, pour tenter de limiter les conséquences sociales de la pauvreté et de la misère (Voir : Giovanni Muto, Corporazioni : da organismo economico a gruppo sociale, Storia d’Italia, Bompiani, op. cit., n° 108, pp. 73-96).

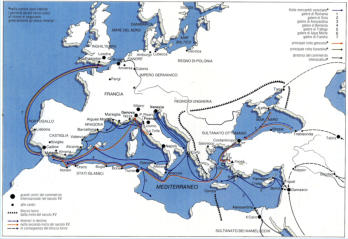

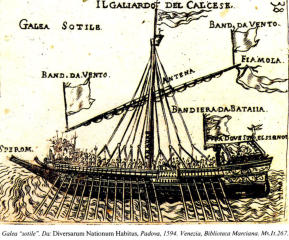
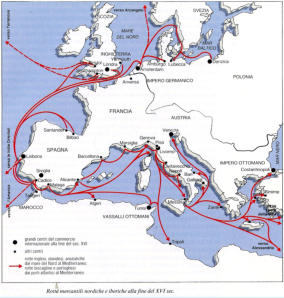
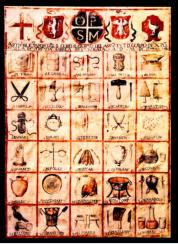
3- L'influence des changements climatiques
Rappelons aussi tout de suite que les XVIe et XVIIe siècles furent perturbés par la « petite ère glaciaire » qui assaillit le monde entier et donc toute l’Europe et la Méditerranée entre 1570 et 1700 : Les peintres en ont parfois fait une source de divertissement, mais ce fut en réalité une catastrophe écologique, donc alimentaire (Cf ci-dessous Heindrick Avercamp, Paysage d’hiver avec patineurs, 1608, Amsterdam). Cette catastrophe climatique abaisse la température de 3 à 5 degrés provoquant des effets désastreux sur les récoltes (par exemple en Sicile, mauvaises récoltes de 1605 à 1608, de 1634 à 1641, de 1668 à 1677) et donc accroissant la misère populaire et les famines (Voir l’ouvrage de Philipp Blom, Quand la nature se rebelle. Le changement climatique du XVIIe siècle et son influence sur les sociétés modernes, Éditions des Sciences de l’Homme, 2017, 270 pages, traduit de l’allemand. En italien, Il primo inverno. La piccola era glaciale e l’inizio delle modernità europea (1570-1700), Marsilio, 2018, 286 pages). Les récoltes de céréales, élément essentiel de la nourriture quotidienne, diminuent, le prix du blé et donc du pain tend à se multiplier par deux ou par trois, d’où une série de révoltes populaires et une situation de guerre civile presque permanente qui obligent même les classes dirigeantes, noblesse et bourgeoisie, à se transformer. Ce phénomène climatique contribue donc à renforcer les changements déjà perceptibles sur le plan technologique (de Guttenberg à Léonard de Vinci, à la médecine), sur le plan religieux (Luther, la Réforme et la Contre-Réforme catholique, d’où les guerres de religion), sur le plan scientifique (Galilée, Newton…), sur le plan artistique (passage de l’art de la Renaissance au Maniérisme et à l’art baroque, plus marqué par le drame de la vie sociale). Tout l’univers social et mental hérité du Moyen-Âge chrétien est bouleversé, et l’Europe entre dans une autre perspective, et dans une crise qui est aussi l’ouverture de notre monde contemporain dans tous les domaines, agricole, économique, scientifique, social, militaire, politique, culturel, artistique. Blom souligne entre autres que cette période vit se développer la « chasse aux sorcières » : dans ce temps religieux, il fallait bien trouver une cause divine (Dieu punit ainsi les péchés des humains) ou magique, alors, ne pouvant punir Dieu, on brûle les sorcières en plus grand nombre dans tous les pays où sévit la crise climatique, hivers très froids, étés trop secs, pluies torrentielles, grêles, etc. (Cf. pp. 50 sq). Il fallut du temps pour que l’on s’aperçoive de l’insuffisance des théologies (qui interprétaient les phénomènes comme manifestation de la colère divine), des processions, de la chasse aux sorcières, du recours à l’alchimie et à la magie. D’autres modèles vont permettre une évolution de la pensée, et parmi ceux-ci le texte du De rerum natura de Lucrèce que Poggio Bracciolini avait redécouvert en 1417 et qui est maintenant édité à de nombreux exemplaires. On prend conscience à nouveau que les phénomènes climatiques conditionnent tout, y-compris le contenu de la pensée et de la vie culturelle.

4- Les dominations étrangères
Les Turcs et autres pirates
Plusieurs puissances sont dominantes en Méditerranée. Commençons par le « Turc », l’Empire ottoman, fondé en 1299, qui a mis fin à l’Empire Byzantin par la conquête de Constantinople en 1453, s’est étendu en Europe jusqu’à la Serbie, au sud jusqu’à l’Égypte et au Yemen, et il n’est arrêté dans son expansion que par la défaite terrestre devant Vienne en 1529 et navale à Lépante en 1571. Les Turcs, aidés par les pirates des États barbaresques d’Alger et de Tunis et souvent alliés de la France contre les Habsbourg, n’en menacent pas moins l’empire vénitien dans la Méditerranée orientale (les Turcs conquièrent Chypre en 1570 et la Crète (Candia) en 1669 après 24 ans de guerre contre Venise), son commerce, son alimentation. Tous les habitants des côtes italiennes, sardes et siciliennes, le long de la mer Adriatique jusqu’au delta du Pô comme de la mer Tyrrhénienne jusqu’à la Toscane, craignent désormais les expéditions turques ou barbaresques. Ce n’est qu’à partir de 1699 que l’Empire ottoman commence à décliner, perdant en 1782 le contrôle de la Mer Noire, puis en 1840 celui de l’Algérie conquise par la France, puis en 1882 celui de l’Égypte dominée par la Grande-Bretagne. Soliman le Magnifique (1494-1566) Un autre danger menaçait Venise, les « Uscocchi », les Uscoques, un petit peuple de chrétiens ayant fui la Bosnie pour échapper à l’avancée turque en 1537, qui devait vivre de la piraterie contre les navires ottomans ou vénitiens dans l’Adriatique ; ils furent combattus et pratiquement éliminés par les Vénitiens en 1617 mais avaient encore quelques activités en 1707 : c’est un bel exemple d’un petit peuple ignoré de la grande histoire, qui avait dû se battre pour résister aux oppressions des « grands » peuples (Voir sur Internet l’essai de Miroslav Bertosa, La guerra degli Uscocchi e la rovina dell’economia istriana). Uscoque - Dessin du XIXe siècle - Zagreb. Les pirates barbaresques étaient alors équipés de « bertoni » (mot dérivé de « bretone » = breton), bâtiments inventés par des Anglais, ronds et très hauts, dotés de trois mats et sept voiles carrées, sa forme lui permettait de bien tenir la mer, même l’océan, et sa coque était très solide, ils étaient dotés de 20 à 30 canons et étaient donc supérieurs aux galères méditerranéennes. Alger et Tunis disposaient d’une centaine de « bertoni », en plus d’autres bateaux et étaient fournis de matériel par les Flamands par haine des Espagnols. Mais la piraterie en Méditerranée connut aussi la présence des Anglais et des Français ; en période de famine, on n’hésitait pas à s’emparer d’un navire de blé traversant la Méditerranée, même si c’était celui d’un autre pays chrétien, tous se battaient alors contre tous.


Soliman le Magnifique (1494-1566) --- Uscoque -Dessin du XIXe siècle - Zagreb
Les Espagnols et l'Empire Romain Germanique
Mais une autre grande puissance dominait alors la Méditerranée et l’Italie, l’Espagne. En 1504, Louis XII de France doit abandonner le Royaume de Naples à Ferdinand II d’Aragon ; à partir de 1519, Charles de Habsbourg, roi d’Espagne et duc de Bourgogne, obtient le titre d’Empereur romain germanique sous le nom de Charles Quint et devient donc le roi de l’Espagne et de son empire colonial, des provinces des Pays-Bas, du Royaume de Naples et des provinces autrichiennes ; ayant repris aussi le duché de Milan à partir de 1522, il est le monarque le plus puissant de son époque ; et il domine une bonne partie de l’Italie, du nord au sud. Possessions de Charles Quint en Europe Titien (1490-1576) - Charles Quint à la bataille de Mühlberg - 1548. La puissance de l’Espagne diminue dans l’océan Atlantique où elle est dominée par les marines anglaises et hollandaises, mais elle garde son influence en Méditerranée et en Italie, où elle est pourtant à nouveau menacée par la France, mais où elle provoque aussi un retour de la féodalité. L’Espagne avait constitué en Italie le Vice-Royaume de Naples (de 1503 à 1707), elle possédait la Sicile, la Sardaigne, la Lombardie (duché de Milan), et elle avait un certain contrôle sur la République de Gênes, sur les Duchés de Modène, Reggio, Parme et Mantoue et sur le Grand-Duché de Toscane. Le peuple devait subir, outre les dévastations des guerres, le poids de la fiscalité et la présence menaçante des soldats qu’il fallait loger et souvent nourrir et qui se livraient volontiers à des violences sexuelles, qui susciteront dans la Commedia dell’Arte la création de l’officier espagnol, le Capitano Spaventa.


La France
En effet, Louis XIV (règne de 1643 à 1715) et Richelieu (1552-1642) puis Mazarin (1602-1661) cherchent de plus en plus à couper les routes côtières aux navires de ravitaillement espagnols, les obligeant à prendre la haute mer, plus dangereuse. Et les incursions françaises en Italie deviennent plus fréquentes : celle dirigée par Thomas de Savoie investit les Presidi (les Présides, petit État stratégique créé par l’Espagne en 1557, pris sur les territoires de la République de Sienne quand celle-ci passe sous domination florentine. Ces territoires et ces petites îles au niveau de l’île d’Elbe permettaient de contrôler le trafic de toute la Méditerranée centrale) ; la France conservera Piombino et Portolongone jusqu’en 1650.Une seconde incursion fut menée par le duc de Guise en juillet 1647 pour tenter de soutenir à Naples le mouvement révolutionnaire de Masaniello, dans le cadre de la guerre de Trente Ans franco-espagnole. Une troisième incursion fut dirigée aussi par Thomas de Savoie en 1648, sans succès.

Les Anglais et les Hollandais
Dès 1568, les provinces septentrionales des Pays-Bas espagnols commencent à se révolter contre la domination espagnole de Philippe II (1527-1598), héritier de Charles-Quint, et prennent bientôt leur indépendance, formant en 1581 la République des Provinces Unies, de religion luthérienne, tandis que le sud (aujourd’hui Belgique et Luxembourg) reste fidèle à l’Espagne et catholique. Cette nouvelle république acquiert bientôt une puissance maritime qui fait à la fois l’admiration, l‘envie et l’hostilité des grandes puissances, à commencer par l’Espagne. Amsterdam, sa capitale, avait été aidée par Venise dans la conquête de son autonomie. Les Hollandais pénètrent en Méditerranée grâce à leurs bons rapports avec Gênes et avec Venise, et ils ont un point d’ancrage à Livourne, mais il n’y eut jamais en Méditerranée une très importante flotte hollandaise, même quand elle tenta d’intervenir dans la révolte anti espagnole de Messine, aidée par la flotte française, entre 1674 et 1678, elle n’y eut que 18 vaisseaux. Par contre, la présence hollandaise devint dominante dans le commerce atlantique, africain et asiatique. Les Anglais aussi avaient pénétré en Méditerranée, apportant du blé, du poisson salé et des draperies à la population italienne affamée, à meilleur marché que les produits vendus par Venise. À partir de 1650, ils eurent en Méditerranée 24 vaisseaux de guerre. Au XVIIIe siècle, les Anglais garantirent de plus en plus la stabilité politique de la Méditerranée, ils étaient à Tanger depuis 1662, à Gibraltar depuis 1704, à Minorque de 1708 à 1783. Mais la Méditerranée perdit de son importance et les grands conflits commerciaux et militaires vont s’orienter plutôt vers l’Amérique. Ne se trouvaient libres de la domination de puissances étrangères que la République de Venise, le Duché de Savoie, devenu Royaume de Piémont Sardaigne en 1720 et les États du Pape (Stato Pontificio). En 1713, on définissait l’Italie comme « un cadavre sans esprit » et elle semblait souvent s’être « endormie ».
Les États italiens indépendants
- Les États du Pape représentaient aussi un État italien, bien que sur les 57 cardinaux du Sacré Collège, 20 viennent de nations étrangères et 37 soient italiens. De nombreux nobles d’autres villes italiennes étaient aussi venus habiter Rome pour profiter de son prestige, et ils s’y faisaient construire de somptueux palais (les Giustiniani venaient de Gênes, les Chigi de Sienne…). Rome était devenue une ville spectaculaire, avec ses palais, ses fontaines, ses monuments dont le plus admiré était celui de Bernini autour de Saint-Pierre, qui coûtaient des fortunes au budget pontifical. En 1680, Rome avait environ 120.000 habitants, souvent soumis à une répression terrible de la part de papes comme Sixte V qui voulaient éliminer ce qu’on appelait le « brigandage » qui n’était en général que révolte populaire contre la misère et l’exploitation.
- Le Grand Duché de Toscane. Comme les autres à l’époque, il se développe artistiquement, construit des monuments splendides pour la gloire des princes, crée des « Académies » de recherche scientifique, on commence à faire de grands voyages d’exploration, dans la montagne et à l’étranger. Cosme de Médicis ouvre le grand port de Livourne, son premier accès à la mer qui devient aussi une escale pour les navires anglais et hollandais, mais ses travailleurs sont surtout des forçats italiens ou turcs. La classe dominante est très riche. Mais le peuple florentin vit pauvrement.
- La République de Venise, bien qu’affaiblie, reste une grande puissance maritime, nous en avons parlé ailleurs (Voir nos dossiers sur Venise dans « Histoire des villes »). Elle a su, dans la capitale, créer des institutions, comme le Carnaval, qui diminuaient la dureté de la lutte des classes, mais partout dans l’État, la pression fiscale est très grande sur les sujets, surtout au moment où il faut financer les guerres contre l’Empire Ottoman. Venise sut aussi éviter largement les conflits religieux ; son doge, qui n’est ni héréditaire ni sacré, est donc moins dominateur et autoritaire que les monarques absolus de droit divin. Vénétie - Villa La Badoera (Rovigo) - Palladio, 1556-1563.
- Le Duché de Savoie enfin, très dominé par la France jusqu’à ce qu’il change d’alliance et se rapproche de l’Angleterre et de la Hollande, à partir de sa victoire militaire à Turin en 1706 sur les armées de Louis XIV. Il accorde alors la liberté religieuse aux protestants et aux Vaudois, qui se sont déjà réfugiés dans les hautes vallées piémontaises. Le Piémont devint donc l’État européen le plus indépendant de l’Espagne catholique, et à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, il favorisa un nouveau système de production textile basé sur l’utilisation du moulin à soie circulaire à roue hydraulique et sur la concentration de tout le cycle productif en un seul grand édifice. En quelques décennies, le Piémont devint le premier producteur de textiles en Italie. À la différence des États catholiques (Espagne, Portugal, Italie) qui restaient à l’arrière-garde à cause de leur attachement au féodalisme et aux idéologies religieuses médiévales, des nations comme la France, la Hollande et l’Angleterre commençaient leur passage au capitalisme, se développaient démographiquement et économiquement, souffraient moins de la peste. L’Italie bourgeoise (et la Curie pontificale) fut incapable de se libérer complétement du féodalisme, de faire son unité politique, de chasser les oppresseurs étrangers et de soutenir les révoltes populaires et paysannes (voir le site internet https://www.homolaicus.com/storia/moderna/seicento.htm#google_vignette).


5- Une crise économique générale - Reconversion sur la terre
Crise démographique d’abord : après les épidémies des peste de 1630 et 1656, il faudra environ un siècle pour que l’Italie retrouve sa population d’avant le drame dans le centre et le nord ; dans le sud, les pestes (le sud a perdu un million d’habitants au cours des deux épidémies, en 1656, le Royaume de Naples perd 36,8% de sa population), la famine, les tremblements de terre ont le même résultat (Diminution globale de 1.800.000 unités, soit 13% de la population ; au début du XVIIIe siècle, elle n’a augmenté que de 100.000 unités par rapport à 1600, et certaines villes du nord perdent de 40 à 61% de leurs habitants). Vénétie - Villa Fracanzan Piovene-Orgiano avec ses barchesse.
L’agriculture était restée le secteur fondamental de l’économie, et les surfaces cultivées se réduisent, c’est là que la crise se manifeste le plus fortement : les surfaces cultivées diminuent au profit des pâturages (dans le Duché de Milan de 70,9% à 63,5%), la productivité des terres diminue (le rendement des semences de blé passe de 3,3 en 1594 à 2,8 en 1690 dans la province d’Alexandrie), le prix des denrées agricoles (le blé) descend en ville, le prix de location des terres (donc la rente foncière, féodale pour les grandes propriétés du sud) diminue (en Basse Lombardie de 33% à 50%) et les propriétaires fonciers exploitent plus durement le travail des paysans, et les dimensions des propriétés foncières augmentent. En ville, vu la raréfaction de la main-d’œuvre, les salaires augmentent, alors les propriétaires transfèrent à la campagne leurs industries, surtout textiles.
Dans l’ensemble, la réaction des classes possédantes est de reconvertir leurs fortunes sur la terre, accomplissant de gigantesques achats de terre : on sait par exemple qu’à Brescia, les ¾ des biens de la campagne appartiennent à des urbains, anciens ou nouveaux aristocrates. Au Piémont, les marchands et banquiers prêtent de l’argent au duc, sous-traitent les gabelles et achètent des terres et des offices publics, autant de nouveaux riches que le duc anoblit et intègre à son administration. À Venise, au moment de la guerre de Candie, la République intègre au Grand Conseil une centaine de familles de terre ferme, moyennant le paiement de 100.000 ducats, et elles deviennent membres du patriciat vénitien. Ce phénomène d’anoblissement se produit dans toutes les régions d’Italie, simple élément d’intégration de nouvelles couches sociales à l’ancienne classe dominante, qui se traduit par une exploitation d’autant plus grande des paysans pour compenser les sommes dépensées pour acquérir ces titres de noblesse. D’où une misère croissante. Les marchands ont aussi abandonné leurs ateliers en ville, augmentant ainsi le chômage. Bouteille en forme de lapin - Venise XVIIe s. - Naples, Capodimonte.
Cela contribue à redonner de la vigueur à l’idéologie nobiliaire et aux oligarchies existantes : un thème comme celui de « l’honneur » est au premier plan des publications sur l’agriculture de l’époque, et on construit de plus en plus de villas suburbaines à partir desquelles peut être géré le domaine (Voir sur ce site dans « Création de formes artistiques - 7.3 - Architecture, Les villas de Vénétie »). La classe dominante est vraiment maintenant celle des propriétaires fonciers, qui agrandissent régulièrement leurs possessions, dont ils tirent aussi leur subsistance quotidienne, cela est visible dans la construction des « barchesse » des villas vénitiennes où étaient entreposées les denrées en attendant leur commercialisation. Même le patriciat d’une république maritime comme Venise a fini par investir dans la propriété foncière. Si on regarde les traités d’économie de l’époque, on constate que le modèle dominant est celui de la famille aristocratique et de la gestion de ses propriétés.
Que représente cette classe dominante ? Un exemple : les patriciens vénitiens en 1740 constituaient 0,2% de la population et possédaient presque 34% des terres recensées auxquels il faudrait ajouter les terres louées. Pour plus de détails, consulter le fascicule 126 de la Storia d’Italia Bompiani de Giorgio Borelli, « Uomini e terra ».
La crise n’appauvrit donc pas la classe dominante de cette nouvelle noblesse qui peut manifester sa grandeur par un luxe effréné (dans les vêtements, les bijoux, les carrosses, les meubles, la vaisselle, les palais, etc.) et par la consommation des produits les plus élaborés. L’évasion fiscale par non-déclaration des nouvelles acquisitions favorisait encore plus cette richesse.
Cette évolution se traduit aussi par une déstructuration des activités de commerce et d’industrie. Si le XVIe siècle avait su se réadapter aux nouvelles conditions internationales, en s’orientant par exemple vers le marché allemand qui continuait à acheter à Venise la soie, les vins de Malvoisie, l’huile des Pouilles, le raisin sec de Céphalonie, le mercure de l’Istrie, le soufre des Marches, les verres de Murano, les velours, les savons, etc., le XVIIe siècle n’a pas pu connaître la même adaptation, vus les changements advenus en Allemagne. Les ports de premier plan étaient maintenant Marseille, Amsterdam, Londres, et en Italie Livourne. Même les blés de Sicile voient leurs exportations diminuer jusqu’à 90% face à la concurrence des blés du Nord et des blés turcs.
Cette évolution se reporte évidemment sur les activités industrielles et commerciales des villes, qui, par exemple pour leur industrie textile, dépendent des campagnes (laine, soie, lin). On a parlé pour cette époque de « capitalisme féodal », ou reféodalisation, c’est en tout cas l’échec du capitalisme marchand que les communes du Centre et du Nord avaient commencé à créer trois siècles auparavant.



6- Apparition de nouvelles formes d'États et de religions bureaucratiques
Paradoxalement, dans cette Italie politiquement faible, se développent des États nouveaux, qui doivent donc se doter d’une nouvelle forme de bureaucratie. L’État a de nouvelles exigences dans tous les domaines, diplomatique (nécessité d’ambassadeurs stables), militaire (les armées sont de plus en plus importantes et doivent être administrées), économique, etc. Il faudra aussi gérer la pauvreté grandissante.
Or la fonction de ces nouveaux fonctionnaires change de nature : ils ne dépendent plus personnellement du souverain qui les a nommés, mais ils sont là pour défendre la loi et l’État. Il se forme alors une bureaucratie, qui devait défendre la stabilité mais qui devient peu à peu un frein au mouvement et un élément conservateur. Ce fut aussi le cas avec l’arrivée au pouvoir des Bourbons à Naples en 1734.
Même l’État de l’Église tend aussi à se bureaucratiser ; cela accentue l’opposition entre la religion officielle (avec ses théologiens, ses conciles, ses collèges de cardinaux, ses dogmes et règles issus du Concile de Trente) et le catholicisme populaire. Comme écrit Giorgio Galli (1928-2020), « les grandes masses vivaient ‘leur’ christianisme, plein de convictions toujours plus persécutées parce que marquées par la “magie” et la “sorcellerie”, mélange de rites de fertilité antiques et de religions matriarcales qu’on ne commencera à réfléchir à notre époque qu’à partir de l’oeuvre pionnière de Margaret Murray » (Storia d’Italia, 125, Bompiani, p.80).
Margaret Murray (1863-1963) est une anthropologue et égyptologue qui a beaucoup fait avancer la connaissance du folklore, en montrant que la sorcellerie était un héritage des anciennes religions païennes, exerçant une forte résistance aux religions officielles modernes.
L’Église commence même à accepter le prêt à intérêt, qu’elle avait toujours condamné. En effet, les Ordres réguliers étaient devenus de grands prêteurs à intérêt modéré (4 à 6%) : ils ne pouvaient pas conserver légalement des maisons ou des terrains qui leur avaient été donnés par des fidèles bienfaiteurs ; alors ils les revendaient et étaient donc à la tête d’importantes sommes d’argent liquide qu’ils utilisaient en faisant des prêts à intérêt parfois à très longue durée, en particulier aux patriciens, créant ainsi un lien étroit entre eux et les couvents et monastères.
Cela conduisit un noble comme le marquis Scipione Maffei (1675-1755) à défendre la théorie du prêt à intérêt dans son traité de 1744, Dell’impiego del denaro.

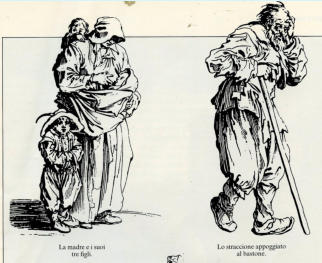
7- La pauvreté involontaire augmente parallèlement à la richesse - Le temps d'une autre pauvreté - Augmentation des différences de classes
Le temps d’une autre pauvreté - Augmentation des différences de classes.
Le résultat de cette évolution est une misère croissante, l’augmentation de ceux que l‘on appelle les « pitocchi », les mendiants, paysans contraints d’abandonner la terre, chômeurs, vagabonds, infirmes, mutilés dans les guerres, prostituées repenties, orphelins, etc, ces pauvres avoués ou « honteux » que Jacques Callot a si bien dessinés en 1622 (Voir images ci-dessus). Les pauvres « honteux » étaient les nobles ruinés ou les artisans appauvris qui avaient honte de mendier.
Mais cela provoque d’abord un développement du brigandage, qui devient un thème important de la littérature italienne, les guides qui indiquent les routes et les auberges sûres se multiplient, et deviennent une mode obsessionnelle qui exagère encore le phénomène. Un voyageur français avait raconté que les brigands « détroussaient les hommes et faisaient le contraire aux femmes ». Il est pourtant vrai que l’accumulation des terres par les nobles des villes, l’augmentation des impôts, la diminution des produits vitaux, l’abandon des terres par les paysans qui ont perdu tous leurs instruments de travail, ont développé, surtout dans les campagnes un appauvrissement qui augmente la mendicité, le vagabondage et le brigandage.
Des bandes armées de paysans très pauvres, rendent les routes et le commerce souvent très dangereux. En ville, le chômage des travailleurs du secteur textile a les mêmes conséquences. La pauvreté a toujours existé au moins depuis la sédentarisation des tribus humaines, sans que l’on puisse lui attribuer un acte de naissance précis, mais elle a pris des formes différentes selon chaque époque de l’histoire, et elle a été pensée avec des concepts différents.
L’idée que l’on a de la pauvreté et de la façon de se comporter avec les pauvres va évidemment changer l’image de la réalité. L’arrivée du christianisme et d’un modèle christique caractérisé par son esprit de pauvreté va contribuer à changer les politiques des États et les comportements sociaux, et donc les formes des oppositions de classes. Le christianisme conduisait à des comportements contradictoires : pour les uns, plus fidèles à l’Évangile, la pauvreté était une valeur essentielle, un renoncement volontaire aux richesses ; pour les autres, la pauvreté était une loi naturelle voulue par Dieu, mais la richesse devenait ainsi un modèle élitiste conforme à la volonté divine, à condition d’être charitable.
Après la féodalité, l’urbanisation bourgeoise sépare de plus en plus l’élite urbaine des paysans. Francesco da Barberino écrivait que « fa spessamente povertà fallire » (la pauvreté fait souvent tomber dans la faute). Pour d’autres, Dieu avait créé les pauvres pour exercer la charité des riches. D’où les confréries d’assistance, les aumônes, les hospices, mais aussi la haine des mendiants, l’expulsion des villes, la répression de la saleté, des odeurs et de l’oisiveté perçue.
Au Moyen-Âge, la pauvreté était vue comme une volonté divine. L’Église chrétienne avait un comportement ambigu, entre valorisation de la pauvreté et peur de la criminalité qu’elle engendrerait. C’est principalement les femmes que l’on enfermait, selon des critères moraux. Dès le XIIe siècle, les hôpitaux et hospices accueillent pèlerins, enfants abandonnés, femmes en difficulté. Ces institutions sont soutenues par les confréries, les communes et l’Église, mais parfois détournées à d’autres fins.
Les États tentent de réguler cette pauvreté grandissante. Des aides sont distribuées, mais on expulse aussi les mendiants, on les enferme, et on leur impose le travail. Le plus grand hospice d’Europe fut l’Albergo dei Poveri de Naples, fondé en 1749. À cette époque, on parle de « poveri vergognosi », les pauvres honteux, souvent des anciens bourgeois ou nobles ruinés, mieux traités par solidarité de classe. Le fossé entre riches et pauvres s’élargit fortement, comme en Toscane en 1427 où 1% possédait 25% des biens de la ville.
La « mezzadria » (métayage) accentue la misère. Les travailleurs agricoles, sans ressources, mendient en ville. Le développement de politiques sociales rationnelles émerge alors, souvent laïques, combinées à une répression accrue de la mendicité. Les Monts de Piété se multiplient dans toute l’Italie. Le premier, à Pérouse en 1462, servira de modèle. Ces institutions permettent aux pauvres d’obtenir des prêts contre gage à taux réduit.
Cependant, certains préfèrent la mendicité ou s’enrôlent comme mercenaires. Tandis que l’élite s’enrichit, les masses s’enfoncent dans la misère. Même l’Église romaine prend conscience de cette situation. Elle autorise la lecture biblique en langues vulgaires pour contrer les protestants et missionner les campagnes. Le Père Diego Ximenez, en 1596, alerte le pape Clément VIII sur l’ignorance religieuse des paysans autour de Rome. Il propose des solutions, mais la Compagnie de Jésus refuse ces missions rurales jugées ingrates.
Pour approfondir, voir le fascicule 129 de la Storia d’Italia Bompiani, « L’ondata di pauperismo » de Daniela Lombardi.
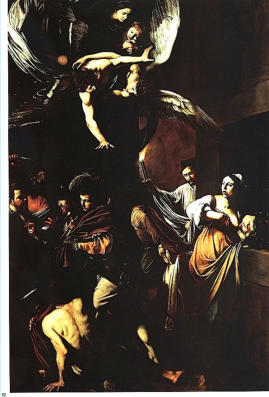





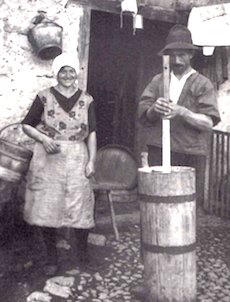

8- Mais c'étaient des communautés vivantes qui avaient leur culture
Par contre il faut remarquer que ce sont les cultures de la « modernité » qui ont finalement reconnu cette misère et cette ignorance pour mieux louer la « supériorité » de la culture industrielle de notre société capitaliste. Or nous sommes bombardés de connaissances et d’informations scientifiques, politiques, intellectuelles, médiatiques, c’est vrai, mais nous n’en sommes que des spectateurs passifs qui n’ont aucun contrôle sur la valeur de ces connaissances ; mais cela est le fait des nouvelles bureaucraties bourgeoises qui avaient besoin pour s’organiser d’imposer leur pouvoir et de détruire toute autre forme d’organisation, en particulier toute forme de communautés rurales, de culture paysanne, (de la même façon que, comme la Bible nous le révèle, la sédentarisation des nomades d’Israël donna naissance au pouvoir tyrannique des rois qui opprimaient les petits paysans et détruisaient la culture des anciennes tribus, suscitant les critiques des prophètes).
Jean-François Millet, Paysanne qui brûle des herbes, Gand – Le semeur, 1850, Boston.
Or, la « pauvreté » rurale d’autrefois n’est pas de même nature que la pauvreté urbaine de l’époque industrielle, il y eut, jusqu’au XVIIIe siècle, une vie des communautés rurales (quantitativement majoritaires) très originale et particulière. D’abord, il faut tenir compte du fait que les communautés montagnardes étaient beaucoup plus alphabétisées que les autres : beaucoup d’éléments imposaient aux montagnards de savoir écrire, lire et compter, depuis les phénomènes de transhumance et de migrations locales qui les mettaient en contact avec d‘autres populations, jusqu’à leur mode de vie plus difficile qui les obligeait à s’entraider, à vivre une vie collective forte, qui les conduisait même à organiser des écoles locales ; paysans, artisans, marins d’autrefois avaient aussi des connaissances pratiques très élaborées, base d’une culture très riche, on en aperçoit des traces dans certains métiers d’aujourd’hui.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’alimentation avait une base meilleure, hors les périodes de famine dues aux guerres et aux changements climatiques. On élevait et consommait les porcs (jusqu’à ce que leur possession soit réglementée), on utilisait tout des chèvres et des brebis, la laine, le lait, la viande, la peau et il y avait des modèles alimentaires locaux très forts (diète alpine, méditerranéenne, etc.), qui ne rendaient pas riches, mais permettaient de vivre correctement. Au XIXe siècle, les bilans nutritifs des populations paysannes se dégradent fortement. Auparavant, les communautés se souciaient aussi de maintenir un équilibre entre démographie et ressources alimentaires disponibles.
La dégradation de la situation d’équilibre est aussi accentuée en Italie par le mépris pour les « paysans » des bourgeois qui veulent se croire supérieurs et ont besoin de montrer l’infériorité à tous niveaux des « cafoni », des « terroni », les culs-terreux. La culture dominante a donc fait disparaître délibérément les cultures paysannes, réduisant ce qui en restait au niveau de ce qui deviendra le « folklore ». Ce n’est pas vrai que de la chanson, mais aussi de tous les aspects de la vie quotidienne, l’habillement, la langue dialectale, la nourriture, etc. Le tourisme exploite maintenant les « vêtements traditionnels » des paysans, souvent plus riches que les produits offerts aujourd’hui par le commerce et la culture « de masse » dans les supermarchés.
Les villages avaient jusqu’au XVIIIe siècle une vie collective intense ; les paysans se retrouvaient dans les « osterie », buvaient et riaient ensemble, chantaient souvent, ou bien l’hiver, dans les étables où ils passaient les soirées ensemble ; il y avait celles qui racontaient des histoires, des légendes, chantaient ; certaines femmes avaient la fonction de médecins ou de « psychiatres », elles connaissaient par tradition un grand nombre de plantes (on parle parfois de plus de 200), et conseillaient les femmes et les jeunes filles, aidant à avoir des enfants ou à avorter, à partir du XIVe siècle, on les accusa de « sorcellerie » ; il faut penser aussi aux fêtes civiles de naissances, de mariages, de funérailles, et religieuses (fêtes des saints, de la Vierge, etc.), au passage des cantastorie qui allaient de villages en villages mais aussi dans les châteaux et qui assuraient une forme de communication avec l’extérieur.
À travers tout cela s’exprimait une vie culturelle, une forme de « philosophie », de vision de la vie, certes peu raisonnée et très influencée par un « bon sens » ambigu et par les idéologies seigneuriales (on racontait des histoires de bon roi, de reines et de princesses… ), mais souvent autonome, fondée sur des pratiques professionnelles très riches, une connaissance approfondie de la nature ambiante, et sur une solidarité communautaire. Il y a encore une « culture rurale », une « philosophie rurale ».
Voir des sites comme www.ruralpini.it, ou www.filosofiarurale.it, ou tapez sur Wikipedia Vita rurale in arte, et surtout relisez les textes de Gianni Bosio, L’Intellettuale rovesciato, 1975 et autres textes.

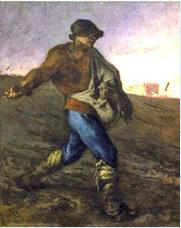
9- Un siècle d'agitation sociale, de révoltes et de banditisme contre les nouvelles bureaucraties aristocratiques - Les révoltes populaires : des "luttes de classes" ?
Ce changement de structure économique et cette expansion qui profitent aux riches et augmentent la pauvreté ont pour conséquence, dans toute l’Europe, une longue période marquée par l’agitation sociale et les révoltes urbaines et paysannes, qui souvent débouchent non sur des révolutions politiques mais sur un banditisme organisé. Les petits ou grands États (nouvelles monarchies centralisées comme la France et l’Angleterre ou la nouvelle République de Hollande) se centralisent et constituent de redoutables bureaucraties, appareils au service du pouvoir central, souvent oppressif vis-à-vis de la masse des sujets, surtout les paysans qui continuent à vivre hors du circuit monétaire car ils n’utilisent pas la monnaie, l’argent liquide (Voir : Giovanni Tocci, Un gruppo emergente : la burocrazia, Storia d’Italia, Bompiani, op. cit., n° 111, pp. 145-168).
Cette bureaucratie fut souvent à la source d’une nouvelle classe dirigeante en rapport avec l’ancienne aristocratie dans une même idéologie nobiliaire. Cette tendance vers ce qu’on appellera « Seigneurie » de presque toutes les villes-États d’Italie du Centre et du Nord a besoin de cette administration centralisée toute puissante pour maîtriser la pluralité de pouvoirs que constituaient aussi bien les féodalités de campagne que les pouvoirs ecclésiastiques, aussi bien les corporations que les communes libres ; mais son seul objectif était le soutien du pouvoir seigneurial en-soi plutôt que l’élaboration d’une stratégie politique cohérente d’adaptation à une nouvelle situation économique.
Paolo Veronese, Les Noces de Cana, 1563, Louvre. Niccolò Cassana (1659-1713), Gentiluomo in rosso, Venezia, Ca’ Rezzonico.
C’est ainsi que se développe une nouvelle culture de « cour » autour du Prince et de son gouvernement qui intègre souvent les plus grands intellectuels comme Annibale Caro, Ludovico Ariosto, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Baldassare Castiglione, Giovanni Della Casa. C’est aussi dans ces cours que naissent nouvelles modes vestimentaires et traditions gastronomiques aristocratiques, avec Bartolomeo Scappi, Cristoforo da Messisbugo ou Domenico Romoli.
À la différence des Flandres, en Italie, la nouvelle classe dirigeante est un patriciat qui intègre les anciens nobles. Elle se referme en caste nobiliaire fermée, rupture avec la masse des pauvres. On passe de la « noblesse de vertu » de Dante à une noblesse fondée sur l’argent. La Curie pontificale suit ce mouvement : les évêques deviennent de nouveaux féodaux. Pompeo Rocchi, Il Gentiluomo (1568), puis Girolamo Muzio (1571) reflètent bien cette transformation (voir : Renzo Sabbatini, Danaro e potere, Storia d’Italia, Bompiani, n° 112, pp. 169-192).
Une pression fiscale accrue, la manipulation monétaire, l’expropriation des biens collectifs, les baisses de salaires, provoquent colère, inquiétude, soulèvements — presque toujours réprimés. L’Angleterre connaît ces phénomènes dès 1517, en France c’est Lyon (1529), la Guyenne (1548), la révolte des croquants (1592), les Pays-Bas (1568-1648), l’Allemagne aussi.
L’Italie : révolte à Lucques (1531-32), à Naples (1585), Milan (1629, racontée par Manzoni). À Lucques, les straccioni (tisseurs) échouent faute d’organisation ; à Naples, le peuple massacre Vincenzo Starace, puis subit une féroce répression. Masaniello (1647) organise une autre révolte à Naples, puis Palerme (1647), L’Aquila (1527-28), Venise (1581), Messine (1674). Messine résiste deux ans, aidée par les Français, mais finit affamée.
Le banditisme est l’organisation extrême de ces révoltes, impliquant nobles marginalisés comme Alfonso Piccolomini ou Marco Sciarra, ou mendiants et paysans ruinés. Les historiens débattent : Boris Porsnev (1963) parle de « luttes de classes », Roland Mousnier (1967) réfute et voit des « fureurs paysannes », Robert Mandrou (1974) nuance avec « conscience collective » et « solidarité des humbles humiliés ». Ces révoltes sont locales, sans programme, vite réprimées, mais manifestent une opposition de classes croissante.




10- Le XVIIIe siècle
On a souvent rappelé que jusqu’aux années 1730, l’Italie avait atteint le point le plus bas de son histoire, était devenue, disait le duc de Parme, « un cadavre exsangue et sans esprit », totalement dépendant d’autres États (France, Espagne, Angleterre), tout en ayant créé la Commedia dell’Arte, le grand art baroque et le modèle musical de l’opéra. Symbole de franc-maçonnerie. En 1718, Venise avait perdu pratiquement tout son empire ; Gênes était sous l’emprise de l’Espagne, combattue par la France, elle perd la Corse en 1768. En Toscane, le dernier Grand Duc, Gian Gastone (1723-1737) meurt sans héritier et sa succession est réglée par les puissances européennes. Les possessions espagnoles (Naples, la Sicile et la Sardaigne sont administrées par un Vice-Roi avec un Parlement qui a perdu toute autorité, Milan par un gouverneur avec un Sénat) ont perdu tout dynamisme et ne sont que des pions de l’empire d’Espagne, deviendront bientôt un simple élément des jeux politiques européens. Le Piémont est une exception, il s’agite beaucoup, espère prendre la Lombardie, oscille entre la France et l’Autriche, obtient de l’Espagne en 1713 la Sicile, qu’il échange en 1720 avec la Sardaigne plus proche mais plus pauvre, et le duc devient roi. En 1706, le duché de Milan passe à l’Autriche, en 1713-14, l’Espagne perd la Sicile et la Sardaigne, elle perd aussi le contrôle de la péninsule italienne.
Dans ce contexte, on voit naître un renouveau d’aspiration à l’unité et à l’indépendance de l’Italie, dans des travaux comme ceux de l’abbé Pietro Tosini (1660 ?-1735 ?), théologien et diplomate de Bologne qui publie en 1718 à Amsterdam La libertà dell’Italia illustrata a suoi prencipi e popoli où on a vu parfois un antécédent du Del primato morale e civile degli Italiani de Vincenzo Gioberti en 1843. Tosini montre que l’Italie n’est pas un fief de l’Empire et qu’elle a donc été usurpée par Charles Quint. Un autre ecclésiastique, le Cardinal Giulio Alberoni (1664-1762), de Piacenza, au service de l‘Espagne, souhaitait que l’Italie se libère de la domination autrichienne.
L’Europe recherche toujours un équilibre stable : au Moyen-Âge elle fit le rêve non réalisé d’un Empire unifié cohabitant avec une Église spirituelle libre de toute domination politico-temporelle ; maintenant, la politique libérée de la morale avec Machiavel, ne cherche plus qu’un équilibre de forces où l’Italie ne compte que marginalement, étant sous la domination espagnole. Mais à partir du XVIIe siècle, le poids de l’Espagne diminue, les Bourbons reprennent l’Italie du Sud, et surtout, ce qui devient prédominant, c’est l’intérêt pour les territoires d’Amérique, d’Afrique et d’Asie.
Ludovico Antonio Muratori. Par ailleurs, la pensée politique cherche de nouvelles formes d’État et de pouvoir, mais elle est la plupart du temps effacée par la censure ecclésiastique : Pietro Giannone (1676-1748) est emprisonné et excommunié, l’abbé Ferdinando Galiani (1727-1787) accusé de répandre la pensée de John Locke, Cesare Beccaria (1738-1794) est suspect pour son livre Dei delitti e delle pene (1764), Gian Vincenzo Gravina (1664-1718, fondateur de l’Arcadie) est inquiété par l’Inquisition, l’érudit Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) est très discuté, Scipione Maffei (1675-1755) est mis à l’index, des ouvrages étrangers comme l’Encyclopédie (mise à l’Index en 1758-59) ou les livres de Pierre Bayle, Montesquieu (L’Esprit des lois est mis à l’index en 1752), Voltaire (toute son œuvre est mise à l’Index entre 1753 et 1757), Machiavelli (mis à l’Index dès 1559), sont interdits. L’historien, philosophe libre-penseur piémontais Alberto Radicati (1698-1737) est mis à l’index et doit s’exiler à Londres. La décadence italienne est aussi morale et intellectuelle.
Mais, comme Benedetto Croce l’a souligné dans sa Storia dell’età barocca in Italia, Bari, 1929, des germes de renouveau apparaissent à Naples (avec Giambattista Vico, 1668-1744) et dans plusieurs autres villes des germes de renouveau qui annoncent déjà le Risorgimento du XIXe siècle.
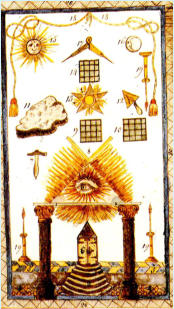


Et comment le peuple vit-il donc tout cela ? - Quelques chansons
Les chansons populaires nous parlent d’abord des guerres et des occupations étrangères. L’une des plus répandues dans toute l’Italie est Cecilia, qui au départ se réfère probablement au comportement des soldats espagnols présents dans le Sud et en Lombardie dès le début du XVIe siècle : un homme est condamné à mort (peut-être simplement pour avoir ramassé du bois mort dans une forêt seigneuriale), sa femme va demander sa grâce au capitaine espagnol qui la lui accordera si elle vient passer une nuit avec lui ; avec l’accord de son mari, Cecilia accepte et au matin en ouvrant la fenêtre, elle voit que le capitaine a fait pendre son mari. Les strophes finales sont diverses, dans quelques-unes Cecilia tue le capitaine (dans la version de La Piazza, Amore piccolino fatte grande, 1994), dans la plupart elle refuse la vie commune qu’il lui propose et se promet de ne plus avoir de mari. En 1944, une chanson reprend l’air pour raconter une histoire semblable arrivée avec un commissaire collaborateur des Allemands, que Clelia tue lors de sa fuite (Leggende e racconti popolari di Roma, Newton Compton, 1982). Costantino Nigra décompte déjà 5 versions de la chanson, dans son Canti popolari del Piemonte, de 1888, repris par Einaudi en 1974 (2 volumes) et il y en a beaucoup d’autres, dont une belle version en dialecte piémontais chantée par Roberto Balocco. Voici une version toscane interprétée par le Canzoniere Internazionale :
VANNE VANNE CECILIA
Vanne vanne Cecilia vanne dal capitan
Va, va, Cécile, va chez le Capitaine
e chiedigli una grazia che lui te la farà
et demande-lui une grâce, il te la fera
Grazia signor capitano che grazia vuoi da me
Grâce, Seigneur capitaine. Quelle grâce veux-tu de moi ?
grazia ti sarà fatta vieni a dormire con me
La grâce te sera faite, viens dormir avec moi
Ora vo' alle Murate a dirlo al mio mari'
Je vais aux Murate le dire à mon mari
se lui sarà contento stasera sarò qui
s'il est d'accord, ce soir je serai ici
Vanne vanne Cecilia ma non pensare all'onor
Va va Cécile mais ne pense pas à l'honneur
salva la vita mia levami di prigion
Sauve ma vie tire-moi de prison
Quando fu mezzanotte Cecilia fa un sospir
Quand ce fut minuit, Cécile pousse un soupir
il capitano l'abbraccia e un bacio gli vuol darle
capitaine l'embrasse et veut lui donner un baiser
Che ha' tu che ha' tu Cecilia che tu non puoi dormir
Qu'as-tu, qu'as-tu Cécile que tu ne peux dormir?
un sogno brutto l'ho fatto che è morto il mio mari'
Un mauvais rêve j'ai fait, que mon mari est mort
E la mattina si affaccia a lo balcon
Et le matin à l'aube elle se met au balcon
lo vede il suo marito col capo ciondolon.
elle voit son mari la tête pendante
Grazia signor capitano lei me l'ha fatta sì
Une grâce, capitaine, oui tu me l'as bien faite
la mi ha tolto l'onore la vita al mio mari'
tu m'as pris mon honneur, la vie à mon mari
Addio castel di paglia castello fiorentin
Adieu château de paille, château en Espagne
me l'hai tolto l'onore la vita al mio mari'
tu m'as pris mon honneur, la vie à mon mari
Non vo' più capitani non voglio più mari'
Je ne veux plus de capitaine, je ne veux plus de mari
son colla rocca e i' fuso me ne vo' stare così.
je veux rester seule avec ma quenouille et mon fuseau.
Va, va Cécile
Va, va Cécile
et demande-lui une grâce, il te la fera
Grâce, Seigneur capitaine. Quelle grâce veux-tu de moi ?
La grâce te sera faite, viens dormir avec moi
Je vais aux Murate le dire à mon mari
s'il est d'accord, ce soir je serai ici
Va va Cécile mais ne pense pas à l'honneur
Sauve ma vie tire-moi de prison
Quand ce fut minuit, Cécile pousse un soupir
capitaine l'embrasse et veut lui donner un baiser
Qu'as-tu, qu'as-tu Cécile que tu ne peux dormir?
Un mauvais rêve j'ai fait, que mon mari est mort
Et le matin à l'aube elle se met au balcon
elle voit son mari la tête pendante
Une grâce, capitaine, oui tu me l'as bien faite
tu m'as pris mon honneur, la vie à mon mari
Adieu château de paille, château en Espagne
tu m'as pris mon honneur, la vie à mon mari
Je ne veux plus de capitaine, je ne veux plus de mari
je veux rester seule avec ma quenouille et mon fuseau.
Un voyageur anglais, Gilbert Burnet (1643-1715), traverse une partie de l’Italie en 1683 et constate que c’est le pays le plus riche d’Europe et où il y a le plus de mendiants. Cette situation contradictoire reste celle du XVIIIe siècle : il n’y a plus la moindre harmonie sociale, et une minorité aristocratique continue à s’enrichir tandis que la masse urbaine et paysanne tombe dans la misère. Sur un autre plan, l’Église oriente la religion populaire vers le culte du Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, dans une dévotion extérieure qui se manifeste par les processions, le sens d’une consolation des misères humaines, qui conduiront en 1799 des masses ignorantes à massacrer les Jacobins napolitains sous la direction du cardinal Fabrizio Dionigi Ruffo (1744-1827) et de l’armée de la Sainte Foi (les sanfedisti), sous le drapeau de saint Janvier. La révolution jacobine fut le fait de nobles et de bourgeois éclairés qui furent combattus par la masse ignorante du peuple, en particulier pour des raisons religieuses. Malgré tout se développe progressivement une classe bourgeoise, du fait de l’affaiblissement de la féodalité, de l’accroissement des biens allodiaux (libres de toute soumission à un seigneur), et qui commence à s’organiser et à prendre conscience d’elle-même dans les loges de la franc-maçonnerie. C’est cette bourgeoisie, avec quelques secteurs de la noblesse, qui accueillera les idées et les pratiques de la Révolution française, surtout dans ce qu’on appela « il triennio giacobino » (les trois années jacobines) entre 1796 et 1799, qui ne parvinrent pourtant jamais à intégrer le peuple urbain et paysan, qui restait sous le contrôle d’une Église traditionaliste et monarchiste ; partout durant ces trois ans éclatèrent des révoltes paysannes et des insurrections urbaines contre les nouveaux pouvoirs révolutionnaires installés avec l’appui des armées françaises.
Le Royaume de Naples est remis en 1734 à Charles de Bourbon (1716-1788), fils de Philippe V d’Espagne. C’est un début d’indépendance, et de réunification entre Naples et la Sicile, séparées depuis le Moyen-Âge (Vêpres Siciliennes de 1282) ; la construction du Palais Royal de Caserta à partir de 1752, le plus grand du monde, sur le modèle de Versailles, est le symbole de cette nouvelle autonomie royale. Mais le pouvoir appartient toujours à la minorité aristocratique : au Parlement, les militaires ont 228 voix, les ecclésiastiques 63 et les petits propriétaires fonciers 43. La justice est toujours aussi vénale et clientéliste, malgré les tentatives de réforme opérées par les Bourbons. Les masses paysannes sont soumises à de grandes famines comme celles de 1763 ou de 1784, 1789, 1793, aggravées par un tremblement de terre comme celui de 1783.
Comment vécut le peuple italien durant ces trois siècles ? On n’en a pratiquement aucun témoignage écrit direct, l’analphabétisme étant très répandu, mais on a les témoignages des voyageurs et des observateurs du pouvoir, et surtout les contenus transmis par des chansons qui commencent à être mieux connues et recherchées par les intellectuels qui s’intéressent toujours plus au folklore, à la culture populaire.
Les Turcs dans la chanson - La bataille de Lépante
La guerre contre les Turcs suscita de nombreuses chansons tant à Venise qu’à Naples. Voici Le Romanele, chantée par Michela Brugnera.
Le romanele
Le rovine de Altin ga fabricao
La sirena del mar Venezia bela
ma la luna vien suso de recao
par volerghe dar smaco a la so stela
El Schissa mo che pareva indormensao
al sbate le ali e al ne vol dir co ele
che contro al can spieghemo nu le vele.
Ortensia vegno a darte bone niove :
co i to francesi a Zara semo stai
e la zente de Zara più se move
nu dopo in Romania semo passai.
E la de bel valor co mile prove
gavemo el Grego castigà i pecai !
ceder tuto a dovesto al nostro sbarco,
Ortensia viva i toi viva San Marco.
Cipro, Candia, Morea xe i nostri regni
e chi ne li vol tior se fassa avanti.
Chi dar sangue no vol xe fioi indegni,
xe dala nostra banda tuti i santi.
Chi dar sangue no vol xe fioi indegni
xe dala nostra banda tuti i santi
Ghe xe un corsaro turco che se vanta
de no voler robar che bele pute
ma le bela fra nu ga l'aqua santa
e quele che xe senza xe le brute.
In 'sta maniera mi lasso che '1 canta
perchè cussi le xe segure tute
se po' el vegnirà qua co i so spaurachì
tagiarghe savaremo nu i mustachi.
Adio bela Venezia, adio laguna,
adio care putele veneziane,
mi vado a misurarme co la luna
vado a farghe paura a le sultane.
Les Romanele
Les ruines d’Altino ont créé
la sirène de la mer, Venise la belle.
Mais la Lune revient à l’attaque
pour donner un coup à son étoile
Le « Nez Plat » qui semblait endormi
il bat des ailes et il veut nous dire par là
que contre le Chien nous devons lever les voiles
Orthensia je viens te donner de bonnes nouvelles :
avec tes Français nous avons été à Zara
et les gens de Zara ne bougent plus
et après nous sommes passés en Roumanie.
Et là en faisant preuve de grande valeur
nous avons châtié les péchés des Grecs !
Ils ont dû tout céder à notre arrivée,
Orthensia, vive les tiens et vive Saint Marc.
Chypre, Candie, Morée sont nos royaumes
et qui veut nous les prendre, qu’il avance.
Qui ne veut pas donner son sang est un fils indigne,
tous les saints sont de notre bande.
Qui ne veut pas donner son sang est un fils indigne,
tous les saints sont de notre bande.
Il y a un corsaire turc qui se vante
de ne vouloir voler que les belles filles
mais chez nous les belles ont de l’eau bénite
et celles qui n’en ont pas sont les laides.
De cette manière je m’arrête de chanter
parce que comme ça elles sont toutes en sécurité
si après il vient ici avec ses épouvantails
nous saurons lui couper les moustaches.
Adieu belle Venise, adieu lagune
adieu chères jeunes filles de Venise
je vais me mesurer avec la Lune
je vais faire peur aux sultanes.
La guerre, fléau de la vie quotidienne des peuples, n’a qu’une compensation, l’amour. Alors il arrivait que des jeunes filles se déguisent en soldats pour accompagner leur fiancé à la guerre, c’est ce que raconte aussi Michela Brugnera dans le même disque, dans la chanson intitulée La guerriera. Costantino Nigra en cite de nombreuses versions (n° 48, pp. 334 sq), découvertes des pays slaves à l’Espagne, dans le sud de la France et dans une bonne partie de l’Italie, faisant l’hypothèse que cette chanson s’était répandue avec les Croisades :
La guerriera
No no pianger mio Bepino
piangi forse pa 'ndar melitar
no no pianger mio Bepino
che ala guera te toca andar.
E mi taglio i miei biondi capelli
e me vesto da melitar
e mi monto sul cavalo
che ala guera me toca 'ndar.
Co' so stada in cima al monte,
un tenente mi fermò
« ma voi siete una donzella
o l'amante de un melitar ? »
« No non sono una donzella
nè l'amante de un melitar
mi so un povaro coscritto
che ala guera me toca 'ndar ».
Noi faremo una fontana
'na fontana in mezo al mar
se la sarà 'na dona
la se lavarà le man.
I soldai che va ala guera
no i se lava mai le man
ma soltanto qualche volta
co el sangue dei cristiano.
Noi faremo un bel giardino
un giardino de rose e fior
se se la sarà 'na dona
la se seglierà el miglior.
I soldai che va ala guera
no i racoglie mai dei fior
ma soltantola baioneta
par combater l'imperator.
E so mama sula porta
so papà gera al balcon
che i spetava la so figlia
comandante de un bataglion.
Verginella gero prima
verginella io son ancor
mi go fato sete ani de guerra
sempre al fianco del mio primo amor.
La guerrière
Non ne pleure pas, mon petit Beppe
peut-être pleures-tu parce que tu pars à l’armée
Non ne pleure pas, mon petit Beppe
parce qu’il te faut aller à la guerre.
Je vais couper mes cheveux blonds
et m’habiller en militaire
et je monte sur mon cheval
puisqu’à la guerre il me faut aller.
Quand je suis arrivé en haut de la montagne
un lieutenant m’a arrêtée
« mais êtes-vous une donzelle,
ou la maîtresse d’un militaire ? »
« Non, je ne suis pas une donzelle
ni la maîtresse d’un militaire
je suis un pauvre conscrit
qui à la guerre s’en doit aller ».
Nous ferons une fontaine
une fontaine au milieu de la mer
et si elle est une femme
là elle se lavera les mains.
Les soldats qui vont à la guerre
ne se lavent jamais les mains
mais seulement quelquefois
avec le sang des chrétiens.
Nous ferons un beau jardin
un jardin de roses et de fleurs
et si elle est une femme
elle choisira la plus belle.
Les soldats qui vont à la guerre
ne cueillent pas de fleurs
mais seulement la baïonnette
pour combattre l’empereur.
Et sa maman est sur la porte
son papa était au balcon
qui attendait sa fille
commandant d’un bataillon.
Jeune fille j’étais avant
jeune fille je suis encore
J’ai fait sept ans de guerres
toujours à côté de mon premier amour.
Les incursions turques étaient redoutées surtout par les villages côtiers du Sud, mais aussi de presque toute l’Italie, car les pirates et corsaires ottomans, algérois et tunisiens remontaient souvent jusqu’au Nord de la mer Adriatique et jusqu’au Nord de la Toscane. Les Turcs arrivaient brusquement, pillaient les richesses du village, enlevaient les filles, tuaient les hommes qui résistaient et repartaient. C’était un élément de la vie populaire rurale que ne connaissaient pas ou peu les grandes villes non côtières. Il est souvent présent dans les chansons. Une chanson de prison en dialecte de Rome (le « romanesco ») commence ainsi :
A tocchi a tocchi, la campana sona
A tocchi a tocchi, la campana sona
Li turchi so’ arivati a la marina
Chi c’ha le scarpe rotte le risola
Io già l’ho risolate stamatina
Come te posso amà
Come te posso amà
Si scappo da sti cancelli
Quarcuno l’ha da pagà.
All’erta all’erta la campana sona
Li turchi so’ arivati a la marina
Viva li monticciani e viva Roma
Viva la gioventù trasteverina.
Coup par coup la cloche sonne
Coup par coup la cloche sonne
Les Turcs sont arrivés au bord de la mer
Que celui qui a des souliers cassés les ressemelle
moi je les ai déjà ressemelés ce matin.
Comment puis-je t’aimer
comment puis-je t’aimer
si je m’échappe de ces grilles
Quelqu’un devra le payer.
Alerte alerte la cloche sonne
Les Turcs sont arrivés au bord de la mer
Vive les monticiani et vive Rome
Vive la jeunesse du Trastevere.
C’est un chant de prisonniers romains, de la prison Saint Michel, qui est aussi une chanson d’amour ; il est d’autant plus significatif que le malheur de la vie (les « souliers cassés ») s’exprime à travers l’arrivée des Turcs.
Une autre chanson des Pouilles, probablement du XVIe siècle, évoque la bataille de Lépante de 1571, elle est sans doute à l’origine de quelques autres des années suivantes :
All’armi, all’armi: la campana sona
All’armi, all’armi: la campana sona
li Turchi son sbarcati alla marina
Chi ci ha le scarpe rotte l’arisola
che noi dobbiamo far lungo cammino.
Da Malta son partite sei galere
a tutte e sei l’onore del mare
Il Capitano avanti e gli altri dietro
la guerra contro i Turchi vanno a fare.
Aux armes aux armes : la cloche sonne
Aux armes aux armes : la cloche sonne
les Turcs ont débarqué au bord de la mer
Que celui qui a les souliers cassés les ressemelle
Car nous devons faire un long chemin.
De Malte sont parties six galères
à toutes les six, honneur de la mer
Le Capitaine devant et les autres derrière
Contre les Turcs ils vont faire la guerre.
C’est de ces chansons qu’Eugenio Bennato s’est sans doute inspiré pour écrire sa chanson de 1980, partie du disque Brigante se more. On sait en tout cas qu’a poussé Bennato à écrire cette chanson une tarentelle traditionnelle qui commémora l’attaque turque de Sorrente en 1558, qui déporta à Constantinople une grande partie des habitants. Une des seules femmes échappées au rapt fut Cornelia Tasso, la grande sœur du poète Torquato Tasso, ce qui fut un des faits qui l’incita à écrire la Jérusalem délivrée. La chanson avait été publiée parmi celles recueillies par Antonio Casetti et Vittorio Imbriani dans Canti e racconti del popolo italiano, Loescher, 1872 :
Quanno sona la campana (La fuga)
All’arme, all’arme, la campana sona
Li Turchi so’ sbarcati a la marina
chi tene ‘e scarpe vecchie se l’assola
c’avimmo a fare nu ungo cammino.
Quant’è lungo stu cammino disperato
sta storia se ripete ciento vote
nuie fuìmo tutte quante assai luntano
quanno sona la campana.
All’arme, all’arme, la campana sona
Li Turchi so’ sbarcati a la marina
Chi tiene o grano lo porta a la mola
comme ce vene janca la farina.
ma nun bastano farina festa e forca
pe sta gente ca n’ha mai vuttato e mane
po padrone vene sempe da luntano
quanno sona la campana.
Quand sonne la cloche (La fuite)
Aux armes aux armes, la cloche sonne
les Turcs on débarqué au bord de la mer
que celui qui a de vieux souliers les ressemelle
nous avons un long chemin à faire.
Qu’il est long ce chemin désespérée
cette histoire se répète cent fois
nous fuyons tous très loin
quand sonne la cloche.
Aux armes aux armes, la cloche sonne
les Turcs on débarqué au bord de la mer
Que celui qui a du blé le porte au moulin
comme ça il aura de la farine blanche.
mais il ne suffit pas d’avoir farine, fête et potence
pour ces gens qui n’ont jamais été violents
le maître vient toujours de loin
quand sonne la cloche.
La bataille de Lépante (7-8 octobre 1571) fut considérée comme une victoire décisive des alliés de la Sainte Ligue chrétienne, même si elle fut qu’une défaite turque et pas la fin de la guerre avec l’Orient, nous en connaissons d’autres formes aujourd’hui. On oublia qu’elle ne fut la marque que d’une supériorité relative et qu’elle coûta très cher au peuple des marins, des soldats et des bagnards qui ramaient sur les galères : 29.000 turcs et 8.000 chrétiens dont 4856 vénitiens, et 18.000 blessés en deux jours ; l’Église célébra aussitôt cette terrible « victoire » et en 1573 le pape Grégoire XIII décida par la bulle Monet Apostolus qu’une grande fête serait célébrée chaque année le premier dimanche d’octobre à Raguse, de même que le pape Pie V avait béni le départ des troupes et remis à Don Juan d’Autriche l’étendard qu’il brandit durant toute la bataille. Raguse continue cette célébration. C’est ce que souligne le beau texte récent d’un chanteur hip-hop italien, Alessio Mariani (Murubutu, 1975- ), qui est en même temps professeur d’histoire et de philosophie au Lycée de Reggio-Emilia, La battaglia di Lepanto (1571). (Voir sur internet son interview par Stefania Parmeggiani, La Repubblica, 28 novembre 2016, « Il professore che insegna a tempo di rap »).
LEPANTO
Maedeta barca
te si ea me candana,
maedeto mio capitan
eta morti e chi ti servi ;
maedeto turco che te me speti.
La luna gùa guà
la gùa ben le lame
le man le man me sua
xe qua xe qua l’Infame
xe fiame xe foghèra
col canon che sbara
rebomba ‘sta galera.
Issa ... forsa ... is ...…. Allez … en avant …... issa … forsa . is ..,
Brusaghe e vele, cavaghe i oci, verzi e buèe .
Meti in caène, magnaghe el core, tajaghe e vene.
Ti te ricordi pare ?
Te souviens-tu, mon père,
Ti me contavi e stele ...
tu me racontais les étoiles…
che gèra beo noare.
Qu’il était beau de nager.
Maedeta note
Che te scondi el me corajo :
toi qui caches mon courage
Maedeto Lion
Che te soffi sempre controvento
qui souffle toujours à contre courant
Maedeto corteo
Cussi violento.
Si violent.
El vento xe de giasso
Le vent est de glace
E i oci dei compari
et les yeux des camarades
In fondo par che diga :
au fond semblent dire :
« Te copo de spavento ».
« je te fais mourir d’épouvante ».
EI mar sempre più rosso,
La mer semble plus rouge
el fià sempre più corto,
le souffle toujours plus court,
sò straco, sò straco morto.
Je suis fatigué, très fatigué.
Brusaghe e vele, .....
Brûle-lui ses voiles,…
Dio ti te incanti ?
Dieu, pourquoi t’étonnes-tu ?
Parchè i s-ciavi
pourquoi les esclaves
gà da liberare i santi ? ...
doivent-ils libérer les saints ? ….
Brusaghe e vele, .....
Brûle-lui ses voiles,…
E penso anche ‘sra volta
Et je pense cette fois encore
che semo tuti mati
que nous sommes tous fous
che ea vita xe ‘na tolta ...
que la vie se fiche de nous …
Maedeta vitoria
Maudite victoire
cussì alegra de miseria.
Si gaie dans sa misère.
Maedeto siensio
Maudit silence
cussì busiàro de rimorsi.
Si trompeur dans ses remords
Maedeto mi
Maudit moi-même
che son parfin contento.
Qui suis même content.
Lepanto
Maudite barque
tu es ma condamnation,
maudit mon capitaine
ses morts et ceux qu’il sert ;
maudit turc qui m’attend.
La lune affile, affile
elle affile bien les lames
mes mains suent
il est là il est là l’Infâme
il y a des flammes, tout un foyer
avec le canon qui tire
Cette galère retentit...
Allez … en avant …...
Brûle-lui ses voiles, arrache-lui les yeux, étripe-le
mets-le dans les chaînes, mange-lui le cœur, taille-lui les veines.
Te souviens-tu, mon père,
tu me racontais les étoiles…
Qu’il était beau de nager.
Maudite nuit
toi qui caches mon courage
maudit Lion
qui souffle toujours à contre courant
maudit couteau
Si violent.
Le vent est de glace
et les yeux des camarades
au fond semblent dire :
« je te fais mourir d’épouvante ».
La mer semble plus rouge,
le souffle toujours plus court,
Je suis fatigué, très fatigué.
Brûle-lui ses voiles,…
Dieu, pourquoi t’étonnes-tu ?
pourquoi les esclaves
doivent-ils libérer les saints ? ….
Brûle-lui ses voiles,…
Et je pense cette fois encore
que nous sommes tous fous
que la vie se fiche de nous …
Maudite victoire
Si gaie dans sa misère.
Maudit silence
Si trompeur dans ses remords
Maudit moi-même
Qui suis même content.
La bataille de Lépante (7-8 octobre 1571) fut considérée comme une victoire décisive des alliés de la Sainte Ligue chrétienne, même si elle fut qu’une défaite turque et pas la fin de la guerre avec l’Orient, nous en connaissons d’autres formes aujourd’hui. On oublia qu’elle ne fut la marque que d’une supériorité relative et qu’elle coûta très cher au peuple des marins, des soldats et des bagnards qui ramaient sur les galères : 29.000 turcs et 8.000 chrétiens dont 4856 vénitiens, et 18.000 blessés en deux jours ; l’Église célébra aussitôt cette terrible « victoire » et en 1573 le pape Grégoire XIII décida par la bulle Monet Apostolus qu’une grande fête serait célébrée chaque année le premier dimanche d’octobre à Raguse, de même que le pape Pie V avait béni le départ des troupes et remis à Don Juan d’Autriche l’étendard qu’il brandit durant toute la bataille. Raguse continue cette célébration. C’est ce que souligne le beau texte récent d’un chanteur hip-hop italien, Alessio Mariani (Murubutu, 1975- ), qui est en même temps professeur d’histoire et de philosophie au Lycée de Reggio-Emilia, La battaglia di Lepanto (1571). (Voir sur internet son interview par Stefania Parmeggiani, La Repubblica, 28 novembre 2016, « Il professore che insegna a tempo di rap »).
La battaglia di Lepanto (1571)
La spia turca entrò alla notte nel golfo, fra le onde del porto
Aveva issato vele nere per non essere scorto su a bordo,
Contò le navi nemiche sul posto rimanendo nascosto
Poi riferì a sua maestà l’entità della flotta pronta allo scontro.
La flotta della Santa Alleanza, di Venezia e di Spagna,
In nome della santa fede, truppe della Santa Sede,
di Genova e Malta
Comandate da Giovanni d’Austria che reggeva
Sull’acqua
Una croce d’oro e la resse alta per la durata dell’intera battaglia.
Rit: La furia abbatte qua un’altra bandiera, un’altra barriera,
un’altra frontiera,
Dal mare si alza là un’altra alba nera e bombarda
un’altra galera !
L’onda abbatte qua un’altra bandiera, un’altra barriera,
un’altra frontiera,
Dal mare si alza là un’altra alba nera, e bombarda... bombarda...
Il vento cambiò in un attimo decretando l’attacco,
Il Cristo contro la Sublime
e all’imbocco del golfo di Patrasso e
Flotta contro flotta e fu in un attimo impatto
Ma la forza d’urto delle galeazze di San Marco
travolse ogni ostacolo.
Le trentotto bocche da fuoco fecero il vuoto sui nemici,
Il rumore del fasciame schiantato da palle di piombo da quaranta chili,
Sfasciato da bocche da fuoco di quaranta tipi
Che frantumavano troppe prue e poppe in rotte, mosse.
da attriti precisi
Il contrattacco ottomano non si fece aspettare,
Arrivarono suonando tamburi che fecero tremare il mare
Poi dalle volte gli arcieri, scontri in pochi metri,
I galeotti morivano incatenati ai remi passati dalle
Dopo il divieto completo di guardarsi
Alla tempesta di frecce si unì il diluvio cieco
del fuoco greco,
Raggiunsero l’ammiraglia reale stringendola in un morso,
Volarono i ganci, il suono del rostro sul corpo in legno di cedro.
Sui lati gli ultimi scontri fra navi di scorta,
Tra le navi di Alì il corsaro apostata e la flotta di Doria
E come vendetta per la sconfitta di Famagosta
La testa mozza del pascià fu issata in segno di vittoria
perché fosse scorta.
Quando scese la sera il mare era pieno di rottami di navi, teste di scafi,
I superstiti mossero in forze verso la baia vicina,
Naufraghi a strati, fuochi alti sui lati dei bastimenti incendiati,
Solo due navi portarono notizia alla vicina Messina.
Fu un ecatombe di morti e colpiti, di monchi o spariti ma
La morte come nube sulle frotte dei volti dei molti feriti ;
Ma Lepanto alla fine del conto non fu fine di molto :
Forse la fine del primato turco sui mari o del primato.
Sul mare nostrum
Ma nel conflitto perenne fra occidente ed oriente
non cambiò niente :
Cambiarono tempi, armi, ma non l’equilibrio fra le potenze,
Le contese fra gli alleati della lega presente
Superava la lotta perenne contro le tenebre del nemico
Come disse il sultano dopo la sconfitta cocente,
Quando seppe dei suoi capi falciati dalle frecce,
Delle carcasse di navi spiaggiate sulle secche
« Gli infedeli mi hanno bruciato la barba ...ahhhhha...
crescerà nuovamente ! ».
La furia abbatte qua un’altra bandiera, un’altra barriera, un’altra frontiera,
Dal mare si alza là un’altra alba nera, e bombarda... bombarda...
La bataille de Lépante (1571)
La nuit tombée, l’espion turc entra dans le golfe, au milieu des eaux du port
il avait hissé des voiles noires pour ne pas être aperçu là-haut sur le bord
il compta les navires ennemis qui étaient là en restant caché
Puis il rapporta à sa majesté l’importance de la flotte prête au combat.
La flotte de la Saint Alliance, de Venise et de l’Espagne
au nom de la sainte foi, des troupes du Saint Siège,
de Gênes et de Malte
commandées par Jean d’Autriche qui dominait
sur l’eau
Une croix en or qu’il tint en l’air pendant toute la bataille.
Refrain : la fureur abat ici une autre bannière, une autre frontière
une autre barrière,
De la mer s’élève là une autre aube noire et bombarde
une autre galère !
L’onde abat ici une autre bannière, une autre barrière,
une autre frontière,
De la mer s’élève là une autre aube noire, et elle bombarde... elle bombarde...
Le vent changea en un instant, décrétant l’attaque,
Le Christ contre la Sublime
et à l’embouchure du golfe de Patras et
flotte contre flotte ce fut l’impact en un instant
Mais la force de frappe des galéasses de Saint Marc
renversa tous les obstacles.
Les trente-huit bouches de feu firent le vide sur les ennemis,
Le bruit du bordage abattu par des balles de plomb de quarante kilos,
Mis en pièces par des bouches de feu de quarante espèces
Qui brisaient trop de proues et de poupes en déroutes, agitées.
par de précis frottements
La contre attaque ottomane ne se fit pas attendre,
Ils arrivèrent en jouant du tambour et firent trembler la mer
Puis à leur tour les archers, des heurts à peu de mètres,
Les bagnards mouraient enchaînés à leurs rames passées au fil de l’épée.
Après l’interdiction complète de regarder derrière soi
À la tempête de flèches se joignit le déluge aveugle
du feu grégeois,
Ils atteignirent le navire amiral du roi, l’enserrant dans une morsure,
Les gaffes d’abordage volèrent, le bruit des rostres sur le corps en bois de cèdre.
Sur les côtés les dernières rencontres entre les navires d’escorte,
Entre les navires d’Alì le corsaire apostat et la flotte de Doria
Et comme une vengeance pour la défaite de Famagouste
La tête coupée du pacha fut hissée en signe de victoire
pour qu’on la voie.
Quand descendit le soir la mer était pleine de navires, de têtes de coques,
Les survivants se dirigèrent en force vers la baie voisine,
Des tas de naufrages, de grands feux sur les côtés des bateaux incendiés,
Seulement deux navires apportèrent la nouvelle à la proche Messine.
Ce fut une hécatombe de morts et de blessés, de manchots et de disparus mais
La mort comme un nuage sur les tas de visages des nombreux blessés ;
Mais Lépante à la fin ne fut pas la fin de grand-chose :
Peut-être la fin du primat turc sur les mers ou de son primat
Sur le mare nostrum
Mais dans l’éternel conflit entre occident et orient,
cela ne changea rien :
Les temps et les armes ont changé, mais pas l’équilibre entre les puissances,
Les querelles entre les alliés de la présente ligue
Ce qui l’emportait, c’était la lutte éternelle contre les ténèbres de l’ennemi
Comme dit le Sultan après cette cuisante défaite,
Quand il apprit que ses chefs avaient été fauchés par les flèches,
Les carcasses de navires échoués sur les hauts-fonds
« Les infidèles m’ont brûlé la barbe ...ahhhhhan …
elle repoussera ! ».
La fureur abat ici une autre bannière, une autre frontière,
De la mer s’élève là une autre aube noire, et elle bombarde... elle bombarde...
De nombreux grands musiciens classiques ont aussi chanté Lépante, Andrea (1533-1585) et Giovanni Gabrieli (1557-1612), Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), Giovanni Croce (1557-1609), Claudio Monteverdi (1567-1643)… Cela fait souvent l’objet de concerts publics.Le monde chrétien et l’Islam avaient en réalité d’autres contacts, commerciaux certes, mais aussi « paramilitaires », conséquences de la guerre ; c’était le cas de ceux qu’on appelait les « renégats », faits prisonniers par les corsaires maures, ottomans, et convertis à l’Islam, faisant parfois ensuite dans le monde turc des carrières importantes qui leur auraient été interdites dans le monde chrétien parce qu’ils n’étaient que de pauvres pêcheurs ou marins, et devenant corsaires barbaresques au service du Sultan. Un exemple particulier fut très connu et chanté, celui de Scipione Cicala (1544-1905) : c’était le fils d’une riche famille de Gênes (« Sinan », c’est-à-dire « génois » en turc. Son père Vincenzo était Vicomte et corsaire), fait prisonnier avec son père quand il a 19 ans (17 en réalité) en 1560 dans la bataille de Djerba, près des Îles Egadi, et devenu esclave du Sultan Soliman le Magnifique, dont il sera page, avant de devenir en 1591 le favori de son successeur Selim II, qui le nomme bientôt commandant de sa flotte puis pacha.Comme le raconte la chanson de De André, il préfère ne pas sortir son sabre et se rendre pour ne pas « chatouiller la fortune » ; c’était pourtant un homme riche, qui mangeait et buvait à sa faim (un « imbuto », un entonnoir), et il devient galérien, puis janissaire. Mais une nuit où le Bey prie en pensant aux jeunes vierges (les « houris ») qui l’attendent au Paradis, il ne s’aperçoit pas qu’il arrive sur un haut-fond, mais Scipione si, et il fait tourner le navire vers le sud-ouest (le « libeccio »), sauvant le navire et son commandant. Il est alors remarqué (on dit aussi que ce fut pour sa beauté physique), se convertit à l’Islam (ce n’est pas un « imbécile ») et devient riche et honoré, ayant montré ses qualités militaires et nautiques (le titre de la chanson signifie « le gênois grand amiral de la flotte ottomane »). Et il repense à une chanson populaire tyrrhénienne qu’il entendait sur son bateau quand il été fait prisonnier. Cette aventure fut aussi celle d’autres marins génois (voir par exemple Uluç Alì Pascià = Giovanni Dionigi Galeni), qui furent souvent très admirés par les Ottomans à Istamboul où ils avaient un quartier et où on peut encore visiter le palais de Sinan.
Sinàn Capudàn Pascià
Teste fascië ‘nscià galéa
E sciabbre se zeugan a lûn-a
A mæ a l’è restà duv’a a l’éale
Pe nu remenalu ä furtûn-a
Intu mezu du mä, Gh’è ‘n pesciu tundu
Che quandu u vedde ë brûtte
U va ‘nsciù fundu
Intu mezu du mä, Gh’è ‘n pesciu palla
Che quandu u vedde ë belle
U vegne a galla.
E au postu d’i anni ch’ean dedexenueve
Se sun piggiaë ë gambe e a mæ brasse neuve
D’allua a cansún l’à cantà u tambûu
E u lou s’è gangiou in travaggiu dûu
Vuga t’è da vugâ prexuné
E spuncia spuncia u remu fin au pëe
Vuga t’è da vugâ turtaiéu
E tia tia u remmu fin a u cheu.
E questa a l’è a ma stöia
E t’ä veuggiu cuntâ
‘N po’ primma ch’à vegiàià
A me peste ‘ntu murtä
E questa a l’è a memöia,
A memöia du Cigä
Ma ‘nsci libbri de stöia
Sinán Capudán Pascià
E suttu u timun du gran cäru
C’u muru ‘nte ‘n broddu de fàru
‘Na neutte ch’u freidu u te morde
U te giàscia u te spûa e u te remord
E u Bey assettòu u pensa ä Mecca
E u vedde ë Urì ‘nsce ‘na secca
Ghe giu u timùn a lebecciu
Sarvàndughe a vitta e u sciabeccu
Amü me bell’amü
A sfurtûn-a a l’è ‘n grifun
Ch’u gia ‘ngiu ä testa du belinun
Amü me bell’amü
A sfurtûn-a a l’è ‘n belin
Ch’ù xeua ‘ngiu au cû ciû vixín
E questa a l’è a ma stöia
E t’ä veuggiu cuntâ
‘N po’ primma ch’à a vegiàià
A me peste ‘ntu murtä
E questa a l’è a memöia
A memöia du Cigä
Ma ‘nsci libbri de stöia
Sinán Capudán Pasciá
E digghe a chi me ciamma rénegôu
Che a tûtte ë ricchesse a l’argentu e l’öu
Sinán gh’a lasciòu de luxî au sü
Giastemmandu Mumä au postu du Segnü
Intu mezu du mä
Gh’è ‘n pesciu tundu
Che quandu u vedde ë brûtte
U va ‘nsciù fundu
Intu mezu du mä
Gh’è ‘n pesciu palla
Che quandu u vedde ë belle
U vegne a galla.
Sinàn Capudàn Pacha
Têtes enturbannées sur la galère
et les sabres jouent avec la lune
Mien est resté où il était
Pour ne pas chatouiller la fortune.
Au milieu de la mer il y a un poisson rond
qui quand il voit les femmes laides
s’en va au fond de la mer
Au milieu de la mer il y a un poisson ballon
qui quand il voit les belles femmes
s’en vient à la surface.
Et au jour de mes dix-neuf ans
ils ont pris mes jambes et mes jeunes bras
depuis lors le tambour a chanté sa chanson
et le travail s’est transformé en tourment.
Vogue tu dois voguer prisonnier
et pousse pousse la rame jusqu’au pied
vogue tu dois voguer, gros mangeur
et tire tire la rame jusqu’au cœur.
Et voilà mon histoire je veux te la raconter
un peu avant que la vieillesse
m’écrase dans le mortier
et voici la mémoire, la mémoire de Cicala
mais, dans les livres d’histoire, de Sinàn Capudàn Pacha
Et sur le timon du grand char
avec la face dans un bouillon d’épeautre
Une nuit où le froid te mord
te mastique, te crache et te mord à nouveau
Et le Bey assis pense à la Mecque
et voit les Houris sur un haut-fond
je tourne le timon au sud-ouest
sauvant sa vie et son navire.
Amour mon bel amour l’infortune est un vautour
qui vole autour de la tête d’un imbécile
Amour, mon bel amour, l’infortune est une bite
qui vole autour du cul le plus proche.
Et voilà mon histoire je veux te la raconter
un peu avant que la vieillesse
m’écrase dans le mortier
et voici la mémoire, la mémoire de Cicala
mais dans les livres d’histoire de Sinàn Capudàn Pacha
Et dis à qui m’appelle renégat
Qu’avec toutes ses richesses, son argent et son or
Sinàn a permis de briller au soleil
blasphémant Mahomet au lieu du Seigneur.
Au milieu de la mer
il y a un poisson rond
qui quand il voit les femmes laides
s’en va au fond de la mer
Au milieu de la mer
il y a un poisson ballon
qui quand il voit les belles femmes
s’en vient à la surface.
Chansons sur les révoltes populaires - Masaniello
De nombreux grands musiciens classiques ont aussi chanté Lépante, Andrea (1533-1585) et Giovanni Gabrieli (1557-1612), Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), Giovanni Croce (1557-1609), Claudio Monteverdi (1567-1643)… Cela fait souvent l’objet de concerts publics.
Le monde chrétien et l’Islam avaient en réalité d’autres contacts, commerciaux certes, mais aussi « paramilitaires », conséquences de la guerre ; c’était le cas de ceux qu’on appelait les « renégats », faits prisonniers par les corsaires maures, ottomans, et convertis à l’Islam, faisant parfois ensuite dans le monde turc des carrières importantes qui leur auraient été interdites dans le monde chrétien parce qu’ils n’étaient que de pauvres pêcheurs ou marins, et devenant corsaires barbaresques au service du Sultan. Un exemple particulier fut très connu et chanté, celui de Scipione Cicala (1544-1905) : c’était le fils d’une riche famille de Gênes (« Sinan », c’est-à-dire « génois » en turc. Son père Vincenzo était Vicomte et corsaire), fait prisonnier avec son père quand il a 19 ans (17 en réalité) en 1560 dans la bataille de Djerba, près des Îles Egadi, et devenu esclave du Sultan Soliman le Magnifique, dont il sera page, avant de devenir en 1591 le favori de son successeur Selim II, qui le nomme bientôt commandant de sa flotte puis pacha.
Comme le raconte la chanson de De André, il préfère ne pas sortir son sabre et se rendre pour ne pas « chatouiller la fortune » ; c’était pourtant un homme riche, qui mangeait et buvait à sa faim (un « imbuto », un entonnoir), et il devient galérien, puis janissaire. Mais une nuit où le Bey prie en pensant aux jeunes vierges (les « houris ») qui l’attendent au Paradis, il ne s’aperçoit pas qu’il arrive sur un haut-fond, mais Scipione si, et il fait tourner le navire vers le sud-ouest (le « libeccio »), sauvant le navire et son commandant. Il est alors remarqué (on dit aussi que ce fut pour sa beauté physique), se convertit à l’Islam (ce n’est pas un « imbécile ») et devient riche et honoré, ayant montré ses qualités militaires et nautiques (le titre de la chanson signifie « le génois grand amiral de la flotte ottomane »). Et il repense à une chanson populaire tyrrhénienne qu’il entendait sur son bateau quand il a été fait prisonnier. Cette aventure fut aussi celle d’autres marins génois (voir par exemple Uluç Alì Pascià = Giovanni Dionigi Galeni), qui furent souvent très admirés par les Ottomans à Istamboul où ils avaient un quartier et où on peut encore visiter le palais de Sinan.

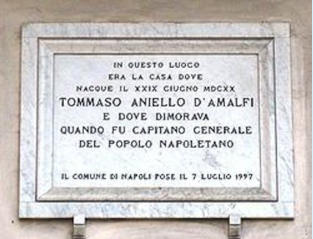

‘o cunto ‘e masaniello
A lu tiempo de la malora
Au temps des malheurs
Masaniello è nu piscatore,
Masaniello est un pécheur,
piscatore nun le rincresce
un pécheur qui ne regrette pas de l’être
Masaniello se magna ‘nu pesce.
Masaniello mange un poisson.
Vene subbeto ‘o Vicerrè
Et tout de suite arrive le Vice-roi
chistu pesce spett’a mme
ce poisson me revient
tutt’a mme e niente a tte
tout à moi et rien pour toi
po’ si a tassa vuo’ pava’,
mais si tu veux payer une taxe
chistu pesce t »o può ‘mpigna’...
ce poisson je peux te le donner en gage…
A lu tiempo de la malora
Au temps des malheurs
Masaniello è nu piscatore.
Masaniello est un pécheur.
A lu tiempo de trivule ‘mpizze
Au temps des troubles
Masaniello se veste ‘a scugnizzo,
Masaniello s’habille comme un mauvais garçon
nu scugnizzo stracciato e fetente,
un garçon en haillons et puant
Masaniello se magna ‘e semmente.
Masaniello mange des semences,
Vene subbeto ‘o Vicerrè
Et tout de suite arrive le Vice-roi
‘sta semmenta spett’a mme
ces semences me reviennent
tutt’a mme e niente a tte
tout à moi et rien pour toi
cu ‘a semmenta tu te ‘ngrasse,
avec ces semences tu grossis
t »a metto n’ata tassa...
je te mets une autre taxe
A lu tiempo de trivule ‘mpizze
Au temps des troubles
Masaniello se veste ‘a scugnizzo...
Masaniello s’habille comme un mauvais garçon.
A lu tiempo de li turmiente
Au temps des tourments
Masaniello se veste ‘a fuiente.
Masaniello s’habille comme un pénitent
Senza rezza e senza cchiù varca,
sans filet de pêche et sans barque
fa’ ‘nu vuto a’ Maronna ‘e ll’Arco..
il fait un vœu à la Madonna dell’Arco
Vene ‘o prevete e ‘o Vicerrè
Arrivent le prêtre et le Vice-roi
‘sta Maronna spett’a mme
cette Madone me revient
tutt’a mme e niente a tte,
tout à moi et rien pour toi
chesta è a tassa p »o Pataterno,
paye la taxe pour le Père Éternel,
lo vai subbet’all’inferno..
ou tu iras tout droit en enfer.
A lu tiempo de li turmiente
Au temps des tourments
Masaniello se veste a fuiente.
Masaniello s’habille comme un pénitent.
A lu tiempo d »a disperazione
Au temps du désespoir
Masaniello se veste ‘a lione
Masaniello s’habille comme un lion
nu lione cu ll’ogne e cu ‘e riente,
un lion qui montre les griffes et les dents
tene ‘a famma e tutt »e pezziente.
Il traîne la faim de tous les gueux.
Vicerrè mò fete ‘o ccisto
Vice-roi, j’en ai assez
songo ‘o peggio cammurrista,
je suis le pire des camorristes
io me songo fatto ‘nzisto,
je suis devenu affreux
cu ‘a ‘nziria e Masaniello
avec la révolte de Masaniello
faie marenna a sarachiello...
tu auras fini d’être arrogant.
A lu tiempo d »a disperazione
Au temps du désespoir
Masaniello se veste ‘a lione.
Masaniello s’habille en lion.
A lu tiempo de primmavera
Au temps du printemps
Masaniello se veste ‘a bannera.
Masaniello s’habille comme un drapeau
‘Na bannera ca ‘o popolo bascia
un drapeau que le bas-peuple baise
sona arreto tammorra e grancascia.
Suit avec tambours et grosses caisses.
Attenzione... battaglione
Attention … un bataillon
s’è sparato nu cannone,
on a tiré un coup de canon
è asciuto pazzo lu patrone,
il est devenu fou le maître
ogge ‘nce ha avasciato ‘o ppane
aujourd’hui il nous baisse le prix du pain
ma nun saie fino a dimmane...
mais qu’en sera-t-il demain ?
A lu tiempo de primmavera
Masaniello se veste ‘a bannera.
A lu tiempo de trarimiento
Masaniello ‘o vestono ‘argiento,
tutt’argiento ‘e signure cumpite
mò ce ‘o coseno ‘stu vestito.
Dice subbeto ‘o Vicerrè
simmo eguale io e te
pazziammo cucù e settè,
si rispunne a chist’invito,
t’aggia cosere n’atu vestito...
A lu tiempo de trarimiento
Masaniello ‘o vestono ‘argiento.
A lu tiempo de li ‘ntrallazze
Masaniello è bestuto da pazzo.
Quanno tremma e ‘o vestito se straccia,
pure ‘o popolo ‘o sputa ‘nfaccia
‘Stu vestito fà appaurace
Masaniello se spoglia annuro,
‘a Maronna nun se ne cura
po’ si ‘a capa ‘nterra ce lassa
accussì pava ll’urdema tassa.
A lu tiempo de li ‘ntrallaze
Masaniello è bestuto da pazzo.
A lu tiempo de ‘sti gabelle
Masaniello è Pulicenella.
Si è rimasto cu ‘a capa a rinto
ll’ate ridono areto ‘e quinte.
Pò s’aumenta ‘o ppane e ll’uoglio
saglie ‘ncoppa n’atu ‘mbruoglio
tira ‘o popolo ca ce cuoglie,
nun ce appizza mai la pelle
chi cummanna ‘sti guarattelle.
A lu tiempo de ‘sti gabelle
Masaniello è Pulicenella.
A lu tiempo de chisti scunfuorte
Masaniello è bestuto da muorto.
Masaniello est vêtu comme un mort
Dint »a nicchia ‘na capa cu ll’oss
dans une niche un crâne et des os
ce ha lassato ‘na coppola rossa.
Il nous a laissé son béret rouge
Chesta coppola dà ‘na voce,
Ce béret donne de la voix
quanno ‘a famme nun è doce,
quand la faim n’est pas douce
quann »o popolo resta ‘ncroce,
quand le peuple est sur la croix,
quanno pave ‘stu tributo
quand il paye son tribut
pure ‘a tassa ‘ncopp » o tavuto.
Une taxe même sur son cercueil,
A lu tiempo de chisti scunfuorte
Au temps du découragement
Masaniello è bestuto da muorto.
Masaniello est vêtu comme un mort
Masaniello s »o credono muorto...
Masaniello, on le croit mort…
L'histoire de Masaniello
Au temps des malheurs
Masaniello est un pécheur,
un pécheur qui ne regrette pas de l’être
Masaniello mange un poisson.
Et tout de suite arrive le Vice-roi
ce poisson me revient
tout à moi et rien pour toi
mais si tu veux payer une taxe
ce poisson je peux te le donner en gage…
Au temps des malheurs
Masaniello est un pécheur.
Au temps des troubles
Masaniello s’habille comme un mauvais garçon
un garçon en haillons et puant
Masaniello mange des semences,
Et tout de suite arrive le Vice-roi
ces semences me reviennent
tout à moi et rien pour toi
avec ces semences tu grossis
je te mets une autre taxe
Au temps des troubles
Masaniello s’habille comme un mauvais garçon.
Au temps des tourments
Masaniello s’habille comme un pénitent
sans filet de pêche et sans barque
il fait un vœu à la Madonna dell’Arco
Arrivent le prêtre et le Vice-roi
cette Madone me revient
tout à moi et rien pour toi
paye la taxe pour le Père Éternel,
ou tu iras tout droit en enfer.
Au temps des tourments
Masaniello s’habille comme un pénitent.
Au temps du désespoir
Masaniello s’habille comme un lion
un lion qui montre les griffes et les dents
Il traîne la faim de tous les gueux.
Vice-roi, j’en ai assez
je suis le pire des camorristes
je suis devenu affreux
avec la révolte de Masaniello
tu auras fini d’être arrogant.
Au temps du désespoir
Masaniello s’habille en lion.
Au temps du printemps
Masaniello s’habille comme un drapeau
un drapeau que le bas-peuple baise
Suit avec tambours et grosses caisses.
Attention … un bataillon
on a tiré un coup de canon
il est devenu fou le maître
aujourd’hui il nous baisse le prix du pain
mais qu’en sera-t-il demain ?
Au temps du printemps
Masaniello s’habille comme un drapeau
Au temps des trahisons
Masaniello est vêtu d’argent
Tout en argent ces messieurs bien polis
Lui ont cousu ce vêtement.
Et tout de suite le Vice-roi lui dit :
toi et moi nous sommes égaux
jouons à cache-cache,
si tu acceptes cette invitation
je te coudrai un autre vêtement.
Au temps des trahisons
Masaniello est vêtu d’argent.
Au temps des complots
Masaniello est vêtu comme un fou.
Quand il tremble et que son habit se déchire
même le peuple lui crache au visage
cet habit fait peur
Masaniello se met tout nu
la Madone ne le protège pas
et si sa tête roule à terre
Ce sera la dernière taxe à payer.
Au temps des complots
Masaniello est vêtu comme un fou.
Au temps de ces gabelles
Masaniello est Polichinelle.
S’il a laissé sa tête par terre
Les autres rigolent en coulisse.
Puis on augmente le pain et l’huile
il y a de plus en plus de magouilles
à tirer sur le peuple on ne prend pas de risques
ils n’y laissent jamais leur peau
Ceux qui gouvernent ces marionnettes.
Au temps de ces gabelles
Masaniello est Polichinelle.
Au temps du découragement
Masaniello est vêtu comme un mort
dans une niche un crâne et des os
Il nous a laissé son béret rouge
Ce béret donne de la voix
quand la faim n’est pas douce
quand le peuple est sur la croix,
quand il paye son tribut
Une taxe même sur son cercueil,
Au temps du découragement
Masaniello est vêtu comme un mort
Masaniello, on le croit mort…
Masaniello a inspiré d’autres chansons jusqu’à Pino Daniele (Je so pazzo, 1979) ; l’une d’entre elles est moins connue, de Ferdinando Russo (1866-1927 - Voir sur ce site le chapitre 34 du livre « Poésie en musique » qui évoque Ferdinando Russo), ‘A mugliera ‘e Masaniello, qui raconte la triste vie de Bernardina Pisa après l’assassinat de son mari : elle fut « Reine » pendant quelques jours, reçue au Palais Royal et couverte de bijoux précieux, mais maintenant elle est réduite à se prostituer dans son Borgo Sant’Antonio Abate, et elle est humiliée, possédée, non payée et maltraitée par les soldats espagnols ; le « pain noir » (complet) était réservé aux pauvres, symbole de pauvreté, tandis que les riches mangeaient du pain blanc.
‘A mugliera ‘e Masaniello
So’ turnate li Spagnuole,
è fernuta ‘a zezzenella ;
comme chiagneno ‘e ffigliole
fora ‘a via d’ ‘a Marenella !
A Riggina ‘e ll’otto juorne
arredotta a ffa’ ‘a vaiassa ;
so turnate li taluorne,
‘ncopp’ ‘e frutte torna ‘a tassa !
Chella vesta, tuttaquanta
d’oro e argiento arricamata,
ll’ha cagnata sta Rignanta
cu na vesta spetacciata.
‘A curona ‘e filigrana
che d’è ? Curona ‘e spine !
‘E zecchine d’ ‘a cullana
mo nun songo cchiù zecchine !
Li Spagnuole so’ turnate
chiù guappune e preputiente
se mo a chiammano, ‘e suldate,
ta Riggina d’ ‘e pezziente !
E lle danno ‘a vuttatella,
e lle diceno’ a parola,
e lle tirano ‘a vunnella...
Essa chiagne, sola sola.
Pane niro e chianto amaro,
chianto amaro e pane niro
vanno a ccocchia e fanno ‘o paro
comm’ ‘e muonece a Retiro.
Da Palazzo essa è passata
dint’ ‘o Bbuorgo e venne ammore ;
tene ‘a mala annummenata,
ma nu schianto mmiez’ ‘o core !
Dint’ ‘o vascio d’ ‘a scasata
mo nce passa o riggimento ;
a furtuna ll’ha lassata
morta ‘e famma e de fraggiello,
chella llà ch’era na vota
‘a mugliera ‘e Masaniello !
La femme de Masaniello
Ils sont revenus, les Espagnols
la belle vie est finie ;
comme elles pleurent les filles
dehors rue Marinella !
La Reine de huit jours
réduite à faire la putain ;
il est revenu le train-train habituel,
sur les fruits la taxe est revenue !
Ce vêtement tout entier
brodé d’or et d’argent
elle l’a échangé, cette Régnante
contre un vêtement déchiqueté.
Cette couronne bordée d’orm
qu’est-ce que c’est maintenant ? une couronne d’épines !
Les sequins que valait le collier
maintenant ne sont plus des sequins !
Les Espagnols sont revenus
plus arrogants et autoritaires
et maintenant, les soldats, ils l’appellent
la Reine des mendiants !
Et ils lui donnent des petits coups
et ils lui disent deux mots,
et ils lui tirent sa petite jupe…
Elle, elle pleure, toute seule.
Pain noir et pleurs amères
pleurs amères et pain noir
vont en couple et font la paire
comme les moines à l’hospice.
Du Palais elle est passée
dans le Borgo où elle vend de l’amour
c’est une femme de mauvaise réputation
mais elle porte une plaie dans le cœur !
Dans ses bas quartiers, la malheureuse
passent maintenant les soldats
la chance l’a quittée
et un vilain vent souffle pour elle.
Elle est si sale et affamée
morte de faim et d’effort
elle qui autrefois avait été
la femme de Masaniello !
La révolution napolitaine de 1799
La dernière révolution d’Italie au XVIIIe siècle fut un événement marquant de l’histoire d’Italie, et déterminant pour toute l’histoire de Naples des siècles suivants, mais ce fut une révolution menée par la bourgeoisie, une partie de la noblesse et du clergé inspirés par la pensée française des Lumières et par la Révolution jacobine française de 1789, contre la monarchie et l’Église institutionnelle réactionnaires, mais aussi du même coup contre le peuple napolitain que celles-ci opprimaient, les « làzzari » (ou « lazzaroni »), restés fidèles à la monarchie et à l’Église romaine. L’appellation de « lazzaro » fut le nom donné par les Espagnols aux Napolitains qui avaient suivi Masaniello dans la révolte de 1647, à partir d’un mot espagnol qui désignait les « pauvres », en référence aux haillons dont était revêtu le Lazare biblique de l’Évangile de Luc, 16, 19. Mais auparavant le mot avait désigné les lépreux qui avaient pour patron saint Lazare, d’où le nom de « lazaret » pour les hôpitaux de lépreux (notez l’île du Lazzaretto Vecchio dans la lagune de Venise).
Le lit du lazzarone
Le « làzzaro » était à Naples un pauvre d’une nature particulière, sans revenus, sans aucun bien, sans métier particulier (ils pouvaient faire ce qui se présentait, si nécessaire), c’était le bas peuple de Naples, un sous-prolétariat urbain misérable, mais qui gardait un caractère joyeux, sachant profiter des fêtes comme des déchets des riches ; jouissant chaque jour du climat, du spectacle de la vie napolitaine, mais en même temps parfois très organisé, obéissant à une hiérarchie (ils avaient des chefs), et très attachés à la monarchie et à l’Église, capables de se mobiliser pour une cause, que ce soit en 1647 celle de Masaniello, qu’ils soutiennent puis abandonnent, ou en 1799, celle de la lutte contre les Français et contre la République, rejoignant l’armée des « sanfedisti » du cardinal Ruffo. De ce bas peuple, les lazzari étaient en quelque sorte l’élite, forte, selon les estimations de 6.000 à 40.000 hommes, et qui pouvaient maintenir l’ordre de la plèbe lorsque le roi s’absentait de Naples. Les historiens officiels les ignorent souvent, mais si on n’en tient pas compte, on ne comprend rien à l’histoire de Naples. Plus tard on les appellera les « scugnizzi », mot qui vient du verbe « scugnare » = ébrécher, égratigner, c’était l’habitude des garçons qui jouaient à la toupie (lo « strummolo » = la trottola. Voir ci-contre) d’égratigner avec la pointe de leur toupie la toupie des autres. Mal habillés, vivant dans la rue, avec des parents qui ne s’occupent pas d’eux, n’allant pas à l’école. Intelligents, rusés, formés par la vie dans la rue, ils savent toujours trouver de quoi vivre, mais ils sont capables de se dresser contre un oppresseur de la ville, comme ils le firent en 1943 pour libérer Naples de l’occupation nazie du colonel SS Walter Scholl. Sur les « lazzari », voir le petit volume de Luisa Basilio et Delia Morea, Lazzari e scugnizzi - La lunga storia dei figli del popolo napoletano, Tascabili economici Newton, 1996, 62 pages, Benedetto Croce, Aneddoti e profili settecenteschi, Remo Sandron Editore, 1914, et Aneddoti di varia letteratura, Laterza, 1954, et Alexandre Dumas, Le corricolo, 1843, réédité par Hachette BNF, 2020 et d’autres éditeurs.
Plaque commémorative de Procida des exécutés de 1799
La révolution jacobine napolitaine n’éclata que plusieurs années après la Révolution française : Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 et Marie Antoinette le 16 octobre 1793, c’était la sœur de Marie Caroline Habsbourg-Lorraine, épouse du Roi de Naples depuis 1759, Ferdinand IV (1751-1825) ; on imagine la haine de la reine pour les Français révolutionnaires, et elle poussa ainsi le roi à adhérer à la Première Coalition antifrançaise et anti jacobine (1792-1797) qui réunissait presque toutes les monarchies européennes, et il commença à réprimer toute forme d’adhésion à l’idéologie républicaine qui se développait : dès 1793 se constitua cependant une Société Patriotique Napolitaine, créée par le pharmacien Carlo Lauberg (1762-1834) qui devint plus tard Président de la République Napolitaine jusqu’en février 1799 et se réfugia en France où il étudia les propriétés du quinquina. Durant les guerres de 1796-7, se créèrent les « républiques sœurs » de la République Française, la République Démocratique de Ligurie (1797), la République Cisalpine en Lombardie, Émilie Romagne, une partie de la Vénétie et de la Toscane (1797) et la République Romaine dans une partie des États Pontificaux (1798). Le 23 octobre 1798, le Royaume de Naples reprit la guerre contre les Français avec l’appui de la flotte anglaise de l’amiral Horatio Nelson (1758-1805), occupa Rome mais fut aussitôt défait par les armées du général Jean Étienne Championnet (1762-1800). Le Roi de Naples dut s’enfuir en Sicile en emportant son trésor, malgré la résistance opposée aux Français par les « làzzari » de Naples et de la province, tandis que les républicains jacobins s’emparaient du Château Saint-Elme permettant l’entrée des Français dans la ville. Environ 3.000 làzzari furent tués dans ce qui fut une guerre civile. La République Napolitaine fut instituée le 23 janvier 1799, avec un gouvernement de 20 puis 25 membres qui préféraient s’appeler « patriotes » plutôt que « jacobins » : c’était clairement une révolution de la bourgeoisie intellectuelle napolitaine non seulement contre les monarchistes mais aussi, involontairement et ce fut le drame, contre le peuple des làzzari, comme le montre bien la liste des 124 condamnés à mort et exécutés par le Roi après la fin de la République (Voir sur Internet : Repubblicani napoletani giustiziati nel 1799-1800) : on compte environ 23 avocats, juristes, magistrats + 2 notaires, 18 ecclésiastiques (dont 1 évêque), 18 officiers supérieurs (souvent marins, généraux, 1 commissaire, 1 maître d’escrime, 1 amiral, Francesco Caracciolo), 12 aristocrates (princes, barons, comtes), 8 enseignants (en général universitaires et 1 vulcanologue), 7 négociants et commerçants, 5 employés, 2 banquiers, 2 hommes de lettres, 1 paysan, et 3 femmes (Francesca De Carolis Cafarelli (1755-1799), Eleonora Fonseca Pimentel, Luisa Sanfelice. Lire le grand roman d’Alexandre Dumas, La Sanfelice, 1863-65, réédité par Quarto Gallimard, 1996, 1736 pages). Une femme comme Eleonora Pimentel (1752-1799), fut familière de la cour royale, dont elle approuvait les tentatives de réforme, elle écrivit et dédia plusieurs sonnets à la reine Marie Caroline dont elle fut aussi bibliothécaire, puis devint adepte des Jacobins à partir de 1794. Elle créa le journal « Monitore napolitano », publié le mardi et le samedi de chaque semaine (35 numéros du 02 février au 28 juin 1799, de 4 pages grand format). Elle s’y battit constamment pour les intérêts et l’insertion du petit peuple dans la structure de la République. Plusieurs autres journaux et de nombreux opuscules et catéchismes furent créés dans la même période. Eleonora était très admirée en Europe, Voltaire l’appelait « Beau rossignol de la belle Italie », Métastase « la très aimable muse du Tage » (le fleuve hispano-portugais, Eleonora était d’origine portugaise) et son surnom à Naples était « Sybille Parthénopéenne ». Alexandre Dumas en fait un portrait dans Emma Lyonna (1876) qui fait suite à la Sanfelice, portrait de Lady Hamilton. Elle fut représentative d’une large participation des femmes à l’animation de la vie républicaine, elles animaient des salons et participaient à la propagande et aux luttes.
On ne signale que deux chefs de lazzari ralliés à la République, Michele Marino (1770-1799), dit « il Pazzo » (le fou), pour répondre à la générosité de Championnet à son égard, qui joua un rôle important d’intermédiaire entre le gouvernement et les lazzari par ses discours en dialecte, et Antonio Avella (1739-1799) dit « Pagliuchella » (fétu de paille), nommé juge de paix par la République bien qu’il soit analphabète. Il y en eut probablement d’autres, anonymes.
Gioacchino Toma, Luisa Sanfelice en prison, 1874 - Museo di Capodimonte.
Entrés à Naples, les Français détruisirent de nombreuses œuvres d’art pour en récupérer l’or des cadres, et en volèrent surtout un grand nombre, tableaux, sculptures, livres, bijoux, jamais restitués (deux tableaux sont encore au Musée de Lyon). À cause de sa brève durée, la République réalisa peu de réformes, en-dehors de l’abolition de la féodalité non appliquée par manque de temps, mais pratiqua une répression sévère des oppositions, en même temps qu’elle préparait des lois destinées à améliorer la situation du peuple. Comportement des Français et répression politique rendirent le gouvernement peu populaire.
L’armée de Championnet doit évacuer Naples le 7 mai, et les jacobins napolitains doivent se défendre seuls contre l’armée organisée par le cardinal chef de guerre Fabrizio Ruffo, l’Armée de la Sainte Foi (i sanfedisti), appuyée par de nombreux lazzari et par des brigands comme Fra Diavolo (Michele Pezza, 1771-1806), Pronio, Giuseppe Costantini (appelé « Sciabolone »), Panedigrano… ; elle reprend Naples le 13 juin et obtient la reddition des derniers jacobins réfugiés dans trois forteresses napolitaines, dont le Château Saint Elme (image ci-contre), faisant environ 8.000 prisonniers, dont 124 seront exécutés par la volonté de Nelson, contrairement aux engagements passés avec le cardinal Ruffo. On imagine mal la cruauté de la plèbe, femmes comprises, vis-à-vis de tout ce qui ressemblait à un bourgeois jacobin, elle tortura, fit des feux dans la rue pour brûler les cadavres et parfois en vendre et en manger la viande, elle joua au ballon avec les têtes coupées, et acheva souvent la destruction de tous les biens des Jacobins riches, avocats ; médecins, etc. La suite de l’histoire napolitaine est aussi la conséquence de cette barbarie de l’aristocratie monarchiste, de l’Église et de la plèbe. Voir le récit de Giuseppe De Lorenzo (1778-1822), Nel furore della reazione del 1799, sur https://www.nuovomonitorenapoletano.it/pdf/delorenzo. Membre de la Garde de la République, il raconte son arrestation, l’horreur des massacres commis par les lazzari du Cardinal Ruffo, et sa libération finale, il fut condamné à l’exil.
Cet échec de la révolution napolitaine de 1799, la rupture avec le peuple analphabète des lazzari qu’elle voulait pourtant défendre, la défaite face aux forces des deux « monstres » de l’époque, le Trône et l’Autel, fut un drame historique aussi décisif pour l’histoire de l’Italie que la Révolution Française pour l’histoire de France.
Canto (marcia) dei Sanfedisti
Chant (marche) des soldats de la Sainte Foi
Le refrain incite à la lutte, en reprenant dans un sens contre-révolutionnaire le chant de la Carmagnole. La Carmagnole est le plus célèbre de tous les chants révolutionnaires, petite sœur de la Marseillaise. Le nom vient d’une commune piémontaise, Carmagnola, la plus grande productrice de chanvre des Marquis de Saluzzo (anciens maîtres du marquisat de Saluzzo, acquis par les Savoie en 1601). Ce chanvre servait à fabriquer une toile utilisée pour fabriquer, outre les cordes, les voiles, les rideaux, les pantalons de travail (voir : www.piemontemese.it/2015/04/01/la-prima-carmagnole-di-marco-doddis/) qui étaient exportés par le port de Gênes (rappelons que le terme « blue-jeans » vient de la locution française « bleu de Gênes » : c’est Carmagnola qui avait inventé les blue-jeans 300 ans avant les Américains !).
Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826), Un sans-culotte, 1790
L’arbre de la Liberté, 1790
Veste des chanvriers de Carmagnola
Mais après l’arrivée des Savoie, de nombreux ouvriers chanvriers émigrèrent à Marseille, qui avait besoin de cette main-d’œuvre, apportant leurs coutumes, leurs costumes, leurs chansons de travail et de lutte, et les Marseillais adoptèrent sous le nom de « carmagnole » leur tunique, leurs chansons et leur danse. Quand les Marseillais, ardents révolutionnaires, montent à Paris après 1789, ils apportent tout cela, dont le vêtement appelé « carmagnole », cette veste courte, avec ce chant de guerre qui devient la Marseillaise, et un autre chant et danse qui devient « la Carmagnole (« Dansons la Carmagnole / Vive le son du canon ») qui eut et conserva un énorme succès. Le texte français, dont on ne connaît pas exactement l’auteur, date d’août 1792, se répand rapidement dans les rangs des Sans-culottes (qui avaient adopté leur veste sur le pantalon qui remplaçait la « culotte » des nobles, et leur bonnet phrygien, – ce chapeau que les anciens Romains faisaient porter à leurs esclaves libérés), il devient leur hymne et il sera repris par toutes les révolutions suivantes en France et en Europe, de 1830 à 1917. C’est un symbole de la révolution, un chant contre les puissants, ce qui amena Napoléon à l’interdire, en même temps que la Marseillaise. Le texte du Chant des Sanfedisti connaît plusieurs versions, mais celle-ci semble la plus exacte.
La première strophe est un appel au peuple, et chaque partie de ce peuple joue d’un instrument : la grosse caisse pour le « popolino », la partie inférieure paysanne, les làzzari, le tambourin pour tous ceux qui n’ont rien, les cloches pour les artisans, le peuple moyen, et le violon pour clamer la mort des jacobins.
La seconde strophe raconte le début de la République, l’arrivée des Français de Championnet, la résistance des lazzari réfugiés dans le fort Saint Elme, la nomination du cornard Antonio Toscano (1774-1799) nommé évêque, la trahison des bourgeois et des nobles qui ont voulu emprisonner le roi. Toscano, fils d’un avocat aisé et républicain de Corigliano mais qui s’était transféré à Naples, était devenu franc-maçon en même temps qu’il se préparait à devenir prêtre, et avait fait trois ans de prison entre 1796 et 1798. Il revient à Naples pour soutenir la République qui le nomma à la tête de 150 légionnaires calabrais (d’autres documents disent 15, mais il n’a jamais été nommé évêque par la République !) dans le fort de Vigliena, aux portes de Naples. Le 13 juin le cardinal Ruffo assiège le fort avec ses sanfedisti et un contingent russe ; quand il voit qu’il ne peut plus résister, Toscano fait sauter la poudrière du fort tuant tous ses compagnons (sauf deux qui ont raconté cette fin) et de nombreux assaillants. Il est honoré aujourd’hui à Corigliano.
Eleonora Pimentel, portrait imaginaire
La troisième strophe évoque la fin de la République, le 13 juin 1799, jour de saint Antoine de Padoue, mort et célébré le 13 juin (pendant plusieurs années, il avait remplacé San Gennaro, soupçonné d’avoir été favorable aux Jacobins car son sang s’était liquéfié en présence des Français), la prise du fort de Vigliena par les troupes du cardinal Ruffo, puis elle rappelle les vexations subies par le peuple, mais aussi les vols et mauvais gouvernement appelés « liberté » et « égalité ». La plèbe sanfedista n’avait pas compris la volonté jacobine de lui donner sa liberté, et s’était laissé prendre par la rhétorique mensongère de Ruffo.
La quatrième strophe continue à dire les dommages causés par les Français, on ne peut plus aller au théâtre et madame Éléonore (Eleonora Pimentel Fonseca) doit danser dans la rue, sur la place du Marché où elle a été pendue ; elle avait en effet l’habitude de déclamer des poésies dans la rue, ce qui était inconvenant pour une femme de l’époque, et on la soupçonnait d’avoir des mœurs libres. Mastro Donato était le bourreau qui décapitait sur la place du Marché.
La cinquième strophe raconte que madame Luisa (Luisa Fortunata de Molina Sanfelice) aurait fait semblant d’être enceinte pour ne pas être exécutée, et que les médecins n’auraient pas pu la faire accoucher puisqu’elle n’était pas enceinte, elle ne fut en effet décapitée que le 11 septembre 1800. Le pont de la Madeleine fut un des lieux de bataille entre Républicains et Sanfedisti.
Le cardinal Ruffo
La strophe suivante invite les Jacobins à s’enfuir, ainsi ils ne pourront plus voler, et dans l’eau ils ne sentiront pas trop les grilles brûlantes de l’enfer. Puis viennent les fêtes de joie, on arrache les arbres de la Liberté plantés par les Républicains, symboles de la révolution, au pied desquels on célébrait des mariages républicains pour diminuer l’influence des mariages chrétiens : le marié récitait « Questo è l’albero con le foglie, ecco mia moglie » (Celui-ci est l’arbre avec ses feuilles, voici ma femme ») et celle-ci répondait « Questo è l’albero fiorito, ecco mio marito » (Celui-ci est l’arbre fleuri, voici mon mari).
La dernière strophe est ironique, reprenant les noms donnés aux mois par le Calendrier révolutionnaire : Janvier = Pluviôse, février = Ventôse, mars = Germinal, jusqu’à juin = Messidor. Elle se termine par l’éloge du peuple des macaronis, les vrais napolitains qui respectent la religion et ont renvoyé les Jacobins avec de l’ail dans le derrière. Voir le commentaire du site www.ilportaledelsud.org/carmagnola.htm.
Ce chant, par ailleurs plein d’inexactitudes, exprime bien la réalité de la révolution jacobine napolitaine : les républicains de Naples qui voulaient sincèrement aider et réformer le peuple, mais qui n’avaient pas assez perçu que le peuple de Naples n’était pas celui de Paris, et qu’il fut aussi révolté par le comportement des soldats français. Ce drame eut pour conséquence la liquidation d’une grande partie des meilleurs intellectuels napolitains, laissant par la suite le régime bourbonien et la petite bourgeoisie intellectuellement médiocre face à un peuple de lazzari qui lui faisait peur et qui la combattit souvent. Voir la thèse fondamentale de Raffaello La Capria, dans L’armonia perduta, Mondadori, 1986, 214 pages, en particulier le chapitre VIII, La paura della plebe. Il écrit, reprenant le texte de Vincenzo Cuoco, « Sur le modèle de la révolution française la bourgeoisie napolitaine, la meilleure que nous eûmes jamais, tenta sa révolution ; mais le peuple, la plèbe, ne la comprit pas. C’étaient deux races et elles ne parlaient pas la même langue, elles ne pouvaient pas se comprendre. Les hordes de la Sainte Foi avancèrent comme les mongols, Ruffo comme le fléau de Dieu, et ils dévastèrent, massacrèrent, détruisirent. Une curieuse histoire de la patrie, sombre et irrationnelle, barbare, où la plèbe opprimée rendit le pouvoir à ses oppresseurs et mit littéralement en morceaux cette poignée de gentilshommes qui lui parlait de liberté » (p. 46). Le duc de Cassano, Gennaro Serra, face à une foule délirante devant le spectacle de son exécution déclara : « Ho sempre desiderato il loro bene e loro gioiscono della mia morte » (« J’ai toujours désiré leur bien et ils jouissent de ma mort »).
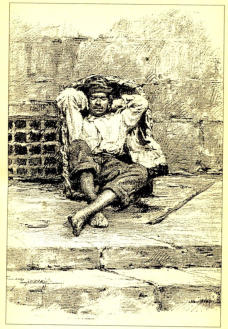











Canto dei Sanfedisti
(Anonimo, 1799, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppe Barra, Guerra, 2001, Accordone, Marco Beasley, Fra Diavolo, la musica delle strade del Regno di Napoli, 2010)
Canto dei Sanfedisti
A lu suono de grancascia
A lu suono ‘re tammurrielli
so’ risurte li puverielli
A lu suono ‘re campane
A lu suono ‘re viulini
morte alli giacubbine.
Sona sona
sona Carmagnola
sona li cunziglia
viva ‘o rre cu la Famiglia.
Sona sona
sona Carmagnola
sona li cunziglia
viva ‘o rre cu la Famiglia.
A sant’Eremo tanto forte
l’hanno fatto comme ‘a ricotta
A ‘stu curnuto sbrevognato
l’hanno miso ‘a mitria ‘ncapo.
Maistà chi t’ha traruto
chistu stommaco chi ha avuto
‘e signure ‘e cavaliere
te vulevano priggiuniere.
Sona sona
sona Carmagnola …
Alli tridece di giugno
sant’Antonio gluriuso
‘e signure ‘sti birbanti
‘e facettero ‘o mazzo tanto.
So’ venute li Francise
aute tasse ‘nce hanno miso
Liberté... Egalité...
tu arrobbe a me
io arrobbo a te.
Sona sona
sona Carmagnola…
Li Francise so’ arrivate
‘nce hanno bbuono carusate
vvualà evvualà
cavece ‘nculo alla libertà.
Addò è gghiuta ‘onna Eleonora
c’abballava ‘ncoppa ‘o teatro
mo abballa miez »o mercato
‘nzieme cu mastu Donato.
Sona sona…
A lu ponte ‘a Maddalena
‘onna Luisa è asciuta prenna
e tre miedece che banno
nun la ponno fa sgravà.
Addò è gghiuta ‘onna Eleonora
ch’abballava ‘ncopp’o triato ?
Mo abballa cu ‘e surdate,
nun ha pututo abballà cchiù !
Sona sona…
Pronte sò li bastimente,
jate ‘e corza pè avvià,
priparateve esultanti
pecchè avite fà partì ;
pè lu mare ‘nc’è l’inferno
li cancielle songo ardente :
traditure andate in giù,
nun putite arrubbà cchiù !
Sona sona …
A lu muolo senza guerra
se tiraje l’albero ‘nterra
afferraino ‘e giacubbine
‘e facettero ‘na mappina.
E’ fernuta l’eguaglianza,
è fernuta la libertà.
Pè vuie so’ dulure ‘e panza :
signò jateve a cuccà !
Sona sona…
Passaje lu mese chiuvuso,
lu ventuso e l’addiruso ;
a lu mese ca se mete
hanno avuto l’aglio arrete !
Viva Tata Maccarone
ca rispetta la Religgione.
Giacubine jate a mare
mo v’abbrucia lu panaro !
Chant des Sanfédistes
Au son de la grosse caisse
Au son des tambourins
sont ressuscités les petits pauvres
Au son des cloches
Au son des violons
mort aux jacobins.
Joue, joue
joue la Carmagnole
joue les Conseils (sonne le rassemblement)
vivent le roi et la Famille.
Joue, joue
joue la Carmagnole
joue les Conseils (sonne le rassemblement)
vivent le roi et la Famille.
Au fort Saint Elme si fort
ils les ont réduits en ricotta
À ce cornard sans vergogne
ils ont mis la mitre sur la tête.
Majesté qui t’a trahi
qui a eu cet estomac
Les messieurs et les chevaliers
qui voulaient te faire prisonnier.
Refrain
joue la Carmagnole …
Le treize juin
jour du glorieux saint Antoine
les messieurs ces brigands
on leur a fait un cul comme ça.
Les Français sont venus
ils nous ont mis d’autres taxes
Liberté… Égalité…
tu me voles
je te vole.
Refrain
joue la Carmagnole…
Les Français sont arrivés
ils nous ont saigné à blanc
et voilà et voilà
coups de pied au cul à la liberté.
Où est allée Madame Éléonore
qui dansait au théâtre
maintenant elle danse au milieu du marché
avec maître Donato.
Refrain
Sur le pont de la Madeleine
madame Luisa est tombée enceinte
et les trois médecins qui sont venus
n’ont pas pu la faire accoucher.
Où est allée Madame Éléonore
qui dansait au théâtre ?
Maintenant elle danse avec les soldats,
et elle n’a plus pu danser !
Refrain
Les navires sont déjà prêts
courez pour les faire partir
préparez-vous en exultant
parce que vous devez les faire partir ;
sur la mer c’est l’enfer
et ces grilles sont brûlantes :
traîtres allez au fond
vous ne pouvez plus voler !
Refrain
Au Môle après la guerre
on a abattu l’arbre de la liberté
planté par les Jacobins
et on l’a mis en morceaux.
C’est fini l’égalité,
c’est fini la liberté.
Pour vous, c’est les douleurs de ventre :
Messieurs allez vous coucher !
Refrain
Il est passé le mois pluvieux
le mois venteux et le parfumé ;
dans le mois où l’on moissonne
ils ont eu de l’ail dans le cul !
Vive la mère Macaroni
qui respecte la Religion.
Jacobins jetez-vous dans la mer
maintenant le derrière vous brûle !
D’autres chansons furent écrites pendant cette période, par exemple celle qui s’intitule Pe li guaje, e pe le contentizze noste. Selon Valentino Sani, 1799 Napoli. La rivoluzione, Osanna Edizioni, 2013, 262 pages, « L‘Istituto Nazionale – créé pour la diffusion de la cuture par décret du 26 pluviose/14 février sur le modèle de l’Institut National des Arts et des Sciences de Paris – confia en outre à quelques écrivains la charge spécifique de composer des chansons politiques en dialecte pour instruire la plèbe. Les textes devaient être remis aux cantastorie, qui avaient la tâche de les chanter sur les places de Naples. Le plus connu de ces écrivains fut Sergio Fasano, auteur d’une des plus célèbres chansons révolutionnaires de cette époque, Pe li guaie, e pe le contentizze noste » (pp. 86-87). Une autre chanson de Sergio Fasano fut Ngiuriata della Coccovaja de Puorto all’exregina de Napoli qui racontait les amours illicites de la reine. Nous remercions les professeurs Giuseppina Aliperta e Salvatore De Stefano, de Somma Vesuviana, pour leur traduction en italien, que nous avons exceptionnellement reproduite pour sa grande qualité, et à partir de laquelle nous avons refait la traduction française. Nous n’avons jusqu’à présent trouvé aucun enregistrement musical
Pe li guaie, pe le contentizze noste
Che prejezza ‘nzicco ‘nzacco !
E che gioia all’improvviso !
Che fortuna e che contiento !
E’ arrevato lo momento
Della nostra lebertà.
E’ fojuto la Teranno
Messo in fuga s’è, il Tiranno,
La Squaltrina, la Ciantella,
la Sgualdrina, la Ciabatta ;
S’hanno rotta la nocella
Se squagliate ‘mmerità.
Son scomparsi, in verità
Che m’ha fatto ssò Nerone ?
Che ci ha fatto ‘sto Nerone !
Nc’ha arrofluto ; nc’ ha spogliato,
Nsi a lo fango nc’ha rucato
Nc’arrutte ‘mpovertà.
Pe tast’anne nc’ha ‘mbrogliate
Co na zorbia, e co no ditto
Esc’ ha fatto fitto fitto
Nire e affritte addeventà.
Ogne ghiuorno ‘na gabella :
Mè l’argiento è reselato :
L’oro è scarso, e chi l’ha dato
Se lo cagna ha da pagà.
Squaglia Sante, e canneliere
Pe doje vote, e manco è fazin,
En ce dà no scartafazio,
Sciala e scioscia, e bà a cagnà ?
Fà ‘noneta, e la zessonna,
Scipa, a accatta lo contante,
nü a trenta, e a lo cinquanta,
nce vò proprio arrojenà.
Che doje piezze d’archetrave !
La menisto, e la mogliera :
Deno’ ‘mpiso, e na ‘mpechera
Vi che ‘nzierto se po fà !
Essa conta, spacca e pesa,
Chillo approba, e isso azzetta :
E fra li ‘mbruoglie, e fala disdetta
Nce trovammo ‘nzanetà.
La Jostizia sià addormuta :
Io pagate li spiune.
E fra lo regno de Briccone
No nc’ è Legge, e Federtà.
L’ommo justo se matratta
Na lo buono ‘ncremenale :
Co lo sauzo, e senza male,
Lo ‘nnocente ha d’agguantà.
Isso è Ciuccio, e ‘nzallanuto,
Essa è Birba, e Pettosella ;
Nfra la vrasa, e latiella
Stamme frische ‘mmeretà.
Nc’ha pigliate pe Picciune,
Vace a Romma pe la Fede :
comm’ è pazzo ! e chi lo crede,
ncè vo proprio mpapocchià !
Fa la guerra pe no cricco ;
La campagna resta a spasso ;
N’ommo ‘nscritto, non ce laffa,
Non se pò cchiù femmenà.
Nfra sti guaje, nfra sti dolur
Chi nc’ajuta, chi nce sente ?
Li smargiasse, e bona gente,
Nce vnettero a farvà.
Co doje botte, a cauce ‘nculo,
Votta, fuje, se so ‘mmarcate :
Li Franzisi sò aarevate ;
Torna mo : che buò tornà ?
Ma ‘ntratanto, non s’arrenne,
Va ‘n Cecilia, e nc ‘ammenaccia
E per darece la caccia,
Pignatelli ha da retta.
Chisso è l’esca da ka Corte,
No Briccone no masauto,
Gira, vota, e non fa auto,
Che volerce fa scannà.
Spenne, e chiamma li Spiune :
Arma gente, e se ne tuje ;
nfra la morte, affritte nuje
simmo state a parpetà.
E’ scomputa la commeddia ;
li Franzise sò trasute ;
Li malanne sò fenute,
simmo tutte ‘n libertà.
Vi che ghiuorno affortunato ?
Vi quant’ obbreche l’avimmo ?
Ora tutta quanta simmo
‘Nfrotta jammole abbraccià.
Nuje pe chille fimmo vive,
Lo rescatto nc’ hanno dato ;
e chi l’ave commannato
chiatto, e frisco pozza fià.
Pour les malheurs, pour nos joies
Et tout à coup quel bonheur !
Quelle chance et quelle joie !
Le moment de notre liberté
Est arrivé.
Le tyran s’est enfui
la Garce, la Cancanière
la suiveuse et une femme soumise
Ils se sont brisé l’os du cou
Ils ont disparu, ils le méritaient.
Que nous a fait cette espèce de Néron ?
Il nous a fait rôtir, il nous a dépouillés
il nous a même sucé le sang
Il nous a réduits en pauvreté.
Il nous a trompés pendant tant d’années
avec ses discours fumeux et quelque racontar
et bien vite il nous a fait
devenir noirs et affligés.
Chaque jour une gabelle
mais les sous se sont réduits :
l’or est rare et qui nous l’a donné
l’échange pour lui-même, il doit payer.
Il fait fondre les statues de saints et les chandeliers
Au moins deux fois, et il n’est pas encore satisfait
il nous donne un certificat de garantie,
il ne regarde pas à la dépense, dilapide et change.
Il fait de la monnaie puis il la gaspille,
et il achète l’argent liquide
il achète et il vend,
il veut vraiment nous ruiner.
Quelle pièce d’architrave ces deux-là !
Le Ministre et sa Femme :
avec un voyou et une femme escroc
vois quel croisement on peut faire !
Elle compte, brise et pèse,
l’un approuve et l’autre se tait :
et entre les embrouilles et la malchance
Nous nous sommes trouvés sans référence.
La Justice dort :
des espions sont payés,
et dans le règne de la Canaille
Il n’y a ni lois ni fidélité.
L’homme juste on le maltraite
l’homme honnête va en prison :
avec de fausses preuves et sans difficulté,
l’innocent doit être attrapé.
Lui est un Âne retombé dans l’enfance
elle est une suiveuse et une femme soumise :
entre la braise et la poêle
Nous sommes vraiment frais.
Il nous a pris pour des pigeons,
il va à Rome pour la Foi :
qu’il est fou ! et qui le croit
il veut vraiment nous embobiner.
Il fait la guerre par caprice,
la campagne n’est plus cultivée ;
il ne nous laisse même pas un homme,
On ne peut plus semer.
Dans ces malheurs et ces douleurs,
qui nous aide et qui nous écoute
Les fanfarons, et les braves gens,
Sont venus nous sauver.
Avec deux coups de pied dans le cul,
pousse, enfuis-toi, ils s’en sont allés :
les Français sont arrivés ;
reviens maintenant : mais qui veut revenir ?
Mais en attendant il ne se rend pas
il s’en va en Sicile et il nous menace
et pour nous donner la chasse,
Pignatelli doit rester.
Celui-ci est l’appât de la Cour,
un voyou, un personnage important
il tourne, il virevolte, et il ne fait rien d’autre
Que de vouloir nous égorger.
Il dépense et il appelle ses espions ;
il arme les gens, et il s’en retire
dans la mort, nous les affligés,
nous continuons à palpiter.
La Comédie est finie ;
les Français sont revenus ;
c’en est fini des malheurs,
Nous sommes tous en liberté.
Vois-tu quel jour heureux ?
Vois-tu combien d’obligations nous avons envers eux
Maintenant, tous autant que nous sommes,
Nous allons nous embrasser.
Grâce à eux nous sommes vivants,
ils ont payé notre rançon ;
et que celui qui les a commandés
reste en forme et en bonne santé.
Per le disgrazie, per le nostre gioie
Che fortuna e che gioia all’improvviso!
Che fortuna e che contento!
È arrivato, ecco, il momento
Della nostra libertà.
È fuggito il Tiranno
Messo in fuga s’è, il Tiranno,
La Sgualdrina, la Ciarlatana,
La Sgualdrina, la Ciabatta;
Si sono rotte la nocella
Si sono squagliate, meritavano.
Sono scomparsi, in verità
Che ci ha fatto questo Nerone?
Ci ha arrostiti; ci ha spogliati,
Ci ha succhiato fino il sangue
Ci ha ridotti in povertà.
Per tanti anni ci ha imbrogliati
Con la fuffa e qualche detto
E ci ha fatti presto presto
Neri e afflitti diventare.
Ogni giorno una gabella:
Or l’argento è assottigliato,
L’oro è scarso e chi ce l’ha dato,
Se lo cambia, ha da pagar.
Squaglia Santi e candelabri
Per due volte e manco è sazio
E ci dà uno scartafaccio,
Sciala, sciupa e va a cambiar.
Fa’ moneta e poi la spreca,
Rubacchia e compera il contante
Fino al trenta e al cinquanta,
Ci vuol proprio rovinar.
Qual due pezzi d’architrave!
Il Ministro e insiem la moglie:
Da uomo tristo e da imbrogliona
Ve’ che innesto si può fare!
Ella conta, spacca e pesa,
Quello approva e quella accetta:
Tra gli imbrogli e la sventura
Ci troviamo all’ospedale.
La Giustizia sta a dormire:
Son pagati gli spioni,
E dentro il Regno del Briccone
Non c’è legge e fedeltà.
L’uomo giusto si maltratta
L’uomo buono va in prigione:
Con il falso e senza colpa
L’innocente è da arrestar.
Lui è Ciuci e rilbambito,
Lei Pedissequa e Birbona:
Tra la brace e la padella
Siamo freschi in verità!
Ci ha scambiati per piccioni,
Va a Roma per la Fede:
Pazzo lui e chi gli crede?
Ci vuol proprio abbindolare!
Fa la guerra per puntiglio
La campagna resta incolta
Un sol uomo non ci lascia
Non si può più seminar.
Fra tal guai e tal dolori,
Chi ci aiuta, chi ci sente?
Gli spavaldi e brava gente
Vennero loro a ci salvar.
Con due botte, a calci in culo,
Spingi, fuggi, imbarcati:
I Francesi ecco arrivati
Torna mo’! Che tornare! ?
Ma frattanto non si arrende,
Va in Sicilia e ci minaccia
E per darci la caccia,
Pignatelli ha da restare.
Questo è l’esca della Corte
Un briccone, un grande capo,
Gira, volta e non fa altro
Che volerci far scannare.
Spendi e chiama gli spioni;
Arma gente e se ne fugge;
Fra la morte, afflitti noi
Siamo stati a palpitare.
È finita la Commedia;
I Francesi sono entrati;
I malanni son finiti,
Siamo tutti in libertà.
Ve’ che giorno fortunato
Ve’ quant’obblighi con loro
Ora andiamo, quanti siamo,
Tutti in frotta all’abbracciar.
Grazie a questi siamo vivi,
Il riscatto ci hanno dato;
E chi li ha comandati
Possa star prospero e fresco.
Remarquons la référence à Néron, trace de l’ancienne légende (réalité ?) du passage de l’empereur venu chanter à Naples. Remarquez tous les noms donnés au Roi, à la Reine et au Ministre pour les déconsidérer aux yeux du peuple. Pignatelli fut un prince, ministre de la monarchie.Résumons : cet épisode fut l’un de ceux qui marquèrent cette longue période de transition entre deux structures sociales, le féodalisme monarchiste et la bourgeoisie capitaliste ; cette période dura en Italie de l’empire napoléonien à l’Unité de 1861, on l’appela le « Risorgimento »

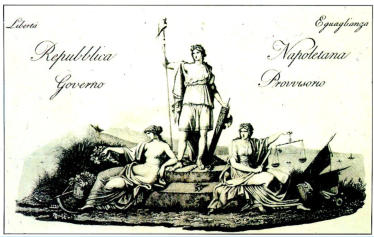
En effet, le jacobinisme ne fut pas seulement un fait napolitain, le mouvement jacobin se développa partout en Italie à partir de 1793, plus encore que dans le reste de l’Europe, aidé aussi par la présence de l’armée française. Nous avons parlé de Carlo Lauberg, qui traduit en 1793 la Constitution montagnarde française, provoquant une dure répression de la part du roi Bourbon ; deux sociétés furent créées à la suite, le ROMO (« Repubblica o morte ») et le LOMO (« Libertà o morte »), toutes deux réprimées ; la Ligurie fut un autre centre de développement du jacobinisme insurrectionnel italien.
Mais à partir de 1796 et de l’entrée de Napoléon à Milan, commence ce qu’on appelle le « triennio giacobino ou repubblicano », où les jacobins tentèrent d’exercer le pouvoir institutionnel, et de former le peuple en diffusant des centaines de journaux et de catéchismes révolutionnaires. Citons en particulier la République romaine de 1798 et la république napolitaine de 1799.
Or ces républiques suscitèrent toutes une forte opposition des peuples ignorants dirigés par des gouvernements réactionnaires et cléricaux, et les « républiques sœurs » furent toutes liquidées, jusqu’au retour de Napoléon en 1800, qui intégrera souvent dans les administrations d’anciens jacobins exilés en France, dont certains devinrent aussi hostiles à l’occupation française de l’Italie par Napoléon, ce qui ne sera pas sans alimenter au XIXe siècle les idéologies indépendantistes. Ce fut le cas de la Società dei Raggi, société secrète maçonnique née à Bologne et à l’origine de la conspiration piémontaise contre l’annexion à la France en 1799.
Ce mouvement jacobin, – constitué essentiellement d’une minorité de bourgeois (avocats, médecins, militaires, intellectuels, étudiants, artisans aisés), d’une partie minoritaire du clergé, et de quelques aristocrates éclairés, de qualité européenne mais isolés dans leur patrie – suscita la réaction radicale de l’Église, des monarchistes, qui entraînaient une grande partie des paysans et du petit peuple des villes.
C’est ce qui provoqua les nombreuses révoltes comme celle des Sanfedisti à Naples, par exemple les « Pasque veronesi » du 17 au 25 avril 1797 contre les troupes françaises (souvent composées de Polonais !), et où les Français furent assassinés en grand nombre ; elles sont toujours célébrées aujourd’hui par les Véronais, suscitant de nombreuses polémiques alimentées encore aujourd’hui surtout par les courants réactionnaires de la Ligue et des forces catholiques qui veulent faire croire à partir de là à une population véronaise toute catholique et monarchiste.
Ce fut un phénomène complexe alimenté aussi par le poids des réquisitions de l’armée française, et l’attachement du petit peuple paysan et urbain à l’Église et au pape. (Voir Anne-Maria Rao (sous la direction de), Foules contre-révolutionnaires. Les insurrections populaires dans l’Italie jacobine et napoléonienne, in Annales historiques de la Révolution française, n° 326, 2001 pp. 189-192).
Enrico De Angelis nous signale que deux chansons populaires véronaises se réfèrent sans doute aux Pasque veronesi, la première est Quando i Francesi se l’à vista bella, la seconde Napoleone in Italia, qui fait plus probablement allusion à la période napoléonienne. Elles sont citées par Ettore Scipione Righi (1833-1894) dans Il canto popolare veronese, a cura di Silvana Zanolli e Alessandro Nobis, Cierre Edizioni, Verona, 2011 :
Quando i Francesi se l’à vista bella
Quando i Francesi se l’à vista bela
Chi i vegnu a spassezar la Valpolisela
E per no saver la via dei monti
I à preso par guida un tal Giacomino Conti.
E questo e li à condoti a Pianaura
E là i gh’à udo una gran paura,
Scominzia un paesan a strepitar
– E’ quà i francesi i ne vol sachegiar. –
Presto toca la campana,
che i vaga a Verona o a Sant’Anna. –
Quando el paesan l’à sentì i primi boti
Come i spianzisi i è saltadi ai s-ciopi.
E i s’à posto ai sò fortini
E i l’à fati scapar zo par quei slavini.
I è passè zo dai Corazoni
I à portà via o cuciari a ancai pironi.
Iè passè zo dai Carneri
I à fati saltar zo da quei sentieri
Alora lori se l’à vistà poco bona,
I à preso la strada de Verona.
I è andè denanzi al so general ;
« Selenza, l’em passada mal ». –
è passadi da Condevigo
i à robà che no vedigo ;
I à robà tuti quanti i santuari,
I à fato scapar tuti quanti i missionari,
Ge passadi su a Corfù,
I ghea bessi e roba infin che in n’à vossù.
Ge gà trato insieme ancala Sciaonìa,
Ci gà le brespe al cul se la para ia.
Arsi arsi come lora,
I magna, beve ogni ora ;
Questi i è pozzi senza fondo,
Che i destruge tuto el mondo.
E poi no gh’ò lingua sufficiente
Da dir su de tuta questa gente.
Terminiamo sto discorso
E andemo a ca’ de l’orso.
Quand les Français ont pensé qu’ils pourraient réussir
Quand les Français ont pensé qu’ils pourraient réussir
ils sont venus se balader en Valpolicella
et ne connaissant pas la route des montagnes
Ils ont pris pour guide un certain Giacomino Conti.
Et celui-ci les a conduits à Pianaura
et là ils ont eu une grande peur,
un habitant commence à hurler
‘Les Français sont là, et ils veulent nous saccager’.
Vite la cloche sonne,
qu’ils aillent à Vérone ou à Sant’Anna.
Quand les habitants ont entendu les premiers coups
ils ont vite sauté sur leurs fusils.
Et ils se sont mis en place sur leurs fortins
Et ils les ont fait fuir en-bas de ces éboulis.
ils sont passés au pied de chez les Corazoni
Et ils ont emporté les cuillères et même les couteaux.
Ils sont passés au pied de chez les Carneri
ils les ont fait descendre de ces sentiers
Alors ils ont vu que ça allait mal,
Ils ont pris la route de Vérone.
Ils sont allés devant leur général
« Excellence, ça s’est mal passé ».
Ils sont passés par Codevigo
ils ont volé, je ne vous dis pas ;
ils ont dévalisé tous les sanctuaires,
ils ont fait fuir tous les missionnaires,
ils sont remontés sur Corfou,
Ils ont eu des sous et des biens tant qu’ils en ont voulu.
Ils les ont même emportés en Slavonie,
Ils ont les guêpes au cul, ils les chassent
aussi avides qu’un entonnoir,
ils mangent et boivent tout le temps ;
Ce sont des puits sans fond,
qui détruisent le monde entier.
Et puis je n’ai pas assez de mots
Pour tout dire sur ces gens
Terminons ce discours
Et allons à la maison de l’ours.
Suivant les indications de Marialuisa Vianello, Corazoni et Carneri sont les noms de familles riches pillées par les Français,
Condevigo est le village de Codevigo, aujourd’hui dans la province de Padoue, Corfou est l’île grecque occupée par Napoléon après le Traité de Campoformio (1797),
si nuisible à Venise, et la Slavonia (la Sciaonia en vénitien) est une partie de la Croatie actuelle.
« Aller à la maison de l’ours » signifie « Allons débusquer l’ours », c’est-à-dire chasser les Français,
objectif des Pâques véronaises.
On peut citer aussi la révolte appelée « Viva Maria » en Toscane (Arezzo) en avril-mai 1799,
révolte de la faim qui prend d’autant plus une dimension religieuse qu’elle se double d’une apparition de la Vierge et d’une éclipse de soleil
(Voir sur internet : Viva Maria).
Ici encore il faut insister sur l’ambiguïté du phénomène, à la fois réaction populaire qui défend sa foi religieuse et son autonomie territoriale
contre une armée française qui veut tirer de l’argent des terres conquises et des habitants, et une expression d’idéologie réactionnaire dressée par l’Église
contre les idéaux de la Révolution française et menée par des prêtres qui défendent leur situation dominante et parfois non dépourvus d’un antisémitisme
que la critique catholique efface généralement.
Tous ces épisodes sont à resituer dans le grand mouvement qui, à partir de la révolution française de 1789,
mettra en place peu à peu la nouvelle société bourgeoise de masse capitaliste, puis impérialiste, société industrielle qui se transforme à nouveau aujourd’hui.
L’Italie du XIXe siècle réalisera elle aussi sa nouvelle société bourgeoise.
La chanson ne doit pas être considérée simplement comme une représentation de la misère causée par la guerre, la peste et l’exploitation par les pouvoirs économiques et politiques,
comme l’ont souvent montrée les romantiques. Elle est plus profondément une vision globale de la vie, de la société, lamentation sur ses misères, c’est vrai,
mais aussi récit de son histoire concrète, de ses rythmes, de ses fêtes, de ses danses, de ses joies, de ses sentiments.
C’est en ce sens qu’elle nous est proche et que nous y sommes le plus sensible.
Elle exprime une authentique culture, que veut effacer la culture dominante de notre société commerciale mondialisée.
Nous devons donc continuer à l’écouter et à la défendre, c’est un élément de notre « identité ».
Non pas pour l’imiter, on ne revient pas en arrière, mais pour pouvoir créer une société qui soit aussi celle du « peuple ».
Voir sur ce site nos autres textes sur la chanson, en particulier le livre Le Pouvoir du chant. Petit tour en chanson des régions d’Italie, 1968-2018.
Notes
- Frédéric Antal, Florentine painting and its social background. The bourgeois republic before Cosimo de’ Medici advent to power: XIV and early XV century, Londres, Kegan Paul, 1947. Trad. française : Florence et ses peintres : la peinture florentine et son environnement social, 1300-1450, Brionne : G. Monfort, 1991. Trad. italienne : La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo Quattrocento, Einaudi, 1960, 2ᵃ edizione, 1969, 544 pages.
- Fernand Braudel, Le modèle italien, Arthaud, 1980, repris par Flammarion, 2008.
- Voir l’ouvrage récent de Philip Blom, Il primo inverno, la piccola era glaciale e l’inizio della modernità, Feltrinelli, 2019, traduzione di Francesco Peri, 286 pages.
- Lire le beau roman de Tahar Ben Jelloun, L’auberge des pauvres, Seuil, 1998.
- Voir l’ouvrage de Rosario Villari, Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero, 1585-1648, Mondadori, 2012, et auparavant, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647), Bari, 1967. Masaniello reste un grand héros populaire napolitain, chanté par de nombreuses œuvres de théâtre, d’opéra et de chanson, dont l’œuvre de Daniel Auber, La Muette de Portici (1828), dont le personnage de Masaniello contribua au déclenchement de la révolution de 1830 en Belgique.
- Voir par exemple Augusto Tocci - Alex Revelli - Susanna Cutini, Taccuinum rinascimentale - Itinerario di trionfi gastronomici, Alieno Editrice, 2005, un beau travail sur la cuisine et les cuisiniers de la Renaissance. Voir aussi Alberto Capatti, Massimo Montanari, La cucina italiana, storia di una cultura, Laterza, 1999, 408 pages. Traduction française d’Anna Colao : La cuisine italienne, histoire d’une culture, Préface de Jacques Le Goff, Éditions du Seuil, 2002, 428 pages.