VENEZIA - Venise
ANNECDOTE : Nouvelle de Venise
Depuis quelque temps, Venise a un quatrième pont conçu par l’architecte Santiago Calatrava sur le Grand Canal. Une belle œuvre, mais qui n’a oublié qu’une chose, respecter la loi sur les handicapés et les personnes en difficulté physique qui impose de prévoir un passage spécifique. Celui-ci a été « oublié ». Après enquête, le juge a malgré tout absous l’architecte et les responsables des travaux. On a donc installé un ascenseur sous la forme d’un œuf rouge en plexiglass destiné aux handicapés. Celui-ci ne sert pratiquement jamais. Il a cependant coûté 2 millions d’euros !
Le 24 mai dernier, la presse a annoncé qu’un couple de touristes américains a dû utiliser l’œuf ; il est resté prisonnier dedans, l’œuf s’étant bloqué, et ils ont été libérés par les spécialistes de service, après être restés quelques minutes prisonniers du verre sous un soleil aveuglant et dans une chaleur insupportable. Ils n’ont pas protesté mais ont trouvé que Venise avait un fonctionnement particulier ! La Cour des Comptes jette depuis quelque temps un œil critique sur le coût de l’opération.
Sommaire :
Îles en sel
Cet article évoque la présence du sel dans l’histoire de Venise, à travers une exposition préparée par une classe d’élèves d’un Lycée vénitien ; il s’agit aussi du sel de cinq îles de la Lagune, d’où le titre : Îles en sel. Il rappelle également l’art italien des “infiorate”, les tapis de pétales qui ornaient les avenues lors des grandes processione dès le XVIe siècle : ancien art éphémère !
Isole in sale
Un romanzo pubblicato trent’anni fa dallo scrittore veneziano Enrico Palandri si intitolava Le pietre e il sale : il titolo sembrava voler attirare l’attenzione sugli elementi inorganici o cristallizzati più che sulla materia vivente di Venezia. E il turista che la visita frettolosamente in genere non conserva nella memoria gli innumerevoli giardini, alcuni visibili molti nascosti, ma le forme sinuose del gotico fiorito che animano le bifore e le trifore dei palazzi in pietra d’Istria e la salsedine che ne erode inesorabilmente i muri e le fondamenta. Questa non è una premessa all’ennesima variazione sull’interminabile morte di Venezia : il sale che corrode e costringe a continui interventi di manutenzione, il sale che i Romani sparsero su Cartagine affinché non vi crescesse più un filo d’erba è stato per Venezia, come il mare in cui è disciolto e la minaccia periodicamente con il suo abbraccio mortale, fonte di vita e sostentamento. Grazie alla continua mescolanza con l’acqua più salata del mare la laguna può rigenerarsi e purificarsi. Il sale conservava i cibi dalla putrefazione e i marinai potevano affrontare lunghi viaggi senza morir di fame. Estratto dalle saline di Cannaregio, Dorsoduro, Sant’Erasmo, Murano, Torcello, Pellestrina, Chioggia, fu la prima merce di scambio, la moneta usata dagli abitanti delle lagune e al sale sembra si debba lo stesso toponimo fondamenta: fondamentum salinarum era “un complesso unitario di saline” [“Il sale a Venezia”, Archeovenezia, n. 1-2 giugno 2006]. La magistratura al Sal era una delle più importanti della Serenissima e per garantirsi il monopolio della produzione e del commercio dell’oro bianco i veneziani affrontarono guerre lunghe ed estenuanti. Se una scuola veneziana che intende trapiantare in Laguna una forma d’arte radicata in altre tradizioni culturali usando materiali autoctoni sceglie di sostituire i fiori con il sale, questa non può che apparire una scelta felice. La scuola è secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Francesco Morosini di Venezia, il progetto che sta portando a compimento è intitolato Isole in sale. All’origine, la mente visionaria di un’artista dalla vita avventurosa, Lucia Spampinato. Nata in uno dei luoghi più propizi alle visioni, la barocchissima Noto, cresciuta a Pachino e diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ha lavorato per il cinema e per il teatro facendo contemporaneamente una brillante carriera di restauratrice: è intervenuta, fra l’altro, sugli affreschi della Scuola Grande della Misericordia. Fra le sue molte passioni c’è anche l’insegnamento, in cui ha deciso alla fine di convogliare i suoi talenti e la sua forza creatrice. Professoressa di “Arte e immagine” nella scuola media dell’Istituto Comprensivo, ha voluto coinvolgere gli allievi “in un’esperienza forte”, in cui potessero realizzare “qualcosa di pratico e bello per la propria città”, per capire che Venezia non va sfruttata commercialmente, consumata, ma salvaguardata senza secondi fini, all’insegna della gratuità. Delle varie esperienze artistiche da proporre, quale la più gratuita, la meno invasiva, la più effimera in senso buono, cioè nel senso che si crea con fatica ed impegno la bellezza, assaporandola e poi lasciandola svanire naturalmente senza rimpianti? Si potrebbe pensare alle sculture di sabbia o di neve, ai disegni dei madonnari, ai mandala buddisti o anche a certe forme di street art, se non fosse che queste ultime non svaniscono rapidamente. Ma Lucia è membro del gruppo Opificio 4 di Noto (presieduto da Giampaolo Leone), collegato all’ Associazione Internazionale delle arti effimere, e l’arte effimera più praticata dal gruppo è quella dell’Infiorata, nella quale si realizzano con i petali dei fiori quadri che fanno da tappeto a processioni o altre manifestazioni. La prima venne fatta a Roma il 29 giugno 1625 in occasione della festa di S. Pietro e Paolo, poi anche Gian Lorenzo Bernini si occupò dell’allestimento di alcune infiorate e probabilmente fu lui a diffonderne la pratica nei Castelli romani, in particolare a Genzano, dove dalla fine del Settecento si realizzano in occasione della processione del Corpus Domini. Nel corso del tempo la tradizione si è propagata in molte altre città italiane e anche straniere; 37 anni fa un giovane di Noto ammirò l’Infiorata di Genzano e la trapiantò nella sua città. I petali dell’Infiorata sono come tessere di un mosaico, quindi a Venezia, segnata dall’impronta bizantina, questa tecnica di composizione sembra familiare, tanto più se il mosaico è composto da cristalli di sale. Le classi di Lucia seguono l’indirizzo artistico e sono coinvolte nel progetto pilota “Crescere con arte” ideato dalla professoressa Anna Gigoli. Sottoposto all’approvazione del Collegio dei docenti, del Dirigente scolastico Roberto Baretton e dell’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Paola Mar, il progetto Isole in sale ha quindi incontrato un consenso unanime ed entusiasta. Il tema riguarda le cinque isole maggiori della laguna : Murano, Burano, San Lazzaro degli Armeni, Sant’Erasmo, Torcello. In collaborazione con la Polisportiva Venexiana di Gloria Rogliani, campionessa di voga e profonda conoscitrice dell’ecosistema lagunare, gli allievi hanno percorso le isole in dragon boat e in vaporetto e hanno acquisito conoscenze storiche e geografiche su quell’ambiente. I ragazzi delle seconde hanno scattato fotografie a cui si sono ispirati i compagni di terza per tracciare su cartoncino i disegni che sono stati trasferiti su cinque pannelli rettangolari, riempiti poi con il sale colorato dai ragazzi assieme ai maestri di Opificio 4 e disposti a raggiera ; ogni pannello rappresenta un’isola, mentre nel sesto pannello circolare al centro della raggiera è raffigurata l’allegoria di Venezia che ha in mano il logo Unicef (l’Istituto Morosini è una delle poche scuole italiane ambasciatrici UNICEF). I pannelli occuperanno la pavimentazione di Campo San Geremia dal 29 maggio all’8 giugno. In una sorta d’esperienza di arte totale, l’esposizione dei pannelli in campo sarà accompagnata da un concerto dell’orchestra d’archi dell’Accademia di Musica G. Verdi (musiche di Galuppi e di altri autori veneziani) e da un breve spettacolo teatrale dell’Associazione Arte-Mide sul merletto di Burano (progetto promosso dalla Regione Veneto e dall’Unesco). Poi i cristalli di sale spariranno dal Campo; potrebbero essere spazzati via come un mandala che alluda alla caducità delle cose e alla loro rinascita (essendo la distruzione necessaria alla creazione di nuova vita) e che educhi a vivere l’istante intensamente. Ma Lucia spera che ogni pannello possa tornare all’isola da cui proviene, e lì restare. È inevitabile il rimando all’opera del grande poeta veneziano Ugo Foscolo, che volendo rilanciare il messaggio di vita dei classici, del trionfo della creazione sulla distruzione, alternò nella sua scrittura simboli di fecondità legati all’acqua e simboli di morte connessi all’aridità, mostrando anche la duplicità di ogni simbolo. In A Zacinto, le sacre sponde dell’isola evocavano una parola latina, sponda, che poteva significare anche bara ; il corpo che vi giacque fanciulletto, come il corpus latino, alludeva anche al cadavere; l’Itaca a cui era tornato Ulisse era “petrosa”… come la Venezia di Le pietre e il sale. Dopo la sepoltura del poeta in terra straniera, il suo canto sarebbe tuttavia tornato alla terra materna, la sua arte, effimera o capace di permanere nella memoria umana, sarebbe stata comunque fonte di nuova vita.
Îles en sel
Un roman publié il y a trente ans par l’écrivain vénitien Enrico Palandri s’intitulait Les pierres et le sel : ce titre semblait vouloir attirer l’attention sur les éléments inorganiques et cristallisés plutôt que sur la matière vivante de Venise. Et en général le touriste qui la visite en vitesse ne garde pas en mémoire ses innombrables jardins, certains visibles beaucoup d’autres cachés, mais les formes sinueuses du gothique fleuri qui animent les fenêtres jumelées et trilobées des palais en pierre d’Istrie, et les traces de sel qui en usent inexorablement les murs et les fondations. Celle-ci n’est pas une prémisse à l’énième variation sur la mort sans fin de Venise : le sel qui érode et oblige à des interventions continues d’entretien, le sel que les Romains répandirent sur Carthage pour que n’ y pousse plus un brin d’herbe a été pour Venise, comme la mer dans laquelle il est dissous et qui la menace de temps à autre par son étreinte mortelle, une source de vie et de subsistance. En se mélangeant à l’eau plus salée de la mer, la lagune peut se régénérer et se purifier. Le sel préservait les aliments de la putréfaction et les marins pouvaient aborder de longs voyages sans mourir de faim. Extrait des salines de Cannaregio, Dorsoduro, Sant’Erasmo, Murano, Torcello, Pellestrina, Chioggia, il a été la première monnaie d’échange utilisée par les habitants des lagunes et le toponyme de fondamenta semble être dû au sel : fondamentum salinarum était « » (Le sel à Venise, « Archeovenezia », n.1-2 juin 2006). La magistratura al sal était une des plus importantes de la Serenissima et pour s’assurer le monopole de la production et du commerce de « l’or blanc » les vénitiens ont soutenu des guerres longues et épuisantes. Si une école vénitienne qui souhaite transplanter dans la Lagune une forme d’art enracinée dans d’autres traditions culturelles en utilisant des matériaux autochtones choisit de remplacer les fleurs par le sel, ce choix ne peut que paraître heureux. L’école en question est le Lycée de l’Etablissement Francesco Morosini, le projet qu’elle est en train de réaliser s’intitule Iles en sel. A l’origine, l’esprit visionnaire d’une artiste à la vie aventureuse, Lucia Spampinato. Née dans un des lieux les plus propices aux visions, la ville sicilienne hyper baroque de Noto, grandie à Pachino et diplômée à l’Académie des Beaux Arts de Venise, elle a travaillé pour le cinéma et le théâtre, en suivant en même temps une brillante carrière de restauratrice : elle est intervenue, entre autres, sur les fresques de la Scuola Grande della Misericordia. Parmi ses passions multiples il y a également l’enseignement, où elle a décidé enfin de canaliser ses talents et sa force créatrice. Professeur d’ « Art et image » au lycée, elle a voulu impliquer les élèves « dans une expérience forte », par laquelle ils puissent « réaliser quelque chose de pratique et de beau pour leur ville », pour comprendre que Venise ne doit pas être exploitée commercialement, consommée, mais sauvegardée sans arrière-pensées, d’une manière désintéressée. Parmi les diverses expériences artistiques qu’elle aurait pu proposer, quelle était la plus gratuite, la moins envahissante, la plus éphémère dans le bon sens, à savoir dans le sens que l’on crée avec fatigue et application la beauté, qu’on la savoure et puis qu’on la laisse s’évanouir naturellement sans regret ? On pourrait penser aux sculptures de sable ou de neige, aux dessins des Madonnari, aux mandalas bouddhistes ou également à certaines formes de Street Art, sauf que celles-ci ne disparaissent pas vite. Mais Lucia est un membre du groupe Opificio 4 de Noto (présidé par Giampaolo Leone), lié à l’Association Internationale des Arts Ephémères, et l’art éphémère le plus pratiqué par le groupe est celui de l’ Infiorata (tapis de fleurs), dans lequel on réalise, avec les pétales des fleurs, des tableaux qui servent de tapis à des processions ou à d’autres manifestations. Le premier a été organisé à Rome le 29 juin 1625 lors de la fête des Saints Pierre et Paul, puis Gian Lorenzo Bernini lui-même a pris soin de préparer quelques infiorate et c’est sans doute lui qui en a diffusé la pratique dans les Castelli romani, notamment à Genzano, où on les met en place, depuis le XVIII siècle, pour la procession du Corpus Domini. Au fil du temps la tradition s’est répandue dans beaucoup d’autres villes italiennes et même étrangères ; il y a 37 ans, un jeune de Noto a admiré l’ Infiorata de Genzano et il l’a transplantée dans sa ville.Les pétales de l’ Infiorata ressemblent aux pièces d’une mosaïque, c’est pourquoi à Venise, marquée par l’empreinte byzantine, cette technique de composition a un air familier, d’autant plus si la mosaïque est composée de cristaux de sel. Les classes de Lucia suivent la filière artistique et sont investies dans le projet pilote « Grandir avec art » conçu par l’enseignante Anna Gigoli. Soumis à l’approbation du Conseil des enseignants, du Proviseur Roberto Baretton et de l’adjoint au Maire pour le Sport, le Tourisme et le Spectacle Paola Mar, le projet Iles en sel a donc rencontré un consensus unanime et enthousiaste. Son sujet concerne les cinq plus grandes îles de la lagune : Murano, Burano, San Lazzaro degli Armeni, Sant’Erasmo, Torcello. En collaboration avec la Polisportiva Venexiana de Gloria Rogliani, championne d’aviron qui connaît profondément l’écosystème lagunaire, les élèves ont parcouru les îles en dragon boat et en vaporetto et ont acquis des connaissances historiques et géographiques de cet environnement. Les jeunes de seconde ont pris des photos dont leurs camarades de première se sont inspirés pour tracer des dessins qui ont été transférés sur cinq panneaux rectangulaire, remplis ensuite de sel coloré par les garçons et le filles avec les maîtres de Opificio 4 et disposés en étoile ; chaque panneau représente une île, tandis que dans le sixième panneau au milieu de l’étoile il y a l’allégorie de Venise tenant dans sa main le logo UNICEF (L’Etablissement Morosini est l’une des quelques écoles italiennes ambassadrices de l’UNICEF). Les panneaux vont occuper le sol de Campo San Geremia du 28 mai jusqu’au 8 juin. Dans une sorte d’expérience d’art total, l’exposition des panneaux sur la place sera accompagnée d’un concert de l’orchestre à cordes de l’Académie de Musique G. Verdi (musiques de Galuppi et d’autres auteurs vénitiens) et d’un bref spectacle théâtral de l’Association Arte-Mide sur la dentelle de Burano (projet promu par la région Vénétie et par l’UNESCO. Puis les cristaux de sel disparaîtront de la place ; ils pourraient être balayés comme un mandala qui évoque la caducité des choses et leur renaissance (la destruction étant nécessaire à la création d’une nouvelle vie) et qui éduque à vivre l’instant intensément. Cependant Lucia espère que chaque panneau puisse revenir à l’île d’où il provient, et y rester. Il est inévitable de renvoyer à l’œuvre du grand poète vénitien Ugo Foscolo, qui voulant relancer le message de vie des classiques, du triomphe de la création sur le destruction, a alterné dans son écriture des symboles de fécondité liés à l’eau avec des symboles de mort liés à l’aridité, montrant également la duplicité de chaque symbole. Dans A Zacinto, les côtes sacrées de l’île évoquaient un mot latin, sponda, qui pouvait signifier aussi cercueil ; le corps qui y avait été couché étant enfant évoquait, comme le corpus latin, également le cadavre ; l’Ithaque où Ulysse était revenu était rocailleuse… comme la Venise de Le pietre e il sale. Après l’enterrement du poète en terre étrangère, son art, éphémère ou capable de rester dans la mémoire humaine, serait pourtant une source de nouvelle vie.
[Texte et traduction : Marialuisa Vianello]

Le Maire de Venise interdit une exposition de photos contre les grands paquebots dans la lagune
Le photographe vénitien Gianni Berengo Gardin avait prévu d’organiser au Palais Ducal à partir du 18 septembre une exposition de 27 photographies en noir et blanc contre le passage à Venise des grands paquebots, que dénoncent les comités vénitiens regroupés sous le nom de NoGrandiNavi. Le Maire de Venise, Luigi Brugnaro (centre-droit) a décidé d’interdire cette exposition.
Elle s’est donc réinstallée dans le « magasin Olivetti » de la Place Saint Marc jusqu’au 6 janvier prochain. C’est le FAI (Fondo Ambiente Italiano - Fond Italien pour l’Environnement) qui a repris l’initiative de cette exposition, réalisée par Alessandro Mauro et inaugurée le 22 octobre dernier. C’est le FAI qui gère à Venise le « magasin Olivetti » de la Place Saint Marc.
Le président du FAI, Andrea Carandini a déclaré : « Les grands navires à Venise sont le symptôme d’une maladie qui touche aussi d’autres villes italiennes, mais Venise est la plus fragile ; le tourisme de masse est en train d’emporter les villes d’art. J’ai lancé un appel au ministre Franceschini (ministre des Biens Culturels) et au président Renzi pour qu’ils interviennent au plus vite pour réglementer un flux désormais hors de tout contrôle ».
La fondatrice du FAI, Giulia Maria Crespi a fait l’éloge des militants des centres sociaux vénitiens pour leur activité, et le photographe a dit avec humour : « Je regrette toujours que quelqu’un se donne un coup de bêche sur le pied. Je regrette donc aussi pour le Maire de Venise. Mais je lui suis très reconnaissant parce que, en bloquant mon exposition au Palais Ducal, il m’a rendu un grand service : tous les journaux italiens et étrangers (Le Monde, le Guardian, El Pais, New York Times et beaucoup d’autres) en ont parlé abondamment. Il est probable que, s’il n’y avait pas eu toute cette attention de la part de la presse, l’exposition aurait été vue par beaucoup moins de personnes. J’étais troublé surtout par la pollution visuelle. Voir ma Venise détruite dans de telles proportions et transformée en un jouet, un de ces clones en carton-pâte comme à Las Vegas, me troublait profondément ».
Le professeur Carandini a aussi déclaré : « J’ai cherché le maire ces derniers jours pour instaurer un dialogue, mais il l’a refusé ».
Luigi Brugnaro a justifié son interdiction en prétextant qu’il voulait jumeler l’exposition à celle de son projet de creuser le canal Victo-Emmanuel qui permettrait aux navires de croisière de passer dans la lagune sans s’approcher de la Place Saint Marc. « Ainsi – a déclaré le président du FAI – on propose des creusements de canaux qui sont délétères, pour maintenir ces monstres à l’intérieur de la lagune, au lieu de les placer hors de la lagune, comme nous le proposons. Cela ferait perdre au port le monopole qu’il a actuellement et il devrait faire alors des adjudications à d’autres organismes ».
Voilà un nouvel épisode de la lutte des Italiens contre le passage des grands navires dans la lagune et à proximité de Saint Marc, ce qui ne rapporte rien aux Vénitiens car ainsi les voyageurs peuvent photographier la basilique sans descendre de leur bateau. Mais qui cherche à entraver cette lutte ? Le maire de la ville. Et pour de simples raisons d’argent.
(Vous trouverez une dizaine de photos de cet événement dans Il Fatto Quotidiano du 23 octobre, d’où sont tirées ces informations).
Jean Guichard, 23 octobre 2015
Éléments d’histoire de Venise par Annie Chikhi
Si vous souhaitez plus d’informations sur l’histoire de Venise, lisez le Cahier de Jean Guichard, Pour mieux comprendre Venise, son histoire, son art (ce que vous ne savez pas toujours quand vous n’allez à Venise qu’en « touriste » …), Éditions de l’INIS, mai 2012.
(Conférence d’Annie Chikhi, à La Tour prend garde, le 9 octobre 2014)
Jean d'Ormesson : « Venise, la ville où les lions ont des ailes et où les pigeons marchent »
Venise venait de s'installer définitivement « dans ses murs » en 811, elle avait besoin de légitimité. À cette époque Venise voulait surtout rivaliser avec la papauté qui avait le corps de St Pierre, il était donc important d'avoir SA relique à elle, presque aussi prestigieuse que Pierre, le 2° évangéliste, l'ami de Pierre, Marc.
Quelle aubaine donc que ce corps volé à Alexandrie en 828 par deux marchands vénitiens qui le ramènent à Venise en le cachant dans une corbeille pleine de morceaux de porc pour éviter que les musulmans n'y touchent ! Marc était donc tout trouvé puisqu'il était venu au 1° siècle, évangéliser les Vénètes, avait fait naufrage dans l'Adriatique et sa barque avait échoué à l'embouchure de la Brenta. L'ange lui était apparu et lui avait dit que la paix soit avec toi, Marc mon évangéliste et il avait même ajouté : ton corps reposera ici. « pax tibi Marce evangelista meus »
C'est cette phrase qui est inscrite sur l'Évangile que le lion tient sous la patte. Venise plantera ce lion partout dans la Méditerranée pour marquer sa domination. Le symbole de l'évangéliste étant le lion, il est devenu celui de Venise. St Marc, le lion et Venise deviennent indissociables. Quand Venise était en guerre, le livre était fermé et le lion tenait une épée.
Le lion ailé de la place St Marc au sommet de sa colonne, c'est une chimère plus qu'un lion, on pense qu'il a été ramené d'Anatolie, lors de la 1° croisade (1095) depuis il a toujours été installé sur sa colonne, sauf en 1797 Bonaparte le ramène à Paris avec les 4 chevaux de la cathédrale.
Ouvrons ici la parenthèse Napoléon.
Ces 4 chevaux en cuivre pur et non en bronze forment un quadrige qui ornait l'hippodrome de Constantinople. Ils datent du IV° siècle avant JC (technique de datation moderne) et auraient été offerts à Néron pour décorer sa statue colossale à Rome, ramenés de Rome par Constantin pour décorer sa nouvelle capitale de l'empire d'Orient, jusqu'à ce que les croisés en 1204, pillent totalement l'hippodrome qui n'était plus que ruine. Pourtant la ville était chrétienne… !
Mais on était Vénitien d'abord, chrétien ensuite, c'était le cri de guerre. On n'avait pas peur de voler, mais on en avait honte : on a gardé les chevaux cachés pendant 50 ans car Venise (E. Dandolo - 4° croisade) avait honte d'avoir demandé à des Chrétiens d'agresser des Chrétiens, mais les croisés devaient payer leurs dettes… Bien avant les Ottomans en 1453 ce sont les Vénitiens qui ont mis à sac Constantinople.
Quand enfin on ose sortir les chevaux, ils sont exposés au-dessus du portail de S. Marc nouvellement terminé, comme symbolisant les 4 évangélistes, alors que chacun sait que ces symboles sont le lion, l'ange, le bœuf et l'aigle.
Mais les Vénitiens en veulent toujours à Napoléon de les avoir humiliés en détruisant le symbole de leur puissance, il n'a fait que confirmer une vérité : Venise vivait sur sa réputation depuis 2 siècles, elle n'avait plus de flotte, elle ne vendait plus rien, ne produisait plus de richesse, elle était minée de l'intérieur par la corruption et les mœurs ramollies ; elle s'est écroulée sur elle-même sans livrer bataille (Ludovico Manin : 120° et dernier doge). Mais c'est plus flatteur d'accuser les autres, Napoléon en l'occurrence !
Il reste que c’est Bonaparte qui a détruit à jamais la République de Venise pour s’en emparer … avant de la remettre « diplomatiquement » aux Autrichiens !
Certes Napoléon a emmené les chevaux à Paris, mais il n'a pas fait que du mal à Venise :
- il en fait un port franc pour relancer l'économie – sens des affaires.
- il créé les jardins de Castello, et transfère le cimetière sur S. Michele – salubrité.
- il ferme la place S. Marc pour l'harmoniser avec les procuraties – grands travaux.
- il créé le musée des beaux arts : l'Accademia dont Venise est si fière – culture.
- il ouvre le ghetto en enlevant symboliquement les portes et les chaînes – humanité, liberté.
Mais tout cela les Vénitiens ne veulent pas s'en souvenir ! Cela se comprend, c’était fait non pas pour Venise mais pour la mieux adapter à la domination française.
La meilleure preuve : en 2003, une statue en marbre commandée en 1811 par des commerçants pour remercier de la création du port franc est retrouvée chez Sotheby's à New York. Le comité français pour la sauvegarde de Venise l'achète pour la remettre à sa place originale : scandale et menaces – elle est sous un verre blindé au musée Correr, livrée et installée de nuit !
À la chute de Napoléon en 1815, l'empereur d'Autriche exige le retour des chevaux à Venise, le lion et les chevaux reviennent en grande pompe, mais bien sûr, ce ne serait venu à l'idée d'aucun Vénitien de les rendre à Constantinople qui est leur véritable patrie !
Ils redescendront encore une fois pendant la dernière guerre (peur des bombes). Mais Constantinople avait pris tout cela ailleurs, et il ne lui viendrait pas à l’idée de les réclamer !
Depuis 1980 le quadrige est protégé de la pollution à l'intérieur de la basilique.
LA LAGUNE PROTECTRICE = la naissance de Venise
Le premier chef-d'œuvre de Venise, c'est sa lagune naturelle, protectrice. La lagune est naturellement le résultat d'une interaction entre les fleuves et la mer. Les sédiments des fleuves durcissent au contact de la mer et forment des cordons de sable qui délimitent un plan d'eau. En italien, ces cordons se disent « lido » et la nature bien faite laisse des estuaires (« des bouches ») faits par les fleuves côtiers (3) pour que le flux et reflux des marées renouvelle l'eau salée tout en emmenant les sédiments trop nombreux qui pourraient combler la lagune.
Les Romains n'occupent pas le site de Venise, il n'y a aucune ruine romaine à Venise. Les Romains, grands bâtisseurs, avaient besoin d'une terre ferme, et à l'époque romaine le site de Venise n'est qu'un marais salant. Au V° siècle, sous la poussée des grandes invasions barbares, les îles de la lagune sont occupées par les populations qui venaient se réfugier dans ces îles inhospitalières recouvertes à marée haute avec l'espoir de retourner sur la terre ferme un jour. Mais la domination lombarde s'intensifiant, elle pousse les populations à s'installer de façon définitive.
À la fin du VI° siècle, les premières îles définitives apparaissent. Torcello - la plus belle à l'époque - est dotée d'une cathédrale (Santa Maria Assunta) ordonnée en 639, sur ordre de l'exarque de Ravenne. Les Vénètes ont appris à se servir de ce lieu ingrat. C'est au prix d'un travail colossal que ces îles marécageuses et insalubres se sont transformées en territoires habitables ; il a fallu lutter constamment contre l'ensablement qui aurait rattaché les îles à la terre ferme, comme ce fut le cas pour Ravenne, 100 km plus bas, qui était un grand port romain et qui est de nos jours à 5 km de la mer.
En cas d'attaque d'une flotte étrangère, il suffisait d'abattre les pieux « le bricole » qui balisaient les passes navigables pour que les cités de la lagune soient à l'abri de tout danger. Les deux fleuves Brenta et Sile qui débouchaient dans la lagune sont détournés au XIV° directement dans l'Adriatique. Le grand canal (4 km) n'est rien d'autre que l'ancien lit de la Brenta.
Les peuples de la lagune se gouvernaient seuls sous l'autorité d'un « dux » représentant Byzance : le premier dux est élu en 697 mais on ne parlait pas encore de Venise. C'est en 811 que le dux de l'époque se réfugie dans le groupe d'îlots de Rivo Alto pour échapper à Pépin le Bref, car en 3 siècles, les anciens pêcheurs de la lagune étaient devenus de hardis navigateurs et d'habiles commerçants qui suscitaient les convoitises.
La victoire maritime sur Pépin donna aux habitants de la lagune le droit du libre commerce dans tout l'empire carolingien comme ils le faisaient déjà dans l'empire byzantin. Cet événement consacra vraiment la naissance commerciale de Venise. Le dux devenu « doge » et les magistrats décidèrent en 811 de fixer leur centre politique au Rivo Alto (Rialto), Torcello gardant le centre du commerce jusqu'au X° siècle.
Sûre de sa force, Venise exploite au maximum les avantages de sa situation géographique au débouché des cols alpins et de la vallée du Pô, elle est le lien unique entre les peuples du nord et le monde Arabe. Elle vend tout à tout le monde : les soieries, les épices, les étoffes, les esclaves en provenance d'Orient, le drap des Flandres, les fourrures de Russie, le sel et le sucre !
Tout, absolument tout ce qui s'échange entre Europe du Nord et pays orientaux passe par Venise qui encaisse des droits de douane faramineux. Venise bat monnaie dès 1284, elle a son ducat d'or, tout comme Florence a son florin !
En l'an 1000, Pietro Orseolo, un des plus grands doges de l'histoire, fait de l'Adriatique un lac vénitien en étendant sa force sur les côtes de Dalmatie (actuelle Croatie). Cette victoire est célébrée chaque année le jour de l'Ascension par la cérémonie des épousailles de la mer par le jet d’un anneau d’or (« nous t'épousons mer en signe de domination »). Voltaire disait que le mariage n'était pas valable car la mariée ne pouvait pas répondre. De nos jours c'est le maire de Venise qui préside la cérémonie et jette une simple couronne de fleurs.
L'âge d'or de Venise coïncide bizarrement avec le temps des croisades : on allait sauver le tombeau du Christ, et on en profitait pour ramener tous les trésors de l'Orient ! Venise a bénéficié d'avantages commerciaux exorbitants accordés par Byzance pour le commerce en Méditerranée, ce qui provoquera la jalousie de nombreux ennemis (Gênes, Florence, Milan et surtout les Turcs). À l'époque de Catherine de Médicis, Venise à elle seule était 3 fois plus riche que la France (15 millions d'habitants) et comptait 190.000 habitants.
La richesse et la puissance de Venise, c'est son commerce et ses bateaux dans les mains d'une aristocratie marchande. Les marchandises étaient si importantes que chaque bateau de commerce était escorté par une galère armée pour lutter contre la piraterie.
L'arsenal de Venise était capable de sortir une galère par jour grâce à la « gestion des flux de production » mise au point ici : préfabrication, pièces de rechange standardisées, montage à la chaîne : en un jour on passait du stade de tas de planches à une galère toute équipée, avec la nourriture pour l'équipage, prête à prendre la mer. Le quartier de Castello a été construit pour loger les 15.000 ouvriers de l'arsenal.
Cette supériorité navale a contribué à sauver le monde chrétien de l'invasion turque lors de la bataille de Lépante en 1571. Les bateaux ramenaient de précieuses marchandises, mais aussi les rats, et les rats à l'époque c'était souvent la peste ! La 1ère épidémie frappa Venise en 1348 et régulièrement jusqu'en 1630. La peste s'arrêta avec le commerce.
Venise a payé un très lourd tribut à la peste. On construisit beaucoup d'églises pour lutter contre la peste ou remercier Dieu ou la Vierge, dont la Salute (100.000 morts en 1630) et le Rédempteur sur la Giudecca. On pourvut aussi Venise de chats pour protéger la ville des rats.
Les guerres avec ses rivales ont affaibli Venise mais il y a eu surtout en 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vasco de Gama passe le cap de Bonne Espérance 5 ans plus tard, Magellan fait le tour de la terre. Le commerce ne se fait plus sur l'Adriatique, mais sur l'Atlantique en faveur des Portugais et des Espagnols, les nouveaux maîtres. Le monde s'agrandit, Venise n'en est plus le centre.
Son déclin commence, mais elle va vivre longtemps encore sur sa lancée grâce à la fortune amassée pendant 7 siècles.
Les dangers de Venise
Pour mieux apprécier ce que l'on voit, il faut parler des dangers qui menacent et qui font que Venise s'enfonce dans les eaux, à cause de cette domination humaine « nous t'épousons... en signe de notre domination ».
Depuis sa construction au XII°/XIII° siècle, Venise s'est enfoncée ; les anciens avaient prévu 1 à 2 cm par siècle à cause de la gravité naturelle, mais le XX° siècle l'a enfoncée de 35 cm !
La lagune est plus petite que le lac Léman, elle mesure 50 km sur 10 et elle ne fait que 5 mètres à son endroit le plus profond. Elle est si peu profonde que pendant l'hiver 1929 elle a complètement gelé et on pouvait aller à pied sur le continent !
Ce que le XX° siècle a ajouté aux marées, c'est :
- le pompage des nappes phréatiques et du méthane du sous-sol ;
- Porto Marghera pompe l'eau et rejette des nitrates – disparition des algues stabilisatrices ;
- la pêche illicite des coquillages à « l’aspirateur » ;
- les navires de croisière type « Costa », plus hauts que les monuments !
Ces croisières n'apportent rien à la ville, on mange sur le bateau… Les croisiéristes rapportent de l'argent au port. Il paraît qu'une croisière en Méditerranée vaut plus cher si on passe au ras de la place S. Marc !
LA SPLENDEUR
Venons-en maintenant rapidement, parce qu’il faudrait trop de temps, à la splendeur de Venise et à un autre de ses symboles, la place Saint Marc. Régulièrement inondée par « l'aqua alta » (elle est à 60 cm au-dessus de la mer à l'endroit le plus bas), régulièrement envahie par 23 millions de touristes chaque année et constamment restaurée, je ne l'ai jamais vue sans échafaudage ! Pourquoi attire-t-elle autant ? Parce que c'est une machine à remonter le temps.
La première église bâtie pour abriter le corps de S. Marc ayant brûlé en 976, le doge de Venise décide de rebâtir sa chapelle privée : une autre église à la hauteur de sa puissance et de sa prospérité, plus qu'une église, une basilique qui sera consacrée en 1094 : celle que nous avons toujours sous les yeux à la mode byzantine, forme de croix grecque avec 5 coupoles, une véritable bande dessinée de l'ancien testament, le pavage du sol qu'on oublie souvent de regarder à force de lever le nez vers les mosaïques, le rétable en or, la loge des magnifiques chevaux.
En passant derrière les chevaux sur la loggia, on a une vue complète de la place construite entre le X° et XII° siècle :
- le Campanile abrite les 5 cloches de S. Marc, il s'écroula sur lui-même le 14 juillet 1902, sans faire aucune victime et fut reconstruit à l'identique ;
- les 3 mâts porte-étendards des 3 républiques soumises : Chypre, Crète, Dubrovnik ;
- les 2 colonnes de la Piazzetta rapportées d'Orient, avec le lion de S. Marc et S. Théodore dessus (la 3e est toujours au fond de la lagune) ;
- la tour de l'horloge et les 2 Maures du XVIIIe siècle qui sonnent les heures ;
- les procuraties, anciens ministères, aujourd’hui musée Correr et cafés historiques Florian et Quadri.
La Basilique c'était la chapelle privée du Doge, pas celle de la ville de Venise qui était à Castello. Entre les deux colonnes, la perspective de St Marc et du palais ducal : le plus beau salon du monde selon Musset !
Le palais des doges concentrait toute l'organisation de la République : pouvoir politique, justice, police, ambassades. Le doge n’avait aucun pouvoir personnel, mais restait le symbole de Venise. Il faut visiter les itinéraires secrets : la forêt de poutres du grand conseil, les salles de torture, la cellule de Casanova, etc.
Aux XVe et XVIe siècles, Venise domine le monde de la peinture : Carpaccio, les Bellini, Giorgione, Titien, Tintoret, Véronèse. Puis viennent Canaletto, les Tiepolo père et fils. Les peintres travaillaient aussi pour les « scuole » : corporations à but charitable, très riches, décorées par les grands artistes.
Les « scuole » remarquables : San Rocco (Tintoret) et San Giorgio Schiavoni (Carpaccio). Il y avait des corporations pour tous les métiers, même pour accompagner les condamnés au supplice !
En architecture, Venise passe du byzantin au gothique fleuri : Ca' d’Oro. Elle forme ses propres mosaïstes à Murano dès le XIIIe. Les fours à verre sont déplacés sur Murano pour éviter les incendies… et garder le secret. Le savoir-faire des verriers était protégé jusqu’à la peine de mort. Colbert a réussi à voler le secret en 1665 pour créer Saint-Gobain.
Les chefs-d’œuvre visibles ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Sous Venise, des forêts de pieux de mélèze soutiennent les bâtiments. Le sol argileux accueille les troncs, puis les planchers, puis la pierre d’Istrie, puis les murs. Pour le pont du Rialto : 12 000 troncs ; pour la Salute : 1 million !
Venise n'est pas une cité lacustre : elle est bâtie au ras de l'eau sur 40 îles reliées par 400 ponts. Jusqu'au XIIIe, les ponts étaient plats en bois. Puis en pierre en dos d’âne pour les bateaux. Les maisons suivent un modèle : rez-de-chaussée pour les marchandises, mezzanine pour le bureau, 1er étage (piano nobile) pour la résidence. Par-dessus : altana (terrasse) et cheminées évasées.
Au Ghetto, les maisons montent jusqu’à 9 étages faute de place. Les Vénitiens redoutaient plus le feu que l’eau. Exemple : l’incendie de la Fenice en 1996. Venise n’a pas d’eau douce : elle vient aujourd’hui du continent. Avant, c’étaient les « cisterne », récupérant l’eau de pluie, toujours fonctionnelles.
Même en déclin, Venise reste symbole de bon goût. Jusqu’au XVIIIe : banque, casino, imprimerie, courtisanes, carnaval. Un guide des courtisanes existait, comme un guide Michelin !
Le café, arrivé de Constantinople, était à la turque. Le premier café : le Florian (1720), devenu célèbre. En face : Quadri, Lavena. Chaque café avait un orchestre. Au XVIIIe, il y avait 34 cafés sous les Procuraties. On y lisait la « Gazetta », le premier journal du monde, qui coûtait 1 gazette (2 sous).
Parenthèse
Malgré tous les dangers qui la menacent, on pense que Venise est arrivée jusqu'à nous épargnée par les siècles. Il n'en est rien, la plus belle maison et la plus représentative, la Ca’ d’Oro, est là depuis le début du XVe siècle, construite à l'emplacement d'un ancien palais plus petit qu'elle. Lors de la construction, on a voulu récupérer les pieux qui n'étaient pas assez nombreux : résultat, elle s'est immédiatement enfoncée de 70 cm, ce qui explique que le rez-de-chaussée soit presque toujours dans l'eau.
Pourtant, on n'avait pas lésiné sur la qualité des architectes ni des matériaux : il la fallait comme le palais des doges, avec un toit pour cacher les tuiles, et des façades en dentelles de pierre réalisées par Matéo Raverti, l'architecte qui venait de terminer le dôme de Milan. Construite de 1421 à 1440, c'est une façade fondamentale du gothique vénitien et la rupture définitive avec le byzantin. Pour lui donner grand air, on avait plaqué 23 000 feuilles d'or sur le marbre, d'où son nom.
La fortune de Venise déclinant, elle n'a pas été entretenue comme elle le méritait. En 1802, elle est vendue comme « ruine », mais le pire est à venir : en 1840, un prince russe l'achète pour loger sa danseuse Maria Taglioni. La demoiselle ne trouve rien de mieux à faire que de la mettre au goût du jour : suppression de la citerne, de l'escalier extérieur et des loggias pour les remplacer par des balcons en fer forgé... on était à l'époque Gustave Eiffel, le métal est à la mode.
C'est en 1894 que le baron Franchetti la rachète, retrouve chez les antiquaires toutes les pièces vendues par la danseuse et rend enfin à la Ca’ d’Oro sa splendeur passée. À sa mort, il en fait don à l'État. Après toutes ces vicissitudes, elle est redevenue comme avant, l'or en moins…
À l'époque « Dada », le futuriste italien Marinetti trouvait Venise symbole du passé et de l'académisme. Il voulait combler le grand canal pour en faire une autoroute et faciliter la circulation.
De nos jours, le danger menace toujours : on a beau s'appeler Venise, on n'est pas à l'abri de la cupidité des promoteurs immobiliers.
- Il y a quelques années, c'est le marché du Rialto vieux de 1000 ans qui avait été menacé de devenir un centre commercial. Ça ne s'est pas fait, mais…
- Venise, toujours à court de liquidité, a vendu à Benetton le Fondaco dei Tedeschi (ancienne poste de Venise), en pensant qu'il allait lui rendre son prestige passé. Benetton se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine : il veut créer un centre commercial (encore) avec boutiques, cinéma, librairie genre FNAC, mettre un toit en verre, installer des escaliers roulants de toutes les couleurs… une horreur…
- Et puis, sur la terre ferme, sur la ruine de Porto Marghera, le couturier Pierre Cardin veut édifier une tour à sa gloire, un « Palais des Lumières » de plus de 245 mètres de haut qu'on verrait de Venise bien sûr ! Aux dernières nouvelles, son prêt pour acheter le terrain a été refusé, et il menace d'aller en Chine édifier son emblème.
LE CARNAVAL DE VENISE
On ne peut pas parler de l'histoire de Venise sans évoquer le carnaval, même si celui que nous connaissons de nos jours est loin de l'original.
Les masques existent dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps, et la religion catholique, qui l'a associé au début du carême, n'a fait que reprendre d'anciens rites saisonniers marquant le passage de l'ancienne année à la nouvelle, de la nuit au jour, de la mort de la nature à sa renaissance. À Venise, où il était difficile de passer inaperçu, on cherchait l'anonymat : le masque était la solution pour s'adonner à tous les excès. Les Romains avaient les saturnales, Venise le carnaval.
Le mot carnaval apparaît vers le Xe ou XIe siècle, probablement issu du bas latin carnem levare : enlever la viande, c'est le début du carême de 40 jours avant Pâques. Mais à Venise, le carnaval durait 6 mois : d'octobre à Noël, de la Saint Étienne (26 décembre) au carême, plus le jour des épousailles de la mer (l'Ascension), la Saint Marc (25 avril), etc. Toutes les occasions étaient bonnes pour se déguiser de façon grandiose.
Les tout premiers carnavals officiels qui célébraient la victoire en 1163 du doge Ulrico Dandolo sur le patriarche d'Aquiléa sont vite abandonnés pour devenir des fêtes populaires où tout le monde participe.
Au XVIIIe siècle, le masque est le maître de Venise. Du plus riche au plus pauvre, tout le monde se masque : les servantes deviennent grandes dames, les grandes dames peuvent s'encanailler sans risque pour leur réputation. On joue sans payer ses dettes, on couche avec n'importe qui, il y a même des règlements de comptes sanglants. Mais de fêtes en fêtes, Venise est au plus bas en 1797, Bonaparte interdit le carnaval, les Autrichiens feront de même. Le cœur n'y est plus.
Pendant 182 ans, on ne parlera presque plus du carnaval de Venise. Mais il a laissé une telle empreinte dans la mémoire collective qu'en 1979, à la faveur des mouvances du retour aux racines, de la quête de son identité, quelques jeunes Vénitiens décident de ressusciter le carnaval entre eux, dans leurs quartiers. La vague plaît : d'abord les Romains, les Milanais viennent faire le carnaval à Venise avec eux, puis la vague devient un tsunami international : on vient du monde entier (Américains, Australiens, une armada de Japonais et beaucoup de Français !).
On estime à un million de personnes les participants au carnaval pendant 10 jours.
Pourquoi se costume-t-on de nos jours ?
De nos jours où plus rien n'est interdit, où l'anonymat et la solitude sont considérés comme des défauts de la société, on ne va plus à Venise pour préserver son anonymat, bien au contraire, on va se faire admirer, photographier. On n'y va que pour ça ! C'est très narcissique d'être un masque vénitien.
Le costume symbolique de Venise, c'est le tabarro (longue cape noire) et la bauta (capuchon de soie cachant toute la tête). Rien ne doit dépasser, un tricorne et un masque en papier mâché blanc écarté au niveau de la bouche pour pouvoir manger, boire, parler et le garder toute la journée.
Les personnages de la commedia dell’arte très populaires (Arlequin, Polichinelle, Pierrot, les médecins de la peste) sont de plus en plus remplacés par des masques éblouissants, éthérés, avec une grande créativité dans les costumes.
L'admiration des milliers de photographes, c'est la récompense, le salaire, d'une année de travail pour réaliser le costume. On se costume pour le plaisir de se prendre une fois dans l'année pour Adriana Karembeu ou Angelina Jolie avec une nuée de photographes aux trousses !
Pour finir : la gondole
La gondole est indissociable de Venise, emblématique, tout comme le lion et la place Saint Marc. L'histoire de la gondole remonte à l'an mille. Son aspect actuel — toute noire, laquée, sans toit — date de 1663. Il a fallu un édit du Grand Conseil pour mettre fin à l'escalade de luxe des gondoles et des habits chamarrés des gondoliers, trop luxueux pour la République.
La gondole était l'équivalent du carrosse terrestre, la Ferrari de l'époque ! Les gens dépensaient des fortunes pour l'agrémenter, signe extérieur de richesse. On possédait plusieurs gondoles qu'on attachait aux paline, poteaux colorés en spirale. Plus il y avait de paline, plus on était riche.
Chaque gondole avait son gondolier, et chaque gondolier avait son chant pour se guider dans le brouillard : la barcarolle, typiquement vénitienne. Le « chant des gondoliers » n’était que fonctionnel.
Au XVIe siècle, on comptait 10 000 gondoliers — de père en fils. Aujourd’hui, la confrérie compte 400 membres promenant les touristes sur des circuits définis. La gondole était un cadeau d’apparat pour les souverains étrangers : Louis XIV a reçu deux gondoles et quatre gondoliers. À Versailles, le restaurant « La petite Venise » rappelle cette époque.
Tout est très précis dans la gondole : dissymétrique et courbe pour compenser le poids du gondolier à l’arrière gauche, barque à fond plat (10 mètres de long) pour naviguer sans profondeur. Elle n’a pas de quille. Une seule rame posée sur la forcola, sculptée d’un seul bloc de noyer. Chaque échancrure permet des manœuvres variées. Une forcola coûte 1 300 €, nécessite trois jours de travail, le bois sèche deux ans avant taille.
Le fer de proue en inox — le fero — symbolise les six quartiers de Venise et la Giudecca, sous la protection du doge (représenté par la corne ducale). On peut encore voir un atelier de gondole à San Trovaso. Une gondole prend deux mois à construire, coûte 35 000 € (prix 2013), nécessite 15 à 20 couches de vernis, et dure environ 20 ans.
Resteraient encore à détailler :
- les grands musées : l’Académie, la Ca’ Rezzonico, le Palazzo Guggenheim, Punta Dogana de François Pinault, et d’autres…
- les grandes églises : la Salute (Les Noces de Cana – Tintoret), San Zanipolo, les 120 églises moins grandes et les grands peintres qui les décorèrent,
- la musique – Vivaldi, les théâtres lyriques (la Fenice, le Malibran), Benedetto Marcello, les chanteurs contemporains,
- les îles – San Michele (le cimetière), Murano, Burano, Torcello, la Giudecca, et toutes les petites îles de la lagune,
- les courtisanes, Casanova et Goldoni (créateur d’un autre théâtre que la Commedia dell’Arte),
- le cinéma et les écrivains inspirés par Venise — ils sont légion.
Bibliographie sur Venise
Quelques lectures utiles et agréables sur Venise

Nous remercions la Librairie MAJOLIRE de Bourgoin-Jallieu pour son aide dans la préparation de cette bibliographie. Les ouvrages disponibles dans le commerce peuvent lui être commandés.
Cette bibliographie a été commencée pour la préparation d'un voyage d'une semaine à Venise, organisé par l’INIS en avril 2002, et constamment actualisée depuis. Excessive pour la préparation d'un voyage, m'a-t-on déjà dit ... ! Elle est pourtant aussi une image de Venise, à travers ce qu'on en écrit, guides, romans, histoires, BD, films….
Vous ne lirez sans doute pas tous ces livres ... en tout cas avant un départ à Venise ! Mais chacun pourra trouver lecture à son goût, continuer à lire après le voyage ... et nous suggérer encore d'autres lectures. On n'en finit jamais avec Venise quand on y a goûté !
Dictionnaires
- Giuseppe BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, 1856, Ristampa anastatica, Martello, Firenze, 1983
- Eugenio Vittoria, Dizionario veneziano-italiano, Editrice EVI, Venezia, 1983
Des lexiques figurent à la fin d’un certain nombre d’ouvrages. Ils seront signalés à propos de chacun de ces ouvrages.
Guides et divers
En italien :
- Venezia, Guida del Touring Club italiano, 1985
- Michela SCIBILIA, Osterie e dintorni, Libreria Sansovino, San Marco 84, bacino Orseolo (près de San Marco), 1998
- Aline CENDON / Giampaolo SIMONETTI, Venezia, istruzioni per l'uso, Marsilio, 1997
- Giulio LORENZETTI, Venezia e il suo estuario, Edizioni Lint, Trieste, 1974
- Giorgio BELLAVITIS, Itinerari per Venezia, Guide dell'Espresso, 1980
En français :
- Venise Cartoville, Gallimard, mars 2001 (7,47 €)
- Guido FUGA / Lele VIANELLO, Les balades de Corto Maltese, Casterman, 1999, 220 p. (18,29 €)
- Venise, Guide vert, Michelin, 2000 (12,50 €)
- Léon DE COSTER, Walter BARECCHI, Découvrir l'architecture en 17 promenades dans Venise, Casterman, 1996, 352 p. (195 F)
- Venise, Gallimard, Coll. "Guides"- Découvertes, 464 p. (26,68 €)
- Venise, Guide du Routard, Hachette Tourisme, 219 p. (12,90 €)
- Venise et la Vénétie, Guide bleu, Hachette, 2001, 440 p. (23,90 €)
- Venise, Guide Visa, Hachette
- Venise, Le Guide Autrement, édition 1999-2000
- Venise, Nouveaux loisirs
- Venise, Ulysse, n. 81, octobre 2001 (5,34 €)
- Paul LUTZ, Anne-Claire MEFFRE, Venise immortelle, Solar, 144 p. (29,72 €)
- Onze occasions d'aller à Venise, Hachette
- L'ABCdaire de Venise, Flammarion, 1998, 120 p. (9,94 €)
- VINCENT Bruno, La lagune de Venise, Gallimard Jeunesse, 1998 (13,42 €)
Cuisine
- Pino AGOSTINI, La table des doges : histoire et recettes de la grande cuisine vénitienne, La Renaissance du livre, Bruxelles, 1992
- Alain BUISINE, Cènes et banquets de Venise, Zulma, 2000, 190 p.
- Jean CLAUSEL, Venise exquise, Robert Laffont, 1990, 176 p.
- Michèle TEYSSEYRE, Saveurs et senteurs de la Sérénissime, Clairsud, 2002
- Emilia VALLI, La cucina del Veneto in cento ricette tradizionali, Tascabili Economici Newton, 1999
- Luigi VERONELLI, Cuisine de Venise : recettes originales du pays des doges, Ed. du Pacifique, 2001
Témoignages, récits de voyages ...
- Paul MORAND, Venises, Gallimard, 1971, 1983, 2006
- Jean-Claude SIMON, Le voyage à Venise, Lattès, 1992
- Philippe SOLLERS, Venise éternelle, Lattès, 1993
- Philippe SOLLERS, Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004
- Venise, un voyage intime, Autrement, hors-série n°14, 1985
- ACHENG, Diario veneziano, Editoriale Consorzio Venezia Nuova, 1993
- Aldo ANDREOLO, Elisabetta BORSETTI, Venezia ricorda, Le altane, 1999
- Serena D'ARBELA, Siete proprio veri?, Edizioni Tracce, 2001
- Virgilio BOCCARDI, Casanova, la Venezia segreta, Filippi Editore Venezia, 2000
- Fernand BRAUDEL, Folco QUILICI, Venise, Arthaud, 1984
- Florence BRIEU-GALAUP, Venise un refuge romantique (1830-1848), L’Harmattan, 2007
- Giiuseppe CALÒ, Ciò, Zibaldone veneziano, Corbo e Fiore Editori, Venezia, 1986
- Bernadette CHOVELON, Dans Venise la rouge, Payot, 1999 (réédité 2004)
- Jean CLAUSEL, Venise chronique, Payot, 2001
- Gioseffa CORNOLDI CAMINER, La donna galante ed erudita, Marsilio, 1984
- Baron CORVO, Lettres de Venise, Le Rocher, 1990
- Michel BULTEAU, Baron Corvo, l'exilé de Venise, Le Rocher, 2000
- Régis DEBRAY, Contre Venise, Gallimard, 1995
- Dominique FERNANDEZ, Le promeneur amoureux, Plon, 1980
- René GUERDAN, Vie, grandeurs et misères de Venise, Plon, 1959
- Henri GUILLEMIN, La Liaison Musset - Sand, Gallimard, 1972
- Michel HOCHMANN, Venise, Citadelles & Mazenod, 2016
- René HUYGHE, Marcel BRION, Se perdre dans Venise, Arthaud, 1986
- Henry JAMES, Heures italiennes, La Différence, 1990
- Guy JOUANARD, Venise en clair – obscur, L’Archange Minotaure, 2006
- John KENT, Venise, guide du promeneur amoureux, Gallimard, 1991
- Mary MAC CARTHY, Venise connue et inconnue, Ed. de l'Oeil, 1964
- En observant Venise, Editions Salvy, 1994
- Liliana MAGRINI, Carnet vénitien, Gallimard, 2002
- Michèle MARÉCHAL-TRUDEL, Chateaubriand, Byron et Venise, Nizet, 1978
- F. T. MARINETTI et al., Contro Venezia passatista, 1910
- Predrag MATVEJEVITCH, L’autre Venise, Fayard, 2004
- Patric MAURIÈS, Quelques cafés italiens, Gallimard, 2001
- James MORRIS, Visa pour Venise, Folio, 1989
- Gonzague SAINT-BRIS, Les romans de Venise, Le Rocher, 2007
- Nicoletta SALOMON, Venise engloutie, Mille et une Nuits, 2008
- Jean-Paul SARTRE, Venise de ma fenêtre, Verve, 1953
- Tiziano SCARPA, Venise est un poisson, Christian Bourgois, 2000
- Giuseppe TASSINI, Curiosità veneziane, Filippi Editore, 1863 (1990)
- Miscellanea, il veridico 1892 - 1894, Filippi, 1970
- Alain VIRCONDELET, Devenir Venise, Lattès, 1994
- Richard WAGNER, Ma vie, Buchet-Chastel
- Voyage à Venise sur les pas de Marcel Proust, Garde-temps, 2000
Histoire de Venise
- Christian BEC, Histoire de Venise, PUF, "Que sais-je?", 1993
- Sergio BETTINI, Naissance d’une ville, Éd de l’Éclat, 2006
- Frédéric C. LANE, Venise, une république maritime, Flammarion, 1985
- Ph. BRAUNSTEIN, R. DEBORT, Venise, portrait historique d'une cité, Point Seuil
- Philippe MONNIER, Venise au XVIIIè siècle, Perrin, 1907
- Alvise ZORZI, Venise, une cité, une république, un empire, La Martinière, 2001
- Histoire de Venise. La République du Lion, Ed Perrin, 2001
- Roberto CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Giuseppe Principato, 1968
- André ZYSBERG et René BURLET, Venise, la Sérénissime et la mer, Gallimard
- Vittore BRANCA, La sapienza civile, Leo S.Olschki, 1999
- Sefano CARBONI (dir.), Venise et l’Orient, Gallimard/IMA, 2006
- Elio COMARIN, La mort de Venise, Perrin, 1998
- Giovanni COMISSO, Les ambassadeurs vénitiens, Le Promeneur, 1989
- Giovanni COMISSO, Les agents secrets de Venise, Le Promeneur, 1990
- Elisabeth CROUZET-PAVAN, Venise triomphante, Albin Michel
- Amable DE FOURNOUX, Napoléon et Venise, De Fallois, 2002
- Pierre DARU, Histoire de la République de Venise, Laffont, 2004
- Charles DIEHL, La République de Venise, Flammarion, 1985
- Il gioco dell'amore, Berenice Art Books, 1990
- Richard GOY, Venise, la ville et son architecture, Ed. Paidon, 2002
- Jean-Claude HOCQUET, Venise et la mer, XIIe – XVIIIe siècles, Fayard, 2006
- Venise au moyen-âge, Les Belles Lettres
- M. JONARD, La vie quotidienne à Venise, Hachette, 1965
- De LAROCHE Robert, Venise, Carnaval secret, La Renaissance du Livre, 2000
- Lodovico MANIN, Io, l'ultimo Doge di Venezia, Canal, 1997
- Donald M. NICOL, Venezia e Bisanzio, Rusconi, 1990
- John Julius NORWICH, Histoire de Venise, Payot
- Paolo PRETO, Peste e società a Venezia, 1576, Neri Pozza, 1978
- Lionello PUPPI, Les pierres de Venise, F. Hazan, 2001
- Gonzague SAINT-BRIS, Les romans de Venise, Rocher, 2007
- Salvatore SETTIS, Se muore Venezia, Einaudi, 2015
- Storia di Venezia, Istituto Treccani, 1999
- Venezia e la difesa del Levante da Lepanto a Candia 1570-1670, Arsenale Editrice, 1986
- Venise, la République des castors, 1297-1797, ENS Editions, 1997
- Venise et la Révolution française, Laffont, 1997
- Lucette VALENSI, Venise et la Sublime Porte, Hachette, 1987
Art
- AA.VV., La peinture dans les musées de Venise, Ed Mengès, 2002
- Eugenia BIANCHI, Nadia RIGHI, Maria Cristina TERZAGHI, La place Saint-Marc et ses musées, Electa, 1997
- Alain BUISINE, Un Vénitien dit "Le Canaletto", Zulma Ed., 2001
- Alain BUISINE, Dictionnaire amoureux et savant des couleurs de Venise, Zulma, 1998
- Roberto CALASSO, Le rose Tiepolo, Gallimard, 2009
- Valentina CONTICELLI et autres, L'ABCdaire de Tiepolo, Flammarion, 1998
- Anne EPELBAUM-MOREAU, Venise à travers les artistes et les écrivains, La Renaissance du Livre, 2003
- Maurice FAVILLA et Ruggero RUGOLO, Venise rococo, Hazan, 2011
- Galienne FRANCASTEL, L'art de Venise, Editions Pierre Tisné, 1963
- GUGGENHEIM MUSEUM, Chefs-d’œuvre de la collection Peggy Guggenheim, Venise, 1999
- Marion KAMINSKI, Venise, art et architecture, Könemann
- Michaël LEVEY, La peinture à Venise au XVIIIe siècle, Julliard, 1959
- Filippo PEDROCCO, Ca' Rezzonico, Marsilio, 2001
- Filippo PEDROCCO, Giambattista Tiepolo, Flammarion, 2002
- Paolo Veneziano, La Renaissance du livre, 2003
- Philippe PIQUET, Monet et Venise, Herscher
- Terisio PIGNATTI, Venise, guide de la peinture, Canal, 1995
- Lionello PUPPI, Les pierres de Venise, Hazan, 2001
- John RUSKIN, Les Pierres de Venise, Hermann, 1983
- Jean-Paul SARTRE, Le séquestré de Venise, Les Temps Modernes, 1957
- Michel SERRES, Esthétiques sur Carpaccio, Hermann, 1975
- Michel SERRES, Carpaccio à Venise ou les esclaves libérés, Le Pommier, 2007
- Salvatore SETTIS, L'invention d'un tableau. La tempête de Giorgione, Ed. de Minuit, 1988
- John STEER, La peinture vénitienne, Tames and Hudson, 1990
- John SUMMERSON, Le langage classique de l'architecture, Tames and Hudson, 1992
- Venise vue par les peintres, Skira, 1956
- Denis MONTAGNON, Venise, Impressions de peintres, Ed. Du Chêne, 2002
- Ettore VIO, La Basilique Saint-Marc de Venise, Citadelles et Mazenod, 2000
Musique
- Nanie BRIDGMAN, La musique à Venise, Que sais-je?, PUF, 1984
- Paolo FABBRI (a cura di), Musica nel Veneto, la storia, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, 1998
- Hélène LECLERC, Venise baroque et l'opéra, Armand Colin, 1987
- Venise, Musique et peinture du XVè au XVIIIè siècle, Opus 111, OPS 7002
- Gian Francesco MALIPIERO, œuvres vénitiennes : Sette canzonette veneziane, Tre commedie goldoniane, Il Mistero di Venezia...
- Luigi NONO, œuvres majeures, élève de Malipiero
- Gianluca AMADORI, Per quattro soldi, Editori Riuniti, 2003
- Musique populaire : Gualtiero Bertelli, Alberto d’Amico, Luisa Ronchini, etc.
Quelques classiques de la littérature
- Christine AUSSEUR, Guide littéraire de Venise, Hermé, 1994
- Jean-Noël MOURET, Le goût de Venise, Mercure de France, 2002
- Evelyne SCHLUMBERGER et al., Venise entre les lignes, Denoël, 2001
- Gabriella ZIMMERMANN, Venise au fil des mots, Vol I, Pimientos, 2006
- Gabriella ZIMMERMANN, Venise au fil des temps, Vol II, Pimientos, 2007
- Dante ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, XXI, 7-45
- BALZAC, Massimila Doni, Ed. Corti
- Giovanni BOCCACCIO, Decamerone, Journée 4
- ARETINO, Correspondance
- Giacomo CASANOVA, Histoire de ma vie, Gallimard, Pléiade
- Jacques CAZOTTE, Le diable amoureux, Folio
- Gabriele D'ANNUNZIO, Il Fuoco, 1900
- Lorenzo DA PONTE, Mémoires, Mercure de France, 1988
- Jean GIONO, Voyage en Italie, Folio
- Carlo GOLDONI, Œuvres complètes, dont La Bottega del caffè
- Carlo GOZZI, Mémoires inutiles, Phébus, 1987
- GOETHE, Voyage en Italie, Aubier
- Théophile GAUTIER, Italia, Hachette, 1860
- BEN JONSON, Volpone
- MONTAIGNE, Voyage en Italie, Garnier
- MUSSET, Le fils du Titien, Magellan
- NIEVO Ippolito, Confessions d’un Italien, Fayard, 2006
- Thomas OTWAY, Venise sauvée, 1682
- Henri de RÉGNIER, L’Altana ou la vie vénitienne, Mercure de France
- George SAND, Lettres d’un voyageur, GF Flammarion, 2004
- SHAKESPEARE, Le Marchand de Venise
- Jean-Claude SIMOËN, Voyage en Italie, Ed. Impact Livres, 2001
- H. TAINE, Voyage en Italie, Hachette, 1880
Voyageurs et photographies
- Yves HERSANT, Italies, Anthologie des voyageurs français aux XVIIIè et XIXè siècles, Robert Laffont, 1988
- TURNER, WORDSWORTH, BYRON, SHELLEY, Robert BROWNING, Ezra POUND, Ernest HEMINGWAY
- Venezia Forma Urbis, Marsilio Editore, 1985
- Fulvio ROITER, Vivre Venise, Mengès
- Fernand BRAUDEL et Folco QUILICI, Venise, Arthaud
- Pierre-Jean BUFFY, Venise, miroir des signes, Terres de brume, 2002
- Giandomenico ROMANELLI, Venise au fil des pierres, Liana Levi
- Ezio TEDESCHI et Gino BIAGIO BRADO, Concerto per Venezia, Padova, 1989
- Frédéric VITOUX, L'art de vivre à Venise, Flammarion, 1990
- Anne WIAZEMSKY, Venise, photos de Jean-Noël de Soye, Ed. Chêne
- Alvise ZORZI et Paolo MARTON, Les plus beaux palais vénitiens, France Loisirs, 1993
Romans
- Marc ALYN, Le piéton de Venise, Éd de Bartillat, 2005
- Alfred ANDERSCH, La Femme aux cheveux roux, Actes Sud, 1991
- Paolo BARBARO, Lunario veneziano, Iles perdues, La Casa con le luci, Petit guide sentimental de Venise
- Giuseppe BERTO, Anonimo veneziano, Rizzoli, 1976
- Gianfranco BETTIN, Dove volano i leoni, Nemmeno il destino, L’héritier
- BOREL Fabienne, Confidences vénitiennes, Les derniers jours du Titien, 2004
- Ray BRADBURY, Morte a Venice, Rizzoli, 1987
- Jean-Denis BREDIN, L'absence, Gallimard, 1986
- Roland BRIVAL, En eaux troubles, Phébus, 2002
- Alejo CARPENTIER, Concert baroque, Gallimard, 1974
- Carolus CERGOLY, Fermo là in poltrona, Mondadori, 1984
- Gian Antonio CIBOTTO, Diario veneto, Marsilio, 1986
- Antoine COMPAGNON, Ferragosto, Flammarion, 1985
- Carlo DELLA CORTE, Di alcune comparse a Venezia, Mondadori, 1968
- Colette FELLOUS, Amor, Gallimard, 1997
- FRUTTERO et LUCENTINI, L’Amant sans domicile fixe, Le Seuil, 1988
- Claude GALAY, Seule Venise, Ed. du Rouergue, 2004
- Alain GERBER, Quatre saisons à Venise, Laffont, 1996
- Olivier GERMAIN-THOMAS, Princesse non-identifiée, Flammarion, 1990
- Robert GIRARDI, Vaporetto n. 13, Neri/Pozza, 1998
- Nedim GÜrsel, Les Turbans de Venise, Seuil, 2001
- Curt LEVIANT, Partita à Venise, Cherche-Midi, 2015
- Thomas MANN, La mort à Venise, Le Livre de Poche
- Paolo MAURENSIG, Le gardien des rêves, éd. du Rocher
- Eduardo MENDOZA, L'Ile enchantée, Seuil, 1991
- Alberto ONGARO, La partita, La taverne du Doge Loredan
- Hanns-Josef ORTHEIL, Lumière de la lagune, Seuil, 2005
- Aldo PALAZZESCHI, Il Doge, SE, 1967
- Dominique PARAVEL, Nouvelles vénitiennes, Serge Safran éditeur, 2015
- Pier Maria PASINETTI, Rouge vénitien, Melodramma, Dorsoduro, Piccole Veneziane complicate, Petite conversation vénitienne
- Henri de RÉGNIER, L’entrevue, Mercure de France, 1919
- Emmanuel ROBLÈS, Venise en hiver, Seuil, 1981
- François-Olivier ROUSSEAU, Les Enfants du siècle, Seuil, 1999
- Nantas SALVALAGGIO, Il campiello sommerso, Fuga da Venezia, Rizzoli
- Marcel SCHNEIDER, La fin du Carnaval, Grasset, 1987
- Arthur SCHNITZLER, Le retour de Casanova, 10/18, 1992
Romans policiers
- Olivier BARDE-CABUÇON, Humeur noire à Venise, Actes Sud, 2015
- James Hadley CHASE, Voir Venise et crever, Gallimard, 1954
- Juan Manuel DE PRADA, La Tempestad, Seuil, 2000
- Michael DIBDIN, Lagune morte, Calmann-Lévy, 1996
- Patricia HIGHSMITH, Le rat de Venise, Calmann-Lévy, 1977
- Donna LEON, Enquêtes du Commissaire Brunetti (divers titres de 1992 à 2013, Calmann-Lévy)
- Thierry MAUGENEST, Venise.net, Liana Levi
- Eduardo MENDOZA, L’île enchantée, Seuil, 1991
- Iain PEARS, Comité Tiziano, 10/18
- Nicolas REMIN, Commissaire Tron (divers titres, Alvik Editions, 2006-2007)
- Maud TABACHNIK, Le sang de Venise, 10/18
- Gabrielle WITTKOP, Sérénissime assassinat, Points Seuil, 2001
Films
- Woody ALLEN, Tout le monde dit I love you (1996)
- Michelangelo ANTONIONI, Identification d'une femme (1982)
- Nanni BALESTRINI et Laura MUSCARDIN, Le mythe d’un aventurier. Casanova (1998)
- René BARBERIS, Casanova (1932)
- Giacomo BATTIATO, Le jeune Casanova (2001)
- Mauro BOLOGNINI, La Venexiana (1986)
- Jean BOYER, Les aventures de Casanova (1946)
- Tinto BRASS, La clé (1983)
- Renato CASTELLANI, La storia di Venezia (1972)
- Romeo e Giulietta (1954)
- André CAYATTE, Les amants de Vérone (1948)
- Eric CLOUÉ, Venise, téléfilm, 1987
- Luigi COMENCINI, Casanova, un adolescent à Venise (1969)
- Enrico COTTAFAVI et Gianpaolo CALLEGARI, Le bourreau de Venise (1952)
- Gianfranco DE BOSIO, Il terrorista (1962)
- Jacques DONIOL-VALCROZE, Venise en hiver, téléfilm
- Marguerite DURAS, La cité des Doges (1976)
- Federico FELLINI, Casanova (1976)
- Riccardo FREDA, Le chevalier mystérieux (1949)
- Enrico FULCHIGNON, I due Foscari (1942)
- F. Gary GRAY, The Italian Job (2003)
- Christopher HAMPTON, Carrington (1995)
- Marshall HERSKOWITZ, Dangerous beauty
- Benoît JACQUOT, Les ailes de la colombe (1980)
- Alain JAUBERT, Giacomo Casanova (1998)
- Otar JOSSELIANI, Lundi matin (2001-02)
- Barbara KOPPLE, Wild Man Blues (1998)
- Georges LAUTNER, Le Guignolo (1980)
- David LEAN, Summertime (1955)
- Eric LOSEY, Eva (1962)
- MANKIEWICZ, Guêpier pour trois abeilles (1967)
- Ernst MARISCHKA, Sissi face à son destin (1957)
- MIELI Valerio, Dix univers à Venise (2012)
- Giuliano MONTALDO, Marco Polo (1982)
- Édouard NIERMANS, Le retour de Casanova (1992)
- Etienne PÉRIER, Venise rouge sang (1988)
- Dino RISI, Anime perse (1976)
- Venezia, la luna e tu (1958)
- Enrico Maria SALERNO, Anonimo veneziano (1970)
- Silvio SOLDINI, Pane e tulipani (1999)
- Steven SPIELBERG, La dernière croisade (1989)
- STENO, Casanova (1955)
- Duccio TESSARI, Le procès des Doges (1963)
- Maurice TOURNEUR, Volpone (1940)
- Giorgio TREVES, Rosa e Cornelia (1999)
- Luchino VISCONTI, Senso (1954), Mort à Venise (1970)
- Alexandre VOLKOFF, Casanova (1927)
Romans
Romans policiers
Films
Quelques BD et livres pour enfants
- CAPDEVILA, Le voyage à Venise de la sorcière Camomille
- Claude CLÉMENT, Le luthier de Venise, coll. Pastel, Lutin Poche
- Gilles CHAILLET, Vasco, Ténèbres à Venise, Ed. du Lombard
- Jean DUFAUX / GRIFFO, Giacomo C., Glénat, Coll. vécu (14 volumes)
- Luc REVILLON, Sur les traces de Giacome C. Côté cour et côté jardin
- Hugo PRATT, Corto Maltese, La favola di Venezia, Casterman
Quelques poètes vénitiens
- Anthologie : Venezia nel canto de' suoi poeti, Raffaello BARBIERA, 1925
- Giorgio BAFFO (1694-1768), Poésies, trad. Apollinaire, Paris 1910
- Luciano MENETTO (1956 - ), poète en vénitien et italien
- Patrizia VALDUGA, poétesse contemporaine
- Andrea ZANZOTTO, Poesie 1938-1972, Mondadori, 1987
Carnaval
- Josyane et Alain CASSAIGNE, Carnaval de Venise, Buchet Chastel, 1999
- Véronique DELLA VALLE, Carnaval à Venise, Albin Michel-Jeunesse, 1993
- Christophe FOUGLÉ, Regards vénitiens : carnaval de Venise, Hermé, 1997
- Robert de LAROCHE, Venise : Carnaval secret, La Renaissance du livre, 2002
- Gérard LEDIG, Sous les fenêtres du Doge, Saint-Cyp, 2002
- Paul LUTZ, Masques de Venise, Chêne, 1995
- Giovanna PASTEGA, Venise, l'esprit du carnaval, Gründ, 2000
- Danilo REATO, Histoire du carnaval de Venise, Oréa, 1991
- Danilo REATO, Les masques de Venise, Herscher, 1991
- Xavier RICHER, Masques de Venise, Plume, 1997
Éditeurs vénitiens
- Filippi Editore, Castello, Casselleria 5284 -30122 Venezia
- Castello, Calle del Paradiso 5763 - 30122 Venezia
- Edizioni Centro Internazionale della Grafica, Campo Sant'Angelo, San Marco 3943
- Il dilettevole gioco del pesse, livre-jeu publié en 2002
- Marsilio Editori, Venezia
Mise à jour : 14 août 2016
Notes sur l’art à Venise
 (Giovanni Bellini, Trasfigurazione sacra, 1504, Florence, Musée des Offices)
(Giovanni Bellini, Trasfigurazione sacra, 1504, Florence, Musée des Offices)
1. Le caractère unique de la peinture vénitienne
a) Couleur et lumière
"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers. La couleur à Venise n'est pas le complément du trait ... ; c'est parce que les artistes vénitiens ont accordé moins de part que les Florentins à la connaissance des coordonnées mathématiques et à l'ordre abstrait d'une logique de la perception, qu'ils ont élaboré un art original, sensible, plus attaché à l'ordre émotif. L'art vénitien n'est pas le simple prolongement du style de Florence... L'emploi original de la couleur suit chez les Vénitiens une conception originale de la lumière - qui est sans doute leur véritable apport créateur.... Une nouvelle et complète expérience esthétique se développe et non l'enrichissement de l'ancienne.... L'art de Venise exprime les valeurs et les pouvoirs d'une société originale dans tous les domaines.... La beauté de Venise n'est pas une beauté de carte postale plus ou moins richement colorée ; c'est une beauté virile qui témoigne de la grandeur d'un groupe d'hommes qui a su déterminer à tous les échelons et dans tous les domaines de son activité, des conduites indépendantes, des formes d'action efficaces. Aucun rapport entre les liens de Venise avec l'Orient ou avec l'Europe du Nord et ceux des autres cités italiennes entre elles. Aucun rapport entre la manière dont fut assimilée la Contre-Réforme ici et ailleurs. La toujours laïque Venise eut le privilège insigne de donner dans ses conseils moins de place que toute autre cité aux militaires et aux prêtres et elle dut sans doute à cette sagesse exceptionnelle la durée de sa grandeur. Le génie de Venise s'exprime, à la fois, dans sa conduite comme cité et dans une production artistique non soumise aux lois d'une logique abstraite ou d'une économie, mais véritablement complémentaire des autres entreprises du temps."
(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)
b) Décalage chronologique
Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités. Par exemple Venise est encore dépendante de l'art byzantin au XIVe siècle alors qu'il a été abandonné depuis longtemps ailleurs ; c’est un phénomène lié au rapport privilégié de Venise avec l'Orient et à la conquête tardive de la terre ferme.
c) Venise, carrefour de cultures
Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient et elle reste en relation étroite avec le monde islamique même après la chute de Byzance en 1453, elle en importe les objets précieux, les tissus, les tapis. Mais, à proximité des cols alpins, elle commerce aussi très tôt avec l'Europe du Nord, Bourgogne, France, Pays-Bas, Allemagne. Enfin sa situation à l'extrémité de la plaine du Pô lui permet d'entrer en rapport avec Florence et Rome par les Marches, et avec l'Italie du Nord. Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.
1. Le caractère unique de la peinture vénitienne
a) Couleur et lumière
"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers. La couleur à Venise n'est pas le complément du trait ... ; c'est parce que les artistes vénitiens ont accordé moins de part que les Florentins à la connaissance des coordonnées mathématiques et à l'ordre abstrait d'une logique de la perception, qu'ils ont élaboré un art original, sensible, plus attaché à l'ordre émotif. L'art vénitien n'est pas le simple prolongement du style de Florence... L'emploi original de la couleur suit chez les Vénitiens une conception originale de la lumière - qui est sans doute leur véritable apport créateur.... Une nouvelle et complète expérience esthétique se développe et non l'enrichissement de l'ancienne.... L'art de Venise exprime les valeurs et les pouvoirs d'une société originale dans tous les domaines.... La beauté de Venise n'est pas une beauté de carte postale plus ou moins richement colorée ; c'est une beauté virile qui témoigne de la grandeur d'un groupe d'hommes qui a su déterminer à tous les échelons et dans tous les domaines de son activité, des conduites indépendantes, des formes d'action efficaces. Aucun rapport entre les liens de Venise avec l'Orient ou avec l'Europe du Nord et ceux des autres cités italiennes entre elles. Aucun rapport entre la manière dont fut assimilée la Contre-Réforme ici et ailleurs. La toujours laïque Venise eut le privilège insigne de donner dans ses conseils moins de place que toute autre cité aux militaires et aux prêtres et elle dut sans doute à cette sagesse exceptionnelle la durée de sa grandeur. Le génie de Venise s'exprime, à la fois, dans sa conduite comme cité et dans une production artistique non soumise aux lois d'une logique abstraite ou d'une économie, mais véritablement complémentaire des autres entreprises du temps."
(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)
b) Décalage chronologique
Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités. Par exemple Venise est encore dépendante de l'art byzantin au XIVe siècle alors qu'il a été abandonné depuis longtemps ailleurs ; c’est un phénomène lié au rapport privilégié de Venise avec l'Orient et à la conquête tardive de la terre ferme.
c) Venise, carrefour de cultures
Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient et elle reste en relation étroite avec le monde islamique même après la chute de Byzance en 1453, elle en importe les objets précieux, les tissus, les tapis. Mais, à proximité des cols alpins, elle commerce aussi très tôt avec l'Europe du Nord, Bourgogne, France, Pays-Bas, Allemagne. Enfin sa situation à l'extrémité de la plaine du Pô lui permet d'entrer en rapport avec Florence et Rome par les Marches, et avec l'Italie du Nord. Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.
2. Des origines au XIVe siècle : un art importé de Byzance
Dès son origine, la ville a eu le goût de s'embellir, mais jusqu'au premier quart du XIVe siècle, elle importe de Byzance "des modèles, des idées, des artistes et des objets d'art".
(Cf. Galienne Francastel, Op. cit., p. 17. Sur Paolo Veneziano, voir : Filippo Pedrocco, Paolo Veneziano, La Renaissance du Livre, 2003, 224 p., 69,50€).
Les grandes villes italiennes ont depuis le début du XIIIe siècle des peintres autochtones qui ont gardé la technique byzantine mais se sont écartés des valeurs transmises à l'Occident par les moines grecs réfugiés en Italie au temps des persécutions iconoclastes (majesté divine, immobilité du monde divin et humain gouverné par des empereurs investis par Dieu ...), au profit d'un univers religieux plus perméable aux réalités humaines (réalisme du Christ de Douleur, apparition des saints contemporains, humanité de la Vierge mère...). Venise au contraire, bien qu’indépendante à partir du VIIIe siècle, importe de Byzance et les contenus et les artistes. Ce n'est pas par ignorance des courants européens (Venise commerce déjà avec l'Europe entière) mais par choix d'un rapport privilégié à Byzance.
Les mosaïques de la Basilique Saint Marc en sont le meilleur exemple ; l'architecture suit la même inspiration : la basilique est largement inspirée de l'église des Saints-Apôtres de Byzance, les matériaux sont importés d'Orient, les chevaux de la façade, les émaux de la Pala d'oro, les objets précieux du trésor viennent de Constantinople.
La mosaïque est l’art dominant. Venise hérite de la mosaïque byzantine plus que de la mosaïque romaine. La basilique Saint-Marc est couverte de plus de 4000 m2 de mosaïques qui illustrent l’Ancien Testament dans le narthex, et le Nouveau Testament dans l’intérieur, avec des scènes de la vie de saint Marc et des principaux saints vénérés à Venise.
Le changement d'orientation commence à se manifester en 1268 (décret enjoignant de former des mosaïstes sur place) et en 1308 (création à Murano des ateliers de verrerie chargés de fabriquer les cubes de verre dont on fait les mosaïques) : c'est le moment où Venise amorce une politique de conquête de la terre ferme. Vers 1310, le Podestà de Murano commande un retable pour la cathédrale à un peintre vénitien, maître Paolo. En 1340 on reconstruit le Palais des Doges en style gothique et en 1365 le décor sculpté de la façade de Saint-Marc en gothique également. Un art local est né.
Voir :
* L'art de la mosaïque à la Basilique Saint-Marc
* Les mosaïques de Torcello : Vierge à l'enfant dans l'abside
* Jugement dernier (revers de la façade)
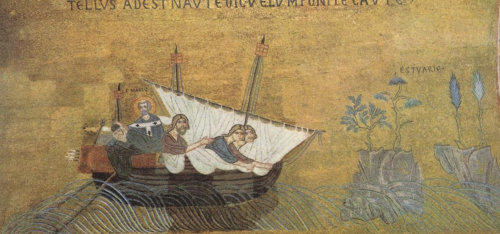
1. Le caractère unique de la peinture vénitienne
a) Couleur et lumière
"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers..."
(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)
b) Décalage chronologique
Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités...
c) Venise, carrefour de cultures
Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient... Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.
2. Des origines au XIVe siècle : un art importé de Byzance
Dès son origine, la ville a eu le goût de s'embellir, mais jusqu'au premier quart du XIVe siècle, elle importe de Byzance "des modèles, des idées, des artistes et des objets d'art".
(Cf. Galienne Francastel, Op. cit., p. 17. Sur Paolo Veneziano, voir : Filippo Pedrocco, Paolo Veneziano, La Renaissance du Livre, 2003, 224 p., 69,50€).
Les grandes villes italiennes... Venise au contraire... mais par choix d'un rapport privilégié à Byzance.
Les mosaïques de la Basilique Saint Marc en sont le meilleur exemple...
La mosaïque est l’art dominant... avec des scènes de la vie de saint Marc...
Le changement d'orientation commence à se manifester en 1268... Un art local est né.
Voir :
* L'art de la mosaïque à la Basilique Saint-Marc
* Les mosaïques de Torcello : Vierge à l'enfant dans l'abside
* Jugement dernier (revers de la façade)
3. Le premier peintre vénitien : Paolo Veneziano et les nouveaux thèmes de la peinture
PAOLO VENEZIANO (vers 1290-1362) inaugure cet art nouveau... jusqu'en 1362. Avec lui apparaissent dans la peinture de nouveaux thèmes que Galienne Francastel identifie au nombre de cinq :
a) L'apparition de saints modernes
Ignorés de Byzance : François, Dominique, Antoine de Padoue, Thomas d'Aquin, Martin de Tours... Saint Marc a remplacé saint Théodore comme patron de la ville.
b) Le thème du Couronnement de la Vierge
Ignoré de Byzance (et de la Bible ...), d'origine française et nordique, en liaison avec la poussée du culte marial... Le Triomphe de la Vierge est le Triomphe de la Femme, et donc le Triomphe de Venise.
c) La Remise des clés à Saint Pierre
Thème de combat de l'Église romaine qui affirme la primauté de la Papauté, dans un rétable de Lorenzo Veneziano.
d) Le Mariage mystique de Sainte Catherine
Très populaire dans la lagune, évoquée comme Fiancée du Christ.
e) La Vierge de l'Humilité
Un des autres thèmes majeurs des Ordres mendiants.
Galienne Francastel conclut : « La peinture à Venise répond à une nécessité historique liée à la conquête de la Terre Ferme et aux mouvements religieux qui, avec cette conquête, pénètrent dans la République » ; elle est née d'un besoin « iconographique et non pas esthétique ».
Voir à l'Académie:
* le Polyptique du Couronnement de la Vierge (1354-8)
* Vierge à l'enfant avec deux donateurs (1335?)
Aux Frari : Vierge, Saints François et Elisabeth, le Doge Loredan et sa femme (1339)

1. Le caractère unique de la peinture vénitienne
a) Couleur et lumière
"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers..."
(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)
b) Décalage chronologique
Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités...
c) Venise, carrefour de cultures
Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient... Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.
2. Des origines au XIVe siècle : un art importé de Byzance
Dès son origine, la ville a eu le goût de s'embellir, mais jusqu'au premier quart du XIVe siècle, elle importe de Byzance "des modèles, des idées, des artistes et des objets d'art".
(Cf. Galienne Francastel, Op. cit., p. 17. Sur Paolo Veneziano, voir : Filippo Pedrocco, Paolo Veneziano, La Renaissance du Livre, 2003, 224 p., 69,50€).
Les grandes villes italiennes... Venise au contraire... mais par choix d'un rapport privilégié à Byzance.
Les mosaïques de la Basilique Saint Marc en sont le meilleur exemple...
La mosaïque est l’art dominant... avec des scènes de la vie de saint Marc...
Le changement d'orientation commence à se manifester en 1268... Un art local est né.
Voir :
* L'art de la mosaïque à la Basilique Saint-Marc
* Les mosaïques de Torcello : Vierge à l'enfant dans l'abside
* Jugement dernier (revers de la façade)
3. Le premier peintre vénitien : Paolo Veneziano et les nouveaux thèmes de la peinture
PAOLO VENEZIANO (vers 1290-1362) inaugure cet art nouveau... jusqu'en 1362. Avec lui apparaissent dans la peinture de nouveaux thèmes que Galienne Francastel identifie au nombre de cinq :
a) L'apparition de saints modernes
Ignorés de Byzance : François, Dominique, Antoine de Padoue, Thomas d'Aquin, Martin de Tours... Saint Marc a remplacé saint Théodore comme patron de la ville.
b) Le thème du Couronnement de la Vierge
Ignoré de Byzance (et de la Bible ...), d'origine française et nordique, en liaison avec la poussée du culte marial... Le Triomphe de la Vierge est le Triomphe de la Femme, et donc le Triomphe de Venise.
c) La Remise des clés à Saint Pierre
Thème de combat de l'Église romaine qui affirme la primauté de la Papauté, dans un rétable de Lorenzo Veneziano.
d) Le Mariage mystique de Sainte Catherine
Très populaire dans la lagune, évoquée comme Fiancée du Christ.
e) La Vierge de l'Humilité
Un des autres thèmes majeurs des Ordres mendiants.
Galienne Francastel conclut : « La peinture à Venise répond à une nécessité historique liée à la conquête de la Terre Ferme et aux mouvements religieux qui, avec cette conquête, pénètrent dans la République » ; elle est née d'un besoin « iconographique et non pas esthétique ».
Voir à l'Académie:
* le Polyptique du Couronnement de la Vierge (1354-8)
* Vierge à l'enfant avec deux donateurs (1335?)
Aux Frari : Vierge, Saints François et Elisabeth, le Doge Loredan et sa femme (1339)
4. L'arrivée du gothique avec Lorenzo Veneziano et les Vivarini
Venise avait su résorber et assimiler les mouvements hérétiques du XIVe siècle... Venise va devoir lutter sur les deux fronts, mais le glissement vers la terre ferme devient toujours plus sensible.
L'art reflète très bien ce compromis permanent entre Orient et Occident... GENTILE DA FABRIANO vient travailler à Venise, introduisant un style où Giotto se mêle aux influences siennoises : JACOBELLO DEL FIORE (1400-1439)...
Une autre école travaille dans ce sens autour des VIVARINI, à Murano... sa fille épouse GIOVANNI D'ALEMAGNA (1411-1450)...
Alvise travaille entre 1461 et 1505 et rejoint par contre l'école des Bellini... À cette période se trouve aussi Carlo CRIVELLI (1435-1495)...
Voir de Lorenzo :
* Polyptique Lion (1357-9) à l'Académie
* Mariage mystique de Sainte Catherine (1360) à l'Académie
* Polyptique de l’Annonciation (1371), Académie
de Jacobello del Fiore :
* Lion de Saint Marc (1415) au Palais des Doges
* Vierge de Miséricorde entre deux saints (1436) Académie
* Justice entre deux archanges (1421) Académie
de Guariento :
* Fresque du Paradis (1365) Palais des Doges, copie à l'Académie
de Catarino Veneziano :
* Couronnement de la Vierge (1375) Académie
de Stefano Veneziano :
* Couronnement de la Vierge (1381) Académie
d'Antonio Vivarini :
* 3 Retables (1443-4) à San Zaccaria
* Couronnement de la Vierge (1444) San Pantaleone
* Vierge en Majesté et 4 Pères de l'Eglise (1446) Académie
de Bartolomeo Vivarini :
* Vierge et saint (1464) Académie
* Vierge de la Miséricorde (1473) S. Maria Formosa
* Saints (1473) San Zanipolo
* Saints (1474) Frari
* Vierge et saints (1487) Triptyque des Frari
* Retable des tailleurs de pierre : Saint Ambroise entouré de 4 saints (1477) Acad.
* Madeleine et Sainte Barbe (1490) Académie
d'Antonio da Negroponte :
* Vierge sur le Trône (?) San Francesco della Vigna.
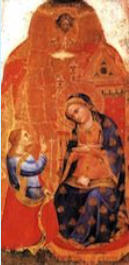

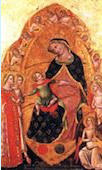



5. Les Bellini
Au XVe siècle, Venise reste encore fidèle au gothique international, lié à la présence d'artistes étrangers comme Gentile da Fabriano (1370-1427) et Pisanello (1395-1455, arrivé de Vérone en 1442) qui ornent la salle du Grand Conseil (fresques détruites dans l'incendie de 1577). Mais elle commence à s'ouvrir à l'influence de la Renaissance toscane, grâce à la présence de Paolo Uccello (1397-1475) vers 1427 et d'Andrea del Castagno (1419-1457) vers 1442.
Centre très important du commerce d'art, Venise connaît aussi dès le début du siècle le travail des peintres flamands qui apportent leur sens des détails de la vie quotidienne et du paysage ; vers 1475, Antonello da Messina (1430-1479) introduit la nouvelle technique de la peinture à l'huile. Enfin, Andrea Mantegna (1431-1506), formé à Padoue, introduit son sens de la perspective, sa culture humaniste, et son répertoire inspiré de l'antique. L'atelier des Bellini subira toutes ces influences.
Le père, Jacopo Bellini (1410-1470), a été l'élève de Gentile da Fabriano à Florence. Il possède à Venise un grand atelier qui a pour clients de grandes confréries religieuses et de nombreuses églises. Sa fille, Nicolosia, épouse Mantegna en 1453. Il travaille en collaboration avec ses deux fils :
- Gentile Bellini (1429-1506), surintendant aux peintures du Palais des Doges, célèbre jusqu'à Constantinople pour ses portraits. Il abandonne une représentation idéologique au profit d’une représentation réaliste.
- Giovanni Bellini (Giambellino, 1430-1516), qui possède un atelier indépendant et travaille souvent avec son frère. Commandes de la Scuola de Saint-Marc après la mort de Gentile. Il reçoit à la fin de sa vie les leçons de Giorgione et du jeune Titien.
Voir :
- Gentile :
- Procession sur la Place Saint-Marc (1496, Académie)
- Miracle de la Croix : Pietro dei Ludovici guéri de la fièvre (1496, Académie)
- La Croix repêchée dans le Canal (1500, Académie)
- Giovanni :
- Christ mort soutenu par la Vierge et Saint Jean (1472, Palais des Doges)
- Triptyque de la Vierge, Christ mort (1462, Académie)
- Polyptique de Saint Vincent Ferrier (1465, San Zanipolo)
- Retable de Saint Job (1478 ?, Académie)
- Sainte conversation (vers 1502, Académie)
- Retable (pala) de San Zaccaria (1505)
L’évolution de Giovanni Bellini est marquée par le passage d’Antonello da Messina, dont le Retable de San Cassiano est présenté à Venise en 1476. Bellini en retire des enseignements techniques (glacis, superposition des couleurs sans mélange) utiles pour son propre traitement de la lumière.
Lorsque meurt Bellini, trois voies s’ouvrent avant que le Titien ne domine la scène picturale :
- l’une, issue des sources traditionnelles (Vivarini), continuée par Crivelli ;
- l’autre, amorcée par Giovanni Bellini, poursuivie par Carpaccio ;
- une troisième enfin, issue des recherches de Giambellino, reprise par toute une série de peintres dominés bientôt par le génie de Giorgione.
(Galienne Francastel, L’art de Venise, op. cit. p. 68. Sur Giovanni Bellini, voir : Mauro Lucco et Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Giovanni Bellini, Silvana Editoriale, Catalogue de l’exposition des Scuderie Reali del Quirinale, Rome, septembre 2008-janvier 2009, 2008, 384 pages).
Nous avons parlé plus haut de Crivelli, voyons maintenant Carpaccio.




6. Vittore Carpaccio (1460 ?- 1525 ?)
Un des peintres les plus fascinants de Venise, encore inspiré par les romans de chevalerie, le merveilleux chrétien et la Légende dorée de Jacopo da Varazze dont la traduction est publiée à Venise en 1475. Peintre d'un Orient féérique dont les architectures sont celles de Venise, il a assimilé le sens de l'espace de Piero della Francesca (peut-être à travers les enseignements du mathématicien Luca Pacioli), mais aussi les techniques d'Antonello da Messina, les paysages de Cima da Conegliano (actif à Venise entre 1492 et 1516), les collections privées de peintres flamands, etc.
Sa première oeuvre est la Légende de Sainte Ursule, pour une petite « Scuola » fondée le 15 juillet 1300 près de San Zanipolo, destinée à accueillir les tombes d’une grande famille vénitienne, les Loredan. En 1488, il fut décidé de l’orner de fresques demandées à Vittore Carpaccio. La chapelle fut restaurée à plusieurs reprises, supprimée en 1806 par Napoléon avec les autres institutions religieuses, et l’édifice fut incorporé dans le nouveau couvent des Dominicains, tandis que les 8 fresques de Carpaccio furent réinstallées en désordre au Musée de l’Académie en 1818. Elles s’inspirent de la vie de Sainte Ursule écrite par Jacques de Voragine.
(Jacques de Voragine, La Légende dorée, GF Flammarion, 1967, Tome 2, pp. 294-8. Les onze mille vierges. La légende de Sainte Ursule (« la petite ourse ») a été très populaire au moyen-âge à partir du IXe siècle, où une pierre tombale à son nom est découverte à Cologne. Ursule est protectrice de Cologne, de la Sorbonne, des drapiers, de la vertu des jeunes filles et à la source de l’ordre des Ursulines, créé à Brescia en 1535 par Sainte Angèle Merici).
Le travail fut réalisé entre 1490 et 1495, en commençant par l’Arrivée de Sainte Ursule à Cologne. Par la suite, Carpaccio travailla pour plusieurs scuole, en général de petite importance, celle des Albanais, celle des Lanieri (les artisans de la laine), celle de San Giorgio degli Schiavoni ou des Dalmates, fondée en 1451, où il peint de 1502 à 1507 la vie de Saint Georges, de Saint Jérôme et de Saint Tryphon.
À ne pas manquer absolument :
- Le cycle de Sainte Ursule (1490-1495, Académie), d'après le récit de Jacques de Voragine, "Les onze mille vierges".
- Le cycle de San Giorgio degli Schiavoni : légende de Saint Georges et Vision de Saint Augustin (Saint Jérôme dans son cabinet de travail) (1502 et 1507), Scuola de San Giorgio degli Schiavoni.
(Sur Carpaccio, voir : Michel Serres, Esthétiques sur Carpaccio, Collection Savoir, Hermann 1975 et Terisio Pignatti, Carpaccio, BMM CDIX, 1955).


7. Giorgione (vers 1476-1510)
Il éclipse dès sa mort les peintres qui continuaient la manière de Bellini et sera beaucoup imité. Parmi ses élèves, Palma il Vecchio (1480-1528) et Sebastiano del Piombo (1485-1547) qui termina Les trois philosophes. Originaire de Castelfranco Veneto, il serait né de l’union d’une paysanne et d’un patricien vénitien de la famille Barbarelli, surnommé « Giorgione » (« le beau Georges »). Il aurait aussi été musicien, pratiquant le luth et le chant.
Peu d’informations sont certaines à son sujet, il ne signait pas ses oeuvres, dont peu sont indiscutablement attribuées. Il meurt jeune, emporté par une épidémie de peste qu’il aurait contractée auprès d’une femme très belle qu’il aimait. Il aurait été l’élève de Giovanni Bellini, aux côtés du Titien, plus jeune que lui, dont il devint le maître.
Il est probablement le porteur d’une nouvelle vision du monde à Venise, qui se développait dans le milieu aristocratique. À cette époque, les patriciens vénitiens développent une culture classique, en aidant notamment Alde Manuce (1449-1515), grand imprimeur et inventeur de la typographie grecque. Manuce fonde une académie à Venise, la Société des Philhellènes, rassemblant les meilleurs intellectuels de la ville.
Giorgione participe probablement à ces réflexions autour des textes grecs. Il exprime ces influences dans son tableau Les Trois Philosophes (1508-1510, Vienne). Chaque figure incarnerait un courant de pensée : l’aristotélisme traditionnel, l’aristotélisme humaniste et une tendance nouvelle vouée au culte de la nature.
Peintre mythique et très laïque, Giorgione a peu abordé les thèmes religieux. Il est le peintre des paysages, des portraits, comme La Vecchia (1508, Académie, Venise). Il peint « pour la peinture », non pour l’Église. Son influence est immense sur ses contemporains et ses successeurs.
(Sur Giorgione, voir : Salvatore Settis, L’invention d’un tableau. « La tempête » de Giorgione, Ed. de Minuit, 1987 ; Terisio Pignatti et Filippo Pedrocco, Giorgione, Liana Levi, 1999 ; Mauro Lucco, Giorgione, Gallimard, 1997 ; Virgilio Lilli, Giorgione, l’opera completa, Classici dell’Arte Rizzoli, 1968).
Disciples et imitateurs : Giulio Campagnola, Vincenzo Catena, Cima da Conegliano, Bernardino Licinio, Sebastiano del Piombo, Dosso Dossi, Lorenzo Luzzi, Palma il Vecchio, Pordenone, et ... Le Titien.



8. Tiziano Vecellio = Titien (1487-1576)
Il commence par travailler aux côtés de Giorgione dans l’atelier du Fondaco dei Tedeschi, en 1508, et il aurait terminé sa Vénus endormie. L’attribution de beaucoup d’oeuvres reste incertaine entre lui et Giorgione, mais de plus en plus, on attribue ces oeuvres (Concert champêtre, ...) à Giorgione. À la différence de Giorgione, il a peu de culture générale, ne sait pas le latin, et ne s’intéresse qu’à la peinture : c’est un peintre pur-sang dont la robe rouge de son Assomption de l’église des Frari (1516-1518) est le meilleur symbole.
En 1511, il peint des fresques à Padoue, puis revient à Venise où il est nommé peintre officiel de la République après la mort de Giovanni Bellini en 1516. Il ouvre un atelier où passent des peintres comme le Tintoret et Le Greco. Il travaille pendant dix ans à Ferrare puis à Mantoue. À partir de 1530, il commence à peindre des portraits, de femmes en particulier (Vénus d’Urbin, 1538, Musée des Offices de Florence). En 1530, il rencontre Charles-Quint, dont il fait le premier portrait (Portrait de Charles-Quint, 1532-1533, Madrid, Prado) et, à partir de ce moment, il travaille pour tous les princes européens, pour les papes, pour le roi de France et pour les doges de Venise, réalisant portraits, peintures mythologiques (bacchanales) et religieuses.
Charles-Quint le nomme Comte Palatin et Chevalier de l’Éperon d’Or ; il aura ensuite la faveur de son fils, l’empereur Philippe II. Ainsi, son métier de peintre lui permet de faire une grande carrière européenne, qu’il fait partager à ses fils. Le statut du peintre a maintenant changé, il n’est plus celui qui travaille pour une collectivité à orner une église ou un autre lieu fixe ; maintenant, le peintre est une personnalité indépendante qui travaille pour des princes et dont les tableaux alimentent des collections privées, et ont une valeur en eux-mêmes. La peinture commence à se commercialiser, et le marché de la peinture à apparaître.
Dans la dernière partie de sa vie, Titien, désormais consacré, laisse réaliser la plupart des commandes par son atelier : « Il peint désormais pour lui-même, sans tenir compte des commandes. Il ne pense qu’à son nouveau procédé, qui d’ailleurs est beaucoup plus qu’un simple procédé : une nouvelle manière d’interpréter le monde visuel. Le monde est un perpétuel changement où tout se commande intimement. Les formes, les couleurs, les lumières, ne sont pas des entités distinctes. Elles nous apparaissent en fonction les unes des autres et on ne les isole qu’en perdant une partie de leur substance vivante. Titien a entrevu, dans son intuition d’artiste, ce que les savants ne viendront à expliquer que deux siècles et demi plus tard et c’est pourquoi, quand on aura remis au rancart tout le côté rhétorique de la Renaissance, son œuvre restera vivante ».
(Fabienne Francastel, L’art de Venise, op. cit. p.137. Sur Titien, voir en particulier : Corrado Cagli, L’opera completa di Tiziano, Classici dell’Arte Rizzoli, 1969).



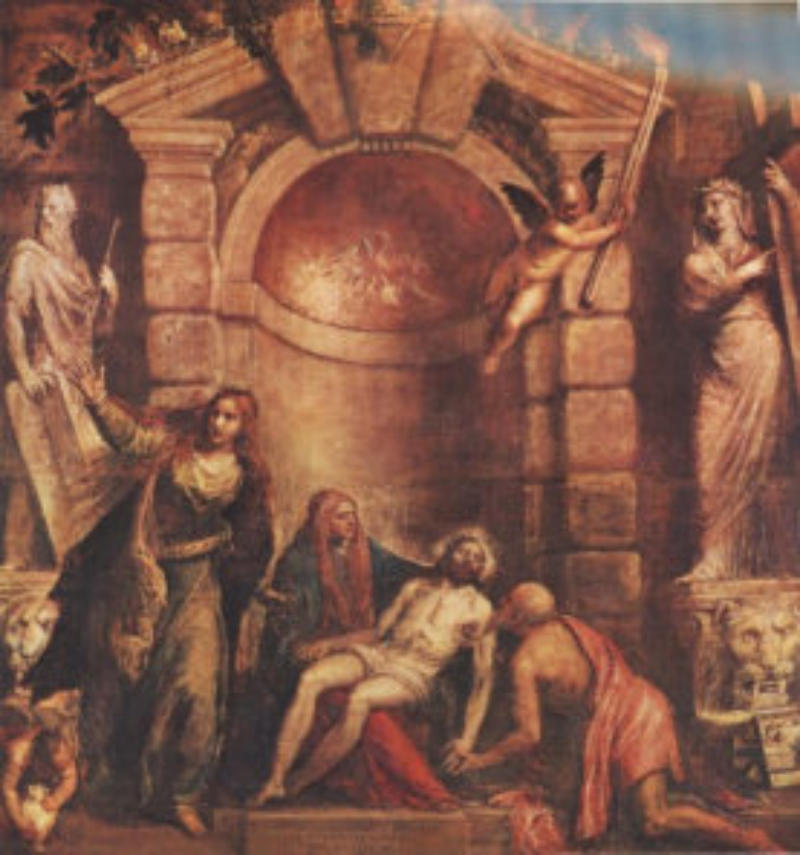
9. Jacopo Robusti = Tintoret (1518-1594)
Malgré les Bacchanales et les nus du Titien et le développement des études grecques à Venise, l’art de la ville s’ouvre peu à la mode romaine antiquisante. Tintoret, élève mal-aimé de Titien, mène le combat contre l’antique, c’est un moderne non-antiquisant : à part quelques toiles du Palais Ducal, il ignore l’antique. Il est appelé le Tintoret (le petit teinturier) du fait du métier de son père Giovanni Battista qui exerçait l’art de teindre les tissus de soie, comme c’était l’habitude du temps. Sur un de ses tableaux figure un dessin représentant une roue qui suggère les petits moulins utilisés pour brasser les tissus en teinture.
Il était capable de travailler très vite, comme le montre sa capacité à conquérir les commandes sur ses concurrents : pour le plafond de l’Albergo de la Scuola di San Rocco, il présenta la toile terminée alors que les autres peintres n’avaient encore qu’un dessin ! De même il plaça une toile de 12 mètres par 5 pour gagner la bataille de la Crucifixion sur son ancien maître Titien, dans la même Scuola.
Il vit dans un temps dramatique et mouvementé : il naît un an après que Luther eût affiché ses 97 Thèses ; de 1519 à 1522, Magellan part pour son tour du monde ; la tension est grande entre Espagne et France, entre Venise et Turquie, entre Réforme et Contre-réforme, qui provoque une crise culturelle intense. Parmi les religieux spirituellement ou physiquement très présents à Venise, il y eut Charles Borromée, Ignace de Loyola et le théologien capucin Mattia da Salò (1535-1611).
Tintoret contemple donc un monde qu’il traduit en « fables dramatiques qui se déroulent dans une scénographie d’ombre et de lumières qui virent rapidement » (Roberto Longhi).
(Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, 1946, cité par Carlo Bernari, L’opera completa del Tintoretto, Classici dell’Arte Rizzoli, 1970, p. 12. Sur la vie du Tintoret et la Venise de son siècle, lire le roman de Melania Mazzucco, La lunga attesa dell’angelo, Rizzoli 2008 ; traduction : La longue attente de l’ange, Flammarion, 2013).
Tintoret passe pratiquement toute sa vie à Venise, travaillant pour le Palais Ducal (scènes de l’histoire et de la grandeur de Venise, dont un Paradis qui est la plus grande fresque du monde, 197 m2), pour des églises (plus de 120 toiles en 50 ans d’activité) et pour des Scuole (Scuola Grande di San Marco, Scuola della Trinità, et Scuola Grande di San Rocco dont il peint les 56 grandes toiles). Ses thèmes religieux préférés seront l’invitation à l’humilité et à la prière guidée par la foi, les mystères de la vie et de la passion du Christ, le culte des saints et de la Vierge. Il illustre aussi la légende de saint Marc pour la Scuola Grande di San Marco.
Il se marie en 1550 et il a trois fils et cinq filles. Son atelier est un des premiers exemples de bottega familiale indépendante, où il travaille surtout avec ses deux fils, Domenico et Marco, et sa fille Marietta. Avec le Tintoret, le statut de l’art change, et le concept moderne d’artiste commence à apparaître.
À partir de 1564, Tintoret se fait attribuer la décoration de la Scuola San Rocco, reconnue par le Conseil des Dix en 1478, et la seule que Napoléon n’ait pas fait détruire ; la confrérie continue à se réunir aujourd’hui. Ces fresques sont un bon exemple de son inspiration.
Salle inférieure
Détruire en nous le péché qui nous détourne de Dieu et amener l'âme à y renoncer = pénitence : Annonciation = décor humble, pauvre et en ruines (conséquence du péché) → résolution de ne plus pécher garantie par l'Ange et la Vierge ; Adoration des mages ; Fuite en Égypte : paysage peut-être influencé par Dürer ; Massacre des Innocents : violence des corps inspirée de Michel-Ange et Giambologna ; Sainte Marie-Madeleine lisant et Sainte Marie l’Égyptienne en méditation = rappel du péché et de la pénitence ; Présentation au Temple et Circoncision = souffrance ; Assomption de la Vierge = récompense.
Grande salle
Concordance entre l'Ancien Testament (plafond) et le Nouveau Testament (murs) selon l'ordre des Exercices de Saint Ignace.
- Semaine 1 : guérison de la faim – activité caritative : Miracles du pain ; Récolte de la manne au centre entourée de scènes préfigurant le Christ ; sur les murs : multiplication des pains, prière à Gethsémani, résurrection de Lazare, Cène.
- Semaine 2 : guérison de la soif – Miracles de l'eau : Moïse et le rocher, péché originel (symétrique à la Pâque), passage de la Mer Rouge ; sur les murs : Nativité, baptême, miracle de Bethseda, tentation du Christ.
- Semaine 3 : Passion du Christ : Pilate, couronnement d’épines, montée au Calvaire, Crucifixion + Gloire de Saint Roch au plafond entourée des saisons et des Scuole.
- Semaine 4 : guérison de la maladie : serpent d’airain = préfiguration de la croix (Jean 3, 14-15), entouré d'épisodes salvateurs de l’Ancien Testament ; sur les murs : Résurrection et Ascension.
Sur un petit côté : Saint Roch et Saint Sébastien sont spectateurs : ils libèrent les hommes de la maladie. L’ensemble est un grand programme de la Contre-Réforme, adapté à Venise. Tintoret dépasse ce cadre sectaire : sa peinture se situe sur un plan supérieur, dramatique, proche du Tasse. Il devine la tension du siècle.
Jean-Paul Sartre, dans Les Temps modernes (1957) repris dans Situations IV, Gallimard, 1964, pp. 291-346, « Le séquestré de Venise », fait l’éloge de Tintoret contre Titien.





10. Paolo Caliari = Véronèse (1528-1588)
À cette époque, Venise eut de nombreux peintres, nés sur place ou venus de l’extérieur : Venise comptait plus de 100 palais dont les patriciens faisaient décorer l’intérieur et la cour, et on faisait appel aux meilleurs peintres. Marco Basaiti (1470-1530), Girolamo Campagna (1548-1625), Lorenzo Lotto (1480-1556), Paris Bordone (1495-1570), Bonifacio de’Pitati (1487-1553), Sebastiano Mariano da Lugano (fin XVe-début XVIe siècles), Giovan Antonio de’ Sacchis dit le Pordenone (1483-1539), Giovan Gerolamo Savoldo (1480-1548), Giambattista Ponchino (vers 1500-1570), Giambattista Zelotti (1526-1578) qui réalise des fresques avec Véronèse, Domenico Riccio (1516-1567), Francesco Salviati (1510-1523) mais un troisième grand peintre marque l’histoire de la peinture vénitienne : Paolo Veronese.
Goethe avait été fasciné par Veronese ; il en écrit ceci après avoir vu un tableau de lui (La famille de Darius devant Alexandre) : « Le don que j’ai depuis longtemps de voir le monde par les yeux du peintre dont je viens de graver les images dans mon esprit, m’a conduit à une pensée particulière. Il est évident que l’oeil se forme d’après les objets qu’il voit dès sa jeunesse, et c’est pourquoi le peintre vénitien doit voir toute chose dans une lumière plus éclairée et plus sereine que d’autres hommes... ».
Goethe poursuit : « ...Lorsque je traversais les lagunes par le plein soleil et que je considérais sur les bords des gondoles les gondoliers aux vêtements bariolés, ramant et avançant d’une course légère, se dessinant dans l’air bleu et sur la surface vert clair, je vis le meilleur et le plus frais tableau de l’école vénitienne. La lumière du soleil donnait aux couleurs locales un éclat aveuglant et les ombres étaient si lumineuses que, toutes proportions gardées, elles auraient pu, à leur tour, servir de lumière. »
« ...Il en était de même du reflet de l’eau glauque – tout était clair sur un fond clair – si bien que les vagues écumeuses et les scintillements de la lumière sur elles étaient nécessaires pour mettre le point sur l’I. Titien et Paul Véronèse possédaient cette luminosité au plus haut point, et quand on ne la trouve pas dans leurs tableaux, c’est que la toile a perdu ou qu’on l’a restaurée ». (Goethe, Voyage en Italie, Tome I, Aubier-Montaigne, 1961, p.177.)
Cette remarque vaut parfaitement pour Veronese, ainsi que celle où Goethe insiste sur le lien entre Véronèse et Palladio : la lumière et l’architecture sont deux éléments essentiels de la peinture de Véronèse. Originaire de Vérone, fils d’un tailleur de pierres, il se forme dans l’atelier d’Antonio Badile et de Giovanni Caroto à Vérone, mais il est surtout formé et protégé par l’architecte Michele Sanmichele.
Il va donc peindre des architectures antiques et les animer de personnages vénitiens habillés de somptueuses couleurs. Il est par conséquent à l’opposé de Tintoret qui se débarrasse très vite des architectures. Véronèse va résider à Venise dès 1553 ; il y passe toute sa vie, à part un bref séjour à Rome en 1560-1. Il décore l’église de San Sebastiano, la villa Barbaro à Maser, la salle du Conseil des Dix au Palais Ducal, et il peint de nombreuses fresques, portraits, tables d’autel.
« Le décor de la villa Barbaro, à Maser près de Trévise, qui alterne paysages, scènes de genre, trompe-l’oeil et couronnes d’allégories radieuses dont la blondeur pâle s’anime au contact des bleus, marque de la manière la plus heureuse l’accession de Paolo à la pleine disposition de ses moyens ». (Galienne Francastel, L’art de Venise, p. 164.)
Il a plusieurs fils, dont deux travailleront avec lui et continueront son atelier. Il est l’auteur de 4 grandes Cènes qui lui attireront parfois l’hostilité des religieux : l’une, pour le réfectoire des Dominicains à San Zanipolo, devra être changée de titre, s’appellera La Cène chez Lévi, et sera transférée à l’Académie ; l’Inquisition lui reproche la présence de personnages incompatibles avec le sujet, de chiens, de perroquets, de soldats allemands armés, etc. (1573).
Véronèse refusa par exemple de remplacer le chien par un portrait de Madeleine, revendiquant la « liberté » du peintre et se référant aux « nus » de Michelange dans le Jugement dernier de la Chapelle Sixtine. Il y aura une course à la Cène entre Véronèse et Tintoret : Véronèse peint les Noces de Cana (1562-3), une Cène chez Simon (1573), une Cène chez Lévi (1573). Tintoret peint au moins neuf Cènes entre 1547 et 1594.
Les beuveries, la violence de Tintoret et les chiens au premier plan n’ont jamais soulevé la moindre objection de l’Inquisition, qui craignait plus l’intrusion du profane dans le sacré chez Véronèse. En réalité, Véronèse est assez indifférent au trouble intellectuel et aux drames de son époque. Seules la peinture, la couleur l’intéressent. Comme écrit Francesco Valcanover : « Tandis que Titien s’enfermait dans un dramatique isolement... Paolo s’abandonne avec un génie inépuisable à son classicisme chromatique, auquel restent étrangers l’anxiété, les contrastes, les rêves tragiques et passionnés de l’époque » (Epoca).
Il faudrait aussi évoquer une autre famille de peintres importants, mais qui ont laissé peu d’oeuvres à Venise même, les Bassano, au moins trois générations de Da Ponte, dits Bassano du fait de leur origine et du lieu où ils travaillèrent surtout, la ville de Bassano del Grappa. Le premier, Francesco Bassano l’Ancien (1475-1530) se définissait comme « peintre paysan », peintre de village, bien qu’il eût subi l’influence de Giovanni Bellini.
C’est son fils, Jacopo Bassano (1515-1592) qui fut le plus connu, formé par Bonifacio de’ Pitati. Il travailla avec ses quatre fils : Francesco Bassano le Jeune (1549-1592), Giovanni Battista Bassano (1553-1613), Leandro Bassano (1557-1622) et Gerolamo Bassano (1566-1621). Leurs oeuvres sont dispersées dans le monde entier, un petit nombre subsiste à Venise.









11. Les peintres des XVIIe et XVIIIe siècles
On parle peu de la peinture vénitienne du XVIIe siècle, et il est vrai que ce siècle est pour l’Italie une période de décadence, économique, politique et culturelle. (Deux exemples : Le livre de Galienne Francastel s’arrête à la fin du XVIe siècle avec le chapitre sur Bassano. Le livre de Pierre Poirier, La peinture vénitienne, Albin Michel, 1953, 298 pages, saute sans transition du XVIe siècle à Tiepolo.)
André Chastel, dans le deuxième volume de son livre sur L’art italien, évoque le XVIIe siècle aussi en peinture, aux pages 176 et suivantes. Il faudrait parler d’abord d’un peintre comme Jacopo di Antonio Negretti, appelé Palma le Jeune (1544-1628), fils d’un autre peintre Antonio Negretti et petit-neveu de Palma il Vecchio (1480-1528). Après un séjour à Rome, il rentre à Venise en 1569 où il travaille avec les grands peintres du XVIe siècle au Palais Ducal après l’incendie de 1574 ; il peint aussi aux Frari, et décore tout un oratoire, l’Oratoire des Crociferi (1589-1592).
Un autre peintre à retenir est Alessandro Varottari, dit le Padovanino (1588-1649), qui connut le Titien à Padoue et resta son disciple ; d’origine padouane, il est à Venise à partir de 1620 (Voir à l’Académie ses Noces de Cana, de 1622 ; et son Rapt de Proserpine).
On pourrait évoquer aussi Antonio Vassilacchi (1556-1629), d’origine grecque, élève de Véronèse, qui laisse des oeuvres au Palais Ducal, à San Marziale, à San Giorgio Maggiore ; Pietro Liberi (1605-1687), un Padouan venu à Venise en 1643 (Voir son Serpent de bronze à San Pietro in Castello, son Annonciation à la Salute). Antonio Fumiani (1645-1710) décore l’église de San Pantaleone Martire.
Citons encore Carlo Saraceni (1579-1620), influencé par le Caravage, qui revient en 1619 à Venise (Voir son Saint François en extase à l’église du Redentore), Ermanno Stroifi (1616-1696). Luca Giordano (1632-1705) résida à Venise de 1653 à 1667 et laisse des Histoires de la Vierge à la Salute (1667).
Mais il faudrait citer surtout Domenico Fetti (1589-1624), romain venu à Venise en 1621, et y laisse des oeuvres à l’Académie ; le Flamand Giovanni Lyss (1600-1630 ?) ; le Florentin Sebastiano Mazza (1615-1685) ; le Génois Bernardo Strozzi (1581-1644), qui abandonne l’ordre capucin pour se livrer à la peinture. Réfugié à Venise en 1631, il laisse de nombreux portraits et fresques (à San Benedetto, au Palais Querini Stampalia, à San Niccolò da Tolentino, au Palazzo Donà, à la Libreria Marciana).
Il a peint environ 500 tableaux. Parce qu’étranger à Venise, il libère la peinture vénitienne du XVIIe siècle de l’influence du XVIe, contribuant à l’adoption du style baroque. Après lui, la peinture put se développer à nouveau, avec Pietro Muttoni, della Vecchia (1603-1678), élève de Padovanino ; devenu peintre officiel de la République, il réalisa des cartons pour les mosaïques de la cathédrale Saint Marc et peignit dans plusieurs églises de Venise.
Il laisse des Têtes de vieillards au Palais Querini Stampalia. Citons aussi Girolamo Forabosco (1605-1679), élève de Padovanino, dont le portrait du Doge Nicolò Sagredo est au Musée des Beaux Arts de Lyon. Il y en eut beaucoup d’autres : ce serait une erreur de négliger la peinture vénitienne du XVIIe siècle.
Les Tiepolo et les paysagistes (les « vedutisti ») du XVIIIe siècle
On connaît mieux les peintres du XVIIIe siècle qui, après la domination du clair-obscur baroque inspiré de Caravaggio, retrouva avec Tiepolo le goût de la couleur et de la lumière.
Il fut précédé de Sebastiano Ricci (1659-1734), originaire de Belluno, qui se forma et travailla d’abord à Venise, puis il dut en partir pour une affaire de moeurs, et il travailla pour différentes cours, d’Angleterre, d’Allemagne, de France ou de Turin. Il revint à Venise à partir de 1698, mais continua à travailler pour l’extérieur. On a des toiles de lui au Palais Ducal, au palais Sagredo (Campo S. Sofia), à l’église San Marziale, à San Stae, à San Vitale, aux Gesuati, à San Sebastiano et d’autres églises. Il fut un des grands peintres du XVIIIe siècle.
(De très nombreuses reproductions de ces peintres sont consultables sur Google, à leur nom.)
Un autre peintre important de l’époque fut Giambattista Piazzetta (1683-1754). Il est formé dans l’atelier de son père, qui était sculpteur, puis il part à Bologne et revient à Venise en 1711, et y réalise de grandes toiles (à San Stae, San Zanipolo – la Gloire de saint Dominique, 1727 – , Santa Maria della Fava – où il serait enseveli dans le tombeau de la famille Albrizzi –, à San Vitale et aux Gesuati et pour d’autres églises, dont l’Assomption de la Vierge, 1735, actuellement au Louvre), des cartons pour les mosaïques de Saint Marc et des gravures pour un éditeur (dont 70 dessins pour la Jérusalem délivrée du Tasse, en 1745 pour l’éditeur Giovanni Battista Albrizzi). Il est nommé directeur de l’École de nus de l’Académie vénitienne en 1750. Plusieurs de ses toiles sont à l’Académie et à Ca’ Rezzonico.
Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), élève de Gregorio Lazzarini, est influencé par Ricci et Piazzetta. Il devient célèbre à Venise par la série de grandes toiles qu’il peint pour Ca’ Dolfin. Il est appelé à décorer des couvents, des voûtes d’églises, des palais, à Venise, Milan, Bergame, Wurtzbourg, en Russie, en Angleterre, à Madrid où il meurt. Il fut aidé par deux de ses fils, Giandomenico et Lorenzo.
Parmi ses plus belles oeuvres, il faut voir ses grands cycles de fresques de Ca’ Rezzonico, à la Scuola dei Carmini, aux Scalzi, au palais Labia, aux villas Valmarana et Pisani. Tiepolo a donné un nouvel éclat splendide à la peinture vénitienne, un « Véronèse ressuscité ».
(Sur Tiepolo, on peut voir : Guillaume Cassegrain, Valentina Conticelli, José de Los Llanos et Stéphane Loir, L’ABCdaire de Tiepolo, Paris musées, Flammarion, 1998, 120 pages ; Filippo Pedrocco, Ca’ Rezzonico, Musée du XVIIIe siècle, Marsilio, 2001, 80 pages (en italien et en français) ; Guido Piovene et Anna Pallucchini, L’opera completa di Giambattista Tiepolo, Rizzoli, 1968, 302 pages.)
La peinture vénitienne du XVIIIe siècle est aussi enrichie par la foule de peintres qui travaillent autour de ces trois « grands » à Venise ou en Vénétie et à l’étranger où ils sont souvent appelés, comme Giambattista Pittoni (1687-1767), élève de son oncle Francesco Pittoni, cofondateur de l’Accademia delle Belle Arti, qui concurrence la Fraglia (la guilde) des peintres, et dont il devient président après la mort de Tiepolo.
Citons encore Jacopo Amigoni (1682-1752), Giustino Menescardi (1720-1806), le dalmate Federico Bencovich (1667-1753), Antonio Marinetti (Il Chiozzotto) (1710-1796), il y en eut beaucoup d’autres.
Mais plusieurs ont marqué l’époque, d’abord Pietro Longhi (1701-1785). « C’est Molière peintre, ou plutôt... Goldoni incisif et narquois », écrit André Chastel. (André Chastel, L’art italien, vol II, op. cit., p.182. Sur Longhi, voir Terisio Pignatti, L’opera completa di Pietro Longhi, Rizzoli Editore, 1974. Sur la peinture du XVIIIe siècle : Michael Levey, La peinture à Venise au XVIIIe siècle, traduit de l’anglais, Livre de poche illustré, Julliard, 1959).
Il peint en effet surtout de petites toiles réalistes de la vie vénitienne, faits divers, portraits, scènes de famille, qui donnent une idée précise de la Venise de l’époque. Goldoni a écrit sur lui le sonnet suivant, vers 1750 :
Sonetto in Italiano
Longhi, tu che la mia musa sorella
chiami del tuo pennel che cerca il vero
ecco per la tua man, pel mio pensiero
argomento sublime, idea novella.
Ritrar tu puoi vergine illustre e bella
di dolce viso e portamento altero ;
pinger puoi di Giovanni il ciglio arciero
che il dardo scocca alla gentil donzella.
Io canterò di lui le glorie e il nome,
la di lei fè, non ordinario vanto ;
e divise saran tra di noi le some.
Tu coi vivi colori, ed io col canto ;
io le grazie dirò, tu l’auree chiome ;
e del suo amor godran gli sposi intanto.
Traduction en français
Longhi, toi qui appelles ma soeur la muse
de ton pinceau qui cherche le vrai,
voici pour ta main, pour ma pensée
un argument sublime et une idée nouvelle.
Tu peux peindre une vierge aussi sublime que belle
de doux visage et de port altier ;
tu peux peindre de Juan le regard offensif
qui décoche son dard vers la noble donzelle.
Je chanterai de lui les gloires et le nom,
d’elle la foi, mérite peu ordinaire ;
et les fardeaux seront entre nous divisés.
Toi par tes vives couleurs et moi par le chant
moi je dirai ses grâces, toi ses cheveux dorés ;
cependant que les époux jouiront de son amour.
Une portraitiste vénitienne fut célèbre à Paris en 1720 et à Vienne en 1730, Rosalba Carriera (1675-1757) ; ses pastels firent fureur auprès de l’aristocratie et de la bourgeoisie européennes ; elle finit sa vie à Venise, aveugle. On peut voir plusieurs de ses oeuvres à l’Académie et à Ca’ Rezzonico.
Mais une des plus grandes nouveautés du XVIIIe siècle vénitien, ce sont les paysagistes, dont le plus important est Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto (voir le dossier) (1697-1768), fils du scénographe et peintre de décors de théâtre Bernardo Canal (d’où son nom), dont il fut d’abord l’élève et dont il se libéra sous l’influence de Luca Carlevaris (1663-1730), qui fut l’initiateur du « vedutismo » vénitien, dont on peut voir des paysages à San Pantaleone, au Palais Moro-Lin, à Ca’ Rezzonico, et des Scènes bibliques dans l’église de Saint Lazare des Arméniens.
Canaletto peint des vues de Venise qui rendent compte de façon admirable de l’atmosphère de la ville à cette époque ; invité à Londres de 1746 à 1753, il revint à Venise où il fut nommé à la chaire de Perspective de l’Académie des Beaux-Arts. Il utilisa la « u » pour mettre en perspective ses vues de canaux. Son oeuvre est dispersée dans le monde entier.
Bernardo Bellotto (1722-1780) travaille d’abord chez son oncle Canaletto, à Venise pendant plusieurs années, puis il sera demandé dans les cours d’Europe, dont Vienne, Dresde, St Pétersbourg et Varsovie où il mourra.
La peinture vénitienne du XIXe siècle se limitera la plupart du temps à une imitation des peintres védutistes du XVIIIe siècle, produisant des portraits, des vues de Venise, généralement peu originales. Même un peintre d’origine vénitienne comme Francesco Hayez (1791-1882) ne reste pas à Venise mais part à Rome, à Naples, puis à Milan où il sera nommé directeur de l’Académie de Brera en 1850 ; il peint surtout des nus et des scènes historiques : on connaît son Baiser de 1859.
On peut citer encore Giacomo Favretto (1849-1887), dont les scènes de famille peuvent rappeler Longhi (Voir ci-contre Musica in famiglia), ou Luigi Nono (1850-1918), le grand-père du musicien, peintre surtout religieux dont un tableau se trouve à Ca’ Pesaro.
Les plus grands peintres du XIXe siècle sont les étrangers, français ou anglais, qui se passionnent pour l’Italie : Corot, Turner, Monet, Signac, Marquet, Dufy... (Voir en particulier : Jacques Lassaigne, Présence de Venise, p. 105-137, in : Brunetti, Pignatti, Pallucchini, Lassaigne, Venise, Skira, 1956, des reproductions de tous ces peintres.)
Il y eut un renouveau à partir de 1870, qui apparut dans la Mostra Internazionale Veneziana de 1887. Le comte Serego, alors Maire de Venise, déclara dans son allocution d’ouverture :
« Ici où souffle encore une telle part du génie qui guida la main et prépara leurs teintes aux Bellini, à Carpaccio, à Titien, à Giorgione, à Paolo, à Tintoret, à toute la pléiade sacrée des imaginatifs et éclatants coloristes de l’École Vénitienne ; ici où dure et durera toujours le charme de cette antique sirène doucement bercée par les eaux paisibles de sa lagune ; dans ces horizons si orientaux et pourtant si italiens ; dans ce type persistant de grâce et de robuste tonalité, que les peintres puissent trouver inspiration et sujet et nouvelles hardiesses, qui rendent toujours plus splendide la couronne de l’art à la grande mère ressuscitée »
On ne peut que se référer à la grande tradition du XVIe siècle ! Venise fut par la suite le siège de la Biennale d’Art, à partir de 1895 ; la 54e Exposition Internationale d’Art s’y déroula du 4 juin au 27 novembre 2011. Elle se tient tous les deux ans dans les Jardins Publics de la rue Garibaldi, construits sur ordre de Napoléon en 1810, en démolissant tout un quartier populaire, un hôpital pour marins pauvres et plusieurs églises.
Citons pour le XXe siècle Giuseppe Santomaso (1907-1990), qui contribue en 1946 à la création à Venise du groupe progressiste Nuova Secessione Artistica Italiana, devenu le Fronte Nuovo delle Arti, avec Renato Guttuso, Renato Birolli, Emilio Vedova (1919-2006), autre peintre vénitien présent à la Fondation Peggy Guggenheim (sur le Canal Grande, au palais Venier dei Leoni), à visiter absolument durant un séjour à Venise.
On n’oubliera pas non plus la Galerie Internationale d’Art Moderne de la Ca’ Pesaro sur le Canal Grande.











12.- Deux mots sur l’architecture vénitienne
On sait peu de choses des premières constructions de Venise, de la première basilique San Marco en 832, des premières maisons autorisées par les « ducs » Orso Partecipazio (864-881) et Pietro Tribuno (881-912) ; on peut avoir une idée du développement de la ville par la fraction ci-contre du plan de Jacopo de’ Barbari de 1500, où l’on voit le travail de bonification de la Punta S. Antonio, au sud de San Pietro, le creusement de canaux et la construction de la « fondamenta ».
Le langage architectural de la ville devait déjà être fixé vers 1063, quand est réédifiée la basilique Saint Marc, où se mêlaient les souvenirs de l’époque romaine, les influences byzantines et les expériences des chantiers romanico-lombards. On a vu au début du dossier comment la ville fut divisée en 6 quartiers à partir de 1170. La carte des églises (p. 18) donne une idée de la ville au XIIe siècle. Le schéma de Ruskin sur les arcs vénitiens illustre un peu l’architecture de l’époque. (Voir : Giorgio Bellavitis et Giandomenico Romanelli, Le città nella storia d’Italia, Venezia, Laterza, 1985, 290 pages. p. 50 où est reproduit le schéma de Ruskin, et tous les premiers chapitres pour les débuts de Venise.)
Jusqu’à cette époque, on n’a guère de noms d’architectes dans les documents, mais seulement les noms des doges, patriciens ou ordres religieux qui ont fait construire l’édifice.
Les principaux édifices seront :
- Santa Maria dei Frari (1340-1440), construite pour les Franciscains
- San Zanipolo (1234-1430), pour les Dominicains
- Sant’Alvise (1388)
- Madonna dell’Orto (vers 1350)
- Fondaco dei Turchi (XIIIe siècle)
- Ca’ d’Oro et Ca’ Foscari (débuts du XVe siècle)
Les grands architectes vénitiens :
- Giovanni Bon (1355-1442) et Bartolomeo Bon (1410-1467) : Ca’ d’Oro, Porta della Carta du Palais Ducal
- Pietro Lombardo (1435-1515), père de Tullio (1455-1532) et grand-père de Sante (1504-1560)
- Mauro Coducci (1440-1504) : Scuola San Marco, San Michele in Isola, Tour de l’Horloge
- Giovanni Sansovino (1488-1570) : Palais Corner, Loggetta, Librairie Marciana
- Michele Sanmicheli (1484-1559) : Palais Corner-Mocenigo et Grimani, fortifications du Lido
- Andrea Palladio (1508-1580) : villas, San Giorgio Maggiore, Redentore
- Vincenzo Scamozzi (1548-1616) : Procuratie Nuove, San Nicola da Tolentino, San Giacomo di Rialto
- Baldassare Longhena (1598-1682) : Église de la Salute, Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro
- Giorgio Massari (1687-1766) : achève Ca’ Rezzonico, construit Palazzo Grassi
Architecture du XXe siècle :
Carlo Scarpa (1906-1978) : restaurations d’exposition (Académie, Ca’ Foscari, Correr, Querini-Stampalia, magasin Olivetti sur la place Saint-Marc en 1957-8). Voir sur le site Archiguide, rubrique Venise.

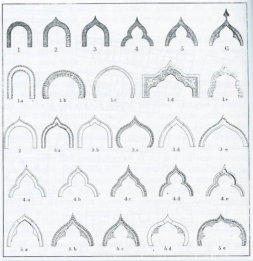
13.- La mosaïque de Torcello
Mosaïque de la contre-façade de Santa Maria Assunta à Torcello
On n’imagine pas aujourd’hui ce que fut la splendeur de Torcello (le nom vient de Turricellum, donné par les réfugiés en souvenir de la Tour de leur patrie perdue) : elle était un des lieux les plus importants avec des églises, des monastères, des industries (laine) jusqu’au XIVe siècle.
L’édifice est une construction vénéto-byzantine du XIe siècle et les mosaïques sont des XIIe et XIIIe siècles.
Mosaïque de la Basilique de Torcello


14.- Venise, ville musicale
On ne comprend pas Venise sans voir sa peinture, mais on ne comprend pas Venise sans écouter sa musique.
Il n’est pas question ici de faire une histoire de la musique vénitienne : on la trouvera très bien écrite par Nanie Bridgman dans ce petit Que sais-je ? (La musique à Venise, PUF, 1984, 128 pages), des origines à la musique d’aujourd’hui.
Essentiel aussi le Venise, Musique et peinture du XIVe au XVIIIe siècle, publié par Opus 111 Muses, Livre et CD, qui met très intelligemment en rapport ce qu’on voit sur les murs des églises et des palais ou sur les toiles des musées avec des enregistrements musicaux. Il y a aussi tellement de représentations de musiciens dans les oeuvres des grands peintres vénitiens !
On pourra voir aussi le livre plus difficile à trouver de Paolo Fabbri, Musica nel Veneto, La Storia, Federico Motta Editore, 1998 (où est pris le détail ci-contre du tableau de Domenico Mancini, Lendinara, 1511, Vergine con il Bambino e angelo con liuto, p. 105). Voir ci-dessous un autre ange musicien de Giovanni Bellini, dans la Pala Pesaro, dans la sacristie de l’église des Frari. On voit aussi en bas un détail du tableau de Antonio Visentini (1688-1782), Concerto in villa.
On n’oubliera pas que Venise fut un grand centre de l’imprimerie et que l’une de ses originalités fut l’impression de partitions musicales.
Alors on pourra se gaver de la musique des Gabrieli, de Claudio Monteverdi, d’Antonio Cesti, de Giovanni Legrenzi, de Benedetto Marcello, d’Antonio Vivaldi. Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, produisirent leurs opéras à la Fenice ou au Théâtre San Moisè. Richard Wagner, Chopin, Liszt, Stravinsky résidèrent à Venise. Et on n’oubliera pas les modernes, Bruno Maderna, Gianfrancesco Malipiero, Luigi Nono. Les noms de cette histoire sont innombrables.
À titre d’illustration, lors d’un séjour à Venise, on pourra aller assister à l’un des nombreux concerts toujours donnés dans la ville. Citons cet itinéraire Vivaldi qui suit les principaux lieux où Vivaldi exerça :
- A) Église Santa Maria della Pietà ; Vivaldi y fut embauché comme maître de violon en 1703, puis aussi maître de viole à l’anglaise ; il y revient de 1711-1718. Il y intervint aussi comme compositeur.
- B) Basilica di San Marco
- C) Église de Santa Maria dei Derelitti (Ospedaletto), de Longhena.
- D) Église de San Lazzaro dei Mendicanti, projetée par Scamozzi.
- 1) Forni di San Martino, où vint travailler la grand-mère de Vivaldi, dont le père fut « barbier » puis « musicien à la Cappella Marciana ».
- 2) Église de San Martino, siège de la Scuola des « sonadori, cantori e compositori », dont faisait partie le père de Vivaldi (Patronne : S. Cécile).
- 3) Église de San Giovanni in Bràgora, où habitait la mère de Vivaldi et où naquit et fut baptisé le musicien.
- 4) Église de San Giovanni Novo, et Campo SS. Filippo e Giacomo, où Vivaldi fut ordonné diacre en 1700 et prêtre en 1703. Il renonça très vite à dire des messes sous prétexte de « mal de poitrine ». Vivaldi habita cette place de 1711 à 1722.
- 5) Maison de Vivaldi sur la Fondamenta del Dose, habitée par Vivaldi de 1722 à 1730.
- 6) Maison de Vivaldi sur la Riva del Carbon, sa dernière habitation à partir de 1730. Il la quitta en 1740 pour Vienne où il mourut en 1741.
Pour les concerts de chaque lieu, voir les agences de tourisme.
Aux églises étaient rattachés des « hôpitaux » (Instituts de charité et orphelinats) qui eurent un rôle musical important, car chacun avait un chœur et un orchestre féminins formés par les orphelines hébergées. Seule la Chapelle ducale avait un orchestre de professionnels, les orphelines n’étaient pas professionnelles, mais elles avaient une très bonne formation musicale, tellement que beaucoup de familles nobles y envoyaient leurs filles.
Tradition vénitienne de musique populaire dialectale
Ajoutons enfin qu’il y a une tradition vénitienne de musique populaire dialectale, que Nanie Bridgman n’aborde pas, et qui vit aujourd’hui de façon intense. Nous en avons vu un exemple avec Gualtiero Bertelli et avec le groupe Calicanto, un des nombreux à rechercher et à chanter cette tradition ; il y en a beaucoup d’autres.
Comme dans toute l’Italie, on trouve en Vénétie et à Venise deux réalités complémentaires, la chanson traditionnelle rurale et la chanson urbaine, elle-même composée de musique savante (opéra, musique instrumentale) dont nous venons de parler et de chanson populaire, celle des artisans, commerçants, ouvriers et petite bourgeoisie vénitienne.
Cependant, à Venise comme à Naples, pour d’autres raisons, il n’y a pas de séparation réelle entre la chanson d’auteur, savante, écrite sur des textes littéraires de poètes, et la chanson populaire. Une première chose est commune aux deux traditions, le dialecte : l’une et l’autre sont écrites en vénitien, et pas en italien.
Une seconde raison vient du fait que, dans cette île, milieu relativement fermé, la musique savante est jouée dans des lieux accessibles à tout le peuple, les églises et les théâtres ; tous vivent dans les mêmes lieux, partagent les mêmes divertissements, participent au même carnaval, écoutent la même musique.
Enfin on peut faire l’hypothèse que le capitalisme marchand, dominant à Venise jusqu’au début du XIXe siècle, connaissait des luttes de classes moins aigues que le capitalisme industriel qui s’était développé à Florence (voir la révolte des Ciompi, les ouvriers de l’industrie textile, en 1378) ; ce n’est qu’à partir du XXe siècle, lorsque des industriels commencent à développer des usines à Mestre et Marghera, que les luttes sociales s’aggravent, et s’expriment dans la chanson vénitienne.
Antérieurement, Barbiera a sans doute raison d’insister sur le caractère musical généralisé de Venise :
« Pendant longtemps, Venise fut la ville musicale par excellence. Musique dans ses nombreux Conservatoires, dirigés par des maîtres éminents ; musique dans les théâtres, dans les oratoires, dans les églises, dans les palais, dans les rues, sur les canaux, pour toutes les fêtes, pour toute occasion joyeuse. Dans les années de la décadence républicaine, la passion de la musique envahissait tout : la République séculaire descendait vers sa ruine dans les gazouillements, les trilles, les violons ».
Un grand musicien comme Simone Mayr (1763-1845), célèbre auteur d’opéra, met en musique la chanson populaire de Antonio Lamberti (1757-1832), La biondineta in gondoleta (La blondinette en gondolette), qui devient une chanson populaire que tous les Vénitiens connaissent. Antonio Buzzolla (1815-1871), autre auteur de musique savante, écrit sept livres de chansons vénitiennes.
(Voir l’ouvrage publié par la Minelliana, Antonio Buzzolla, una vita musicale nella Venezia romantica, a cura di Francesco Passadore e Licia Sirch, Rovigo, 1993, en particulier le chapitre « Le canzoni in dialetto veneziano di Antonio Buzzolla », pp. 326-369.)
Il y a toujours à Venise un mode de communication et de collaboration entre la musique savante et la musique populaire. On connaît un peu la nature et le contenu des chansons populaires par l’ouvrage publié en 1872 par D. G. Bernoni, Canti popolari veneziani, Venezia, Tipografia Fontana-Ottolini, composé de douze livrets de textes de chansons dialectales, que souvent Luisa Ronchini entendra encore chanter dans les années 1970.
Une des plus grandes fêtes vénitiennes est celle du Rédempteur, église construite par Palladio entre 1577 et 1592 sur l’île de la Giudecca pour célébrer la fin de l’épidémie de peste de 1575-6. Elle se déroule le troisième week-end de juillet, et elle a toujours été l’occasion de création de chansons, que nous connaissons bien surtout à partir de 1866, date du rattachement de Venise au Royaume d’Italie. Elle permit alors de rénover la chanson vénitienne, peu vivante sous l’occupation autrichienne ; elle fut alors l’équivalent vénitien de la fête de Piedigrotta à Naples, et comme pour celle-ci, fut organisé un concours de chansons sous l’égide d’une revue satirique, « Sior Tonin Bonagrazia », qui primait chaque année une ou plusieurs chansons qui devenaient très populaires et le restèrent ; ce concours dura jusqu’en 1935.
Après la seconde guerre mondiale, la chanson populaire reprend vie sous d’autres aspects. Citons deux groupes importants, le Canzoniere Popolare Veneto et Calicanto.
Le premier groupe fut créé après la rencontre en 1964 de la céramiste et chanteuse Luisa Ronchini (1933-2001) et de Gualtiero Bertelli (né en 1944), auxquels se joignirent Tiziano Bertelli, Alberto d’Amico (né en 1943), Rosanna Trolese, Renzo Bonometto et Linda Caorlin ; ils réalisèrent un remarquable spectacle sur Venise en 1968, Tera e acqua, dont des extraits se trouvent dans le disque Addio Venezia, addio. Ils se séparèrent en 1971, date à laquelle Bertelli fonde le Nuovo Canzoniere Veneto, insistant plus sur la dimension socio-politique de Venise.
À partir des années 1980, Gualtiero Bertelli écrivit de nouvelles chansons, en dialecte ou en italien (Barche de carta en 1986) et publia deux disques de chansons d’émigrants. Il a aussi toujours fait de la recherche des traditions populaires.
Le groupe Calicanto se forme en 1981, sous l’impulsion de Roberto Tombesi, centré sur la recherche ethnomusicologique dans tout le territoire de l’ancienne République de Venise. Il publie de nombreux disques, de chansons traditionnelles et de chansons qu’ils écrivent selon la tradition poétique et musicale de la Vénétie.
Le groupe est invité dans le monde entier, et ses disques sont essentiels à la connaissance de la chanson traditionnelle vénitienne (En particulier : Venexia, CNI, 1997 ; Labirintomare, Calicanto CNI, 2001 ; Isole senza mar, Calicanto Cierre, 2005 ; l’anthologie 25 anni di Calicanto, Calicanto, 2006 ; Mosaico, Calicanto, 2011).






Jean Guichard, texte revu le 18 août 2015
Canaletto
Antonio Canal, dit « CANALETTO » : « vedutismo »
Quel heureux hasard que de s'appeler Canal lorsqu'on peint à l'envi tous les canaux de Venise ! J'ai longtemps cru qu'il avait pris un pseudonyme, mais c'est son vrai nom : Antonio Canal, né à Venise le 18 octobre 1697, fils de Bernardo Canal, décorateur de théâtre. Il aide son père à peindre des décors de théâtre : ce sont ses premiers paysages, ses premières vedute, il a juste 20 ans. Les Italiens friands de diminutifs l'appellent donc Canaletto, comme il y avait eu avant lui, Tintoretto (du métier de son père qui était « tintore », teinturier).
Le XVIIIe siècle et le déclin de Venise
Au XVIIIe siècle, l'orgueilleuse Venise connaît déjà un certain déclin. Mais curieusement, elle attire des visiteurs en provenance du monde entier, essentiellement les aristocrates du Grand Tour, les premiers touristes qui avaient le désir de repartir avec un souvenir de Venise. Canaletto n'est pas le premier à peindre des Vedute. Ces peintures de vues urbaines sont mises au goût du jour au XVIe siècle par les peintres du Nord : les ruines de Rome sont une inspiration pour les peintres Hollandais qui exécutent leur Grand Tour en reproduisant fidèlement des dessins précis.
Les débuts de Canaletto
En 1720, il avait accompagné son père à Rome pour réaliser deux décors de théâtre, et il y connaît les premiers peintres du « vedutisme », Viviano Codazzi (1604-1670), Giovanni Paolo Panini (1691-1765) et Vanvitelli. C'est une révélation et Canaletto peint ses premières « vues » de Rome (A droite, Capriccio con rovine classiche, 1720-21).
Influence de Gaspar Van Wittel
Gaspar Van Wittel dit Vanvitelli (1653-1736), présent à Rome dès 1674, est le trait d'union entre la tradition védutiste hollandaise et la vue urbaine italienne (Cf. à gauche sa Vue de Venise). Son succès ouvre la voie aux grands représentants du genre que seront Canaletto, son neveu Bellotto et Guardi.
Le style de Canaletto
Canaletto peint « sa » Venise non pas comme un décor, mais comme un sujet à part entière, tels le Rio dei Mendicanti (1723) ou Chiesa di san Zanipolo con la Scuola di San Marco (1725-1726) (Cf. ci-contre). Les tons sont bruns, la touche épaisse, c'est une Venise populaire, quotidienne, authentique qui fourmille de détails. Revenu à Venise, Canaletto abandonne le décor de théâtre, et il imite les vedutistes vénitiens, comme Luca Carlevarijs (1663-1730) ; il innove en présentant des vues en perspective.
Les commandes et la rencontre avec Joseph Smith
A la même époque, Canaletto a déjà beaucoup de commandes (Cf. à gauche, Il Canal Grande verso Rialto, 1723, et à droite Il Bucentauro al Molo, 1727), et plusieurs commanditaires comme Stefano Conti et Alessandro Marchesini. Déjà connu, il est remarqué par des commanditaires anglais, à un moment où les jeunes britanniques viennent faire leur Grand Tour à Venise, et il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie : il se lie à Joseph Smith, un Anglais collectionneur, marchand d'art qui deviendra consul britannique à Venise. La brillante élite britannique en voyage à Venise gravite autour de Joseph Smith qui finit par monopoliser le marché des vedute, frustrant de nombreux amateurs qui doivent attendre plusieurs mois leurs commandes, pendant que les prix s'envolent ! Les Anglais sont fascinés par Canaletto. Son ascension est fulgurante, irrésistible, il éclipse tous ses concurrents.
L'évolution artistique sous l'influence de Smith
Sous l'influence de Smith, peu à peu il éclaircit sa palette et délaisse les cieux tourmentés de ses débuts pour arriver à une vision plus sereine, il doit tenir compte du fait que les riches touristes achètent plus volontiers des paysages baignés de lumière dorée, que les sombres ciels d'orage et les lividités de l'hiver. Sa nouvelle manière sera claire et lumineuse : ce sont les innombrables vues de l'entrée du grand Canal avec la Salute (1728) (Ci-contre à gauche), ou la Piazza San Marco avec la tour de l'horloge (1731) (Ci-contre à droite). Il « croque » aussi les mœurs de son temps : la Fête de la San Rocco (1735) (Ci-contre à gauche), la Fête de San Pietro di Castello (1745) (Ci-contre à droite).
Le séjour en Angleterre
La guerre de succession d'Autriche (1740-48) prive Venise de nombreux visiteurs. Smith conseille à Canaletto de se rendre en Angleterre afin de côtoyer ses acquéreurs et d'amplifier sa clientèle. Il arrive à Londres au printemps 1746 et y restera une dizaine d'années. Tout ce que l'Angleterre compte de Ducs et de Comtes sollicite Canaletto pour des Vedute de ses domaines. Il réalisera de très belles vues de la Tamise et du château de Warwick. Certains perfides, disant qu'il ne savait faire que des bâtiments, le mettront au défi de peindre un arbre ! Mais malgré ces jalousies mesquines, son séjour britannique est un triomphe (Ci-contre à gauche, L’Abbaye de Westminster, 1749, et La Old Horse Guards, da St James, 1749, ci-contre à droite).
Le retour à Venise et la fin de sa vie
Avant de mourir et pour éviter la dispersion de ses œuvres, Smith vendra cinquante-quatre peintures de Canaletto au roi George III, sans compter les dessins et les estampes. Ceci explique que la plus importante collection de Canaletto au monde appartienne à … la Reine d'Angleterre.
De retour à Venise, fidèle à ses aspirations, Canaletto continue d'observer la vie quotidienne, tel le Campo San Giacometto (1757) (Ci-contre à gauche), où son dernier commanditaire l'Allemand Sigmund Streit décrit avec minutie le tableau « des arméniens avec leurs longs manteaux et leurs chapeaux pointus, et des Juifs à la calotte rouge ».
Elle est là, la perfection de Canaletto : aussi grand soit le tableau, il soigne avec une infinie précision tous les détails minutieux qui le rendent vivant. Il faut vraiment prendre une loupe pour ne rien en perdre : les cordages sont enroulés sur les ponts des bateaux, le linge sèche aux fenêtres, les marchandises sont sur les étals.... (Ci-contre à droite, détail de La Scuola di San Rocco, 1730, et ci-dessous à gauche, Chiesa e Scuola della Carità, 1726-7, détail).
En 1763, il est enfin accepté à l'Académie de peinture et de sculpture, une première pour un peintre de Vedute, genre apprécié de tous mais toujours considéré comme mineur par l'Académie. Il meurt le 20 avril 1768. Son neveu Bernardo Bellotto qui travaillait dans l'atelier de son oncle est nommé à Varsovie, peintre de la cour de Stanislas Poniatowski, il va exporter la mode des Vedute dans les capitales étrangères.
La disparition de Canaletto et l'héritage de Guardi
La disparition de Canaletto ne signifie pas la fin de l'engouement pour les Vedute. C'est Francesco Guardi qui prend le relais. C'est un peintre religieux orienté vers les tableaux d'autel. A quarante ans passés, il s'essaie à la vue urbaine et inscrit ses pas dans ceux de son illustre prédécesseur, non en imitateur, mais en émule. Sa première Veduta datée de 1758, représente la fête du jeudi gras sur la Piazzetta, une scène populaire et pittoresque comme les aimait Canaletto.
Progressivement Guardi fera des ciels plus sombres, des personnages plus importants, il trouve sa manière qui ne peut plus être confondue avec celle de Canaletto, mais la référence reste constante. En 1782, il devient peintre officiel de Venise avec une série en l'honneur de la visite du pape Pie VI.
En 1797 le soleil se couche définitivement sur la Sérénissime, mais les deux maîtres en ont conservé le souvenir éblouissant.
La technique de la chambre noire
Les paysages de Canaletto sont d'une précision exceptionnelle. Comment parvient-il à mêler une observation renversante de précision à un sens créatif aussi personnel ?
Il se promène partout avec sa chambre optique, appelée aussi chambre noire (en latin camera obscura). Cet instrument est indispensable aux védutistes, mais son usage est plus ancien : le premier Vénitien à y avoir eu recours est Véronèse en 1568. A ses débuts, c'est une véritable petite chambre dans laquelle s'installe l'observateur, elle devient plus pratique et portable : c'est celle qu'utilise Canaletto (A droite, la camera oscura de Canaletto). Le principe est le même : un rayon lumineux pénètre dans une boîte au travers d'un petit trou et reflète l'image sur la paroi opposée au trou de façon inversée. L'adjonction d'un support en verre où on pose un papier transparent permet de dessiner le tracé. Cependant, l'image est toujours inversée haut/bas.
Les progrès de l'optique aident l'artiste : en ajoutant une lentille sur l'orifice et un miroir, l'image n'est plus inversée haut/bas mais toujours inversée droite/gauche, ce qui sera corrigé par l'adjonction d'un autre miroir à 45° : l'image est parfaitement reconstituée à condition que l'utilisateur se place dos à la scène. Le musée Correr à Venise conserve pieusement la camera obscura de Canaletto.
Le fonctionnement détaillé de la camera obscura pourrait laisser croire que Canaletto ne faisait que décalquer ce qu'il voyait. Évidemment non !
Canaletto sillonnait la ville souvent en barque, emportant avec lui des cahiers, ses quaderni (Ci-contre 4 pages de son Quaderno de Venise) et sa camera obscura indispensable pour parfaire la perspective de ses compositions. Une fois le point de vue trouvé, il traçait à la mine de plomb, les premières lignes d'après l'image projetée par la camera, puis les rehaussait à la plume. C'est là que son talent intervient : si le bâtiment est trop élevé, il n'en dessine pas le sommet ou réduit les dimensions. Les vues panoramiques occupent souvent plusieurs pages du quaderno, il note alors « première bande gauche ou droite... ». Il note également tous les rappels précis tels que le nom des bâtiments, les enseignes, le nombre de fenêtres ou de colonnes, les couleurs, les tonalités, les matériaux et même les reflets du soleil... C'est ce que Canaletto appelait ses scaraboti, ses brouillons.
De retour à l'atelier, il réalise sa toile grâce aux données des dessins à l'aide d'un compas-rapporteur qui lui permet d'ajuster les proportions sans altérer la perception visuelle. Le talent de Canaletto réside dans son art de manipuler la réalité, celle-là même qui offre aux visiteurs étrangers la Venise dont ils souhaitent se souvenir.
Annie CHIKHI et Jean GUICHARD
16 décembre 2016
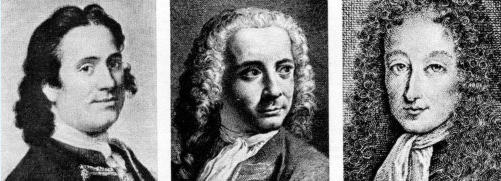















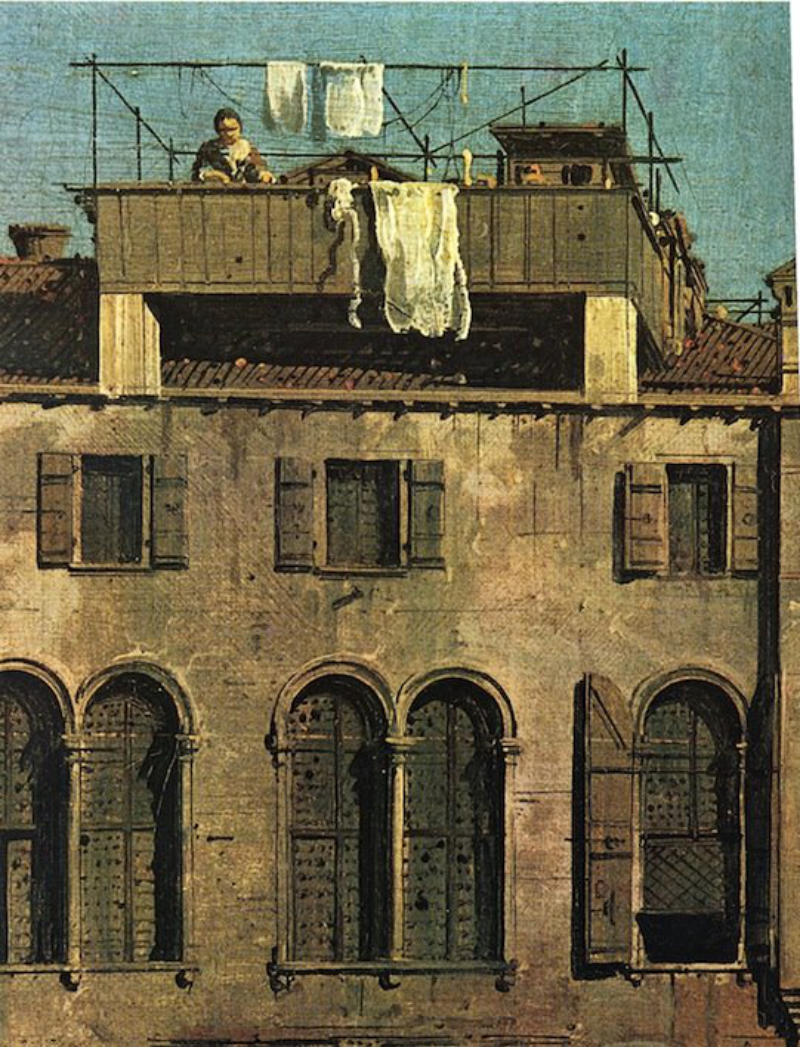
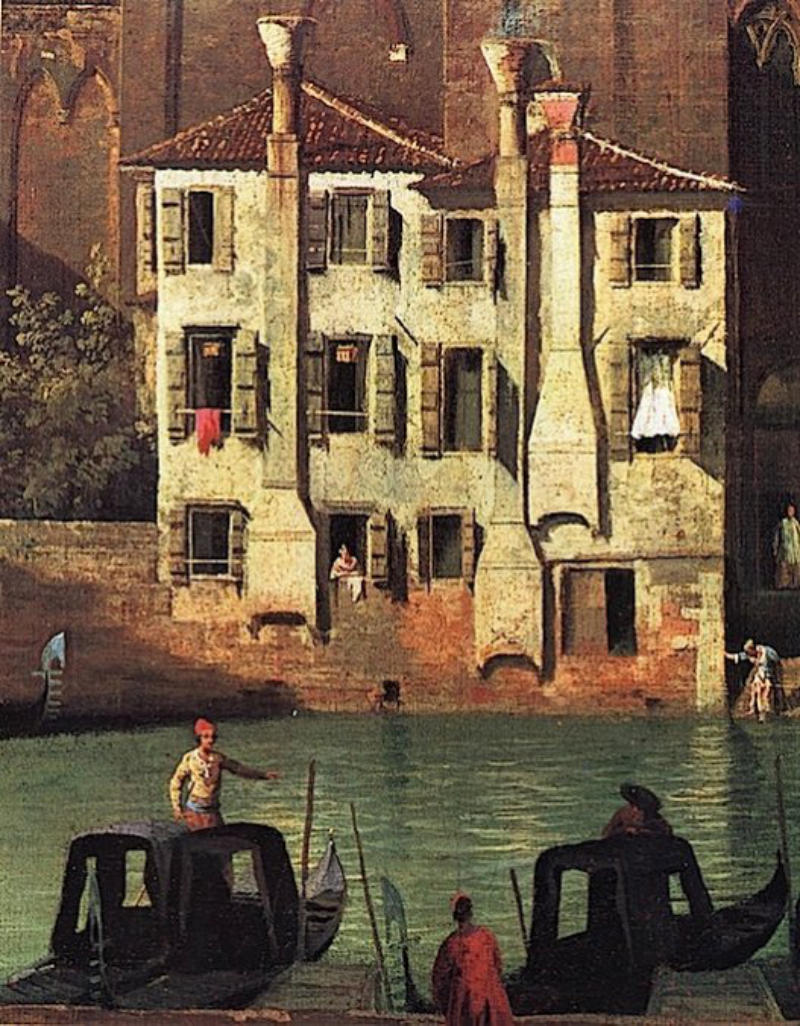



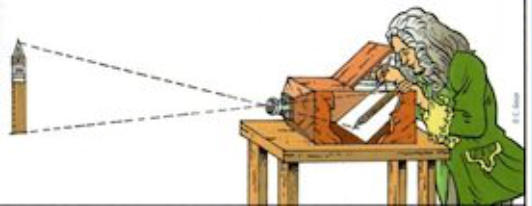

Textes sur Venise
De nombreux textes sur Venise se trouvent dans plusieurs ouvrages, parmi lesquels :
- Christine AUSSEUR, Guide littéraire de Venise, Hermé, 1994, 192 pages.
- Jean-Noël MOURET, Le goût de Venise, Mercure de France, 2002.
- Evelkyne SCHLUMBERGER, Hélène DEMORIANE, Roger GOUZE, Venise entre les lignes, Textes choisis et commentés, Préface de Jean D’ORMESSON, Denoël, 23001, 500 pages.
Voir notre dossier : Histoire des villes - Bibliographie sur Venise.
1) SAINT MARC, EVANGELISTE (1) DANS LA LÉGENDE DORÉE
11. Ordérie Vital raconte (Hist. Eccl., part. I, liv. 11, c. xx) chacun des faits consignés dans la légende de saint Marc.
Marc veut dire sublime en commandement, certain, abaissé et amer. Il fut sublime en commandement par la perfection de sa vie, car non seulement, il observa les commandements qui sont communs à tous, mais encore ceux qui sont sublimes, tels que les conseils. Il fut certain en raison de la certitude de la doctrine dans son évangile, parce que cette certitude a pour garant saint Pierre, son maître, de qui il l'avait apprise. Il fut abaissé, en raison de sa profonde humilité, qui lui fit, dit-on, se couper le pouce, afin de ne pas être trouvé capable d'être prêtre. Il fut amer en raison de l'amertume du tourment qu'il endura lorsqu'il fut traîné par la ville, et qu'il rendit l'esprit au milieu des supplices. Ou bien Marc vient de Marco, qui est une masse, dont le même coup aplatit le fer, produit la mélodie, et affermit l'enclume. De même saint Marc, par l'unique doctrine de son évangile, dompte la perfidie des hérétiques, dilate la louange divine et affermit l'Église.
Marc, évangéliste, prêtre de la tribu de Lévi, fut, par le baptême, le fils de saint Pierre, apôtre, dont il était le disciple en la parole divine. Il alla à Rome avec ce saint. Comme celui-ci y prêchait la bonne nouvelle, les fidèles de Rome prièrent saint Marc de vouloir écrire l'Evangile, pour l'avoir toujours présent à la mémoire. Il le leur écrivit loyalement, tel qu'il l'avait appris de la bouche de son maître saint Pierre, qui l'examina avec soin, et après avoir vu qu'il était plein de vérité, il l'approuva et le jugea digne d'être reçu par tous les fidèles. (Saint Jérôme, Vir. i11ustr.~ C. viii ; - Clément d'Alexandrie, dans Eusèbe, I. Il, c. xv.)
Saint Pierre, considérant que Marc était constant dans la foi, le destina pour Aquilée, où après avoir prêché la parole de Dieu, il convertit des multitudes innombrables de gentils à J.-C. On dit que là aussi, il écrivit son évangile que l'on montre encore à présent dans l'église d'Aquilée, où on le garde avec grand respect. Enfin saint Marc conduisit à Rome, auprès de saint Pierre, un citoyen par les infidèles et reçut la couronne du martyre. Pour saint Marc, il fut envoyé par saint Pierre à Alexandrie où il prêcha le premier la parole de Dieu. (Eusèbe, c. xvi ; Epiphan., LI, c. vi ; saint Jér., ibid.) A son entrée dans cette ville, au rapport de Philon, juif très disert, il se forma une assemblée immense qui reçut la foi et pratiqua la dévotion et la continence. Papias, évêque de Jérusalem, fait de lui le plus grand éloge en très beau langage ; et voici ce que Pierre Damien dit à son sujet : « Il jouit d'une si grande influence à Alexandrie, que tous ceux qui venaient en foule pour être instruits dans la foi atteignirent bientôt au sommet de la perfection, par la pratique de la continence, et de toutes sortes de bonnes œuvres, en sorte que l'on eût dit une communauté de moines. On devait ce résultat moins aux miracles extraordinaires de saint Marc et à l'éloquence de ses prédications, qu'à ses exemples éminents. » Le même Pierre Damien ajoute qu'après sa mort, son corps fut ramené en Italie, afin que la terre où il lui avait été donné d'écrire son Evangile eût l'honneur de posséder ses dépouilles sacrées. « Tu es heureuse, ô Alexandrie, d'avoir été arrosée de son sang glorieux, comme toi, ô Italie, tu ne l'es pas moins de posséder un si rare trésor. »
On rapporte que saint Marc fut doué d'une si grande humilité qu'il se coupa le pouce afin que l'on ne songeât pas à l'ordonner prêtre. (Isidore de Sév., Vies et morts illustres, ch. LIV.). Mais par une disposition de Dieu et par l'autorité de saint Pierre, il fut choisi pour évêque d'Alexandrie. A son entrée dans cette ville, sa chaussure se rompit et se déchira subitement ; il comprit intérieurement ce que cela signifiait, et dit : « Vraiment, le Seigneur a raccourci mon chemin, et Satan ne sera pas un obstacle pour moi, puisque le Seigneur m'a absous des œuvres de mort. » Or, Marc, voyant un savetier qui cousait de vieilles chaussures, lui donna la sienne à raccommoder : mais en le faisant l'ouvrier se blessa grièvement à la main gauche, et se mit à crier : « Unique Dieu. » En l'entendant, l'homme de Dieu dit : « Vraiment le Seigneur a rendu mon voyage heureux. » Alors il fit de la boue avec sa salive et de la terre, l'appliqua sur la main du savetier qui fut incontinent guéri. Cet homme, voyant le pouvoir extraordinaire de Marc, le fit entrer chez lui et lui demanda qui il était, et d'où il venait. Marc lui avoua être le serviteur du Seigneur Jésus. L'autre lui dit : « Je voudrais bien le voir. » « Je te le montrerai », lui répondit saint Marc. Il se mit alors à lui annoncer l'Evangile de J.-C. et le baptisa avec tous ceux de sa maison. Les habitants de la ville ayant appris l'arrivée d'un Galiléen, qui méprisait les sacrifices de leurs dieux, lui tendirent des pièges. Saint Marc, en ayant été instruit, ordonna évêque Anianus, cet homme-là même qu'il avait guéri. (Actes de saint Marc.) et partit pour la Pentapole, où il resta deux ans, après lesquels il revint à Alexandrie. Il y avait fait élever une église sur les rochers qui bordent la mer, dans un lieu appelé Bucculi. (Probablement : l'abattoir)
Il y trouva le nombre des chrétiens augmenté. Or, les prêtres des temples cherchèrent à le prendre ; et le jour de Pâques, comme saint Marc célébrait la messe, ils s'assemblèrent tous au lieu où était le saint, lui attachèrent une corde au cou et le traînèrent par toute la ville en disant : « Traînons le buffle au Bucculi ». Sa chair et son sang étaient épars sur la terre et couvraient les pierres, ensuite il fut enfermé dans une prison où un ange le fortifia. Le Seigneur J.-C. lui-même daigna le visiter et lui dit pour le conforter : « La paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste ; ne crains rien car je suis avec toi pour te délivrer ». Le matin arrivé, ils lui jettent encore une fois une corde au cou, et le traînent çà et là en criant : « Traînez le buffle au Bucculi ». Au milieu de ce supplice, Marc rendait grâces à Dieu en disant : « Je remets mon esprit entre vos mains ». Et en prononçant ces mots, il expira. C'était sous Néron, vers l'an 57. Comme les païens le voulaient brûler, soudain, l'air se trouble, une grêle s'annonce, les tonnerres grondent, les éclairs brillent, tout le monde s'empresse de fuir, et le corps du saint reste intact. Les chrétiens le prirent et l'ensevelirent dans l'église en toute révérence. Voici le portrait de saint Marc : Il avait le nez long, les sourcils abaissés, les yeux beaux, le front un peu chauve, la barbe épaisse. Il était de belles manières, d'un âge moyen ; ses cheveux commençaient à blanchir, il était affectueux, plein de mesure et rempli de la grâce de Dieu. Saint Ambroise dit de lui : « Comme le bienheureux Marc brillait par des miracles sans nombre, il arriva qu'un cordonnier auquel il avait donné sa chaussure à raccommoder, se perça la main gauche dans son travail, et en se faisant la blessure, il cria : "Un Dieu"! Le serviteur de Dieu fut tout joyeux de l'entendre : il prit de la boue qu'il fit avec sa salive, en oignit la main de l'ouvrier qu'il guérit à l'instant et avec laquelle cet homme put continuer son travail. Comme le Sauveur, il guérit aussi un aveugle-né ».
L'an de l'Incarnation du Seigneur 468, du temps de l'empereur Léon, des Vénitiens transportèrent le corps de saint Marc, d'Alexandrie à Venise, où fut élevée, en l'honneur du saint, une église d'une merveilleuse beauté. Des marchands vénitiens, étant allés à Alexandrie, firent tant par dons et par promesses auprès de deux prêtres, gardiens du corps de saint Marc, que ceux-ci le laissèrent enlever en cachette et emporter à Venise. Mais comme on levait le corps du tombeau, une odeur si pénétrante se répandit dans Alexandrie que tout le monde s'émerveillait d'où pouvait venir une pareille suavité. Or, comme les marchands étaient en pleine mer, ils découvrirent aux navires qui allaient de conserve avec eux qu'ils portaient le corps de saint Marc ; un des gens dit : « C'est probablement le corps de quelque Egyptien que l'on vous a donné, et vous pensez emporter le corps de saint Marc ». Aussitôt le navire qui portait le corps de saint Marc vira de bord avec une merveilleuse célérité et se heurtant contre le navire où se trouvait celui qui venait de parler, il en brisa un côté. Il ne s'éloigna point avant que tous ceux qui le montaient n'eussent acclamé qu'ils croyaient que le corps de saint Marc s'y trouvait.
Une nuit, les navires étaient emportés par un courant très rapide, et les nautoniers, ballottés par la tempête et enveloppés de ténèbres, ne savaient où ils allaient ; saint Marc apparut au moine gardien de son corps, et lui dit : « Dis à tout ce monde de carguer vite les voiles, car ils ne sont pas loin de la terre ». Et on les cargua. Quand le matin fut venu, on se trouvait vis-à-vis une île. Or, comme on longeait divers rivages, et qu'on cachait à tous le saint trésor, des habitants vinrent et crièrent : « Oh! que vous êtes heureux, vous qui portez le corps de saint Marc ! Permettez que nous lui rendions nos profonds hommages ». Un matelot encore tout à fait incrédule est saisi par le démon et vexé jusqu'au moment où, amené auprès du corps, il avoua qu'il croyait que c'était celui de saint Marc. Après avoir été délivré, il rendit gloire à Dieu et eut par la suite une grande dévotion au saint. Il arriva que, pour conserver avec plus de précaution le corps de saint Marc, on le déposa au bas d'une colonne de marbre, en présence d'un petit nombre de personnes ; mais par le cours du temps, les témoins étant morts, personne ne pouvait savoir, ni reconnaître, à aucun indice, l'endroit où était le saint trésor. Il y eut des pleurs dans le clergé, une grande désolation chez les laïcs, et un chagrin profond dans tous. La peur de ce peuple dévot était en effet qu'un patron si recommandable n'eût été enlevé furtivement. Alors on indique un jeûne solennel, on ordonne une procession plus solennelle encore ; mais voici que, sous les yeux et à la surprise de tout le monde, les pierres se détachent de la colonne et laissent voir à découvert la châsse où le corps était caché. À l’instant on rend des actions de grâce au Créateur qui a daigné révéler le saint patron ; et ce jour, illustré par la gloire d'un si grand prodige, fut fêté dans la suite des temps.
Un jeune homme, tourmenté par un cancer dont les vers lui rongeaient la poitrine, se mit à implorer d'un cœur dévoué les suffrages de saint Marc ; et voici que, dans son sommeil, un homme en habit de pèlerin lui apparut se hâtant dans sa marche. Interrogé par lui qui il était et où il allait en marchant si vite, il lui répondit qu'il était saint Marc, qu'il courait porter secours à un navire en péril qui l'invoquait. Alors il étendit la main, en toucha le malade qui, à son réveil le matin, se sentit complètement guéri. Un instant après le navire entra dans le port de Venise et ceux qui le montaient racontèrent le péril dans lequel ils s'étaient trouvés et comme saint Marc leur était venu en aide. On rendit grâce pour ces deux miracles et Dieu fut proclamé admirable dans Marc, son saint.
Des marchands de Venise qui allaient à Alexandrie sur un vaisseau sarrasin, se voyant dans un péril imminent, se jettent dans une chaloupe, coupent la corde, et aussitôt le navire est englouti dans les flots qui enveloppent tous les Sarrasins. L'un d'eux invoqua saint Marc et fit, comme il put, vœu de recevoir le baptême et de visiter son église, s'il lui prêtait secours. À l’instant, un personnage éclatant lui apparut, l'arracha des flots et le mit avec les autres dans la chaloupe. Arrivé à Alexandrie, il fut ingrat envers son libérateur et ne se pressa ni d'aller à l'église de saint Marc, ni de recevoir les sacrements de notre foi. Derechef saint Marc lui apparut et lui reprocha son ingratitude. Il rentra donc en lui-même, vint à Venise, et régénéré dans les fonts sacrés du baptême, il reçut le nom de Marc. Sa foi en J.-C. fut parfaite et il finit sa vie dans les bonnes œuvres. – Un homme qui travaillait au haut du campanile de saint Marc de Venise tombe tout à coup à l'improviste ; ses membres sont déchirés par lambeaux ; mais, dans sa chute, il se rappelle saint Marc, et implore son patronage : alors il rencontre une poutre qui le retient. On lui donne une corde et il s'en relève sans blessure ; il remonte ensuite à son travail avec dévotion pour le terminer. – Un esclave au service d'un noble habitant de la Provence avait fait vœu de visiter le corps de saint Marc ; mais il n'en pouvait obtenir la permission : enfin il tint moins de compte de la peur de son maître temporel que de son maître céleste. Sans prendre congé, il partit avec dévotion pour accomplir son vœu. À son retour, le maître, qui était fâché, ordonna de lui arracher les yeux. Cet homme cruel fut favorisé dans son dessein par des hommes plus cruels encore qui jettent, par terre, le serviteur de Dieu, lequel invoquait saint Marc, et s'approchent avec des poinçons pour lui crever les yeux : les efforts qu'ils tentent sont inutiles ; car le fer se rebroussait et se cassait tout d'un coup. Il ordonne donc que ses jambes soient rompues et ses pieds coupés à coups de haches, mais le fer qui est dur de sa nature s'amollit comme le plomb. Il ordonne qu'on lui brise la figure et les dents avec des maillets de fer ; le fer perd sa force et s'émousse par la puissance de Dieu. À cette vue son maître stupéfait demanda pardon et alla avec son esclave visiter en grande dévotion le tombeau de saint Marc. (...)
(Jacques de Voragine, La Légende dorée, GF Flammarion, 1967, T. I, pp. 302-07)
2) Michel de MONTAIGNE (1580)
LA CHAFFOUSINE (Fusina), vingt milles, où nous disnâmes.
Ce n'est qu'une hostellerie où l'on se met sur l'eau pour se rendre à Venise. Là abordent tous les bateaux le long de ceste riviere, avec des engins et des poulies que deux chevaux tournent à la mode de ceux qui tournent les meules d'huile. On emporte ces barques atout des roues qu'on leur met au dessous, par dessus un planchier de bois pour les jetter dans le canal qui va se rendre en la mer où Venise est assise.
Nous y disnâmes, et nous estans mis dans une gondole, vismes souper à VENISE, cinq milles.
Lendemain, qui fut dimenche matin, M. de Montaigne vit M. de Ferrier, ambassadeur du roi, qui lui fit fort bonne chere, le mena à la messe et le retint à disner avec lui.
Le lundy M. d'Estissac et lui y disnarent encore. Entres autres discours dudict ambassadeur, celui-là lui sembla estrange : qu'il n'avoit commerce avec nul home de la ville, et que c'estoit une humeur de gens si soupçonneuse que, si un de leurs gentilshommes avoit parlé deux fois à lui, ils le tienderoint pour suspect ; et aussi cela que la ville de Venise valoit quinze çans mille escus de rente à la seigneurie. Au demeurant les raretés de ceste ville sont assez connues. Il (Montaigne) disoit l'avoir trouvée autre qu'il ne l'avoit imaginée et un peu moins admirable ; il la reconnut et toutes ses particularités avec extreme diligence. La police, la situation, l'arsenal, la place de Saint-Marc et la presse des peuples etrangiers, lui samblarent les choses plus remarquables.
Le lundy à souper, 6 de novembre, la signora Veronica Franca (une ex-courtisane qui avait abandonné le métier à 29 ans), gentifame venitienne, envoïa vers lui pour lui presenter un petit livre de lettres qu'elle a composé ; il fit donner deux escus audit home.
Il n'y trouva pas ceste fameuse beauté qu'on attribue aus dames de Venise, et vit les plus nobles de celles qui en font traficque ; mais cela lui sembla autant admirable que nulle autre chose, d'en voir un tel nombre, comme de cent cinquante ou environ (215, selon le Catalogue des plus honorées courtisanes, de 1574) faisant une dépense en meubles et vestemans de princesses ; n'ayant autre fons à se maintenir que de ceste traficque ; et plusieurs de la noblesse de là, mesme avoir des courtisanes à leurs despens, au veu et au sceu d'un chacun. Il louoit pour son service une gondole pour jour et nuict, à deux livres, qui sont environ dix-sept solds, sans faire nulle despense au barquerol (barcarol = gondolier). Les vivres y sont chers comme a Paris ; mais c'est la ville du monde où on vit à meilleur conte, d'autant que la suite des valets nous y est du tout inutile, chacun y allant tout seul, et la despense des vestemans de mesme ; et puis, qu'il n'y faut nul cheval.
Le samedy, dousiesme de novembre, nous en partimes au matin et vismes à LA CHAFFOUSINE, cinq milles ; où nous nous mimes homes et bagage dans une barque pour deux escus. Il (Montaigne) a accoutumé creindre l'eau ; mais ayant opinion que c'est le seul mouvement qui offense son estomac, voulant assaïer si le mouvement de ceste riviere qui est eguable et uniforme, attendu que des chevaux tirent ce bateau, l'offenceroit, il l'essaïa et trouva qu'il n'y avoir eu nul mal. Il faut passer deux ou trois portes dans ceste riviere, qui se ferment et ouvrent aus passans.
Nous vinmes coucher par eau à PADOUE.
(Journal de voyage en Italie par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 1581, Classiques Garnier, 1955, pp. 72-3)
3) Les futuristes contre Venise passéiste (1910)
« Contre Venise passéiste » 27 avril 1910
« Nous répudions l’ancienne Venise exténuée et défaite par des voluptés séculaires que nous aimâmes pourtant et que nous possédâmes dans un grand rêve nostalgique.
Nous répudions la Venise des étrangers, marché d’antiquaires faussaire, calamité du snobism et de l’imbécillité universels, lit enfoncé par des caravanes d’amants, bain de siège orné de pierres précieuses pour des courtisanes cosmopolites, grand cloaque du passéisme.
Nous voulons guérir et cicatriser cette ville putrescente, magnifique plaie du passé. Nous voulons réanimer et ennoblir le peuple vénitien, déchu de son antique grandeur, intoxiqué par une lâcheté écoeurante et avili par l’habitude de ses petits commerces louches.
Nous voulons préparer la naissance d’une Venise industrielle et militaire qui puisse dominer la mer Adriatique, grand lac italien.
Pressons-nous de combler les petits canaux puants avec les débris des vieux palais croulants et lépreux.
Brûlons les gondoles, fauteuils à bascule pour les crétins, et élevons jusqu’au ciel l’imposante géométrie des ponts métalliques et des usines coiffées de fumée, pour abolir les courbes flasques des vieilles architectures.
Que vienne finalement le règne de la divine Lumière Électrique, pour libérer Venise de son vénal clair de lune de chambre meublée.
Le 8 juillet 1910, 80.000 feuilles contenant ce manifeste furent lancées par les poètes et par les peintres futuristes du haut de la Tour de l’Horloge sur la foule qui revenait du Lido. Ainsi commença la campagne que les futuristes mènent depuis trois ans contre Venise passéiste.
Le texte qui suit, Discours contre les Vénitiens, improvisé par le poète Marinetti à la Fenice, suscita une terrible bataille. Les futuristes furent sifflés. Les passéistes furent frappés.
Les peintres futuristes Boccioni, Russolo, Carrà ponctuèrent ce discours par des claques sonores. Les coups de poing d’Armando Mazza, poète futuriste qui est aussi un athlète restèrent mémorables.
Discours futuriste aux Vénitiens
Vénitiens!
Quand nous avons crié : Tuons le clair de lune! nous pensions à vous Vénitiens, nous pensions à toi, Venise pourrie de romantisme!...
Mais aujourd'hui notre voix grandit et nous ajoutons très haut : « Oh ! délivrons enfin le monde de la tyrannie de l'amour! »
Nous sommes fatigués d'aventures érotiques, de luxure, de sentimentalisme et de nostalgie!
Pourquoi veux-tu donc nous offrir encore des femmes voilées à tous les carrefours de tes canaux ...
Assez! Assez! Finis donc de murmurer d'obscènes invitations à tous les passants de la terre!
Venise! vieille entremetteuse courbée sous ta pesante mantille de mosaïques!
Pour qui donc prépares-tu encore d'exténuantes nuits romantiques, de plaintives sérénades et de sinistres embuscades.
J'ai aimé moi aussi, comme tant d'autres, ô Venise, la somptueuse pénombre de ton Canal Grande, imprégnée de luxures rares ...
J'ai aimé moi aussi la pâleur fiévreuse de tes belles amantes qui glissent au bas des balcons par des échelles tressées d'éclairs, de fils de pluie et de rayons de lune, parmi un cliquetis d'épées croisées.
Suffit! Suffit! Toute cette défroque absurde, ce bric-à-brac abominable et irritant nous donne la nausée!
Nous voulons désormais que les lampes électriques aux mille pointes de lumière déchirent brutalement tes ténèbres mystérieuses, fascinantes et persuasives.
Ton Canal Grande deviendra fatalement un grand port marchand.
Trains et tramways, lancés dans les grandes rues construites sur tes canaux enfin comblés, viendront amonceler des marchandises parmi une foule riche et affairée d'industriels et de commerçants.
Vénitiens, esclaves du passé, ne hurlez donc pas contre la prétendue laideur des locomotives, des tramways et des automobiles, dont nous dégageons à coups de génie la grande esthétique futuriste!
Ces merveilleux engins de vitesse peuvent toujours écraser tel couple d'Autrichiens sales et grotesques sous leurs petits chapeaux tyroliens!
Mais vous aimez vous prosterner devant tous les étrangers, quelle que soit leur nationalité, car vous êtes d'une servilité répugnante!
Vénitiens! Vénitiens!
Pourquoi vouloir être encore et toujours les fidèles esclaves du passé, les vils gardiens du plus grand bordel de l'Histoire, les infirmiers du plus triste hôpital du monde, où languissent des âmes mortellement empoisonnées par le virus du sentimentalisme.
Oh! les images ne me font guère défaut quand je veux définir votre innommable paresse, aussi vaniteuse et sotte que la paresse d'un fils de grand homme ou d'un mari de chanteuse illustre!
Ne pourrais-je pas comparer vos gondoliers à des fossoyeurs qui creusent en cadence des fosses puantes dans un cimetière inondé?
Mais vous ne vous offensez guère, car votre humilité est incommensurable...
L'on sait d'ailleurs que vous avez la sage préoccupation d'enrichir la Société des Grands Hotels, et que dans ce but vous vous obstinez à pourrir sur place.
Et pourtant vous fûtes autrefois d'invincibles guerriers et des artistes de génie, des navigateurs audacieux et de subtils industriels...
Mais vous n'êtes aujourd'hui que des garçons d'hôtel, des cicérones, des proxénètes, des antiquaires frauduleux, des fabricants de vieux tableaux, des peintres rabâcheurs, copistes et plagiaires!
Avez-vous donc oublié que vous êtes avant tout des Italiens?
Sachez que ce mot, dans la langue de l'histoire, veut dire : Constructeurs de l'Avenir!
Allez! Vous ne vous défendez pas, j'espère, en dénonçant les effets abrutissants du siroco!
C'était bien ce vent-là qui gonflait de ses bouffées torrides et belliqueuses les voiles des héros de Lépante!
C'est ce même vent africain qui tout à coup, en un midi infernal, hâtera l'œuvre des eaux corrosives sur les fondements de vos palais.
Oh! nous danserons bien ce jour-là et nous applaudirons, pour encourager les Lagunes...
Les mains chercheront les mains pour former la ronde immense et folle autour de l'illustre ruine noyée...
Et nous serons tous fous de gaieté, nous, les derniers étudiants révoltés de ce monde trop sage!
C'est ainsi, ô Vénitiens, que nous avons chanté, dansé, et ri devant l'agonie de l'île de Philae, qui mourut comme un vieux rat dans le barrage d'Assouan, immense souricière aux trappes électriques, où le génie futuriste d'Angleterre emprisonne les eaux sacrées et fuyantes du Nil.
Vous pouvez bien m'appeler un barbare, incapable de goûter la divine poésie qui flotte sur vos îles enchanteresses!...
Allons donc! Il n'y a vraiment pas là de quoi être très fiers!
Vous n'avez qu'à débarrasser Torcello, Burano, l'Isola dei Morti de toute la littérature maladive et de l'immense rêverie nostalgique dont elles furent enveloppées par les poètes, pour qu'il vous soit possible, tout en riant avec moi, de considérer ces îles comme les énormes fientes que les mammouths ont laissé choir ça et là en traversant à gué vos lagunes préhistoriques.
Mais vous les adorez en extase, heureux de pourrir dans votre eau sale, pour enrichir sans fin la Société des Grands Hôtels, qui prépare soigneusement les nuits galantes de tous les grands de la terre.
Certes, ce n'est pas une mince affaire que d'exciter à l'amour un Empereur...
Il faut pour cela que votre hôte couronné navigue longtemps dans l'eau grasse de cet immense évier plein de vieux pots cassés...
Il faut que ses gondoliers piochent avec leurs avirons plusieurs kilomètres d'excréments liquéfiés, dans une divine odeur de latrines, se faufilant parmi des barques chargées de belles immondices, pour qu'il puisse enfin toucher son but en empereur satisfait de soi et de son sceptre impérial.
C'est bien là, c'est bien là votre gloire, Vénitiens!
Oh! Rougissez de honte et tombez à plat ventre, l'un sur l'autre, entassés comme des sacs pleins de sable et de pierres, pour former un rempart sur la frontière, tandis que nous préparerons la grande et forte Venise industrielle et militaire, qui doit braver l'insolence autrichienne sur la mer Adriatique, ce grand lac italien!
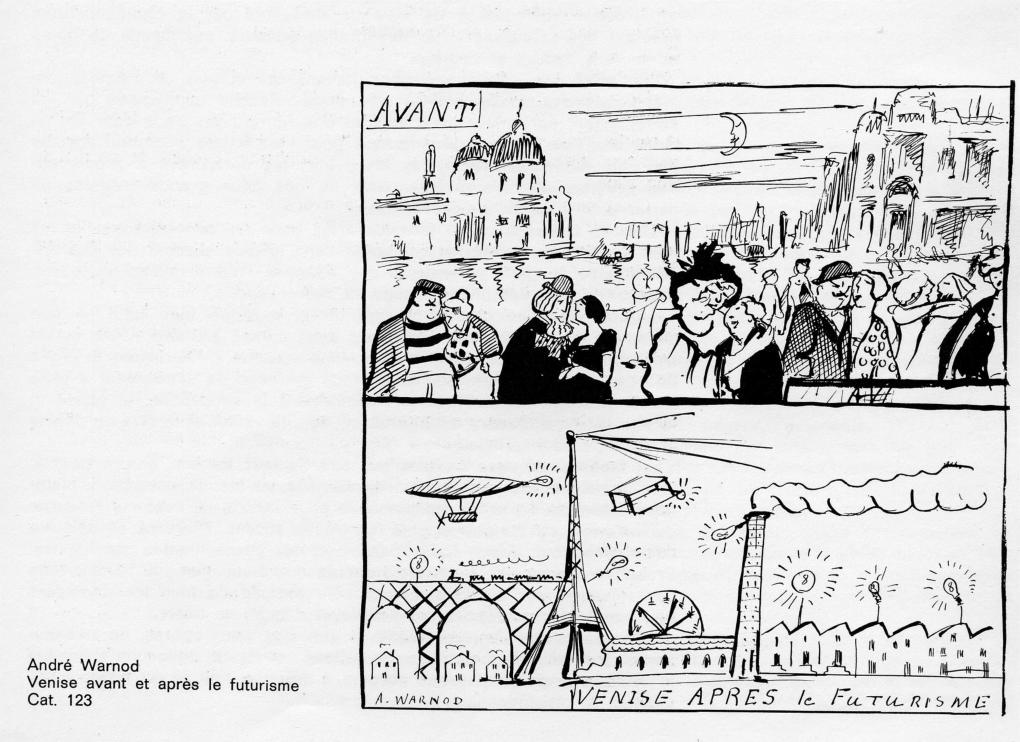
Le Carnaval hier et aujourd’hui
Peut-on écrire un cahier sur Venise sans dire deux mots du Carnaval ?
Le carnaval d’aujourd’hui n’a que de lointains rapports avec ce que fut le carnaval entre le XIIe et le XIXe siècle.
Napoléon interdit les fêtes de carnaval ; après 1815, l’Autriche, qui avait conquis la Vénétie et la Lombardie, l’autorisa un temps puis l’interdit, avec le port du masque, et il ne se passa presque rien jusqu’en 1979. Seuls, dans les quartiers, en 1979 et 1980, quelques groupes de jeunes avaient repris la tradition de se masquer et de lancer parfois des projectiles, de la farine ou parfois des œufs frais ou pourris, sur les passants, ils installent quelques éventaires et étalages dans les rues, on vend du vin et quelques beignets ; en 1981, pour encadrer ces manifestations, qui risquaient de ne pas être assez favorables au tourisme, la Municipalité de Venise décida donc d’organiser à nouveau le Carnaval, en liaison avec la Biennale qui a saisi l’occasion de faire un événement culturel et un moment de grand divertissement. En 1982, avec le jumelage entre Venise et Naples, le Carnaval reçoit 700.000 visiteurs ; en 1983, la Commune consacre au Carnaval un demi-milliard de lires et le Théâtre de la Fenice 200 millions, Venise voit passer en 10 jours près d’un million de visiteurs. En 1984, la Commune s’associe à un sponsor (la société financière Alivar) qui offre 250 millions de lires, organisant 390 spectacles, des bals, des fêtes.
Tout est organisé, Luigi Nono pense que ça l’est trop et que chacun n’est venu que pour montrer son masque dans une promenade sur la place Saint-Marc ; le billet d’entrée au bal organisé par la Fenice chez le prince Orlowsky coûte 150.000 lires et le règlement impose un costume vénitien ou viennois de la fin du XIXe siècle. Même prix pour le bal du samedi gras organisé à l’hôtel Cipriani par Natale Rusconi ayant pour thème « Une nuit en bleu sur l’orient Express » ; le ministre De Michelis offre aussi sa fête au palais Bernabò. Le carnaval commence à être monopolisé par la publicité et par les ministres qui se mettent en valeur dans les fêtes. Hugo Pratt déclare que le carnaval a cessé d’être une fête du peuple vénitien et que dorénavant il n’ira plus. Le Maire Mario Rigo interdit tout jet de farine ou de pétards et n’autorise que les confettis et les étoiles filantes. Il y a maintenant chaque année un thème dominant ; le centre de la fête est la place Saint Marc, décorée en 1986 d’un immense lampadaire de 3000 lampes avec 5 kms de fil électrique ; cette année-là, dont le thème est « Lumières de Venise, lumières d’Orient », la fête la plus curieuse est un bain turc véritable dont les acteurs sont nus, la tête couverte de grands turbans lumineux, au milieu de fumées parfumées et buvant des thés de saveur orientale, tandis que d’autres acteurs, des hommes politiques, des entrepreneurs, des intellectuels racontent des histoires de Mille et une nuits et tandis que l’on projette un film érotique, tout cela retransmis par la télévision. On projette sur la façade du palais Correr d’immenses publicités du sponsor... On peut louer très cher, si on ne les fait pas soi-même, des costumes chez Al Baule, Fiorella Shop, la Sartoria Pin ou Lorenzo Rubelli. Le carnaval est devenu une belle opération touristique et commerciale.
Mais Venise est Venise, et s’il y a parfois des spectacles médiocres et de mauvais goût, l’ensemble reste souvent de qualité. Prenons l’exemple du carnaval de 1985 : c’est l’année du jumelage avec Paris et on y verra Noureïev, Monica Vitti, Jean-Claude Brialy, le corps de ballet de l’Opéra de Paris ; même Hugo Prat y reviendra pour une grande exposition consacrée au personnage de Corto Maltese ; on pourra visiter la « Venezia minore », il y eut des manifestations pour les enfants et pour les personnes âgées, une marche œnologique dans les principaux bars de Venise, « l’ombra lunga » pour déguster des milliers de litres des meilleurs vins de Vénétie, mais aussi un bal des courtisanes où on dut élire la reine du bal qui, à la fin interdite aux mineurs, eut pour tâche de consoler le « roi des cocus » élu au cours de la fête des taureaux le soir de l’inauguration du carnaval ; les chats furent aussi de la fête avec un groupe de dames déguisées en chats roses racontant des histoires de chats au profit des chats abandonnés de San Lazzaro. Il y eut encore une « festa barona » (c’est-à-dire coquine) interdite aux mineurs où l’on reconstitua le carnaval de 1750 et où se rencontrèrent Casanova, Guardi, Gozzi, Goldoni, les courtisanes Angela Zaffetta et Veronica Franco, des cartomanciens, des marionnettistes, des arracheurs de dents, des musiciens, des funambules, et où le poète licencieux Giorgio Baffo vint distribuer et faire réciter ses très érotiques poésies avant d’être arrêté par des sbires de l’inquisition. On put voir aussi les « Trésors de l’Oncle Picsou », les personnages de Walt Disney... Mais combien de « touristes » peuvent aller aux spectacles les plus intéressants ?
Le carnaval de l’histoire fut autre chose. Sa première apparition dans la tradition vénitienne date de 1094, et on sait que le peuple vénitien se livrait à de nombreux divertissements la veille du Mardi gras, qui fut déclarée jour férié en 1296. On donne plusieurs origines au mot, « carnem laxare », veille d’un Carême où la consommation de viande était limitée, ou bien « car naval » (char naval), la nef des fous. Et peu à peu, le développement de ces divertissements fut tel (au XVIIIe siècle, il commençait en octobre jusqu’à Noël et reprenait le 26 décembre, pendant six mois) que la République dut les organiser, publiant nombre de décrets pour réglementer par exemple le port du masque. Mais les références de ces fêtes étaient cosmiques (l’arrivée du printemps en mars) ou historiques (celle de 1094 célébrait une victoire de Venise sur Aquileia, celle de 1572 la victoire de Lépante sur les Turcs...).
Essayez de voir Venise à travers son histoire et ses mythes sous les masques de carnaval !


Une catastrophe annoncée : les paquebots monstres marins
Une nouvelle catastrophe annoncée : les paquebots monstres marins !
Venise connaît un autre problème : le passage dans le Canal de la Giudecca des énormes bateaux de croisière, qui s’arrêtent devant Saint-Marc pour que les touristes puissent prendre des photos de la place, du Pont des Soupirs et de la Riva degli Schiavoni.
Les Vénitiens protestent, mais en vain. Qu’est-ce que cela rapporte à la ville ? Qui sait ? Peut-être quelque compensation financière donnée à la Municipalité ? Mais sinon, rien : les touristes ne s’arrêtent pas à Venise, et mieux ne pas imaginer les dégâts que causerait un Costa-Concordia, s’il avait un accident dans la lagune.
Et qui sait combien ces énormes carcasses de 15 étages causent de dommages écologiques ? On n’en parle pas, et les passages continuent : il en passe environ 300 par an. Quelle conception désastreuse du tourisme !
Un Comité s’est formé pour interdire l’entrée des « géants des mers » dans le bassin de Saint-Marc, dénonçant l’érosion des fonds marins, les émissions polluantes, les vibrations faisant bouger les sédiments, etc.
Après le drame du Giglio, l’UNESCO demande l’arrêt du passage des paquebots dans le bassin ; le Ministre de l’environnement proteste aussi.
Nous adressons une pétition au Maire de Venise, photocopiez-la, signez-la et adressez-la au siège de l’INIS, nous la faisons suivre, avec la traduction en italien.
Dossier : l’histoire de Venise
La lagune, élément naturel et culturel
La lagune avant l’histoire
L’occupation romaine
Les invasions barbares et la fin de l’empire romain d’Occident
Rappel de quelques dates (312-774)
La formation des « îles » et les prémices de Venise
L’autorité du dux entre Francs, Byzantins et Église catholique
L’affirmation de Venise aux Xe et XIe siècles
Saint Marc et le lion
Vers le grand empire vénitien
- Byzance (rappel)
- Venise et Byzance
- En Europe
- Les croisades
- Le développement urbain
Lexique de la maison
Un capitalisme marchand
- Commerce et manufacture
- Une classe politique figée gère un capitalisme d’État
- Structure de la population vénitienne
Schéma de la place Saint-Marc
Schéma de l’organisation politique vénitienne
Un régime statique qui n’évolue pas vers un capitalisme industriel
Petite nomenclature vénitienne
Chronologie sommaire (814-1381 et 1381-1866)
La situation actuelle de Venise
- Le problème
- Les causes
- Les solutions proposées
Évolution de « l’Acqua alta » depuis 1897
Jean Guichard
POUR MIEUX COMPRENDRE VENISE ET SON HISTOIRE
(Ce que vous ne savez pas toujours quand vous n'allez à Venise qu'en « touriste »...)
(La pointe de la Douane de mer, de Travani et Lefebvre, 1855)
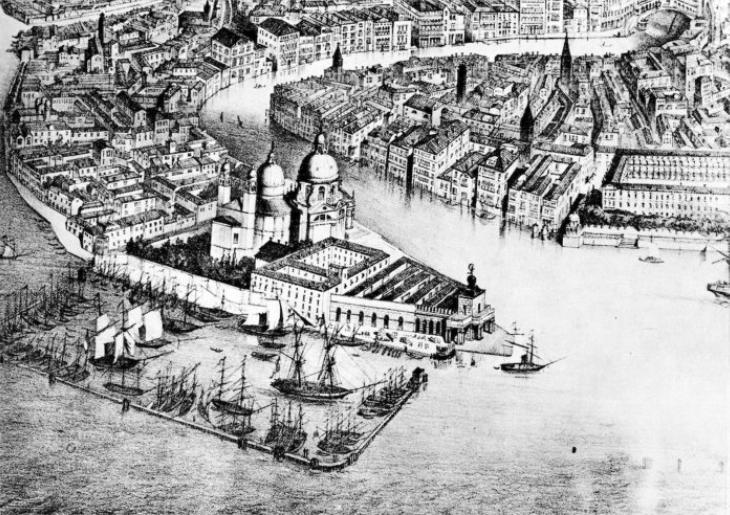
Venise, un mythe ? Oui mais lequel ?
Celui que viennent parcourir pour son « pittoresque » les touristes pressés qui logent ailleurs et font un petit tour à Venise, histoire de se faire photographier sur la place Saint-Marc avec un pigeon sur l'épaule (l'un de ceux qui déposent des tonnes de fiente dans les greniers des palais) ou face au Pont des Soupirs, et qui retourneront chez eux avec une gondole en plastique éclairée de l'intérieur par de petites lampes rouges et fabriquées à Taïwan ?
Un de ces « barbares » que décrit dans une chanson Alberto d'Amico :
In carovana 'riva le bistecche
se femo s-ciompe tuta l'istà
amaestrai come le foche
e i foresti bate le man
En caravane arrivent les beeftecks
nous faisons des plongeons pendant tout l'été
dressés comme des phoques
et les étrangers battent des mains
Qui ne les a vus, en été, dans les « calli », torses nus brûlés par le soleil, jetant dans les canaux leurs canettes de bière vides, écrasant leurs cigarettes sur les dalles de marbre et allant le soir reprendre leur voiture au Tronchetto pour aller dormir à Jesolo, ayant laissé Venise plus sale et sans qu'elle ait gagné un sou ?
On comprend les édiles de la ville quand ils ont décidé d'instaurer une taxe d'entrée à Venise pour tous ceux qui n'y résident pas, fût-ce temporairement, ou d'établir un numerus clausus à l'entrée du pont routier. Le Directeur de l'Office de Tourisme proposa même en 1983 de faire passer un examen aux candidats à Venise afin de s'assurer qu'ils avaient le minimum de culture nécessaire pour profiter vraiment de la ville, et le leur donner en cas de besoin : un cours de formation pour mériter Venise ?
« À Venise, -disait-il -, les pierres parlent, mais il faut savoir les comprendre ; pour venir à Venise une préparation serait nécessaire, il faudrait presque un examen culturel pour les touristes, parce qu'il est difficile de comprendre cette ville, si pleine d'histoire » (La Stampa, 8 novembre 1983), et il souhaitait remplacer le tourisme de masse par un tourisme de qualité, « certes pas lié aux conditions économiques, mais au bien très précieux de la connaissance ».
Où faut-il donc chercher le « mythe » de Venise ?
Un mythe raconte toujours l'origine des choses, comme les mythes grecs ou la Genèse ou l'histoire de Gilgamesh, les mythes indo-américains ou africains. Mais les vrais mythes, ceux qui durent à travers les siècles, les histoires que l'on continue à se raconter, ne nous parlent de l'origine que pour mieux nous projeter dans l'avenir, -ce pourquoi on lit toujours Homère et Virgile, on fait toujours le récit de l'histoire des ancêtres, et la Genèse prend un sens pour les incroyants comme pour les croyants. Robinson Crusoé est le mythe de l'avenir du capitalisme anglais, et pas seulement une histoire qui se déroule dans le passé originel. Ainsi le mythe fait le lien entre le passé et le futur, et par là il éclaire le présent.
Il en est ainsi de Venise.
Venise est un « mythe » parce que l'histoire de sa construction, de son développement entre le VIIIe et le XVe siècle, de ses choix économiques et politiques à partir du XVIe siècle, tout cela trace un modèle fascinant de ville à échelle humaine. Venise est un cas unique, elle n'a pas d'antécédent grec ou romain, elle n'est pas marquée par la féodalité en plein Moyen-âge, ni dépendante de l'empire ou de la papauté, républicaine et laïque en pleine Europe monarchique et chrétienne, dotée d'un des premiers empires coloniaux et d'une flotte exceptionnelle, le plus stable des États italiens dans ses dix siècles d'existence.
Certes elle n'a pas surgi de rien, mais elle donne toujours l'impression d'être née comme Vénus de l'écume de la mer. Venise est une ville-archétype, ville modèle et idéal de développement harmonieux, d'équilibre entre la société urbaine et la nature, dans le respect absolu d'un écosystème très fragile ; et la crise actuelle de Venise, son dépeuplement, son « enfoncement », sa transformation en musée ..., sont emblématiques de la crise des villes contemporaines, ses causes profondes sont en concentré celles de nos villes, de Toulouse, de Milan ou de Londres ; le problème de Venise est donc notre problème.
« Et si cette ville ou plutôt ce double de ville, n'était pas au passé mais au futur? Si notre présent s'y éclairait, comme le passé, d'une façon aussi inattendue qu'inquiétante? » (Philippe Sollers). Et parcourir Venise, goûter son charme encore inoubliable, c'est en même temps apprendre des choses sur nous-mêmes, réfléchir aux solutions de nos problèmes d'urbanisme et de vie quotidienne dans la ville comme au cadre idéal de nos amours. Cela donne sens à la tradition du voyage de noces à Venise ! Vérité oubliée des clichés !
Marinetti avait très bien compris cela
lui qui voyait en Venise le contre-modèle de sa ville idéale : du béton partout, des rues pour faire circuler le maximum de tramways, et de voitures, et il proposait logiquement de combler les canaux de Venise, -Grand Canal compris -, pour en faire des voies de circulation automobile et des lieux d'industrie et de commerce.
Voilà du coup défini l'objectif de ce dossier
quelques informations et propositions pour faciliter votre visite de Venise. Elles ne remplacent pas un guide ni les lectures que vous pourrez faire avant ou après le voyage, parmi les innombrables textes sur Venise ou ayant Venise pour cadre, dont quelques uns sont rappelés dans la bibliographie.

Quand tes murs de marbre
seront recouverts par les eaux
il y aura
un cri des nations pour tes portiques engloutis
une longue plainte sur la mer violente
Byron - Ode à Venise

Navires à l’ancre devant l’Arsenal (Détail du plan de Jacopo de’ Barbari)
I) L’environnement naturel de Venise. La lagune avant Venise entre la nature et l’histoire
Le premier chef-d'œuvre de Venise, ce ne sont ni ses palais, ni ses églises, ni ses peintures : tout cela repose sur un autre chef-d'œuvre, la lagune. Venise a la caractéristique à peu près unique d'être une « ville de lagune » et non pas simplement une « ville de delta » comme Amsterdam, Calcutta, Saigon ou Saint-Pétersbourg : elle ne se dresse ni sur l'embouchure d'un fleuve, ni au bord de la mer, ni en contact avec la terre ferme, mais elle est composée d'un système d'îles à l'intérieur de la lagune.
1. La lagune, élément naturel et culturel
La lagune est d'abord un élément naturel de formation antérieure à l'arrivée de l'homme et indépendante de sa présence ; mais elle devient ensuite un élément culturel, dans la mesure de l'intervention humaine pour transformer le milieu naturel et en modifier les facteurs.
Une lagune est un milieu côtier, résultat d'une interaction entre des fleuves et la mer. Les matériaux solides apportés par les fleuves se sédimentent au contact de l'onde contraire des marées et forment des cordons littoraux de sable qui s'étendent jusqu'à former un plan d'eau entre terre et mer. Ces cordons (« lido ») présentent des interruptions (les « bocche a mare ») à travers lesquelles le flux et le reflux des marées permettent le renouvellement permanent en eau salée. La lagune est donc un milieu de transition en transformation perpétuelle selon que l'emporte l'action de la mer (la houle, les courants, l'ampleur des marées, le régime des vents ...) ou le travail de sédimentation des fleuves (quantité de matériaux déposés, ce qu'on appelle « l'atterrissement », « l'interrimento »). À ces facteurs s'ajoutent les phénomènes d'abaissement du sol ou d'élévation du niveau de la mer (par exemple par fonte des glaciers). C'est dire qu'une lagune est par nature un élément fragile et mouvant dont il faut préserver l'équilibre dynamique entre la mer et les fleuves, pour éviter la transformation ou en bras de mer ou en terre ferme.
La lagune devient un élément culturel, à partir de l'époque historique où les hommes commencent à intervenir sur son évolution naturelle. La forme de la lagune de Venise est dans une large mesure artificielle, fruit d'une politique visant non pas à faciliter le passage de la mer à la terre ferme par les fleuves, mais au contraire, à partir du XIVe siècle, à bloquer les eaux fluviales, à les détourner de la lagune pour laisser l'eau salée de la mer pénétrer plus profondément, envahir la zone côtière interne de la lagune et « isoler » ainsi la ville, en faire une île. La matrice fluviale de Venise est ainsi neutralisée, aucun fleuve ne débouchant plus dans la lagune (ni le Brenta au sud ni le Sile au nord), au profit de la matrice maritime. D'où une double image de Venise : à marée haute, la ville apparaît comme un ensemble d'îles émergeant du plan d'eau de la lagune ; mais à marée basse, lorsque les « francs-bords » (la « golena », les terrains en bordure de l'eau) sont découverts, on retrouve le tracé méandreux d'un delta de fleuve plus ou moins marécageux. D'où aussi les difficultés que rencontrent les administrations pour préserver cet équilibre, à partir du moment où Venise a perdu la maîtrise de ses eaux pour tomber sous la domination autrichienne d'abord (du Traité de Campoformio en 1797 par lequel Bonaparte remettait à l'Autriche Venise à peine conquise, jusqu'en 1866) puis sous domination de l'État central italien à partir de 1866, deux pouvoirs assez indifférents à la spécificité de la lagune et de la ville et qui amorcèrent le déclin de Venise, qu'il faut donc dater du XIXe siècle et non pas du XVIIe selon un cliché qui a de la peine à mourir.
2. La lagune avant l'histoire
Les sondages, carottages, photographies aériennes nous permettent de faire maintenant des hypothèses plus précises sur la formation de la lagune.
À la fin de l'Ère tertiaire (Pliocène : vers 3 millions d'années), le niveau de la mer était particulièrement haut et l'eau recouvrait toute l'actuelle plaine du Pô (cf carte 1).
Au début de l'ère Quaternaire, le refroidissement du climat provoqua des glaciations successives qui font descendre le niveau de la mer d'environ 90 m. par rapport au niveau actuel ; la ligne de côte descendait jusque vers la moitié de l'Adriatique.
1) L’eau de la lagune
2) Les terres émergées, îles, « barene », etc
3) Le fonds boueux de la lagune
4) La couche argileuse compacte ou sableuse
5) La nappe phréatique
6) La couche de tourbe
7) Les volumes de gaz méthane.
La ville de Venise repose sur une couche argileuse comme une couche douce et élastique, homogène qui la défend contre d’éventuelles secousses telluriques. Pour construire une maison, on enfonçait les pieux jusqu’à la couche d’argile sous-marine (Cf. ci-contre) (Source : Ferruccio Piazzoni, Turismo scolastico, Moizzi Ed. op.cit. p. 46)
Construction d’une maison : les pieux de chêne ou de mélèze (aujourd’hui de béton) venaient reposer sur la couche d’argile ; ils soutenaient, à l’abri de l’eau, une série de planches sur lesquelles reposent les blocs en pierre d’Istrie des fondations et par-dessus les murs en brique de la maison. Les pieux étaient plantés des deux façons ci-contre.
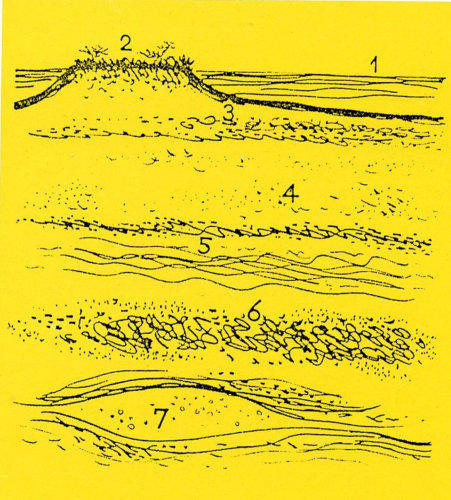
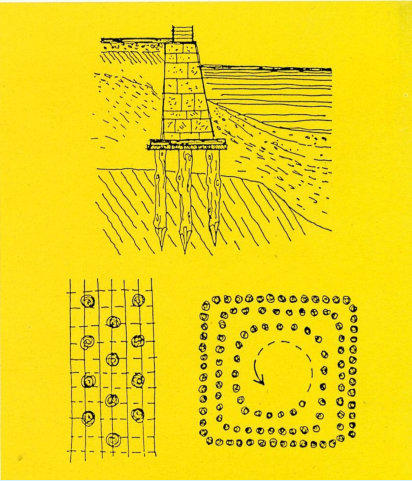
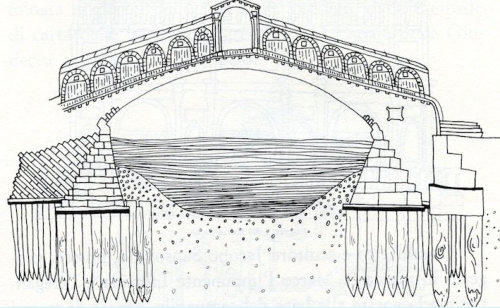

Il y a environ 6000 ans, la fonte des glaces fait remonter le niveau de l'eau qui correspond alors à peu près à l'état actuel. Les alluvions fluviales forment des cordons de dunes derrière lesquels l'eau douce stagne, tandis que l'eau de mer pénètre par les ouvertures entre les cordons, correspondant au débouché des fleuves dans la mer. C'est alors que se forment les lagunes primordiales dans les régions de Venise et de Ravenne, avec une prédominance des eaux fluviales qui donne aux lagunes un aspect marécageux.
C'est seulement il y a environ 2000 ans (peu avant ou peu après Jésus-Christ) que l'avancée de la mer donne à la morphologie lagunaire sa forme actuelle marquée par une prédominance de l'eau saumâtre et une diminution progressive des terrains marécageux. L'image d'une ville qui se serait construite sur des îlots déserts épars au milieu des eaux d'une vaste lagune préhistorique est donc parfaitement improbable ; la montée des eaux de mer se fait probablement en plusieurs fois (aux IV-Vèmes siècles, au IXème et encore aux XI-XIIIèmes siècles) ; au IXème siècle, quand est construite la première « basilique » Saint-Marc, l'îlot de San Servolo est encore décrit comme « loco angusto ... infra paludes » (lieu étroit au milieu des marais).
De même les relevés par photos aériennes réalisés à Heraclea (au niveau de Jesolo. La ville est aujourd'hui ensevelie sous 50 cm de terres agricoles) en 1977 et 1983 font apparaître un ensemble de petits lots rectangulaires étalés le long du méandre d'un fleuve côtier courant entre les marais d'eau douce, dont les rives furent bonifiées et urbanisées. On peut faire l'hypothèse que, dès l'époque romaine et peut-être étrusque, il en fut de même du site de Venise : régularisation, protection, bonification des méandres fluviaux alors dominants avant l'avancée de la mer. À la lettre, il n'y a pas de « lagune » mais des terres agricoles sillonnées de canaux et plus ou moins marécageuses.

3. L'occupation romaine
On sait en particulier, à travers le témoignage de Tite Live, que les deux villes de Padoue et Altinum alimentaient des trafics maritimes à l'époque préromaine, et devaient entretenir, à l'embouchure des fleuves Brenta (le Medoacus des Romains qui donnera son nom à Malamocco) et Sile, des villages qui constituaient des points de contrôle des embarcations à fond plat capables de remonter les fleuves et que l'on pouvait tirer facilement sur la rive. Le site de la future Venise n'est pas non plus le "désert" évoqué par le mythe selon lequel on passerait du chaos initial à la splendeur vénitienne, comme dans le récit biblique de la Genèse !
Les Romains conquièrent la région à partir de 229 av. J.C. ; ils construisent en 148 av. J.C. la Via Postumia de Gênes à Aquileia et y ajoutent en 132 av. J.C. la Via Popilia (Ravenne-Padoue) et la Via Annia (Padoue-Aquileia) puis la Via Flavia (Aquileia-Pola). Padoue était une des villes les plus riches de la région, Aquileia (fondée par les Romains en 181 av. J.C. comme avant-poste contre les tribus des Gaulois transalpins, la plus importante ville commerciale du nord de l'Italie) et Altino, un grand port qui jouissait du monopole du commerce de l'ambre. Le site de la future Venise est alors traversé par un cordon de dunes parallèle à la côte qui séparait l'aire occidentale d'influence fluviale à usage agricole (comme le confirment les « centuriations » révélées par photos satellites en 1977) et l'aire orientale soumise à l'envahissement par les eaux de mer. Les Romains creusent par ailleurs des canaux (« fossa ») qui longent la côte de Ravenne à Aquileia. L'aire de la future Venise est ainsi prise dans un réseau de relations comportant :
- le trafic maritime vers Padoue et Altino ;
- le trafic par les canaux internes ;
- l'exploitation agricole des bonifications de l'aire fluviale riches en fruits, légumes, bois, roseaux pour la construction des cabanes et des refuges, mais aussi de l'exploitation du sel.
L’archéologie contemporaine découvre qu’il y eut en fait une occupation préromaine de la lagune, encore en cours. (Voir les recherches de Ernesto Canal, Revue Archeologia, n° 66 ; nov./déc. 1997, pp. 18-34.)
Aquileia fut, après Milan et Ravenne, une des villes les plus importantes du nord de l'Italie romaine, porte vers l'orient, couloir de trafics multiples, chef-lieu de province riche en monuments, siège des institutions impériales ; elle est renforcée par la tradition d'une fondation apostolique par l'évangéliste Marc, délégué par Pierre à l'évangélisation de l'Italie du nord, et par la légende du martyr Ermacoras premier évêque d'Aquileia, qui aurait été converti directement par Marc et ordonné par Pierre lui-même à Rome, avant de mourir dans les persécutions de Néron. Ses évêques Ruffin, Cromatius et Jérôme pouvaient être comparés aux grands saints plus connus que furent Ambroise, Zénon et Augustin. Il y eut probablement une liturgie propre à Aquileia jusqu'à l'uniformisation sur l'unique modèle romain en 1596. La ville eut des liens privilégiés avec Alexandrie d'Egypte (d'où la légende des dépouilles de Marc volées à Alexandrie), pays d'origine des premières communautés judéo-chrétiennes venues s'installer sur les côtes de l'Adriatique nord.
C'est dans les mêmes lieux que se diffuse le christianisme à partir du moment où il devient religion d'État (Concile de Nicée, 325), et où la capitale de l'Italie et de l'Afrique est transférée à Milan (293) tandis que Constantin déplace le centre de l'Empire à Byzance rebaptisée Constantinople (330 après J.C.). L'Église de Milan, dominée par la grande figure de Saint Ambroise, élit Eliodore évêque d'Altino en 381 et Cromatius évêque d'Aquileia en 388 ; un autre évêque, celui de Concordia, revendique les reliques de Saint Jean l'Évangéliste et de Saint Thomas apôtre pour les églises de cette aire côtière définie comme Venetia maritima, partie de la Xème « Regio » augustéenne (Venetia et Histria). En 402, Ravenne devient la capitale de l'empire romain d'Occident, après la cassure imposée par les invasions des tribus germaniques. À cette époque les lagunes de Ravenne ont déjà commencé à être comblées par atterrement, le delta du Pô avance et la rive s'éloigne de plus en plus, condamnant bientôt le port de Ravenne, Classis. Pline place déjà Spina parmi les villes disparues ; elle sera remplacée par Comacchio, grande rivale de Venise dans le commerce maritime et fluvial.
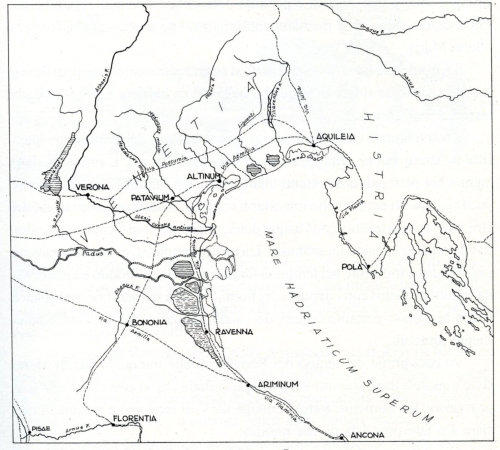
4. Les invasions barbares et la fin de l'empire romain d'Occident
Il faut renoncer à la tradition selon laquelle, pendant les invasions barbares du Vème siècle, les habitants de la terre ferme se seraient transférés de façon stable dans les îles de la lagune pour y chercher refuge. Une lettre de Cassiodore (487-583), préfet du prétoire de Théodoric, est adressée en 537-538 aux « tribunis maritimorum » des Venetiae pour solliciter le transport de denrées alimentaires d'Istrie à Ravenne. Il décrit la zone lagunaire comme occupée par peu d'habitants, qui vivaient dans de modestes maisons en bois, de la pêche et de l'extraction du sel. Les fouilles effectuées à Torcello ont confirmé que cette zone n'était pas déserte (l'île était située sur la voie qui conduisait de la mer à Altino) mais habitée de façon sporadique et modeste (on a retrouvé en 1990 les restes d'une maison romaine du 1er s., sous une strate romaine tardive, une strate byzantine et une strate médiévale) ; ce n'est qu'à partir de la fin du VIème, début du VIIème siècle que la colonisation devient permanente et plus intense, développant une activité de marché mais aussi une activité industrielle, le travail du verre, jusqu'au VIIIème siècle, après quoi l'île devient surtout un centre religieux. (Santa Fosca, San Giovanni Evangelista, la cathédrale Santa Maria fondée en 639).
Cette lettre de Cassiodore évoque aussi les « tribuns », autorités civiles des anciens villages de l'époque romaine maintenus par le royaume ostrogoth de Théodoric. Vinrent s'y ajouter les « duces » ou « magistri militum », chefs militaires nommés par l'empereur Justinien à la tête de troupes orientales, après la reconquête de l'Italie et la nomination d'un représentant à Ravenne (« exarque »). Cette double présence de la tradition romaine et de l'empire byzantin pèsera plus tard sur la formation de la ville de Venise.
Rappel de quelques dates :
- 312 : Constantin l'emporte sur Maxence à la bataille de Ponte Milvio aux portes de Rome et se convertit au christianisme
- 313 : Edit de Milan, liberté de culte pour les chrétiens
- 324 : Constantin reste seul empereur romain
- 330 : transfert de la capitale de l'Empire à Byzance
- 379-395 : Théodose empereur ; infiltrations d'éléments germaniques dans l'armée romaine, début d'invasion des Goths
- 380 : Edit de Thessalonique, le christianisme devient religion d'État et se répand dans tout le bassin méditerranéen
- 395 : deux empereurs, Honorius, empereur d'Occident (395-423) ; Arcadius, empereur d'Orient (395-408)
- 410 : Les Wisigoths d'Alaric saccagent Rome
- 452 : les Huns d'Attila saccagent les villes de Vénétie (dont Altino) et sont arrêtés à Mantoue par le pape Léon-le-Grand
- 455 : les Vandales de Genséric saccagent Rome
- 476 : Odoacre, roi des Erules, dépose le dernier empereur d'Occident Romulus Augustulus et se proclame Roi des Germains et Patricien de l'empire d'Orient
- 474-491 : Zénon, empereur d'Orient envoie Théodoric, roi des Ostrogoths, lutter contre Odoacre qui est vaincu et tué à Ravenne en 493
- 493-526 : Théodoric, reconnu Patricien des romains, adopte l'hérésie arienne
- 527-565 : Justinien empereur reconquiert l'Italie sur les successeurs de Théodoric, l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne, grâce à ses généraux Bélisaire et Narxès
- 568 : Un « exarque » est nommé à Ravenne par l'empereur d'Orient
- 568-774 : invasion des Longobards : Albuin, Agilulf qui les convertit au christianisme, Liutprand et Astolphe qui occupent l'exarcat de Ravenne (751) ; le roi Didier menace Rome, le pape fait appel à Charlemagne et Pépin-le-Bref. Didier est vaincu à Pavie en 774. Début du pouvoir temporel du pape.
En 568, sous la pression des nouveaux envahisseurs longobards (les Lombards), l'archevêque d'Aquileia Paolo se transfère à Grado, plus proche de la mer, en emportant les trésors de l'église. C'est en réalité la pression longobarde qui accentue peu à peu le déplacement des populations de l'intérieur vers les côtes. Les invasions précédentes des Ve et VIe siècles n'avaient pas modifié la structure régionale augustéenne et l'unité régionale vénéto-istrienne : d'Odoacre aux Byzantins, elle fut simplement intégrée aux nouveaux royaumes. La fuite vers les côtes était considérée comme provisoire : Paolo n'a pas l'intention de transférer le siège de l'église vénéto-istrienne de façon définitive, et son successeur Probino est probablement retourné pour quelques temps à Aquileia. Les Goths et les Huns ne font que passer sans volonté d'installation durable ; les habitants de la terre ferme fuyaient avec l'espoir de rentrer chez eux, passé l'orage.
Puis la domination des Lombards se perpétua, eux s'installaient de façon définitive ; la région se partagea entre eux qui occupaient tout l'intérieur, et les Byzantins à qui ne resta à partir de 639 que la zone côtière de la lagune où commença alors à se construire un nouvel équilibre des pouvoirs religieux, civil et militaire, dans la dépendance de l'exarque de Ravenne sous la haute souveraineté de l'empereur de Constantinople. La hiérarchie byzantine est respectée, perpétuant l'unité du monde romain : il faut insister sur ce fait que, malgré la profondeur du bouleversement social et l'éparpillement des implantations dans les diverses « îles », l'ensemble des populations exilées garda une totale cohésion politique sous l'autorité du magister militum dans un ordre hiérarchique unique : au royaume lombard, les réfugiés préfèrent l'ancien ordre romain incarné par Byzance. Les châteaux (« castrum ») qui se construisaient dans chaque île (cf encore le quartier nord de Venise : Castello), ne furent jamais des entités indépendantes mais dépendirent toujours de la Civitas nova, la ville nouvelle, qu'elle soit installée à Héraclea ou à Rialto.
En 639, Marcello, le magister militum, gouverneur de la provincia Venetiarum, s'installe à Héraclea, puis, à la demande de l'exarque, sur l'île de Torcello où il fait construire une église dédiée à « Maria Dei Genetrix ». En 742, le dux transporte son siège à Malamocco, sur le litoral, en contact étroit avec la mer et la flotte byzantine. En 776, est créé un second évêché dans le « duché » sur l'ilôt d'Olivolo, près de l'actuel San Pietro di Castello. Ce choix est emblématique du tournant opéré dans la stratégie territoriale du duché : on abandonne les anciennes lignes de développement (le trafic vers Altino et Padoue) au profit des îles où s'étaient déjà installés les monastères bénédictins qui servaient de point d'appui pour les trafics avec l'Orient, à San Servolo (à 1500 m. au sud-ouest d'Olivolo), San Zaccaria (près duquel se dressera San Marco), San Giorgio Maggiore. Enfin, le nouveau dux, Agnello Partecipazio (811-827), abandonne Malamocco attaqué par les Francs et transfère son siège près d'Olivolo dans la zone appelée Rivoaltum, Rialto, nom qui restera longtemps à Venise.
On assiste donc à un double phénomène :
- Le pouvoir de l'exarque est délégué au magister militum qui prendra pour la première fois, avec un certain Deusdedit le titre de dux à partir de 713-716. En 732, quand les longobards chassent l'exarque de Ravenne, le patriarche de Grado fait appel à la flotte des Vénètes qui commence donc à avoir une existence autonome.
- Les organes religieux et politiques sont peu à peu transférés de la terre ferme ou de la périphérie de la lagune vers les « îles » de l'aire qui va devenir Venise. En choisissant Byzance contre les Lombards puis contre les Francs, Venise échappait dès le départ à un avenir terrien et agricole pour se tourner vers l'Orient et vers la mer. Venise allait devenir « l'intermédiaire naturel et officiel pour les échanges entre les deux puissances (royaume franc, empire byzantin). Voilà donc confirmée définitivement la vocation de Venise comme centre des communications et des échanges commerciaux entre Orient et Occident » (Alvise Zorzi).

5. La formation naturelle des « îles » et les prémices de Venise
Mais pour que les habitants de la terre ferme puissent s'installer dans les îles, il fallait qu'il y eût des îles... Ce choix stratégique fut en effet rendu possible par les événements naturels : vers 590, toute la Vénétie fut affectée par un ensemble de très fortes inondations, dues à des phénomènes de bradysisme (mouvement vertical du sol) qui bouleversèrent tout l'équilibre hydrogéologique. Les eaux de l'Adige noyèrent Vérone, déplaçant leur lit pour déboucher dans l'Adriatique près de Chioggia ; le Brenta se déversa loin de Padoue, abandonnant son lit au Bacchiglione, le cours du Piave et du Sile fut changé, bouleversant les aires d'Altino, Concordia et Torcello. Tout le système agraire, routier, fluvial de la zone côtière est modifié, voire détruit, et pour la première fois on commence à parler d'« insulae » (« îles ») et de « Venetia » insulaire, à la différence de la période précédente où des îles n'apparaissaient qu'à marée basse et étaient noyées à marée haute. (Cassiodore écrit dans sa lettre : « Vous habitez des terres que l'eau couvre et découvre selon son mouvement alterné. Vos maisons, qui semblent tantôt posées sur la terre, tantôt flotter sur l'eau, ressemblent à celles des oiseaux des marais ».)
Ce n'est donc que vers la fin du VIème s. que l'on peut dater les premières traces d'installation stable dans des îles jusqu'alors inexistantes.
Dans les siècles suivants, les nouveaux « vénitiens » apprirent à connaître cette dialectique entre les eaux douces des fleuves et les eaux saumâtres de la mer. Ils tendirent à stabiliser l'équilibre atteint en limitant toute avancée des alluvions fluviales, qui provoquaient l'atterrement, la création de marais et la malaria. On dévia donc le Brenta et le Sile pour les faire déboucher non plus dans la lagune mais directement dans l'Adriatique, on protégea les cordons littoraux de l'érosion marine par la construction des « murazzi » (1716-1787), énormes digues en pierre d'Istrie de 4,50 m. de haut et d'une largeur de 14 m., on aménagea la profondeur des « bocche » pour les maintenir navigables, on creusa en 1727 le canal de Santo Spirito qui mettait en communication la « bocca » de Malamocco avec le bassin de Saint-Marc ; en 1791, on marqua les limites de la lagune par 99 bornes sur un périmètre de 157 kms. Tout cela était réalisé au nom d'une politique cohérente parfaitement contrôlée et maîtrisée par la République de Venise, sous l'autorité du « Magistrat des eaux », un des plus importants et des plus surveillés : « Pesélo, paghélo, impichélo » (Évalue-le, paie-le, pends-le, s'il fait mal son travail), disait la formule de présentation au peuple par le doge !
Les problèmes commenceront à partir du moment où Français, Autrichiens et Piémontais subordonnèrent leur politique vénitienne à des exigences et à des intérêts qui n'étaient plus ceux de Venise. La situation actuelle est l'héritage de presque deux siècles de négligences et d'erreurs par méconnaissance de la réalité naturelle et de l'histoire de la construction de Venise.
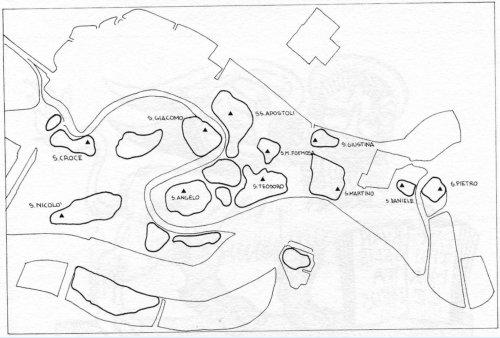
II) L’ « invention » de Venise entre VIIIe et XIIe siècles
1. L'autorité du dux entre Francs, Byzantin et Église romaine
La domination byzantine avait certes ses adversaires dans les populations de la Ville nouvelle, mais c'est une querelle religieuse qui provoque la révolte contre Byzance et permet le début d'un développement autonome de Venise : la querelle des images. Entre 725 et 730, l'empereur Léon III l'Isaurien engage une lutte iconoclaste, réprouvant la présence de représentations du Christ et des saints dans les lieux de culte : il les considère comme idolâtres et les fait interdire et détruire.
L'opposition du pape Grégoire II à l'extension de l'édit iconoclaste de Léon offre aux adversaires de Byzance le prétexte pour se révolter contre sa domination. La révolte s'étend de l'Église aux sphères sociales et militaires, à la défense de la foi commune se joint la revendication de liberté politique. L'armée de Vénétie (« exercitus Venetiarum ») décide alors d'élire son propre dux jusqu'alors nommé par l'empereur et l'exarque de Ravenne. Le pape, qui avait déclenché la révolte pour la sauvegarde de ses prérogatives, freine ensuite les révoltés qui pensaient conclure leur lutte en élisant un nouvel empereur d'Occident. Mais il reste que cette élection du dux est la première manifestation de la future autonomie de Venise par rapport à Byzance.
Qui fut le premier dux élu ? Le Paulicio Anafesto considéré comme le premier n'est en réalité qu'une lecture tendancieuse par un diacre de l'inscription inscrite sur les bornes « PAUL - (PATR) - ICIUS » qui désignait Paul l'exarque de Ravenne mort en 727. Le chef des rebelles fut plus probablement un certain Orso hypatos, reconnu ensuite par l'empereur Léon III lorsque fut restaurée l'autorité impériale après la révolte. Lui succèdent d'abord son fils Deusdedit (Theodato hypatos), en 742, puis un citoyen de Malamocco, Domenico Monegario, tous assassinés par des révoltes populaires. C'est un citoyen d'Heraclea, Maurizio, qui sera élu « duca » en 764, compromis entre les deux composantes de la population, les marchands et propriétaires fonciers de terre ferme (Héraclea) et les marins commerçants de Malamocco.
La conquête de Ravenne par les Longobards entre 740 et 751 diminue encore le territoire byzantin en Italie, l'exarque se réfugie dans la lagune ; l'empire byzantin affaibli se concilie les ducs en les couvrant d'honneurs et de titres.
L'avancée des Longobards, qui conquièrent l'Istrie après Ravenne en 751, oblige le pape à faire appel aux Francs de tradition catholique pour contrebalancer l'influence des Longobards ralliés à l'arianisme. (Les ariens, disciples du prêtre Arius (280-336), d'Alexandrie, auteur d'une théorie trinitaire selon laquelle le Fils, engendré dans le Temps, était semblable mais non égal, non consubstantiel au Père. L'arianisme est condamné comme hérésie par le Concile de Nicée en 325, mais il reste vivant jusqu'au VIIème siècle parmi les barbares (Goths et Ostrogoths) et dans l'Empire d'Orient.)
Les Francs (Charlemagne puis Pépin-le-Bref) avaient déjà vaincu les Arabes à Poitiers (732) et constituaient la plus grande puissance terrestre de l'Europe chrétienne ; après 20 ans de guerre, ils défont l'armée longobarde à Pavie en 774 ; c'en est fini du royaume longobard dont le dernier roi, Didier, est déposé. Mais Charlemagne revendique la couronne impériale qui lui est remise par le pape Léon III en 800. C'est la rupture entre deux empires, Rome et Constantinople, doublée d'une rupture entre deux églises, grecque-orientale et latine-occidentale dont les querelles se transfèrent dans la lagune. Venise est prise entre trois puissances : l'empire byzantin, l'empire carolingien et l'Église de Rome : en faisant appel aux Francs, le pape avait revendiqué pour lui-même la possession des anciens territoires longobards, y compris « les provinces de Vénétie et d'Istrie », tandis que Charlemagne revendiquait lui aussi ces territoires ; il établit un blocus économique autour de la lagune qui résiste, sa flotte assiège, conquiert peut-être Malamocco mais ne réussit pas à entrer dans la lagune et est bientôt mise en fuite. Venise était sauvée. En 814, Constantinople (l'empereur Nicéphore) reconnaît à Charlemagne le titre impérial ; en échange, les Francs restituent à Byzance ses possessions adriatiques et dalmates. Le « duché » revient sous domination byzantine, et le nouveau dux, Agnello Partecipazio (811-827), transfère sa résidence à Olivolo : ainsi commence à se former la future ville de Venise.

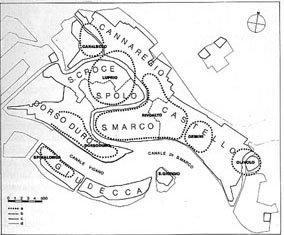
2. L'affirmation de Venise aux Xème et XIème siècles
Mais à cette époque, la population est encore dispersée en de nombreux centres, 17 selon le Pacte de Lothaire de 840, 28 selon le Traité de l'empereur byzantin de 948-952, parmi lesquels s'affirment peu à peu celui de Rivoalto comme centre politique, résidence du dux, et celui de Torcello comme centre commercial principal. Le drainage des canaux existants, le creusement de nouveaux canaux dessine progressivement le tracé de la future ville, encore mobile du fait d'une nouvelle avancée de la mer.
Au XIème siècle est délimité un ensemble de six « régions », dont le nom se réfère à leurs caractéristiques morphologiques naturelles, et qui commencent à révéler la distribution des fonctions administratives, civiles et ecclésiastiques :
- Olivolo, île où étaient plantés des oliviers ;
- les Gemine, deux îles « jumelles » ;
- Rivoalto, terre plus élevée et plus solide, de même que
- Dorsoduro, un « dos » plus dur
- Luprio, de la racine « Lup » indiquant un sol émergeant d'une zone marécageuse, infiltré par l'eau de mer à travers le Grand Canal ; c'est la zone correspondant à la paroisse de San Giacomo dell'Orio, « Orio » étant une contraction de « Luprio ».
- Canaleclo, zone plantée de roseaux (cannaie, futur « Cannaregio ») et marécageuse, occupée par l'eau douce de la rivière de Mestre qui débouchait vers cette île.
L'opposition entre ces deux zones, l'une plus haute (Rivoalto et Dorsoduro), l'autre plus basse (Luprio et Canaleclo), concorde avec les indications des carottages selon lesquelles un cordon de dunes passait dans cette zone, séparant les eaux douces des eaux salées.
Le territoire de Venise était donc probablement assez incohérent à cette époque : des maisons en bois ou en dur dispersées entre les zones marécageuses appelées « piscine » qui séparaient les îlots et pénétraient même les zones dures comme Dorsoduro.
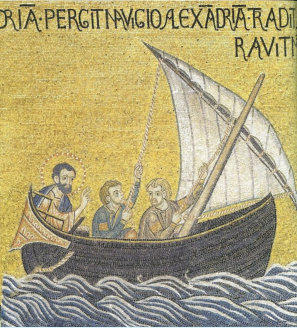

3. Saint Marc et le lion
C'est dans ce contexte que la basilique Saint-Marc prend son nouveau visage, à partir de sa reconstruction de 1063 et du transfert des reliques de saint Marc vers 1094. La basilique n'est pas la résidence de l'évêque (la cathédrale était à San Pietro di Castello), mais l'église officielle de l'État vénitien, la chapelle du palais ducal ; elle avait le privilège de ne pas dépendre de l'autorité de l'évêque mais d'un « primicerius » nommé par le doge et qui jouissait de quelques privilèges épiscopaux. C'était une magistrature de la République, la « Procuratia de supra » qui s'occupait de la gestion de la basilique. Les cultes ne se déroulaient pas selon le rite romain, mais selon un rite liturgique propre à Saint-Marc jusqu'en 1807, date à laquelle le Patriarcat de Venise est transféré de San Pietro à San Marco ; un certain nombre de mélodies et de lectures se maintiennent même jusqu'après le Concile Vatican II.
Saint-Marc, c'est donc Venise même, non pas un simple édifice religieux, mais le symbole de la ville, de son indépendance par rapport aux autres puissances et à l'Église de Rome, de son unicité. La légende de saint Marc s'affirme à partir du XIIIème siècle au moment où la basilique s'orne de marbre et de mosaïques, et elle devient histoire et article de foi. Elle veut que Marc, de retour d'Aquileia où Pierre l'avait envoyé annoncer la bonne nouvelle, fut pris par une tempête à l'embouchure du Medoaco (le Brenta) et poussé vers un bas-fond où sa barque s'échoue. Un ange lui apparaît alors qui lui annonce : « Paix à toi, Marc, et sache qu'ici reposera ton corps. Une grande route s'ouvre encore devant toi, oh Evangéliste de Dieu, tu devras encore supporter de nombreuses souffrances au nom du Christ ; mais après ta mort les peuples fidèles qui habitent ces terres construiront ici une merveilleuse ville et se rendront dignes de posséder ton corps, qu'ils honoreront ensuite de la plus grande vénération ». La barque reprend alors son cours jusqu'à Alexandrie d'Égypte dont Marc devient le premier évêque et où il subit le martyre. La légende est due à Eusèbe de Césarée (IVème siècle), le conseiller ecclésiastique de l'empereur Constantin, qui est aussi le seul à situer à Alexandrie les reliques de Marc.
Le symbole de Marc était le lion, qui devient le symbole que Venise place dans tous les territoires conquis comme signe de sa puissance (on appelait les Vénitiens des « pianta leoni » des planteurs de lions !).
La tradition dit seulement que Jean, dit Marc, était le fils d'une femme de Jérusalem qui avait mis sa maison à la disposition des Apôtres pour leurs réunions (Cf Evangile de Marc, 14, 51) ; il suivit le Christ après son arrestation, réussit à s'enfuir, rejoint son cousin Barnabé, Pierre et Paul, suit Paul dans son premier voyage missionnaire, évangélise Chypre (Actes des Apôtres, 15, 37), retrouve Paul prisonnier à Rome (Épître aux Colossiens, 4, 10), reste lié à Pierre qui l'appelle « fils » (Épître de Pierre, I, 5, 13). La tradition veut que l'évangile de Marc ait été écrit en Italie, et en partie à Rome vers 71.
Selon la tradition vénitienne, deux marchands vénitiens, Buono da Malamocco et Rustico da Torcello volent les dépouilles de saint Marc à Alexandrie en 828 et les rapportent à Venise où le doge Giustiniano Parteciaco les accueille (lorsque le cercueil touche terre, une suave odeur de rose parfume la rive ...). Il les dépose non pas à Grado, alors centre religieux de l'État, mais à Rialto, dans le « castrum » qui deviendra le Palais des Doges : Giustiniano avait déjà en tête l'idée de la future Venise indépendante du Patriarche de Grado et souveraine par rapport aux deux empires. Le doge (et ses successeurs), ne se fiant pas au clergé, cache le corps du saint sous la protection de son seul gouvernement, et il ordonne la construction d'une « basilique du bienheureux Marc Évangéliste », achevée en 883. L'arrivée du corps de saint Marc, vrai ou faux, en 828, constitue une remarquable opération politique du doge : les évêques de Grado et d'Aquileia se disputaient alors le titre de « Patriarche » ; le pape et l'empereur carolingien avaient pris parti pour Grado qui relevait de leur juridiction : ils entendaient ainsi se soumettre le nouveau duché de Venise, risquant de créer un conflit avec Byzance. Le doge renversa alors les positions : au souvenir de saint Marc, lié à Aquileia, il opposait la présence physique de la relique elle-même. La ville nouvelle s'assurait ainsi un primat sur Aquileia comme sur Grado, en s'inventant une identité « sacrée ». Avant même d'être construite, Venise devenait une des plus importantes villes du Moyen Âge par la possession du corps d'un évangéliste.
Détruite par un incendie en 976 (un incendie « politique » où meurt le doge Pietro Candiano IV haï par les vénitiens parce que trop soumis à l'empire d'Occident et surtout soupçonné de tyrannie et pouvoir personnel), elle est restaurée par le doge Pietro Orseolo, qui appartenait à une faction adverse plus favorable à une alliance avec Byzance. En 1071, Marc est officiellement proclamé patron de Venise et on « retrouve » miraculeusement sa dépouille !. Une troisième église, celle d'aujourd'hui, est consacrée en 1094 par le doge Vitale Falier. La précédente église de saint Théodore est détruite à cette occasion : soldat martyr oriental, Théodore, dont les reliques avaient été transférées moitié à Venise moitié à Chartres, était le symbole de la dépendance vis-à-vis de Byzance. Marc apparaissait au contraire comme un personnage plus représentatif, oriental mais envoyé évangéliser l'occident, plus important aussi, presque à l'égal de Pierre, avec le privilège d'être un des quatre évangélistes : le choix de Marc mettait Venise sur un pied d'égalité avec la Rome de Pierre. Le lion est une des quatre figures du Tétramorphe qui apparaît à partir du IVème siècle, s'inspirant de la vision d'Ézéchiel et de celle de l'Apocalypse de Jean : quatre êtres vivants entourent au ciel le trône du Souverain universel, un lion, un taureau, un être ayant l'aspect d'un homme, un aigle. À l'origine, le Tétramorphe désigne les quatre points cardinaux, mais aussi l'action de salut du Christ sous quatre formes selon les quatre évangiles. Le Christ est homme quand il vit, taureau (du sacrifice) quand il meurt, lion quand il ressuscite, aigle quand il monte au ciel. Jean est l'aigle, Marc est le lion, Luc le taureau et Matthieu l'homme. Les Vénitiens avaient déjà revendiqué les dépouilles de saint Jean l'Évangéliste, l'aigle. En choisissant Marc, le lion, pour saint patron, à la place du plus modeste Théodore (bien que celui-ci eût la réputation d'être le continuateur d'Hercule et de Thésée et de tuer les dragons... comme plus tard saint Georges), ils se donnaient pour symbole une représentation du Christ ressuscité, ils étaient la force et l'énergie cosmique en même temps que l'envol spirituel, au-dessus même de Pierre qui n'était au fond que le successeur humain du Christ. Le lion (sans ailes) n'était-il pas déjà le symbole de Rome au XIIIème siècle ? Roi des oiseaux, l'aigle n'était-il pas symbole royal et impérial ? Sur le double plan religieux et politique, le choix de Marc et d'un lion ailé représentaient donc bien la conscience qu'eut très tôt Venise de sa situation unique et de son rôle exceptionnel parmi les nations chrétiennes.




Quant au lion ailé de la colonne sur la Piazzetta, son origine reste un mystère. On sait que le 14 mai 1293, le Grand Conseil décide de le restaurer. Depuis quand était-il sur la colonne ? Les deux colonnes sont élevées par Niccolò Barattieri en 1172 ; la statue de saint Théodore est posée sur l'une en 1329, le lion, on ne sait pas ; les chapiteaux ayant été installés à la fin du XIIe siècle, on peut penser que le lion y a été disposé aussitôt. Les chroniques n'indiquent pas que les Vénitiens l'auraient rapporté de Constantinople avec les chevaux de la basilique en 1204. Par contre il a pu être rapporté de la 1ère croisade (1095) à laquelle participe la flotte vénitienne, qui conquiert plusieurs villes côtières d'Anatolie et de Syrie (par exemple Tyr, où les Vénitiens font construire en 1164 une église dédiée à saint Marc dont ils rapatrient les richesses à Venise en 1249 après avoir dû céder l'église aux Français), et qui en ramène un riche butin. En 1797, les Français détruisent systématiquement les lions de saint Marc, symboles de la puissance vénitienne, et emportent à Paris celui de la colonne avec les quatre chevaux. Il fait retour le 11 décembre 1815, cassé en 14 morceaux, il est restauré et remis sur la colonne. Il a été sauvé !
Mais d'où vient-il ? Le lion-griffon remonte à la nuit des temps au Moyen-Orient, où on en trouve des traces jusqu'au IVème millénaire av. J.C., être hybride unissant la force du lion à la rapidité de l'aigle. L'origine orientale est donc la plus probable, mais d'où et de quand ? L'hypothèse la plus récente est celle de Ward Perkins qui analyse le lion en 1945, lors de son exposition au public, et conclut prudemment que c'est sans doute une sculpture des VIIe-VIe siècle av. J.C., produite à la lisière du monde grec dans les régions de l'Anatolie orientale ou de la Syrie septentrionale, où la métallurgie était florissante.
4. Vers le grand empire vénitien
Les grandes lignes de l'histoire de Venise après le XIIe siècle sont tracées dans tous les Guides ou dans le Que sais-je ? auxquels nous renvoyons. Rappelons seulement quelques points principaux.
a) Venise et Byzance
Venise arrache peu à peu à Byzance sa totale autonomie. Elle en obtient d'abord des avantages commerciaux en Méditerranée et en Orient (elle dispose d'un quartier à Constantinople et dans de nombreuses villes), en échange d'une aide militaire et financière apportée à l'empire : lutte contre les Sarrasins qui menacent les possessions byzantines en Italie du Sud ; lutte contre les Slaves à qui elle arrache la maîtrise de l'Adriatique et donc la route de l'Orient ; conquête de la côte Est de l'Adriatique (Dalmatie) qui donne à Venise la maîtrise de la mer, d'où s'affirme la tradition des épousailles de la mer (« Desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique dominii »). Dernier péril : les Normands installés en Sicile et à Naples qui menacent les possessions byzantines en Grèce ; Venise les affronte de 1082 à 1085 et remporte finalement la victoire. Cela lui vaut de nouveaux titres honorifiques de la part de Byzance, et de plus grandes facilités commerciales. Venise devient le partenaire privilégié en Orient. En 1084, Byzance lui accorde son indépendance juridique.
Jusqu'à la IVème croisade, Venise regarde vers Byzance, à qui elle emprunte non seulement ses formes picturales et architecturales, mais ses artisans, mosaïstes en particulier. Le décret de 1268 décidant de former des mosaïstes sur place est une des marques concrètes de l'indépendance artistique de Venise, de même que la création en 1308 d'ateliers de verrerie bientôt transférés à Murano pour des raisons de sécurité et qui fournissent les cubes de verre des mosaïques. L'apparition du style gothique dans la reconstruction du Palais Ducal en 1340, puis dans la façade de Saint-Marc en 1365 marque le début d'une influence européenne dont la synthèse avec l'art byzantin fera l'originalité de l'architecture et de la peinture vénitiennes.
Il faut souligner combien ce développement artistique de la ville a aussi un sens politique : toute la construction, toute la décoration des monuments vénitiens se font sous un strict contrôle de l'État, d'un pouvoir civil prédominant qui gouverne sans confusion avec le pouvoir religieux, à la différence de Byzance où le pouvoir politique est sacralisé.
b) En Europe
Venise sait rester à l'écart des grands conflits entre l'empereur d'Allemagne et les Communes italiennes alliées au pape, ce qui lui vaut d'être choisie comme médiatrice du conflit : en 1177 est signée la Trêve de Venise qui jette les bases d'une réconciliation entre le pape, l'empereur et les Communes et marque la fin de la querelle des Investitures. Le doge Sebastiano Ziani accueille à Saint-Marc le pape Alexandre III et l'empereur Frédéric Barberousse, épisode rappelé dans les fresques de la salle du Grand Conseil comme signe de reconnaissance de la puissance politique et commerciale de la République déjà capable d'intervenir sur un plan d'égalité avec les plus grandes puissances du temps. De plus Venise a obtenu de Frédéric Barberousse qu'il impose aux sujets de l'empire germanique d'utiliser le port de Venise pour leurs trafics.

Byzance.
Rappelons qu’en 324, l’empereur romain Constantin (272-337) décida, pour des raisons diverses, stratégiques, économiques et politiques, de transférer la capitale de l’Empire de Rome à Constantinople. Il avait auparavant éliminé Licinius, son co-empereur, en 324 et il s’était converti au christianisme, que l’empereur Galère avait toléré en 310, et que l’empereur Licinius avait semblé adopter en confirmant dans « l’édit de Milan » de 313, sa tolérance pour tous les cultes et en ordonnant la restitution des biens confisqués aux Chrétiens. Constantin se fit baptiser à la veille de sa mort.
Constantinople,
l’ancienne colonie mégarienne de Byzance, à la pointe de la presqu’île triangulaire qui avance entre la mer de Marmara et le port naturel de la Corne d’Or, avait une situation stratégique exceptionnelle sur la route des Détroits, au point de rencontre de l’Europe et de l’Asie. Constantin en quintupla les dimensions et en fit une grande ville, inaugurée le 11 mai 330, où il résida. Rome était abandonnée.
Par la suite, Byzance conserva la domination d’une partie de l’Italie du Nord, où elle était représentée par l’exarque de Ravenne, dont Venise dépendit longtemps.
Il y eut bientôt deux empires, d’Orient et d’Occident, grec et latin ; le christianisme devient religion d’État en Orient, à partir de Théodose, tandis qu’en Occident Ambroise, évêque de Milan, proclame l’indépendance du spirituel par rapport au temporel.
Byzance développa une grande civilisation, et ne tomba aux mains des Turcs de Mahomet II que le 29 mai 1453. Elle avait auparavant été ruinée par les croisades chrétiennes, de la première en 1095 à la quatrième détournée contre Constantinople au profit de Venise.
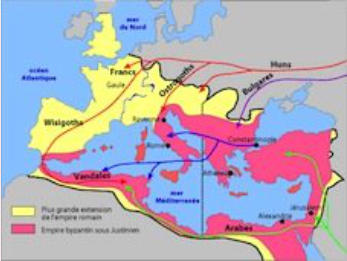
Empire byzantin sous Justinien vers 560
c) Les croisades
Mais c'est la 4ème croisade qui consacre en 1204 la puissance maritime de Venise. Le doge Enrico Dandolo conduit les opérations de façon que les croisés mènent une attaque décisive contre Byzance (Cf. ci-contre, Palma il Giovane, Conquête de Constantinople, Palais Ducal) ; la ville est prise et saccagée, les croisés fondent l'empire latin d'Orient ; c'est seulement en 1261 que l'empereur grec reviendra à Constantinople avec Michel Paléologue VIII, qui favorise Gênes pour affaiblir la puissance vénitienne. Après une longue lutte entre les deux villes, Gênes capitule en 1381 (Paix de Turin). Venise, bien qu'affaiblie par un siècle de guerre, prend un nouveau point de départ pour la domination des mers ; c'est au contraire la décadence de Gênes qui se donne au roi de France en 1396.
Les chantiers vénitiens avaient préparé des navires spéciaux équipés pour l'embarquement et le débarquement des chevaux, et avec des plateformes de combat placées très haut sur la proue. Venise a conquis non seulement son indépendance définitive, mais aussi un véritable empire colonial maritime, de Constantinople à la Crète et Corfou, relié à Venise par des escadres de bateaux de guerre et de navires marchands parmi les plus puissants de l'époque.
Venise ne cesse d'accroître son commerce avec l'Orient, y compris avec l'Égypte, centre de l'Islam, et ce malgré les croisades et les interdictions papales (colonies vénitiennes du Caire et d'Alexandrie ; elle cherche même à s'ouvrir l'accès des grands marchés de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient, bouleversé par l'invasion mongole (voyage de Marco Polo -1254 -1324 - de 1271 à 1295 ; des ambassades vénitiennes concluent des traités de commerce en Perse au XIVe siècle). Parallèlement au commerce, l'activité bancaire et le change rapportent à Venise des sommes fabuleuses. Au début du XVe siècle, Venise compte 190 000 habitants, elle a 3000 navires de commerce et 300 navires de guerre. L'Arsenal devient, avec Saint-Marc et le Palais ducal, un des trois lieux stratégiques de la ville.

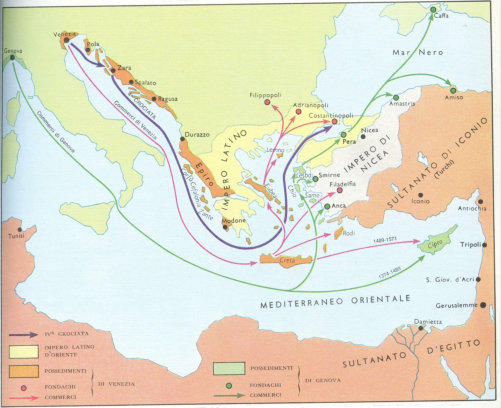

d) Le développement urbain
La place Saint-Marc : Si Venise est choisie en 1177 pour signer la trêve entre la papauté et l'empire, c'est aussi parce que la ville disposait déjà de l'espace nécessaire : vers 1160, la République enrichie par son commerce pouvait investir des sommes énormes dans les travaux publics ; elle décide donc de couvrir pour la première fois un canal (le Rio Batario) qui limitait la place devant la basilique pour réaliser un espace d'une exceptionnelle grandeur pour l'époque.
La « forma urbis » : au début du XIIIème siècle, Venise est un organisme urbain de structure semblable à la forme de poisson actuelle, coupée par la double anse du Grand Canal et parcourue par le réseau de « rii » qui délimitent les îlots urbains. Depuis 1169, la ville est divisée en six « sestieri », Cannaregio, San Marco, Castello sur la rive gauche du Grand Canal, Santa Croce, San Polo, Dorsoduro sur la rive droite, division peut-être motivée par des raisons politiques (mettre une limite aux pouvoirs du doge) mais qui permet d'imaginer une ville déjà bien structurée, avec ses divers types de maisons et de palais, ses édifices publics et religieux, ses rues (« calle ») très étroites et allongées, ses places (« campo ») de toutes formes avec leur margelle de puits (« vera da pozzo »), ses murs le long des jardins privés, ses passages sous les maisons (« sottoportego »), dans un enchaînement rare entre espace privé et espace public.
Évolution de la « forma urbis » de 1200 à 1961
Les églises : Dès le XIIème siècle, le réseau d'églises est pour l'essentiel constitué (cf plan ci-dessous). On peut y remarquer une spécificité vénitienne dans le choix des noms de saints, qui correspond à celui de la plus ancienne liturgie de la ville, selon le rite « marciano » dit « patriarchino » ou « marcolino » : le calendrier des saints célébrés au cours de l'année (« santorale ») comporte un nombre très élevé de noms dont on retrouvera la représentation dans les mosaïques des églises. Venise, ville commerçante, a toujours eu tendance à ramener dans la ville les cultes (et si possible les corps, à commencer par celui de saint Marc) rencontrés ailleurs, en Orient et dans les différentes régions visitées. Parmi ceux-ci, les saints de l'Ancien Testament (Moïse, Samuel, Jérémie ...), les premiers disciples des apôtres (Ermagoras et son successeur Siro, Martial ...), les évangélistes (Marc, Luc, Jean), les saints d'origine locale (Jérome né en Dalmatie près d'Aquileia), dont on reprend la légende, à moins qu'on ne l'invente en fonction des nécessités du temps et des exigences institutionnelles et politiques de la République. C'est une confirmation de l'autonomie séculaire de l'église ducale, renforcée par la liturgie des fêtes souvent conduite par le doge lui-même (lavement des pieds le jeudi saint, procession du samedi saint, célébration de saint Marc ...).




Devant chaque église, son "campo", la place, avec ses palais, ses maisons, ses boutiques, son puits, lieu de rassemblement communautaire pour les cérémonies, les marchés, les spectacles, les foires, les fêtes. Chaque place a sa forme, dans une étonnante diversité qui fait le charme d'une promenade dans Venise.
Le puits est construit selon une technique qui permet de recueillir l'eau de pluie et de la purifier (cf. plan ci-dessous : l'eau coule dans le puits A par les quatre caniveaux E, passe dans le sable C contenu dans la grande vasque étanche en argile D) :
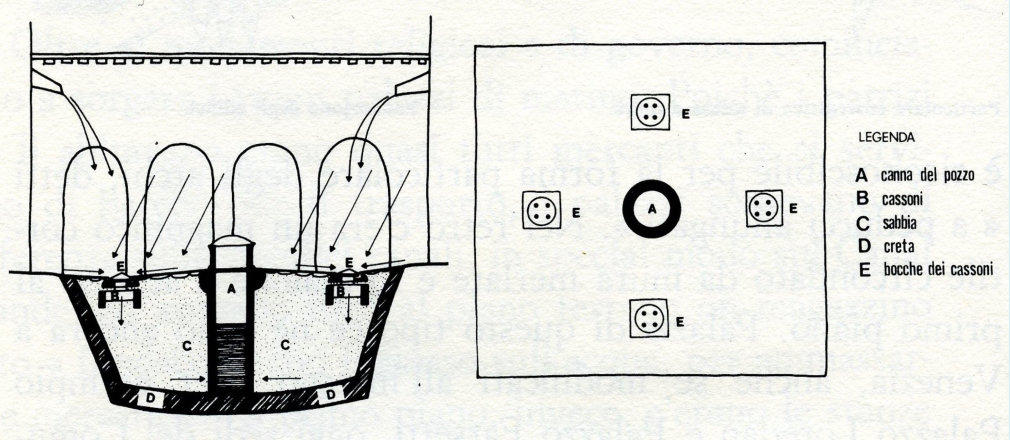
La maison : La maison vénitienne la plus ancienne a pour modèle la maison romaine, mais elle se développe ensuite de façon originale, commandée par l'eau : il faut charger et décharger les marchandises, d'où les porches au bord du canal ; les constructions serrées et assez hautes dans un espace limité imposent de larges fenêtres et des loggias aux étages qui répondent à une exigence d'esthétique et d'éclairage mais ont aussi l'avantage d'alléger les murs. L'histoire de Venise inspire aussi la diversité des constructions de style byzantin, roman, moresque, gothique, plus tard Renaissance et baroque, qui se mêlent dans une synthèse originale. Mais typique de Venise est la "casa-fontego", la maison-entrepôt, avec sa double fonction commerciale au rez-de-chaussée (un grand hall bordé d'entrepôts et de pièces de travail en mezzanine) et de réception et d'habitation aux étages (au premier, "piano nobile", salon de réception et espace d'exposition des produits précieux du marchand propriétaire, et sur les côtés pièces d'habitation ; au second pièces de service et d'habitation des domestiques).
Les techniques de construction n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui : transport des matériaux en bateau, travail manuel et artisanal ; absence de mécanisation, qui font à la fois le coût élevé de toute réparation et restauration, et le charme d'un produit artistique non standardisé par une production industrielle, unique en son genre et pourtant d'une exceptionnelle unité esthétique : afin de protéger le site, la République a toujours contrôlé strictement tout l'urbanisme, dans une programmation rare en Europe à cette époque.
Les phases de construction de Venise sont résumées dans les dessins ci-dessous réalisés par Giorgio Bellavitis (Autrement Venise, un voyage intime, op.cit., pp. 30-33) : On pense parfois que Venise est construite sur l’eau, comme une sorte d’île flottante sur une plateforme. Non ! Venise est bâtie sur un ensemble de petites îles entourées d’une eau en général très basse, dans une lagune.
Venise semble construite sur l’eau.


Les pieux de sapin, de chêne vert et de mélèze viennent des forêts de la terre ferme ; le sable vient du Brenta, le marbre rouge de Vérone, le marbre blanc d'Istrie, les pavés des rues des collines Euganéennes, les briques et les tuiles sont fournies par les carrières d'argile de la terre ferme, le fer vient de l’Agordino (Dolomites).
Les fondations de bois sont compactes et élastiques ; elles se minéralisent et deviennent encore plus résistantes, à condition de ne pas être en contact avec l'air. Les sols des étages sont faits de poutres équarries sur lesquelles on pose un plancher. Dans les palais, les poutres restent apparentes (plafond "alla Sansovino"). Sur les planches on construit un pavement "alla veneziana" constitué d'une poudre de briques et de chaux parsemée de poudre ou de petits morceaux de marbres multicolores : ainsi le sol est élastique, il "respire", s'adapte aux mouvements éventuels des fondations et sa légèreté est accentuée par les effets de couleur multicolores du marbre.
La maison est constituée de plusieurs niveaux différents, car elle a les deux fonctions de magasin commercial et de résidence du marchand : au rez-de-chaussée, un salon qui sert d’accès pour les marchandises et débouche sur l’eau par un portique (« portego ») et sur la rue par un portail ; de chaque côté de cette entrée se trouvent les magasins et dans la mezzanine (« mesà »), les pièces de bureau et de comptabilité. Au premier étage se trouvent les salons destinés aux réceptions et exposition de la marchandise précieuse (« piano nobile ») ; les pièces latérales servent à l’habitation de la famille. Le dernier étage est destiné aux serviteurs et aux employés qui sont partie intégrante de la maison qui constitue un système économique et social de caractère patriarcal. C’est la « casa-fontego », le « fontego (fondaco) » étant le comptoir, le siège de l’entreprise.
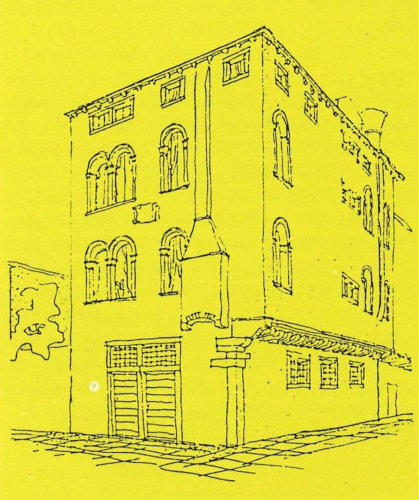
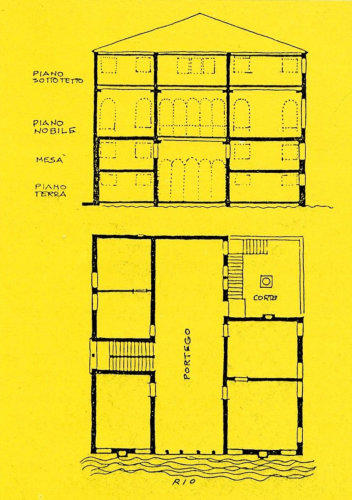

Lexique de la maison
- La casa = la ca' (Ca' d'oro, Ca' Rezzonico ...) = la maison
- La casa a schiera : "la maison en bande" = maisons mitoyennes alignées au bord d'un canal ou dans une rue.
- I barbacani : les consoles en bois qui soutiennent les étages supérieurs, agrandissant la surface des étages sans gêner le passage dans la rue.
- L'altana : Terrasse en bois sur les toits, lieu idéal pour prendre le frais, s'isoler de la rue, étendre le linge, dissimuler les amoureux ; autrefois, les vénitiennes s'y faisaient blondir les cheveux - la mode du Titien ... - sous un chapeau sans fond à larges bords pour garder la peau blanche.
- Il camino : la cheminée ("il n'y a pas autant de petits poissons dans l'Arno qu'il y a de tignasses et de cheminées à Venise" - né sono in Arno tanti pesciolini / quant'è in Vinegia zazzere e camini", Burchiello, 1400).
Les Vénitiens ont inventé toutes les formes possibles de cheminées ; amusez-vous à en faire collection photographique, ou allez les voir alignées à Corte Granda della Giudecca (Cf aussi les 13 cheminées de Corte dei Cordami à la Giudecca ou la Casa dei 7 camini de Fondamenta Tron, près de l'église S. Nicolò dei Mendicoli).
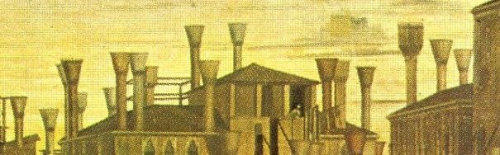

III) Comment Venise s’est enrichie, pourquoi elle s’est appauvrie
Hypothèse de travail : Venise a construit son économie, son urbanisme, son exceptionnelle richesse matérielle et culturelle sur la base d'un capitalisme marchand qui n'a pas évolué vers un capitalisme industriel ; son appauvrissement, sa "décadence", commence lorsque, après l'abandon dans lequel est laissée la ville au XIXe siècle, les Italiens et quelques Vénitiens bien intentionnés tentent d'en faire une ville industrielle en créant et en développant la zone industrielle de Marghera ; les problèmes d'aujourd'hui n'ont pas d'autre origine.
Une chanson de Francesco Guccini offre une belle image de cette réalité : il met en parallèle "Venise qui meurt dans la fumée - ou la colère - de Porto Marghera", avec Stefania, une jeune femme qui "meurt en couches en criant en sueur dans le lit d'un grand hôpital : Venise meurt d'avoir accouché de Marghera !".
1) Un capitalisme marchand
a) Commerce et manufacture
Lorsqu'elle arrive au sommet de sa puissance, entre XVe et XVIe siècles, Venise vit d'un commerce florissant, qui reste à la base de sa richesse, doublé d'une activité manufacturière intense (textiles à partir de la production de laine et de soie des possessions vénitiennes de terre ferme et productions précieuses) organisée et limitée par la réglementation des corporations (cf. plus loin, le "Scuole" et le "Arti") en fonction de la nécessité de fournir et d'alimenter une population croissante. La vocation commerçante de Venise est liée à sa nature même de petit État longtemps réduit à une île : elle produit pour consommer et commerce pour se procurer ce qu'elle ne produit pas. Cette accumulation mercantiliste repose sur le grand commerce international (comme en Hollande) ; l'instrument en est la flotte marchande et militaire ; un des trois lieux stratégiques de Venise est, avec Saint-Marc et le Rialto (voir les noms de rues et de quais autour du Rialto : Riva del vin, etc.), l'Arsenal (Cf. dessin ci-dessous de Gianmaria Maffioletti, XVIIIe s.). Aujourd'hui, le Musée de la Marine reste un témoignage de cette activité productive et marchande ; l'industrie vénitienne est subordonnée aux besoins du commerce.

b) Une classe politique figée gère un capitalisme d'État
Peu à peu les marchands riches abandonnent de plus en plus leur activité manufacturière et marchande directe pour se consacrer à l'activité politique et financière entièrement contrôlée par l'État vénitien. C'est l'État qui finance et organise les activités commerciales ; la classe politique des marchands assure la gestion de l'État, administration et banque, de la "Zecca" où l'on frappe la monnaie (le "zecchino", le sequin) au "banco-giro", la banque de virement créée en 1619 qui centralise tous les paiements et opérations de change. Cette immense accumulation d'argent permet de financer les dépenses publiques, parmi lesquelles celles qui sont consacrées à l'embellissement de la ville, architecture, peinture, sculpture, musique, fêtes... La place Saint-Marc est le lieu stratégique de ce pouvoir politique et financier, avalisé et consacré par le pouvoir religieux.
Le Palais ducal doit être vu comme ce centre unique, grand ensemble symbolique à la fois d'une organisation politique exceptionnelle (cf la répartition des salles du palais : Grand Conseil, Sénat, Petit Conseil, Sages, Inquisiteurs d'État, Collèges, Conseil des Dix...) et d'une vision du monde (voir le détail des chapiteaux extérieurs du rez-de-chaussée si bien décrits par Ruskin). Les plus grands peintres et architectes viendront orner l'ensemble tout entier consacré à la célébration de Venise et à sa mémoire (on entre par la Porte de la "Carta", des archives).


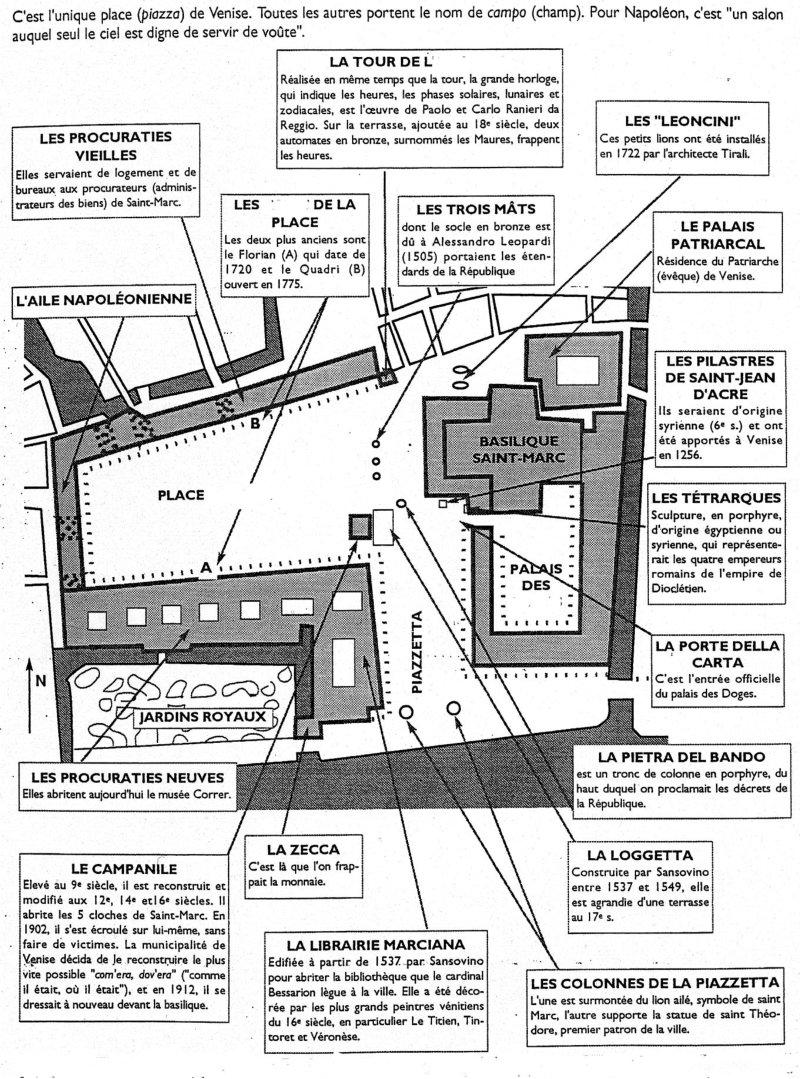

Auprès du pouvoir politique se trouvent le pouvoir religieux symbolisé par la basilique Saint-Marc, qui est à la fois la chapelle ducale privée et la chapelle du peuple, le pouvoir juridique représenté par les « Piombi », les prisons que l'on rejoint par le Pont des Soupirs, le pouvoir administratif dans les "Procuratie" autour de la place (les "Procurateurs" étaient les plus importants magistrats après le Doge), le pouvoir "idéologique", intellectuel (la Libreria Sansoviniana et la Bibliothèque "marciana") et le pouvoir financier : la "Zecca" qui, au XVe siècle, frappe par an un million de ducats d'or (le "zecchino", monnaie de Venise depuis 855), 200 000 monnaies d'argent et 800 000 sous d'argent, faisant de Venise la « maîtresse de l'or de la chrétienté » en parallèle avec Florence et son « fiorino ». Le sequin est la monnaie internationale de l'Europe en particulier au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.
L'ensemble est complété par le clocher construit entre le XIIe et le XIVe siècle (98,60 m., un des plus hauts d'Italie, reconstruit à l'identique après l'écroulement de 1902) avec sa « Loggetta » du XIIIe siècle, « ridotto », lieu de rendez-vous des nobles, reconstruite par Jacopo Sansovino de 1537 à 1549 ; la Tour de l'Horloge de Mauro Codussi (1496-99) et la patine sombre du bronze de ses « Mori »; les trois « Pili » de bronze sur lesquels sont dressées les bannières de Saint-Marc et dont la décoration (le Lion, la Justice, Neptune) est encore un symbole de Venise ; les deux piliers de la Piazzetta portant l'ancien et le nouveau patron de Venise, Saint Théodore (San Todaro) et Saint Marc (à la base des colonnes, représentation des métiers) ; enfin, dans un angle, les « Quattro Mori », Tétrarques impériaux (statues syriaques du IVe siècle), pétrifiés pour avoir voulu, selon la légende, reprendre les dépouilles de Saint Marc : on ne touche pas impunément au symbole de Venise. Ajoutons, pour compléter, le tronc de colonne de porphyre à l'angle de la basilique, d'où le « Commandador » proclamait les lois, et on a le plus bel ensemble architectural qui soit, d'une parfaite cohérence à l'image du pouvoir vénitien.
c) Structure de la population vénitienne
La classe dirigeante vénitienne, celle des patriciens, est unique dans son genre et donne naissance à ce que Philippe de Commynes appelait « le plus sage gouvernement du monde » : une classe dominante identique à elle-même pendant près de dix siècles, mais cependant assez abondante pour se renouveler, mélange de marchands et de politiciens interchangeables dans l'un ou l'autre rôle, avec une alternance régulière du chef, le "dux", un peu à la manière du régime consulaire romain, mais avec un seul consul au lieu de deux. Elle est unique aussi parce que auto-engendrée, nommée ni par le pape ni par l'empereur, elle s'est faite elle-même, à partir de ces populations de terre ferme émigrées dans la lagune. Elle élabore son propre style de maison, qu'elle prend le plus grand soin de développer et d'embellir ainsi que ses églises. Elle partage avec toutes les autres classes sociales la même langue de leurs pères, évitant la séparation radicale entre les lettrés qui parlent latin et le peuple qui parle la langue « vulgaire ». De même qu'elle partage ses cultes avec tout le peuple, du culte du doge à ceux des corporations ou aux fêtes prévues par le calendrier ou inventées au hasard de l'histoire. Il y avait aussi des patriciens pauvres, qui habitaient dans le quartier de San Barnaba, où les maisons étaient moins chères, d'où leur nom de "barnabotti". Participant de droit au grand Conseil, ils étaient un problème pour la République : ils étaient tentés de vendre leur voix, lors de l'élection du doge ! Mais l'État leur assurait des fonctions dans la magistrature mineures ou dans l'armée, à partir desquelles ils pouvaient obtenir des postes plus importants, étant donné les changements permanents de responsables dans chaque fonction.
Cette aristocratie s'est maintenue pendant toute l'histoire de la République. Limitée en nombre (environ 5 % de la population de la ville, soit 7000 personnes sur 140 000 habitants), elle monopolise tout le pouvoir d'État jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Sur ces 7000 personnes, 1500 ont, depuis la « clôture » du grand Conseil, l'exclusivité absolue d'accès aux charges politiques et administratives ; cela assure d'une part le secret total des décisions qui ne sont discutées que dans le cadre des institutions d'État, et d'autre part la rotation permanente des charges publiques pour maintenir un pouvoir collégial et empêcher toute forme de pouvoir personnel du Doge. Si l'on tient compte aussi de la richesse extraordinaire qui afflue dans la ville, ce système explique que la République n'ait connu aucune crise politique grave au long de son histoire : la stabilité des institutions fait que les courants réformistes peuvent se manifester mais jamais s'imposer.


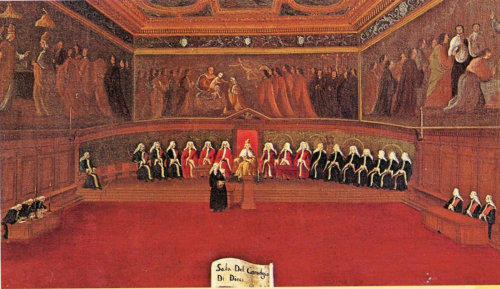
À la base du pouvoir politique, il y eut à l'origine le CONCIO, assemblée populaire qui élisait le doge. Le concio nommait trois électeurs qui nommaient les 35 puis 100 conseillers du Consilium Sapientes qui élisait le doge. Le Concio fut supprimé en 1172 (officiellement en 1423) et remplacé par le MAGGIOR CONSIGLIO, qui assura le monopole du pouvoir à l'aristocratie à partir du 28 février 1297, à la « Serrata del Maggior Consiglio » (la « clôture »), en décidant que ne feraient partie du Conseil que ceux qui y avaient participé dans les 4 années précédentes et, chaque année, 40 de leurs descendants par tirage au sort. Or c'est le Grand Conseil qui élit et nomme la totalité des fonctionnaires et organes de pouvoir de Venise.
Les « patriciens » vénitiens étaient dès l'origine les familles anciennes les plus éminentes qui prétendaient descendre des nobles romains qui s'étaient réfugiés dans les îles lors de l'invasion des Barbares ; elles étaient au nombre de 24. Puis on ajouta celles qui faisaient partie du Conseil lors de la « Serrata » de 1297. Un troisième groupe fut constitué de ceux qui étaient intégrés au Conseil lors de guerres coûteuses qu'ils avaient contribué à financer. En 1797, le Livre d'or comprenait 1030 noms (3,2% de la population, répartis en 111 familles).
Le Grand Conseil élit donc le DOGE, par l'intermédiaire du CONSIGLIO DEI QUARANTA (ils étaient en fait 41 pour éviter un partage égal des voix). Il était très encadré et surveillé, par 6 CONSIGLIERI, nommés par le Grand Conseil, un par quartier de Venise et par les 3 chefs des Quaranta, avec lesquels il formait la SERENISSIMA SIGNORIA, et auxquels on ajouta plus tard 16 SAGES chargés de contrôler les divers services et administrations, l'ensemble formant le COLLEGIO.
Le Grand Conseil nommait aussi le SENATO, organe législatif et exécutif de l'État, formé à l'origine des 60 « pregadi » (« priés » par le doge de se réunir) dont le nombre fut porté à 120 en 1450 et auxquels s'ajoutaient les Quarton et la Signoria.
Enfin, le Grand conseil élisait le plus important des Conseils, le CONSIGLIO DEI DIECI, qui veillait à la sécurité de l'État. Il s'adjoignait parfois une commission de 20 membres, la ZONTA. Le Conseil des 10 était un organe de haute police qui contrôlait la totalité des activités vénitiennes, et dont le pouvoir se renforça lorsqu'on créa en 1539 les INQUISITORI DI STATO (Venise interdisait l'existence de l'Inquisition ecclésiastique).
Le Grand Conseil élisait aussi toutes les magistratures, majeures (les 9 Procurateurs de S. Marc, les Avocats de la Commune, le Grand Chancelier), mineures (Terre ferme, Dalmatie, judiciaires, financières, caissiers de la Commune, etc.).
Autrement dit, toute l'activité vénitienne est contrôlée par l'État, par le Grand Conseil, qui était aux mains de la seule aristocratie, mais qui assurait aussi la protection des citoyens, car il n'était ni clérical ni tyrannique.
Cette structure politique figée et profondément inégalitaire trouve sa compensation dans le port du masque et la liberté qu'il donne : « Le masque devient une compensation nécessaire à l'inégalité trop sensible qui existe entre les diverses classes de la population, et une façon artificielle et irrationnelle de les dépasser. En public, dans les lieux de rendez-vous, les fêtes, les théâtres, la condition sociale empêcherait une fréquentation commune, comme l'établissent quelques lois, tandis qu'au contraire la ville a inauguré des divertissements basés sur le profit et qui exigent donc une fréquentation généralisée du public : théâtres, fêtes données dans les palais, maisons de jeu, cafés » (Lucio Balestrieri, Venezia, presente e passato. Per una interpretazione ideologica della storia, Universitaria Venezia, 1978, p. 112.) : le masque donne à chacun, - en particulier aux femmes -, la possibilité d'entrer librement là où la loi leur aurait interdit de pénétrer. Les forces exclues de toute jouissance de droits politiques mais actives dans la vie économique retrouvent par le masque une forme d'égalité qui fait un peu oublier les inégalités réelles ; le théâtre et la fête font ainsi partie de la pratique sociale quotidienne de toutes les classes de la population, surtout à partir du XVIIe siècle.
Autour des patriciens gravite une classe de marchands et d'entrepreneurs, souvent étrangers, qui ne participent pas au pouvoir politique mais qui constituent une importante « bureaucratie » issue de ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes, qui gèrent les diverses administrations de la République, les offices politiques, les banques, les entrepôts de marchandises, le commerce, ou qui exercent des professions libérales, médecins, avocats, ou qui sont simplement possédants, propriétaires fonciers. C'étaient les citoyens de jure, de droit, nés de père et de mère vénitiens et n'ayant jamais exercé d'« art mécanique ». On était citoyen de gratia, après approbation du Grand Conseil, si on avait résidé vingt-cinq ans sans interruption à Venise sans exercer d'art mécanique. Après dix ans de résidence, on obtenait la citoyenneté de intus (intérieure) qui donnait le droit d'exercer un métier à Venise (les émigrés de Lucques, artisans de la soie, au XIVe siècle ; un fripier de Crémone, un fourreur d'Istrie, un tailleur de Vérone, un charcutier de Feltre ...) ; après encore six ans, on devenait citoyen de extra (extérieur), autorisé à naviguer sous protection du pavillon vénitien, et donc d'être marchand et armateur. À ces natifs de Venise vient s'ajouter une quantité impressionnante d'« étrangers résidents », italiens de diverses régions, natifs du bassin méditerranéen, turcs, dalmates, grecs, juifs en très grand nombre, mais aussi allemands qui importent très tôt à Venise l'art de l'imprimerie, développent celui de la banque, à la manière des Fuger. Il y a encore un « fondaco », un entrepôt « degli Arabi », un « dei Tedeschi », un « dei Turchi ».


Le reste du peuple est pauvre, ouvriers, porteurs (les « facchini », - d'où le français « faquin » -, venus de la « province », Bergame, etc...), domestiques, mendiants, ... ; mais c'est une pauvreté « contrôlée » par la République, comme tout le reste. On en a pour preuve la quantité d'instituts de charité, d'hospices qui accueillent les incurables et les mendiants (cf l'église de « San Lazzaro dei mendicanti », au bord du « Rio dei mendicanti », le canal des mendiants) ; le nombre de ces institutions est parfois de quatre fois supérieur à ceux des autres villes italiennes. Un autre instrument de contrôle de la pauvreté, ce sont les 190 boutiques, tenues par des « étrangers » de la Valtellina (des « forestieri », les italiens qui ne sont pas de Venise, à ne pas confondre avec les « stranieri », ceux qui appartiennent à d'autres nations) et protégées par l'État, qui vendent des « luganeghe », c'est-à-dire des viandes bon marché, sous forme de saucisses, de tripes et autres viscères comestibles, ce qui permet d'assurer à la population une alimentation carnée suffisamment riche en protéines et en lipides. 190 boutiques : autant que de paroisses, une par paroisse, mise à la disposition de tous, à proximité de tous, même les vieillards et les impotents, « à portée de pied » ! L'État maintenait ainsi un équilibre de l'alimentation du corps comme de l'âme pour le petit peuple vénitien, assurant un ordre « harmonieux » entre les classes sociales, ce qui explique que la République n'a pas connu de luttes de classes analogues à celles de Florence ou de Naples.
Un autre élément d'intégration sociale est la corporation de petites entreprises, de métiers, d'« arte », dont le modèle sont les « Scuole », ou « Fraglie » : ce sont des corporations à fond religieux, contrôlées par l'État, à but caritatif, pour soulager les misères des populations en cas de crise (épidémies, guerres, famines), ou à but professionnel et mutualiste, pour défendre les intérêts des diverses professions, former les apprentis, régler les horaires de travail et le prix des marchandises et assurer le progrès technique. Même les « stranieri » présents à Venise pour leur travail pouvaient s'organiser en « Scuola » pour défendre leurs intérêts : Scuola dei Fiorentini, dei Milanesi, degli Albanesi, degli Schiavoni, Scuola Greca, à côté de celle des « Barbieri », « Barcaroli », « Bombardieri », « Fruttaroli », « Laneri », « Linaroli », « Luganegheri », « Mureri », « Orefici », « Pittori », « Pollaiuoli », « Sartori », « Setaioli », « Tajapiera », « Varotari » (tanneurs), etc. Il y avait même une « Scuola dei Picai » (degli impiccati = des pendus) dont les membres accompagnaient le supplice des condamnés à mort (San Fantin), une « Scuola dei Battuti » (des flagellants qui se battaient jusqu'au sang avec des verges dans les processions publiques), une Scuola degli Zoppi (des boiteux, mutilés de guerre) et une « Scuola dei morti » ! À partir de 1539, l'adhésion à une corporation devint obligatoire. On les appelait ainsi « écoles » parce qu'on y enseignait les préceptes de la foi chrétienne. Chacune avait son église, où on honorait le saint protecteur de son activité, et son local de réunion avec chapelle, salle capitulaire, « albergo », archives, trésor, que l'on faisait construire par les plus grands architectes et décorer par les plus grands peintres. Chacune était dirigée par les bourgeois les plus riches (seuls votaient les maîtres, - les ouvriers et apprentis étant exclus du vote, mais pouvant devenir maîtres à leur tour) qui y accumulaient un patrimoine artistique immense ; il n'en reste guère que celle de San Rocco (les fresques du Tintoret), de San Giorgio degli Schiavoni - à droite - (fresques de Carpaccio), celles de San Marco, della Carità, della Misericordia (transformées en édifices d'utilité publique), celle de San Giovanni Evangelista (siège de la Società di Arti edificatorie), et celle de San Teodoro (cinéma).
À côté des « Scuole », il y avait les « Arti » (corporations de métiers), chacune ayant aussi son lieu de culte et son saint protecteur : Arte dei Barileri (à San Silvestro ; San Tommaso di Canterbury), dei Boteri (fabricants de tonneaux ; à Santa Maria Assunta ; Maria Vergine della Purificazione), dei Conciacurame (tanneurs de cuir ; Beata Giuliana di Collalto), dei Carboneri (à San Salvador ; San Lorenzo), dei Caldereri (chaudronniers ; à San Luca ; San Giovanni Decollato), dei Libreri (aux Santi Giovanni e Paolo ; San Tommaso d'Aquino), dei Capoteri (tailleurs de vêtements de marins ; à San Nicolò da Tolentino ; San Nicolò), dei Remeri (rameurs ; à San Bartolomeo), dei Farmacisti (à Santo Stefano ; San Salvatore), etc...
Bien d'autres lieux et d'autres moments assuraient la stabilité vénitienne, la cohésion de la cité, sa continuité même dans les changements (« semper idem » est une des devises de Venise, inscrite sur les billets du théâtre San Giovanni Crisostomo où les spectacles se renouvelaient constamment ...) : les grandes églises où on célébrait les fêtes publiques (La Salute ...), le port du masque dans un Carnaval qui durait presque six mois de l'année, etc. Et cet extraordinaire théâtre qu'est la ville elle-même, lieu de célébration de sa propre gloire, de ses victoires, de sa richesse, de son importance internationale, dans un ensemble unique et inimitable, presque utopique. Tout cela sous le contrôle bienveillant ou répressif (l'appareil policier et d'espionnage le plus perfectionné d'Europe) de l'État qui assure la permanence et le développement de son propre mythe, entretenu et répandu ensuite dans toute l'Europe par les « touristes », ambassadeurs, lettrés, souverains, artistes. Et les Vénitiens avaient conscience de cette unicité, de cette supériorité : « Moi, je suis le grand lion, je m'appelle Marc. Quiconque s'opposera à moi sera anéanti » (« Io sono el gran leon, Marco m'appello - disperso andrà chi me sarà rubello »). Ils étaient « d'abord vénitiens, ensuite chrétiens », rivaux de Rome, systématiquement indépendants de Rome, quasiment hérétiques, refusant l'inquisition d'Église au profit d'une inquisition d'État, hostiles aux papistes (« Les Vénitiens croient beaucoup en saint Marc, assez en Dieu, peu ou point au pape »), ce qui valut à Venise son prestige politique international mais aussi l'hostilité de Rome et des grandes puissances, constituées à plusieurs reprises en ligues qui jamais ne réussirent à abattre la « Sérénissime ». Venise fut dans l'Europe chrétienne la seule puissance laïque, qui pratiqua la séparation de l'Église et de l'État, refusant par exemple l'existence de tribunaux ecclésiastiques pour juger les prêtres qui sont soumis aux tribunaux civils, ou bien expulsant du Grand Collège et du Sénat ceux qui avaient des parents cardinaux chaque fois que l'on y discutait de politique ecclésiastique et des rapports avec Rome ; le procès-verbal indiquait alors : « cazzadi Papalisti » (Les Papistes ayant été chassés ...). Le frère Paolo Sarpi (1552-1623), de l'ordre des Servites, fut le théoricien et l'avocat de ce principe de séparation ; il mérite sa statue sur le Campo Santa Fosca. Mais, malgré les tentatives de quelques ambassadeurs anglais, les Vénitiens refusèrent toujours d'adhérer à la Réforme, pratiquèrent toujours un catholicisme orthodoxe et s'efforcèrent de rester en bons termes avec Rome, sauf quand l'indépendance de la patrie était en jeu : politique oblige !
La date de naissance officielle de Venise est selon les anciennes chroniques le 25 mars 421. La légende est significative : le 25 mars était à la fois la date de la création du monde selon les Grecs anciens, celle du début du printemps selon les Romains et celle de l'annonce faite par l'Ange à Marie, donc de la conception de Jésus. La naissance de Venise a donc quelque rapport avec celle de Jésus, du monde et du printemps... La légende ne dit-elle pas aussi que c'est la Vierge Marie qui indiqua la voie à suivre à ceux qui voulaient fuir les barbares, en leur montrant réfléchie dans le ciel la vision des îles au milieu d'une lagune peuplée de barques ? Quant à l'année elle coïnciderait avec l'érection de la première église de Venise, San Giacomo in Rialto (construite en réalité au XIème siècle pour les marchands du Rialto, mais toujours objet d'une visite du doge le Jeudi Saint en souvenir des indulgences accordées par le pape Alexandre III en 1177). Toujours est-il que la date légendaire continua jusqu'en 1797 à être utilisée dans l'établissement du calendrier vénitien, avec l'indication M.V., More Veneto, « selon l'usage de Venise » comme les Romains dataient leur calendrier Ab Urbe Condita, « à partir de la fondation de la ville ». La création de Venise est une sorte de commencement absolu, l'apparition de quelque chose de radicalement nouveau dans la conscience des Vénitiens. La légende dit d'ailleurs aussi qu'ayant créé le monde, Dieu se reposa le septième jour, et laissa les Vénitiens « inventer » Venise : « Nous verrons bien - dit-il - ce qu'ils sauront faire »... Et ils inventèrent Venise !




De gauche à droite : Tailleur ducal, Raffineurs de cire, Pompiers, Fabriquant de futaine





CHRONOLOGIE SOMMAIRE (SUITE)

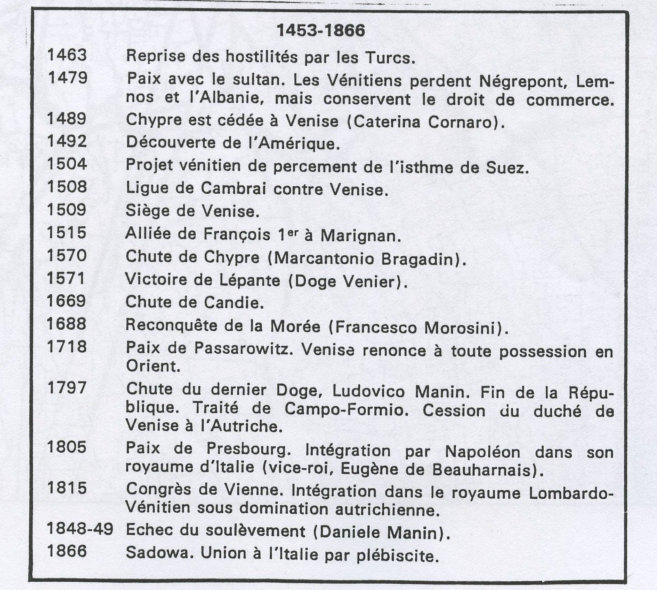





3. La situation actuelle de Venise
a) Le problème
Venise « s'enfonce »-t-elle ? La ville a toujours été soumise à des phénomènes naturels de bradysisme. Pendant toute son histoire, le sol s'est probablement abaissé d'un maximum de 2 à 4 cm par siècle. La République contrôlait très attentivement l'équilibre de la lagune livré aux soins d'un « Magistrato delle acque », et « l'aqua alta » envahissait rarement la ville et de façon peu grave, même récemment : entre 1867 et 1947, il n'y eut sur presque un siècle que 20 inondations peu importantes. Les géologues sont partagés, mais beaucoup estiment que le niveau altimétrique de Venise n'a guère changé depuis 2000 ans (Cf. la fiche de synthèse de GEO).
Depuis quelques années la situation se modifie :
- Le niveau de Venise s'est abaissé par rapport à celui de l'eau : à Saint-Marc, niveau le plus bas de la ville, sous la Tour de l'Horloge, le niveau s'est abaissé de 13 cm, et le campanile de 18 cm, entre 1908 et 1961, le Palais Ducal de 11 cm entre 1960 et 1980. Sur la terre ferme, à Mestre, on constate un « abaissement » de 8 cm de 1925 à 1968 ; à Marghera, les écoles s'abaissent de 9 cm de 1952 à 1968.
- L'« acqua alta » est plus fréquente : 20 inondations en 80 ans de 1867 à 1947, 25 en 7 ans de 1958 à 1967. De 1988 à 1997, il y a eu 137 marées de plus de 1 m d'amplitude. L'amplitude des eaux augmente : en 1951, 1,50 m au-dessus de la mer ; en 1966, 1,94 m (et de 3 à 5 m sur la place Saint-Marc), en 1979, 1,66 m ; en 1996, 1,34 m ; en 1997, 1,26 m ; en 1998, 1,23 m. À ce rythme, on prévoyait en 2040 environ 460 inondations par an !
- Les conséquences sont catastrophiques : dégâts causés aux édifices et œuvres d'art : après la grande inondation de 1966, on estimait que la moitié des maisons et palais étaient à restaurer ou à démolir, les clochers tombent (celui de San Giorgio deux fois), les marbres des façades s'écroulent, le salpêtre ronge les murs. Cela contribue à la fuite des habitants : de 1951 à 1966, 50 000 habitants sont partis sur la terre ferme. Pour ceux qui restent la vie est très difficile ; guère plus de 300 familles continuent à habiter des rez-de-chaussée. De 1976 à 1994, les magasins d'alimentation passent de 400 à 170, les boulangers de 110 à 74 ; de 1987 à 1992, 28 sièges de banques et d'assurances ont disparu.
- Le résultat est que Venise tend à la « monoculture » touristique : 8 268 000 touristes en 1992, près de 12 millions en 2000, dont le séjour moyen n'excède pas une journée... Venise tend à devenir une « coquille vide » ou un musée, dont le coût d'entretien est d'autant plus grand que la ville est moins habitée : 4 milliards de lires par an pour le seul entretien des toits de l'Arsenal, par ailleurs fermé au public...
b) Les causes
A) Les causes naturelles :
- Venise est construite sur une forêt de pieux (« pali », « palafitte ») plantés sur une base de limon sableux, d'argiles, de tourbes. Le terrain a donc une certaine mobilité ; les pieux résistent tant qu'ils sont dans l'eau mais se dégradent au contact de l'air (quand on vide un canal pour le nettoyer ou du fait d'un mouvement trop fort des vagues). De plus, phénomène de « subsidence » : affaissement de l'écorce terrestre sous le poids des sédiments (15 cm en moyenne au XXe siècle).
- Le niveau des mers s'élève progressivement (l'« eustatisme ») (du fait de la fonte des glaciers polaires) ; les marées augmentent à cause d'un sirocco plus fort (le 4 novembre 1966, le vent soufflait à 100 km à l'heure, poussant l'eau à l'intérieur de la lagune). Le niveau moyen augmente de 8 cm au XXe siècle.
B) Les causes humaines :
Mais la principale cause d'« enfoncement » de la ville est dans l'intervention humaine, la prise de possession du sol et du sous-sol de Venise par les industriels.
- Les puits artésiens : depuis les années 20, pour satisfaire la demande domestique d'eau courante, la demande agricole et surtout les besoins de l'industrie, on a creusé des puits (environ 8000) qui pompaient l'eau du sous-sol (les industries de Marghera consommaient par jour 40 000 m3 d'eau tirée des nappes souterraines). Ils sont maintenant interdits et on prévoit de combler les poches vides.
- Les passages de vaporetti et de bateaux à moteur créent dans les canaux des vagues violentes qui viennent se briser sur la base des palais, rongeant les fondations et les pieux mis alternativement en contact avec l'eau et avec l'air. Les canaux étaient faits pour le battement des rames, non pour les hélices, et il ne reste à Venise qu'à peine 400 gondoles sur les milliers qui y circulaient au XVIIIe siècle.
- Les canaux de grande profondeur creusés dans la lagune pour permettre l'accès des pétroliers à Marghera ont détruit l'équilibre délicat réalisé dans le passé (le « Canal des pétroles » creusé en 1963 a 15 m de profondeur et 18 km de long). La flore et la faune sont bouleversées, les eaux se polluent, l'eau pénètre en plus grande quantité et avec plus de violence par les « bocche », les 3 ouvertures sur la mer.
- L'occupation des « barene » (terres émergées à marée basse, immergées à marée haute) et des « valli da pesca » par les zones industrielles et l'aéroport : les « barene » qui occupaient une partie importante de la lagune permettaient aux eaux de la marée haute de se répandre sur une surface plus grande, limitant ainsi l'amplitude de la marée. Or, sur les 42 000 hectares de la lagune, 6000 hectares de « barene » ont été récupérés par les zones industrielles et l'aéroport ; 9000 hectares ont été fermés par des propriétaires privés qui en font de fructueux terrains de pêche. Sur ces 15 000 hectares, l'eau ne se répand plus et monte avec plus de violence sur le reste de la lagune et sur la ville.
- La pollution atmosphérique ronge les monuments et les sculptures : les sulfates et les chlorures déposés par le « smog » altèrent le carbonate de calcium de la pierre d'Istrie en sulfate de calcium, une sorte de craie molle détruite ensuite par l'humidité (voir les murs couverts d'une sorte de peau malade qui se gonfle et finalement se détache du mur). D'autre part, plusieurs îles servent de décharge qui envoient leurs produits toxiques dans la lagune.
Face à cela, l'inertie des gouvernements et des pouvoirs locaux a pendant des années laissé pourrir la situation, dans l'incapacité à choisir des solutions décisives, par peur de l'opposition de ceux que Nantas Salvalaggio appelle « la mafia industrielle et politique » (cf son roman Il campiello sommerso, Rizzoli, 1974), mais aussi de l'opposition des syndicats à toute modification de l'équilibre industriel atteint, et donc de l'emploi. En 1974, le Maire Giorgio Longo se prononçait encore pour une extension de la zone industrielle au sud de Marghera vers Chioggia. En 1995, le gouvernement adoptait un décret pour la sauvegarde de Venise, mais le Parlement ne réussit pas à le convertir en loi avant la fin de la législature et tout tomba à l'eau, provoquant la fureur de Massimo Cacciari. « Il faut sauver Venise de ses sauveteurs »... (Le Monde, 14-10-1994)
Les causes politico-administratives : l'île forme une seule commune avec les « villages » de Mestre et Marghera. Or ceux-ci ont grandi au point de créer un déséquilibre en leur faveur :
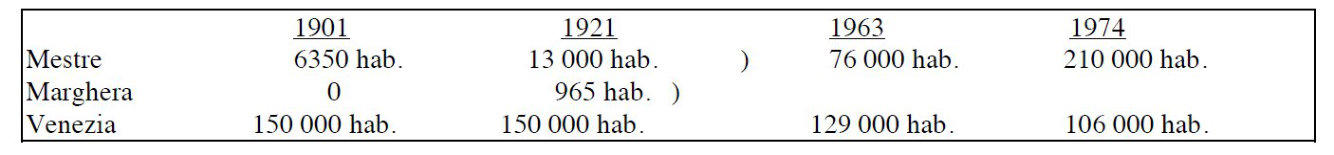
Et la descente continue : 75 000 habitants en 1975, 60 000 en 2000...
Or la sauvegarde de Venise imposerait que le développement (industriel et touristique) soit dirigé par le Centre historique et non par la terre ferme, et contrôlé par les pouvoirs publics et non par l'initiative privée.
c) Les solutions proposées
- Contre « l'aqua alta », le projet MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico et jeu de mots sur Mosè, Moïse, libérateur du peuple hébreu !) de digues mobiles dans les trois accès à la mer, permettant de bloquer les eaux lors des marées de plus de 1 mètre d'amplitude. Le projet est en discussion depuis le début des années 80, défendu par les uns (le Comité des 5 « sages » internationaux, et le gouvernement qui a dit « oui » aux digues en décembre 2001), contesté par les autres (les Verts, le WWF, Legambiente, une partie des élus, le Comité des spécialistes de l'Université de la Sapienza de Rome, les techniciens du Ministère de l'Environnement, la VIA = Valutazione d'Impatto Ambientale, le Comité d'évaluation sur l'environnement qui refuse le projet mais est désavoué par le TAR, Tribunal administratif régional...) : une dépense de 2,6 milliards d'euros en 8 ans ! Mais les études préalables menées par 500 experts ont déjà coûté des centaines de milliards de lires. La question est complexe : les digues suffiront-elles à compenser les conséquences de l'effet de serre qui, selon le WWF, pourrait se traduire par une montée des eaux de 65 cm d'ici 2070, c'est-à-dire provoquer l'inondation complète de Venise ? Plus récemment, un énorme scandale financier a été découvert, compromettant la fiabilité du projet.
- Mais un autre problème préoccupe les Vénitiens, celui des pollutions atmosphériques par l'anhydride carbonique et d'autres gaz, par les décharges industrielles (250 000 tonnes de déchets toxiques brûlés par an). On a prévu 10 000 milliards de lires par an pour « dépolluer » la lagune, mais en même temps on laisse en activité le pôle polluant de la pétrochimie de Porto Marghera et de ses décharges : c'est comme « chercher à vider un évier plein d'eau avec une éponge en laissant le robinet ouvert » (Greenpeace, 1995). Le vrai problème de Venise, dit Arrigo Cipriani, le propriétaire du Harry's Bar, c'est la faillite du processus d'industrialisation de Marghera : « Marghera est en soi une folie, née sous le fascisme comme pure spéculation. Comment peut-on faire passer dans la lagune des pétroliers plus dangereux qu'une bombe ? » (La Repubblica, 12 janvier 1995). En 1994, le Tribunal de Venise avait reçu une plainte d'un ex-ouvrier contre les dirigeants de la Montedison-Enichem de Marghera pour homicide : l'enquête avait montré en effet que 157 ouvriers étaient morts de cancer et 103 étaient gravement malades de cancer pour avoir travaillé sans protection du CVM (Chlorure de vinyle monomère) et du PVC (Polyvinyle de chlorure) utilisés pour produire le plastique. Le Procureur avait demandé 185 ans de réclusion, dont 12 ans pour l'ex-Président de la Montedison, et 80 000 milliards de dommages et intérêts pour les victimes et pour l'État. Après 3 ans de discussion, une sentence d'acquittement général a été prise par le Tribunal le 2 novembre 2001, provoquant la colère des familles des victimes ; la raison invoquée par les juges est qu'il n'y avait pas à l'époque de normes de protection de l'environnement : la faute est au législateur ! Signe d'un système industriel qui s'est développé de façon sauvage, sans contrôle de l'État, sans règles précises, sans souci de l'environnement et de la spécificité de Venise, sans souci non plus de la santé des habitants... et des touristes (Ceux qui sont allés à Mira se souviennent de la puanteur qu'exhalait alors la Mira Lanza !).
Quelles solutions donc ? Dans un premier temps la Cour des Comptes avait proposé en 1994 de faire payer les « prédateurs » de la lagune, ceux qui ont fermé les « valli da pesca » (environ 240), ceux qui ont construit abusivement villas, maisons et autres (environ 3500) sans autorisation, les riches familles à qui ont été cédées abusivement quelques îles de la lagune, etc... Mais que va-t-on faire en pratique ? Qui sait si l'acquittement de 2001 ne va pas faire prendre conscience du problème et pousser à mettre en œuvre l'assainissement du Petrolchimico de Marghera, tout en maintenant le niveau actuel d'emploi ? Et Venise là-dedans.
Et puis bien d'autres difficultés à résoudre, par exemple :
- Les restaurations de maisons et monuments : la Municipalité avait prévu de restaurer les appartements vides (environ 5000 à Venise) et de les mettre à disposition de jeunes couples qui n'ont pas les moyens de se payer un logement dans le Centre et s'en vont habiter à Mestre. La restauration des monuments s'accélère, ainsi le Moulin Stucky (200 000 m3) sur la Giudecca, construit en 1895 et abandonné en 1955 après une longue crise : la restauration a commencé en 1995, sous la responsabilité de la Srintendance aux Beaux-Arts, pour un investissement de 200 milliards de lires qui l'a transformé en un hôtel de 379 chambres et suites, 7 restaurants, un centre de congrès, centre commercial, établissement de thalassothérapie, résidence de 130 appartements...
- La « guerre des moules » : les pêcheurs de moules de Pellestrina et San Pietro in Volta, qui revendiquent la liberté de pêche avec n'importe quels moyens (en particulier avec des « turbosouffleurs » qui décrochent les moules du sable, mais détruisent aussi les fonds lagunaires) et n'importe où (y compris dans les zones polluées de Porto Marghera), provoquant de graves incidents chaque fois qu'est arrêté un pêcheur en contravention avec la loi.
- La « guerre des pigeons » qui polluent les monuments (que l'on doit, comme à Milan, protéger par des filets) et peuvent transmettre des bactéries aux touristes : les éloigner ?, les éliminer ?, les stériliser ?, interdire de leur vendre des graines sur la place Saint-Marc ?... La question revient en discussion tous les 10 ans...
- Le développement des algues par manque d'oxygénation de l'eau : un robot sous-marin commence à sonder les fonds marins et à analyser le taux d'oxygène contenu dans l'eau.
Ces problèmes forment un tout difficile. De leur solution dépend la survie de Venise.
Évolution de l'Aqua alta (calculs faits à partir de la marée de 0 degrés de 1897 à la pointe de la Salute ; à partir de 1983, les calculs sont faits par le Centro previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia
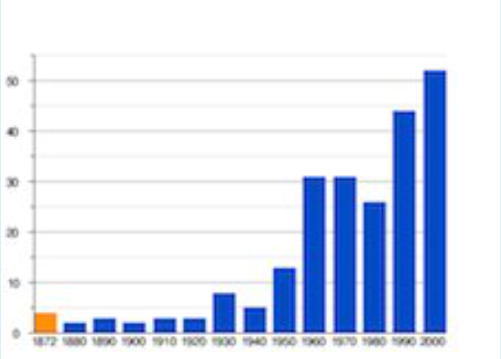

Fréquence des marées de + de 110 cm / Fréquence des marées de + de 120 cm
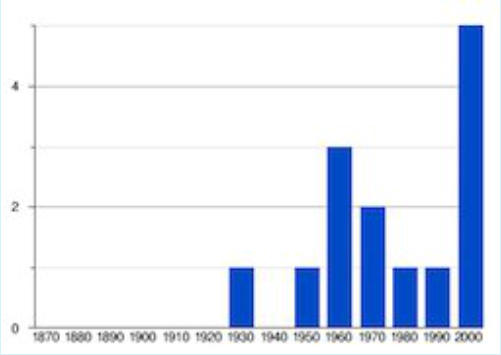

Fréquence de marées de + de 140 cm. / Distribution mensuelle des marées (1872-2009)

Distribution des marées hautes (maree molto sostenute) de 1923 à 2008
Une proposition révolutionnaire : fermer la mer Adriatique (Il Giorno, 14-8-1969)




