ROMA - Rome
Les grandes périodes :
- – 753 – 313 : la Rome antique : Rome est capitale de la monarchie, de la république puis de l’empire païen, jusqu’à la reconnaissance par Constantin du christianisme qui devient très vite religion officielle.
- 313 – 1309 : Rome est capitale de l’Église chrétienne pendant cette période du Moyen-Âge, très riche événements et constructions, où le clergé prend de plus en plus d’importance.
- 1309 - 1420 : Exil des papes à Avignon
- 1420 – 1527 : Développement de Rome avec le retour du pape, entrée dans une brève « Renaissance ».
- 1527 – 1798 : Rome devient un des grands centres européens, elle se restructure selon les normes de l’art baroque.
PREMIÈRE PARTIE
Quelques éléments de l'urbanisme romain
Rome ville de collines
On sait que Rome est « la ville des sept collines ». Mais ce n'est pas qu'une question géographique de relief : les collines sont consubstantielles à Rome, définissent l'essence de Rome. Car les collines à Rome sont ces mamelons que désignait le vieux mot latin "ruma" qui signifiait « mamelles d'un animal ». Rome, nom d'un lieu désigné par la forme de son relief, est la ville des mamelles, qui deviendront dans le mythe les mamelles de la louve qui allaite Romulus et Remus sous le figuier « Ruminal » (l'arbre des mamelles, cf. celui du Forum) au bord du « Rumon », l'ancien nom du Tibre, le fleuve qui traverse les « ruma », les collines, les mamelles. C'est sur ce lieu préexistant, déjà nommé et depuis longtemps habité que sera fondée la ville au VIIIe siècle (Cf plus loin), sur une partie limitée du site, le Palatin, étendu plus tard à toutes les collines avoisinantes.
Histoire des villes : Roma - 1
Le tableau synoptique de l’histoire de Rome se trouve dans la rubrique Histoire
- 1798 – 1814 : Domination française qui sort la ville de la domination pontificale.
- 1814 – 1870 : Dernières années de la domination pontificale.
- 1870 – 1946 : Rome est capitale de l’Italie unifiée par la monarchie de Savoie
- 1946 – .... : Rome est capitale de l’Italie républicaine.
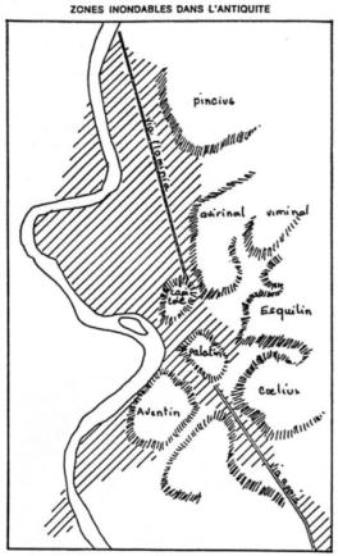
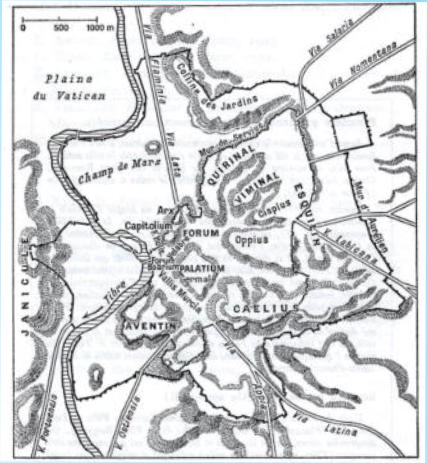

1) Les sept collines :
Palatin
(51 m. de haut, 1700 m. de circonférence) : De la racine indigène "pa", que l'on retrouve dans le nom de la déesse primitive Palès et dans « Patres », les pères, les morts dont Palès était la déesse protectrice de la terre, la « Patria », d'où « Palatium ». Autre étymologie possible : « Pallantium », Pallantée, la ville d'Arcadie dont était originaire Evandre, le berger grec qui apparaît dans la tradition de la fondation de Rome comme étant celui qui montre à Énée le site de l’ancienne Saturnie du Capitole. Avant lui, Hercule aurait chassé de la colline et tué le monstre Cacus anthropophage mais cependant lié à Vulcain et à la sphère du feu.
Le choix du Palatin comme site de fondation de Rome peut être dû à la situation stratégique de la colline, bien défendue par ses falaises, alors entourée d'eau sur trois côtés (Velabro Maggiore = Forum + Velabro actuel, Velabro Minore = Valle Murcia = Grand Cirque, et vallée entre Coelius et Palatium), permettant de contrôler les gués du Tibre à la hauteur de l’île et le lieu de rencontre et de marché du Forum Boarium. Une possible occupation grecque antérieure au -VIIIe siècle est peut être à la source de la légende du roi-berger Evandre et de son fils Pallas, présence confirmée par la découverte de pavements de cabanes du début de l'âge du fer, à l'angle de la colline qui domine le Forum Boarium (le Cermalus) puis de restes de cabanes datant de la seconde moitié du -VIIIe siècle, dont l'une, plus grande, est considérée comme la « casa Romuli ».
Palatin primitif ‘face Sud, le Cermalus – Reconstitution Carandini : en bas à g. la grotte du Lupercal, l’escalier de Cacus et la plage des courses le long des marais de la Valle Murcia. En haut à g., le Capitole et la plaine inondable du Vélabre. Sur la colline, cabanes primitives (800-750 av.J.C.)
Le Palatin est le lieu des cultes les plus anciens, en particulier les fêtes des « Palilia » (en l'honneur de Palès le 21 avril, jour de la fondation de Rome par Romulus), les « Lupercalia » (célébrées par des « prêtres-loups » en l'honneur de la louve), près de la grotte (le Lupercal) où la louve aurait allaité les jumeaux, les cultes de la Victoire et de Cybèle (la Magna Mater importée d'Asie Mineure) puis ceux d'Apollon et de Vesta introduits par Auguste. Habité par les classes dirigeantes (le père des Gracques, Cicéron, Marc-Antoine, Auguste...), puis par les empereurs (jusqu'à Charlemagne) qui y construisent leurs palais (au point que « Palatium » devient ensuite le nom de toute demeure impériale et noble, le « palais »), le Palatin garda toujours intacte la zone des cabanes par respect du fondateur de la ville. La colline fut abandonnée au moyen âge, jusqu'à ce que le cardinal Farnese y installe sa villa et ses jardins (Orti farnesiani) au XVIe siècle. Les fouilles reprennent à partir du XVIIIe siècle ; la Commune de Rome rachète le site en 1870 et les poursuit ; on ne retrouve la maison d'Auguste qu'en 1961, elle vient d’être ouverte au public en 2007. En dessous, on vient de découvrir une grotte...
Capitole
Le Capitole ("Campidoglio", 48 et 46 m. de haut, 925 m. de circonférence, treize hectares de superficie) : le nom vient de « caput », la tête (selon la légende, en construisant les fondations du grand Temple de Jupiter, on aurait retrouvé la tête d'un certain Olus en creusant les fondations du temple à Jupiter Capitolin), la capitale, le centre du monde et de Rome. Il reste le symbole du pouvoir et les jeunes États-Unis d'Amérique donnèrent le nom de « The Capitol » à l'immense édifice néoclassique qui abrite les branches du Congrès.
Autre lieu stratégique de la ville, isolé de trois côtés par ses falaises à pic (est encore bien visible la falaise sud, la roche « tarpéienne », premier nom de la colline : « Mons tarpeius ». mais la Roche Tarpéienne était peut-être de l'autre côté, sous l'actuel Monument à Victor-Emmanuel II...?), sauf vers le Quirinal auquel il était relié par une « selle » rasée par Trajan pour la construction de son forum, il est dans une position dominante par rapport à la plaine du Forum d'un côté et celle du Champ de Mars de l'autre. Il avait été, selon la légende, le lieu où s'était réfugié Saturne après avoir été détrôné par Jupiter ; accueilli par le dieu Janus, qui habitait le Janicule, il reçut pour résidence le Capitole, d'où il put gouverner et civiliser les hommes pendant un bienfaisant « âge d'or ». C'était alors le Mons Saturnius, et l'on y retrouva des fragments de céramique datant de 1700 à 1500 av. J.-C. L'ancienneté du culte de Saturne s'est poursuivie par la construction d'un Temple de Saturne au pied de la colline dès la fin du VIe siècle av. J.-C.
Il comportait deux sommets, le « Capitolium » au SE et l'« arx » au NO (vers S. Maria in Aracoeli). Entre les deux, une dépression, « l'asylum », lieu de refuge des jeunes Italiques bannis des communautés voisines qui formèrent la tribu des « Lucerenses », les Lucériens, l'une des trois centuries de chevaliers instituées par Romulus avec les « Rhamnenses », les Rhamnenses et les « Titienses ». Il a été habité dans sa partie sud depuis le XIVe siècle (cf céramique trouvée dans les fouilles de S. Omobono) ; il devient le siège du gouvernement par opposition à la colline résidentielle du Palatin : l'« arx », la forteresse de la ville, le Tabularium (les archives d'État qui conservaient les senatusconsultes, les décrets du Sénat), le Temple de Jupiter Capitolin, Junon et Minerve, la triade capitoline. Tombé en ruines à partir du Moyen Âge (on l'appelle alors le « Monte Caprino », la colline aux chèvres), le Capitole reste le siège des assemblées populaires et de la vie communale (Palais du Sénateur sur les restes du Tabularium) tandis qu'à ses pieds, sur le Forum, se trouvent les maisons des plus grands artistes de la Renaissance (Michel-Ange, Jules Romain, Giacomo Della Porta, Pietro da Cortona). Paul III Farnese charge ensuite Michel-Ange de créer un cadre nouveau pour la vie politique de la ville : la place, les palais latéraux, l'escalier d'accès tourné maintenant vers le Champ de Mars où s'est désormais concentrée la ville. Les constructions post-unitaires (Monument à Victor Emmanuel II, de 1885 à 1911), puis les fouilles et destructions fascistes (de 1928 à 1943) ont démoli toutes les constructions qui s'appuyaient sur ses pentes, l'ouverture des grandes voies comme Via dei Fori Imperiali indispensable aux défilés de propagande du régime, du Colisée au palais de Venise, ont réduit la colline à sa forme actuelle.
Quirinale
(58 m., la plus haute et une des plus étendues : 52 hectares) : doit son nom au temple du dieu Quirinus (les Quirini étaient les habitants de la ville sabine de « Curii », Cures d'où étaient partis les Sabins pour venir s'établir sur cette colline bien avant la fondation de Rome (on trouve des traces archéologiques vers Santa Maria della Vittoria, remontant au –XIe siècle). Après la fusion avec les Sabins, les Romains prirent le nom de "Quirites". Ce dieu dont on discute beaucoup, est assimilé ensuite à Romulus divinisé lorsqu’il monte au ciel. Peut-être faut-il aussi rapprocher le mot de « quiris », la lance : dans les temps primitifs, les Romains assistaient aux comices « curiates » (assemblées du peuple par « curies », une division du peuple romain) munis de leur lance (« hasta », la lance, était le symbole royal porté pendant les sacrifices -Cf bas-relief de l'Ara Pacis-, elle est aussi la hampe du drapeau que l'on porte dans les cérémonies : souvenir de l'ancien culte de la lance?).
Le Quirinal était une zone surpeuplée, mais qui comportait aussi de nombreuses villas et parcs (Salluste, Scipion l'Africain, Lucullus... et sur la rue du XX Septembre, villa de la gens Flavia, d'origine sabine et importante à Rome : elle accèdera à l'Empire). Sous l'Empire, il y avait sur le Quirinal le Temple de Sérapis et les thermes de Dioclétien et de Constantin, d'où proviennent les statues des Dioscures aujourd'hui sur la place du Quirinal accompagnés de leurs chevaux, qui firent qu'au Moyen Âge on appelait cette colline "Monte Cavallo" (la colline du cheval). Au Moyen Âge, y habitaient des intellectuels, dont Pétrarque, Platina, Pomponio Leto ; Vittoria Colonna y eut son cénacle, auquel participait Michel-Ange. Résidence d'été pontificale à partir du XVIe siècle, puis palais royal à partir de 1870, où de nombreux Ministères s'installèrent Via XX Settembre, le Quirinal est depuis 1948 le siège de la Présidence de la République.
Viminale
(54 m., la plus petite des sept collines) : littéralement la colline des roseaux, de l'osier, ainsi appelée à cause des saules ou de l'osier qui y poussait. Elle comportait un temple à Jupiter « Vimineo », ouvert par-dessus pour laisser passer la pluie nécessaire à la poussée de l'osier. Siège du Ministère de l'intérieur, construit par Giolitti et restauré en 1920.
Esquilino
(58 m., la plus étendue des sept collines, 75 à 80 hectares) : Étymologie incertaine : de « esculus », chêne rouvre consacré à Jupiter, qui recouvrait la colline, ou de « excubiae », les gardes que Romulus y plaçait la nuit parce qu'il se méfiait du Sabin Tatius, ou de « ex quiliae », les Esquilies, constructions extérieures aux murailles (contraire de « inquilinus », le locataire, celui qui est à l'intérieur). La colline est composée de trois « sommets », Fagutal (colline du hêtre), Cispio (S. Maria Maggiore), Oppio (pour ces deux derniers, du nom de deux chefs de tribus venus défendre Rome sous Tullius Ostilius).
C'est dans ce quartier que se trouvait le cimetière des pauvres et des esclaves, dont les corps étaient souvent laissés à l'abandon sur la terre, en proie aux corbeaux et aux chiens de l'Esquilin (cf dans le Forum les nécropoles au pied de la colline). Mécène (Caius Cilnius Maecenas, 70-8 av. J.-C. ami d'Auguste et protecteur des arts et lettres) transforma le lieu en une splendide demeure avec jardins, où habitèrent Horace, Virgile, Properce. L'incendie de 64 détruisit tout le quartier et Néron y fit construire sa Maison Dorée ; après sa mort, les empereurs y installent les énormes Thermes de Titus puis de Trajan ; lorsque ceux-ci cessèrent de fonctionner au VIe siècle, l'Esquilin fut largement abandonné, s'enterra et devint zone rurale ; au Moyen Âge, se souvenant de l'origine macabre, les sorcières continuaient à venir y cueillir les herbes de leurs filtres ! À partir du XVIe siècle, on fouilla et on y trouva de nombreuses sculptures, dont le Laocoon en 1506. Sixte V s'y fit construire une immense villa, qui sera remplacée par la Stazione Termini (Gare centrale). Là se trouvent plusieurs églises du Moyen Âge, Santa Maria Maggiore, Santa Pudenziana, Santa Prassede, San Martino, San Pietro in Vincoli.
Caelius
(Monte Celio, 48 m.) : du nom de Celio Vibenna, le « Lucumon » (chef) des Étrusques venu au secours des Romains contre les Sabins et qui s'installa ici, formant la tribu des Lucerenses » (Cf Capitole). Avant, la colline s'appelait « Querquelutanus », colline des chênes, consacrés à Jupiter parce que la foudre ne les atteignait jamais.
D'abord riche de temples, domus et casernes, la colline se ruralise après le sac normand de 1094 et se couvre de vignes. Elle comporte des églises importantes (Santo Stefano Rotondo, Santi Quattro Coronati, Santi Giovanni e Paolo ; elle reste un des lieux les plus suggestifs de Rome.
Aventin
(47 m., 31 hectares) : Étymologie incertaine : viendrait de « ab avibus », des oiseaux dont se prévalut Remus pour prendre les augures et proposer de fonder Rome sur cette colline ; ou de « Aventino », roi d'Albe enseveli ici après la destruction de la ville par Rome ; ou de « ab adventu », du rassemblement que faisaient ici les plébéiens pour sacrifier au temple de Diane (opposé au temple de Jupiter sur le Capitole). Les Romains se souvinrent en tout cas toujours que là fut tué puis incinéré Remus, et la colline garda une réputation de lieu néfaste.
Extérieur au « pomoerium » jusqu'à l'époque de Claude, quartier essentiellement commerçant habité par des étrangers, l'Aventin fut le centre de la vie politique et religieuse de la plèbe et des sécessions de la plèbe (« se retirer sur l'Aventin », comme le firent encore en 1924 les députés socialistes pour protester contre le pouvoir de Mussolini après l'assassinat de Matteotti). En -456, la loi déclare l'Aventin propriété publique et ses terrains furent distribués aux plébéiens pour la construction de leur maison. La plèbe y pratiquait le culte de Diane, dans le temple, - refuge des plébéiens -, fondé au temps du roi plébéien Servius Tullius, et de Cérès. Sous l'empire, la colline perdit son caractère populaire pour devenir quartier résidentiel aristocratique, ce qui lui valut d'être saccagé par les invasions barbares. La colline fut appelée aussi « Murciae », de « myrtus », le myrte, plante consacrée à Vénus, d'où le nom de « Valle Murcia » donné à la dépression où se trouve le Grand Cirque. La colline se garnit plus tard de couvents et d'églises : moines de Cluny, templiers dont les biens passent, après sa dissolution en 1312, aux Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, puis de Rhodes puis de Malte qui détiennent encore le sommet de la colline, modelé pour eux par Piranesi en 1765 : il a orné la place d'obélisques, armes, boucliers en souvenir de la présence ici de l'« Armilustrum », l'enceinte où l'armée romaine purifiait ses armes. Plus haut subsistent le couvent bénédictin de Saint Anselme (chant grégorien), le couvent de Saint Alexis et la basilique de Sainte Sabine. Au pied de l'Aventin, l'ancien cimetière juif, transféré au Campo Verano, laisse place à la Roseraie communale.
Autres collines de Rome
Le "Mons Vaticanus"
Aulu-Gelle donne pour étymologie « vaticinium », le lieu du « vates », le devin, = le lieu des vaticinations, (à cause de l'abondance des cultes prophétiques orientaux à l'époque impériale), sur lequel sera construit le Cirque de Caligula, où fut martyrisé et enterré l'apôtre Pierre. Plus tard, sur la tombe de Pierre, Constantin fait construire la première basilique.
Le Janicule
(82 m.) : Colline de Janus, roi des Aborigènes, qui accueillit ici Saturne, chassé du ciel, dont il reçut le don de prophétie. Au-delà commençait le domaine des Étrusques. Bastion naturel de la ville, il jouait un rôle défensif important. Janus, le plus ancien des dieux italiques, fut représenté bifrons, à double face. Son temple restait fermé en temps de paix. Il était aussi le dieu des portes (ses deux visages surveillaient l'entrée et la sortie) et le dieu des commencements, présidant au début de chaque année. Une partie de la colline porte le nom de « Montorio » (église de Saint-Pierre in Montorio, où on situe le lieu du martyre de Saint Pierre), altération de « Monte d'Oro », colline d'or, en souvenir des sables jaunes dont elle se compose et de ses jardins qui, au Ve siècle, passaient pour une des merveilles du monde (au XVIIe siècle, les lettrés y reconstituèrent le « Bosco Parrasio », ou « Théâtre des Arcadiens » (la Parrasia était une des régions de l'Arcadie), un des plus beaux jardins de Rome). Cela fut rendu possible par la reprise de l'ancien aqueduc romain restauré par le pape en 1612 (Acqua Paola) qui suscita aussi la construction de belles villas (Villa Pamphilj). Le Janicule est lié au souvenir de la défense de la République romaine, dirigée par Garibaldi en 1849, contre les troupes françaises du général Oudinot venu restaurer le pouvoir pontifical. Le souvenir en est marqué par les monuments dédiés à Giuseppe et à Anita Garibaldi.
La Velia
Petite hauteur qui fermait la vallée du Colisée et reliait le Palatin et l'Esquilin. Sur la Velia se trouve l'Arc de Titus dans le Forum romain ; le reste de la colline a été coupé par l'ouverture de la via dei Fori Imperiali.
Le Pincio
(culminant à 60 m.), de la famille des Pincii qui avait ici une somptueuse villa au IVe siècle, connue pour ses jardins (d'où le nom de « Colline des jardins » donné dès l'Antiquité), héritiers des délicieux jardins de Lucullus, mais aussi de Salluste, fusionnés dans une immense villa impériale, abandonnée après la destruction des aqueducs par Alaric en 410 ; puis vers 1550, à partir des puits et tuyaux de l'Acqua Vergine, le cardinal Ricci commencera à y reconstruire une villa qui passera ensuite aux Médicis, puis à la France en 1803 (siège de l'Académie de France encore aujourd'hui). Cette partie de la colline est marquée par la présence française, autour de l'église de la Trinità dei Monti.
Ici se déroulèrent les orgies de Messaline et fut déposée l'urne funéraire de Néron, qui fut retrouvée, dit la tradition populaire, sous un noyer plus grand que les autres, et employée comme mesure de la chaux et du sel sur l'ancien marché du Capitole ! Sur commande de Pie VII, en 1822, Valadier remplaça l'ancienne vigne par les jardins actuels ornés de bustes des hommes illustres d'Italie.
Montecitorio
Petite colline formée par les terres d'extraction des fondations de la colonne de Marc-Aurèle (Mons Acceptorius, où les citoyens se réunissaient pour les votes) ou, selon d'autres auteurs, par les ruines de l'amphithéâtre de Statilius Taurus. Le niveau s'éleva tellement qu'il ensevelit la colonne consacrée à Antonin le Pieux, que Pie VI fit découper pour restaurer l'obélisque de Psammétique II, gnomon du cadran solaire du Champ de Mars.
Testaccio
(52 m.) = la colline des tessons : une des 7 collines artificielles de Rome (les autres ont disparu, sauf Montecitorio) formée par les débris (« testaceus » = de terre cuite) d'amphores dans lesquelles arrivaient à Rome l'huile, le vin, les légumes (le marché, l'« Emporium » était tout proche), ou, disait-on, par les ruines provoquées par l'incendie de Néron. La colline qui eut jusqu'à 70 m. de haut devint un lieu de fêtes religieuses, on y planta une croix (au pied de laquelle Nicolas Poussin venait, dit-on, contempler Rome au coucher du soleil), puis des jeux pendant le Carnaval : jeux populaires comme les courses de taureaux ou de porcs poussés du haut de la colline ou d'ignobles courses de juifs ; ou jeux aristocratiques, courses de chevaux de race payées par l'Université Hébraïque qui devait donner chaque année 1330 florins, dont les 30 derniers avaient été ajoutés en mémoire des 30 deniers dépensés par les Juifs pour corrompre Judas ! Sous la colline sont creusées des grottes dans lesquelles on conserve le vin, à température constante de 10 à 7 degrés.
Rome, la ville aux 13 collines, et même plus !
Noter que la ligue latine dite « Septimontium » (= des 7 collines) ne correspond pas aux sept collines de Rome, mais à sept villages préexistants à la fondation de Rome, sur le Palatin, l'Esquilin, la Velia et le Caelius, tandis que les Sabins occupaient le Quirinal et le Viminal.
Ville de collines, Rome est naturellement aussi ville d'escaliers, de rampes et de rues en pente. Plus subtil que le français, l'italien distingue « la scala » (un escalier ordinaire) de la « scalinata » (un escalier monumental comme celui de la Trinità ai Monti, du Capitole ou de l'abside de Sainte-Marie-Majeure). On parle aussi de « scalea », escalier d'honneur, de parade, par exemple pour la Scala Santa.
À l'origine, les escaliers avaient simplement un rôle de raccordement entre deux niveaux ; ils deviennent ensuite des éléments d'architecture essentiels de l'urbanisme romain, - interprétés selon la sensibilité esthétique de chaque époque -, des moyens de créer de magnifiques scénographies urbaines, souvent dans la perspective d'une rue ou d'une place. La même esthétique commande les escaliers intérieurs des palais, par exemple le grand escalier hélicoïdal à double rampe de Gian Lorenzo Bernini qui donne accès aux Musées du Vatican.
Les escaliers (« scale » et « scalinate »)
D'abord l'escalier légendaire de Saint-Jean de Latran, dit « Scala Santa », que Jésus-Christ aurait monté et descendu par trois fois jusqu'à sa condamnation dans le Palais de Ponce Pilate à Jérusalem : selon une tradition inventée au XVe siècle, l'escalier fut transporté à Rome en 326 par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, et installé par le pape Sylvestre I dans le palais des Patriarches, résidence officielle des papes au Latran. En 1589, Sixte V fait transporter l'escalier en une seule nuit, marche par marche, dans la chapelle privée des papes (le « Sancta Sanctorum ») construite sur un projet de Domenico Fontana en 1589. Un des premiers témoignages sur la vénération de cette relique et sur l'usage, encore vivant, de la monter à genoux durant la semaine sainte, se trouve dans le Zibaldone de Giovanni Rucellai, qui était à Rome pour le Jubilé de 1450.
Mais le culte de la Scala Santa se développa tellement qu'on en fit faire par exemple une copie en 1717 pour un monastère afin que les religieuses cloîtrées puissent le parcourir en jouissant des mêmes indulgences que ceux qui montaient à genoux l'original du Latran. La Scala Santa est aussi reproduite, dans une mise en scène baroque très théâtrale, dans l'église Saint-Alexis sur l'Aventin.
Un autre escalier de grande signification religieuse est celui de Sainte-Marie in Aracoeli (Cf dessin p. 8) sur le Capitole. Il est construit en 1348 par Lorenzo di Simone Andreozzi, inauguré par Cola di Rienzo et financé par le peuple romain pour remercier la Vierge d'avoir protégé Rome de la grande peste de 1348. Cet escalier très raide de 122 marches exprime bien une conception médiévale de la vie comme montée pénible à travers les obstacles jusqu'à la conquête du ciel. Il contraste en cela avec l'escalier voisin qui monte à la place du Capitole (Cf dessin p. 8), une "cordonata", rampe tout en douceur, légèrement fuselée, dessinée par Michel-Ange (et modifiée en 1578 par Giacomo Della Porta) à l'occasion de la venue à Rome de Charles Quint, accès très agréable au spectacle harmonieux de la place exécutée aussi sur dessin de Michel-Ange en 1568 (Palais des Conservateurs à droite) et 1655 (Palazzo Nuovo à gauche). Pour mieux souligner la joie qui préside à la construction, on dépose en 1588 en bas de l'escalier, sur des socles de Della Porta, des lions égyptiens en basalte gris qui crachèrent, au lieu de l'eau, du vin blanc et du vin rouge pour le couronnement d'Innocent X (on ajouta alors sur les lions deux anges sur la tête desquels volaient des colombes portant dans leur bec un rameau d'olivier, emblème des Pamphilj, la famille d'Innocent X) et de Clément X Altieri.
Mais c'est surtout l'époque baroque qui enrichit Rome d'escaliers monumentaux qui contribuent à faire de la ville un immense théâtre. Ainsi celui que l'on trouve en haut de la Salita del Grillo, derrière les marchés de Trajan : les deux rampes en tenaille qui donnent à l'église Saints Dominique et Sixte son mouvement ascensionnel (Vincenzo Della Greca, 1655-63), première reprise d'une forme profane propre aux villas de la Renaissance et utilisée ici pour un édifice religieux.
Outre la Scala regia des musées, G.L. Bernini crée aussi la triomphale ellipse de la place Saint-Pierre, dont l'escalier d'accès à la Basilique constitue un prolongement naturel, qui apparaît d'une ampleur d'autant plus grande qu'on le découvre en débouchant de l'espace resserré de la colonnade.
La plus grandiose scénographie baroque est celle de l'escalier de la Trinité des Monts. Réalisé entre 1723 et 1726 en travertin par Francesco De Sanctis pour Innocent XIII, il avait pour but de relier la via Condotti à l'église située beaucoup plus haut. Jusqu'alors la liaison se faisait par un chemin de terre bordé d'arbres, peu commode. Le cardinal Mazarin eut le premier l'idée de l'escalier mais c'est le legs de 24.000 écus de l'ambassadeur français Étienne Geuffier qui permit la réalisation du projet.
Le modèle fut le jeu de formes concaves et convexes de l'escalier réalisé par A. Specchi pour le port de via Ripetta. Les trois rampes se rejoignent pour donner accès à deux escaliers, à trois paliers séparant des rampes de 12 marches, illustrant le thème de la Trinité qui donne son nom à l'église. Au fond du troisième palier, un autre escalier à double rampe arrive jusqu'à l'église.
Et encore : l'escalier du parvis de Sainte-Marie-Majeure de F. Fuga, et surtout le monumental escalier de l'abside sur la place de l'Esquilin (Carlo Rainaldi, 1669-75) qui comble de façon géniale la différence de niveau entre la rue et l'église. Et le grand escalier (aménagé par Pie IX en 1866) qui descend de la place du Quirinal et rejoint, par la via della Dataria e il vicolo Scandenberg jusqu'à la fontaine de Trevi.
Le XIXe siècle apportera aussi son lot d'escaliers, celui du Palais des Expositions, de la Galerie d'Art moderne, du Palais de justice, dont les bases sont modelées par des escaliers de travertin qui ont une fonction essentiellement esthétique. Sans oublier le grand escalier du Vittoriano, le monument élevé à partir de 1885 par Giuseppe Sacconi (inauguré en 1911) en l'honneur du premier roi d'Italie, ni celui du "Colisée carré", le Palais de la Civilisation du Travail construit à l'EUR en 1938-43, reproduction des villes imaginaires de Giorgio De Chirico.
Regardez les escaliers de Rome, et gravissez-les : qui sait ? Peut-être gagnerez-vous quelques indulgences ?




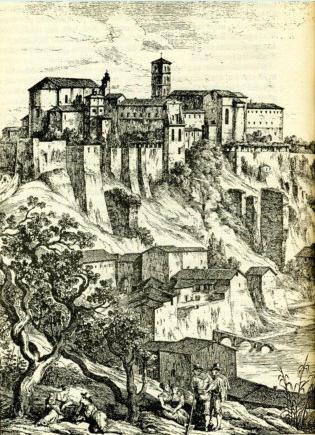







Les 13 obélisques de Rome, les colonnes et les « statues parlantes »
Rome possède plus d'obélisques égyptiens que tous les autres pays réunis, y compris l'Egypte. Il faut en chercher la source dans les cultes solaires chers aux Romains, que les papes ne font que « baptiser » en cultes du « soleil de justice ». L'obélisque est un monolithe destiné à être dressé ; il a quatre faces qui s'amincissent vers le haut et se terminent par une flèche pyramidale. Symbole solaire, l'obélisque évoquait aussi, dans son élan vertical, la transcendance et l'immortalité. Il était placé devant les temples et couvert d'inscriptions se référant aux souverains qui l'avaient fait construire. Il n'en reste que cinq en Egypte, et quatre dans d'autres pays (Constantinople, Paris, Londres, New-York). À Rome, il y en a treize, apportés après la conquête de l'Egypte, qui ornaient le Grand Cirque et d'autres monuments (deux sur la tombe d'Auguste, deux dans les temples d'Isis et de Sérapis, d'autres dans les cirques de Caligula et de Domitien), symboles de la domination romaine sur le monde. Écroulés pendant le Moyen-Âge, ils sont redécouverts et dressés à nouveau à partir du XVIe siècle, comme points focaux de l'urbanisme pontifical de Sixte V et de ses successeurs, en relation étroite avec les rues en ligne droite des programmes d'urbanisme (Vaticano, Esquilino, Lateranense, Flaminio, Quirinale, Trinità dei Monti).


« Ombre de l'obélisque : combien d'hommes ont regardé cette ombre en Egypte et à Rome ? » (Chateaubriand)
I - Vaticano
L'obélisque du Vatican, monolithe de granit rouge de 25 m. 37 (hors la base). Sans inscriptions, on en ignore la date de fabrication. Transporté à Rome par Caligula en 37 ap. J.C., il reste en place, intact, dans le cirque du Vatican, propriété de Caligula, jusqu'au XVIe siècle. La légende voulait que dans la boule de bronze de la flèche, il y eût les cendres de César. Premier obélisque « baptisé », il est transporté par les soins de Domenico Fontana en 1586 au centre de la place Saint-Pierre, surmonté d'une croix et revêtu d'inscriptions chrétiennes. Le transport, exécuté selon les techniques des Egyptiens, nécessita plusieurs mois de travail, 40 treuils, 60 chevaux, 800 hommes et un trompette pour coordonner les tensions exercées sur les milliers de cordes de chanvre fabriquées spécialement à Foligno.
II - Esquilino
L'obélisque de l'Esquilin, en granit (14m. 75), lui aussi sans inscriptions ni date. Retrouvé en morceaux sur le Mausolée d'Auguste, il est installé par Domenico Fontana en 1587 vers l'abside de Sainte-Marie-Majeure. Sixte V y fait inscrire un texte à la première personne où l'obélisque dit sa joie d'honorer le Christ, « moi qui triste servais au sépulcre d'Auguste mort ».
III - Lateranense
Le troisième obélisque relevé par Sixte V est celui du Latran, en granit rouge (32m.12, le plus haut et le plus ancien des obélisques de Rome). Il est recouvert de hiéroglyphes qui le datent du règne de Thoutmosis III (1504 - 1450). Porté à Rome en 357 sur un navire de dimensions exceptionnelles, il est élevé sur l'arête centrale du Grand Cirque, puis déplacé devant l'ancienne entrée de la basilique Saint-Jean de Latran en 1588 par Domenico Fontana.
IV - Flaminio
Dernier obélisque de Sixte V, transporté en 1589 au centre de la Place du Peuple. Haut de 23m.20, daté par ses inscriptions du règne de Séthos I (1318-1304), il est le premier transféré à Rome par Auguste pour célébrer la conquête de l'Egypte et placé sur l'arête du Grand Cirque. Sur sa base subsiste la dédicace au Soleil accompagnée d'inscriptions chrétiennes célébrant la Vierge « dans le sein de laquelle, sous Auguste, naquit le soleil de justice ».
V - Agonale
Obélisque presque romain dont les hiéroglyphes sont commandés par Domitien (81-96) et exaltent la gloire de l'empereur à travers des représentations de divinités égyptiennes. L'empereur Maxence le fit retirer du temple d'Isis pour le transporter dans son propre cirque, d'où Innocent X le récupère pour sa propre famille. Il confia les travaux à Borromini ; mais le Bernin obtint finalement la commande en offrant à Olympia, la belle-sœur du pape, un modèle en argent de la fontaine des Fleuves qui se trouve au milieu de la place Navone (ancien cirque de Domitien). Il y ajoute la colombe portant un rameau d'olivier, emblème de la famille d'Innocent X, les Pamphilj.
VI - Minerveo
Le petit obélisque de granit rouge de la place de la Minerve (5,47 m.) fut fabriqué pour le pharaon Apriès (589-570) dont il porte les hiéroglyphes. On ne sait pas quand il fut transporté à Rome pour être placé dans le temple d'Isis, où il fut découvert par les dominicains de Sainte-Marie-sur-Minerve. Le Bernin s'inspira d'un dessin qui illustrait le livre du dominicain Francesco Colonna, Le songe de Polyphile, pour dessiner le petit éléphant qui supporte l'obélisque que les Romains appellent "il pulcino" della Minerva (non pas "le poussin", mais le petit cochon : "il porcino", parce que les Romains le jugeaient laid!). Une inscription explique que le monolithe représente la sagesse antique, l'éléphant le plus fort des animaux ; « il faut un esprit robuste pour porter une solide sagesse »!
VII - Macuteo
En 1711, Clément XI fait ériger devant le Panthéon un obélisque de 6,34 m. de l'époque de Ramsès II (1304-1236) installé dans le temple d'Isis. L'architecte Filippo Baggioni l'installe sur une fontaine qui remplace celle qu'avait construite Della Porta et le surmonte de l'étoile des Albani, famille de Clément XI, et de la croix.
VIII - Quirinale
Erigé par Pie VI en 1786 sur la place du Quirinal, alors palais pontifical. Monolithe de granit rouge de 14,64 m. sans inscription ni date. Il se trouvait avec l'obélisque de l'Esquilin devant le Mausolée d'Auguste. Il est placé au centre de la fontaine de Monte Cavallo par Giovanni Antinori puis par Raffaele Stern qui modifie la fontaine en 1818 sur demande de Pie VII.
IX - Sallustiano
Devant l'église de la Trinità dei Monti, Pie VI fait placer un obélisque égyptien de granit rouge (13,91 m.) mais gravé à Rome d'inscriptions copiées de celles de l'obélisque de la place du Peuple. Trouvé dans les jardins de Salluste, il est érigé devant l'église par Giovanni Antinori en 1789.
X - Campense
En 1792, Pie VI fait ériger par Giovanni Antinori son troisième obélisque sur la place de Montecitorio. Il remonte à l'époque de Psammétique II (595-589) qui y est représenté sous la forme d'un sphinx couché avec des scarabées ailés qui supportent le disque solaire. En granit rouge, il mesure 21,79 m. Il faisait fonction de gnomon de l'immense cadran solaire-calendrier installé par Auguste au Champ de Mars, décrit par Pline l'Ancien et dont on a retrouvé récemment les marqueteries de bronze qui indiquaient les périodes de l'année.
XI - Matteiano
En 1582, par donation du Conseil du Capitole, le marquis Ciriaco Mattei avait fait dresser dans sa villa (aujourd'hui Villa Celimontana) un petit obélisque d'origine inconnue dont la partie supérieure porte des inscriptions de l'époque de Ramsès II. Placé successivement dans le temple d'Isis puis sur l'escalier de Sainte-Marie en Aracoeli, il est ensuite transporté dans la villa. On pensait que son globe contenait les cendres d'Auguste. Il est dressé à l'emplacement actuel du parc en 1817.
XII - Aureliano
En 1822, Pie VII fait arranger la promenade du Pincio et décide de l'orner de l'obélisque d'Antinoüs, construit par Hadrien pour son jeune ami noyé dans le Nil, avec des inscriptions égyptiennes de main romaine. Haut de 9,25 m., il est érigé par l'architecte Giuseppe Marini dans une allée ombragée du parc où le pape aimait se promener.
XIII - Dogali
Le dernier obélisque romain, de l'époque de Ramsès II (granit rouge de 9,25 m.), ornait le temple d'Isis d'où il est déterré en 1883. En janvier 1885, l'armée italienne subit une grave défaite à Dogali, lors de la première tentative de conquête de l'Ethiopie (548 soldats italiens tués). En juin, l'architecte Francesco Azzurri dressait l'obélisque près de la gare (Via terme de Diocleziano) et le transformait en monument funéraire en l'honneur des morts de Dogali, en y gravant les noms des morts et en y ajoutant de petits édicules de cimetière du plus mauvais goût.
Ajouts aux 13 obélisques
Aux 13 obélisques il faut ajouter :
- La Stèle d'Axoum, monolithe de basalte de 24 m. de haut remontant au IVe siècle et apporté à Rome en 1937 après la conquête de la ville sainte éthiopienne. Après réalisation d'une copie, le monolithe est en cours de restitution par l'Italie à l'Ethiopie. La stèle se trouve place de Porta Capena au bout du Grand Cirque.
- Les colonnes :
- Les colonnes coclides (avec une frise en spirale tout autour du fût) : La Colonne Trajane, restaurée entre 1981 et 1987, se dresse dans le Forum de Trajan. Haute de 39,87 m. elle est composée de 25 blocs de marbre de 3,50 m. de diamètre et raconte les épisodes de la guerre des Daces (101-103 et 107-108) : environ 2500 figures d'un auteur inconnu. Au sommet, la statue de Saint Pierre remplace depuis 1587 celle de l'empereur. Sa hauteur témoigne de celle de la colline préexistante et rasée pour la construction du Forum de Trajan. La Colonne de Marc-Aurèle (42 m.) Place Colonna, érigée en 180-193 en marbre de Luni, à l'imitation de la Colonne Trajane, célèbre les victoires de l'empereur sur les Marcomans, les Quades et les Sarmates en 172-3 et 174-5. En 1588, Sixte V fit remplacer la statue perdue de l'empereur par une statue en bronze de Saint Paul. Une troisième colonne érigée en 161 en l'honneur d'Antonin-le-Pieux fut détruite pour réparer des obélisques ; il n'en reste que la base sculptée dans la Cour des Cuirasses dans les Musées du Vatican.
- Les colonnes honoraires : les bases de 7 d'entre elles, du début du IVe siècle, sont encore alignées le long de la Basilique Julienne au Forum romain, en face de la colonne de Phocas consacrée en 608 à l'empereur d'Orient Phocas qui avait donné le Panthéon à l'Église. Elle était autrefois surmontée d'une statue de l'empereur.
- Les papes reprennent la tradition à partir du XVIe siècle : Paul V fait transporter devant Sainte-Marie-Majeure l'unique colonne corinthienne restante de la basilique de Maxence qu'il dédie à la Vierge. La pratique des colonnes surmontées d'une croix se répand, surtout devant les églises franciscaines : Saint-François à Ripa, Saint-Pierre in Montorio, Saint-Sébastien, Saints Nérée et Achille, Saint-Pancrace, Saint-François de Paule). La colonne qui se trouve aujourd'hui dans une cour de Sainte-Marie-Majeure, avec son fût en forme de canon, fut érigée en 1595 pour célébrer l'abjuration d'Henri IV de France. La colonne de l'Immaculée Conception, en marbre cipolin antique, retrouvée au Champ de Mars en 1777, est installée place d'Espagne en 1856 par Luigi Poletti en souvenir du dogme proclamé en 1854 par Pie IX. Giuseppe Obici installe au sommet la statue de la Vierge et orne la base de statues des prophètes Moïse, Isaïe, Ezéchiel et David.
- Les deux imitations fascistes en marbre de Carrare : le monolithe dédié à Mussolini à l'entrée du Forum Italique (1932) et la stèle à Marconi au centre du quartier de l'EUR (1939-59), sans parler des obélisques-lampion de Via della Conciliazione qui imitent celui du Vatican...
- Les réalisations laïques post-unitaires : colonne de la brèche de Porta Pia célébrant la prise de Rome en 1870, celle de Villa Glori (1899) en souvenir du sacrifice des frères Cairoli tués ici en 1869, premier des monuments aux morts de ce type. En 1959 est dressé rue de Paris un fût de colonne antique pour célébrer le jumelage entre Paris et Rome.
- Les "statues parlantes" et les pasquinades : la tradition latine de la satire revit dans la Rome pontificale par la bouche des « statues parlantes » : statues sur lesquelles on affiche des pamphlets - contre le pape, le gouvernement ou les personnalités romaines en vue -, écrits en vers, en italien (parfois par de grands poètes comme Pietro Aretino ou Giovan Battista Marino), en dialecte « romanesco » ou en latin. Ces textes prirent le nom de « pasquinades », du nom de la plus célèbre de ces statues, Pasquino, un torse mutilé de presque 2000 ans, retrouvé dans la boue en 1501 et placé à l'entrée de la « via Papalis » (via del Governo Vecchio) par où passaient les cortèges religieux, de cardinaux, et où se construisaient les palais des nobles de la cour pontificale. Une autre statue était Marforio, autrefois devant la prison Mamertine, aujourd'hui dans la cour du Musée du Capitole, statue d'océan du 1er siècle. À l'angle du Palais de Venise se trouve Madama Lucrezia (peut-être de Lucrezia d'Alagno, maîtresse du roi de Naples Alphonse d'Aragon et amie du pape Paul II?), retrouvée dans le temple d'Isis et placée là en 1500. Il faut y ajouter l'Abate Luigi adossé au transept de Saint-André della Valle, statue en toge de l'époque impériale (à qui les Romains coupent régulièrement la tête, des années 30 jusqu'en 1985!), il Babuino, via del Babuino, le silène retrouvé en 1576 et inséré dans la fontaine construite en 1738 par les Boncompagni Ludovisi, et Facchino, autre fontaine sur le côté gauche du Palais De Carolis, Via del Corso, représentant un marchand d'eau avec son baril, remontant au temps de Grégoire XIII (1572-1585) et que la tradition populaire attribue à Michel-Ange ; on a voulu aussi y voir les traits de Martin Luther.
Les coupoles, écho architectural des collines
Dominique Fernandez avait ébauché dans son Promeneur amoureux une théorie des villes viriles et des villes féminines. Autant Florence nous apparaît comme une cité virile, avec ses rues droites et ses tours basses et ses palais trapus et ses bossages sévères, autant le gothique siennois, tout en élégance, en grâce et en fioritures, incarne les aspirations féminines à la coquetterie et la séduction. De ce point de vue, Rome est un couple parfait : si les obélisques dressés et les colonnes en représentent la dimension virile, les coupoles des églises en seront la dimension féminine. Et les coupoles vont souvent par deux comme pour évoquer la splendeur d'une poitrine, dont les deux seins enserrent un obélisque ou une colonne : la Colonne Trajane entre les deux coupoles de Sainte-Marie de Lorette et du Saint-Nom de Marie, l'obélisque Flaminio de Piazza del Popolo entre celles de Sainte-Marie de Montesanto et de Sainte-Marie des Miracles, les deux coupoles de Sainte-Marie-Majeure autour de la colonne corinthienne à l'avant et de l'obélisque de l'Esquilin à l'arrière .... Sensualité de Rome ! Mais les coupoles ne sont-elles pas l'écho construit des collines naturelles ? Et les collines à Rome sont ces mamelons que désignait le vieux mot latin « ruma » ... : Rome, ville de collines, ville de mamelons, ville de coupoles... ! Fellini est la plus pure représentation de cette obsession romaine du sein maternel !
Du haut de la terrasse de Saint-Sabine, de celle du Pincio ou de la place du Quirinal, on distingue mal le relief naturel des collines, mais les coupoles scandent le paysage romain : celle du Panthéon, la plus ancienne, la première application de la coupole de thermes à un édifice religieux ; en face, de l'autre côté du Tibre, la coupole de Saint-Pierre, la plus haute, celle qui, selon la loi, ne peut être dépassée en hauteur par aucun édifice de Rome, plus grande que son modèle florentin, celle que les Romains appellent "Il cupolone", la grande coupole. Il faut localiser les autres coupoles baroques : la coupole du Gesù, la coupole de Saint-Ignace, la coupole de Saint-André della Valle, près de la coupole en spirales sans tambour que construit Borromini pour Saint-Ivo della Sapienza, différente de la coupole ovale qu'il invente pour Saint-Carlino (Saint-Charles Quattro Fontane) ; et celle de Saint-Charles ai Catinari, et de Saint-Jean des Florentins, de San Carlo al Corso, la coupole du Bernin à Saint-André du Quirinal, la coupole des Saints-Luc et Martino conçue par Pierre de Cortone au-dessus du Forum ... et celles de beaucoup d'autres églises, sans oublier la coupole de la Synagogue au bord du Tibre, et celle de la Mosquée, près de Piazza del Popolo.
Voilà un jeu qui risque de vous prendre du temps : sur l'une des terrasses panoramiques de Rome, prenez votre plan de la ville et essayez de repérer le plus grand nombre de coupoles possible. À partir d'une dizaine, vous commencez à être un bon touriste romain.
Les places de Rome
Les places ont toujours été des lieux destinés aux réunions populaires, aux comices politiques, aux célébrations sacrées et profanes, aux rendez-vous des marchands, à la réception des hôtes illustres, et aussi aux révoltes et aux exécutions capitales.
La place romaine prend la suite du « forum » latin, mot qui signifiait à l'origine un espace libre, hors de la ville (« foras », « foris » = dehors, ou « foris » = la porte) où se trouvait le marché. La plupart des 18 forums romains portent le nom du produit que l'on y vendait : Forum Boarium (des bœufs), Forum Olitorium (des légumes), Forum Piscarium (des poissons), Forum Suarium (des porcs), Forum Pistorium (du pain, aujourd'hui Via dei Fornari = des boulangers), Forum Vinarium.
Puis le Forum devient la place publique, au cœur de la ville ; il symbolise la vie publique quotidienne, les affaires, surtout financières, la vie politique et l'art oratoire, les tribunaux (en italien, l'adjectif "forense" signifie encore : qui se rapporte au Palais de justice, au barreau ; "l'eloquenza forense", "la professione forense" = la profession d'avocat).
À partir de la fin de la République, les places deviennent des lieux théâtraux symbolisant le pouvoir politique et dont les temples et les édifices publics servaient de toile de fond. Plusieurs forums furent construits pour célébrer solennellement un événement important, celui de César pour fêter la bataille de Pharsale, celui d'Auguste (consacré à Mars Vengeur) pour commémorer la victoire sur Brutus et Cassius, assassins de César, à la bataille de Philippe.
Après la chute de Rome, la décadence de la ville et l'arrivée du christianisme, les églises viennent remplacer les temples en ruines, et les palais féodaux les anciens palais impériaux ; les places perdent leur rôle social et deviennent de simples appendices des églises. Les Forums s'enfouissent sous les décombres, le Forum romain devient un champ où paissent les vaches (« Campo vaccino »). C'est seulement après le retour des papes d'Avignon que la ville reprend vie, se repeuple (elle était passée de 1 million et demi d'habitants sous l'Empire à 20.000 au Moyen Âge) et se reconstruit. Sixte IV (1471-1484) élabore le premier plan d'urbanisme. La ville qui, sous l'empire romain, était tournée vers les rues conduisant en Orient, s'oriente maintenant vers le nord : la piazza del Popolo devient la principale porte de Rome.
Avec la Contre-Réforme et l'essor de l'art baroque, la place reprend un rôle essentiel : elle devient le cadre idéal de la scénographie romaine, et elle est à nouveau conçue comme un grand décor du théâtre urbain, qui inclut les façades d'églises et de palais, les fontaines, les obélisques et l'ensemble des monuments. Chaque place prend donc sa configuration particulière, sa couleur, son charme, sa signification en fonction des statues qui la peuplent, chacune a son type de marché populaire, ou son immobilité silencieuse, chacune a son atmosphère propre, qui change selon qu'on la voit à la lumière de l'aube ou au coucher du soleil. Chacune exprime un état d'âme de Rome.
L'ouvrage de Cesare Jannoni Sebastianini, Le piazze di Roma (Schwarz & Meyer Editori, Roma, 1986) décrit 88 places de Rome. Nous ne les verrons pas toutes, bien sûr, et on trouve des descriptions des plus importantes dans tous les Guides.
Les indications sont parfois sommaires sur l'histoire et la symbolique de chaque place. Ainsi, Piazza del Popolo n'est pas la place du "peuple", mais du "peuplier" (populus, pioppo), arbre qui entourait la place au Moyen Âge. Piazza S. Anastasia (à l'origine, dell'« Anastasi », de la Résurrection) était le lieu où s'assemblaient les gardiens de bœufs à la recherche de travail ; sur la Piazza Barberini, on célébrait les jeux consacrés à la déesse Flore ; la petite Piazza del Biscione devait son nom à un des hôtels qui l'entouraient, géré par un milanais (la couleuvre est l'emblème de Milan) ; la Piazza del Gesù, toujours battue par le vent, trouve une explication légendaire du phénomène : un jour, le Vent et le Diable, parcourant Rome, se retrouvèrent devant l'église ; le Diable dit au Vent qu'il avait une affaire importante à dépêcher et lui demanda de l'attendre, il entra dans l'église et n'en sortit jamais : depuis, le Vent attend le retour du Diable sur la place... Une autre légende se rapporte à Piazza in Campo Marzio : Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II, avait la réputation d'être sorcier. Il y aurait eu sur la place une statue qui tendait l'index droit, et sur le doigt était écrit « Percute hic » (frappe ici). Beaucoup avaient tenté de frapper le doigt sans succès. Gerbert un jour marqua le point où tombait l'ombre de l'index, puis revint de nuit avec un serviteur, ouvrit la terre en ce point par un enchantement, et vit le fabuleux trésor d'Octavien (jamais retrouvé). Il ne put cependant pas l'emporter parce que les statues d'or massif qui gardaient le trésor, agressaient ceux qui tentaient de s'approcher. Gerbert referma donc la terre, et le trésor resta là... Espérons que le miracle de la neige ne se renouvellera pas durant notre séjour : dans la nuit du 5 août 352, le pape Liberius et un patricien romain eurent en même temps la même vision de la Vierge qui les invitait à construire une église sur le lieu où ils trouveraient la neige intacte le lendemain matin. C'est aujourd'hui la place S. Maria Maggiore...
On pourrait raconter Rome à travers l'histoire de ses places.
Les fontaines de Rome
À chaque place sa fontaine, point d'aboutissement des anciens aqueducs romains détruits par les Barbares et reconstruits par les papes. C'est un autre élément symbolique essentiel de l'urbanisme romain. L'eau est le devenir, le temps qui passe. Dans la fontaine, l'eau ne court pas mais reste sur place, comme si le temps s'enroulait sur lui-même, s'immobilisait dans une sorte d'éternité. Et lorsque la fontaine est assortie d'un obélisque dressé vers le ciel, cette maîtrise du temps devient presque absolue, comme on le voit à la fontaine de la place du Quirinal ou à celle de la place Navone. C'est ce qu'ont voulu les papes qui ont conçu places et fontaines : l'Église est maîtresse du temps et dispensatrice d'éternité ; le pape détient les clés qui ouvrent le Royaume des Cieux, comme le rappelle l'inscription intérieure en lettres d'or de la coupole de Saint-Pierre ("... CLAVES REGNI ..."). D'où l'extraordinaire dérision de la mort omniprésente à Rome, dont l'expression extrême se trouve dans le cimetière des Capucins de S. Maria della Concezione, au pied de Via Vittorio Veneto : la décoration est réalisée avec les ossements de 4000 capucins qui forment des stucs de vertèbres, des autels de crânes ou de tibias, des lustres de côtes ... jusqu'à un squelette d'enfant qui orne le plafond d'une des six chapelles !
Cette éternité conquise se double de tous les éléments de la sensualité baroque, des Néréides et des Naïades nues de la place Navone et de la place de la République, jusqu'aux éphèbes nus de la Fontaine des Tortues, place Mattei, tout concourt à cet éveil des sens dont la séduction devait ramener le peuple à la « vraie » religion romaine battue en brèche par la Réforme luthérienne.
Les dauphins, - consacrés non seulement à Neptune mais aussi à Vénus -, s'ébattent dans les fontaines de la place Nicosia, de la place de la Rotonda, de la place Colonna, et même de la place S. Pierre, gages de Salut des naufragés ... et des pécheurs puisqu'ils symbolisent aussi le Christ Sauveur. Le Triton, fils de Neptune, se dresse dans les fontaines de la place Barberini et de la place Navone, avec le cheval (Fontaine des Quatre Fleuves) et le lion (fontaines de Piazza del Popolo, des Quatre Fleuves et de la place S. Pierre). Cela est l'occasion de parler du bestiaire.
Le bestiaire romain
Rome est habitée par les Romains mais aussi par une quantité incroyable d'animaux, ceux en chair et en os, comme les chats qui peuplent le Colisée ou le tour de la pyramide de Cestius, et ceux qui sont peints ou sculptés sur les monuments, dans les fontaines ou ceux qui figurent sur le blason des papes (les abeilles des Barberini, les colombes des Pamphilj, les dragons et les aigles des Borghese ou le lion avec des poires des Peretti, la famille de Sixte V) : une véritable arche de Noé comme celle que Raphaël peint dans la Loggia du Vatican. Une chatte égyptienne regarde du haut de la corniche d'un palais, une tête de cerf avec une croix entre les cornes domine le tympan d'une église, une truie est encastrée sur la façade d'une maison, une louve étrusque allaite deux jumeaux ... Ce bestiaire fantastique est un parcours de l'histoire romaine. Mais surtout, il raconte les histoires, les mythes, les symboles que chaque époque, chaque pape, chaque constructeur a considérés comme essentiels pour dire, pour faire la ville de Rome. On ne comprend pas Rome sans son bestiaire. Il faut chercher les petites bêtes ! Et on pourrait raconter Rome le long d'un itinéraire qui irait d'une bête à l'autre.
La louve
Un bestiaire de Rome ne peut que commencer par la louve, « mère des Romains ». L'histoire est connue, racontée par tous les historiens latins, des deux enfants, fils de Rhéa Silvia, petits-fils du bon Numitor, chassé du trône d'Albe par son méchant frère Amulius. Pour supprimer tous les descendants de Numitor, Amulius fait jeter au Tibre les enfants de Rhéa (et du dieu Mars...). Le panier dans lequel ils ont été déposés s'échoue au pied du Palatin (près de l'actuelle église de S. Anastasia), sous un figuier. Une louve, descendue au fleuve pour se désaltérer, les entend crier et, au lieu de les croquer, leur tend ses mamelles pleines de lait. Un berger voit la scène, et s'approche ; la louve se retire tranquillement dans un bois consacré au dieu Faunus et dans une grotte creusée dans le flanc de la colline, appelée ensuite « Lupercal ». Le berger étrusque Faustulus, qui connaissait l'histoire de Rhéa et des deux enfants, emmena les enfants chez lui et les confia à sa femme Acca Larentia. Mais Tite Live suggère que cette Acca était peut-être dite « la Louve » parce qu'elle se prostituait auprès des bergers, et « Lupa » signifiait aussi « prostituée » en latin, comme en italien dans le sud du pays jusqu'au XIXe siècle (cf la nouvelle de G. Verga).
La louve est représentée par « la Louve capitoline », statue traditionnellement considérée comme étrusque (attribuée à Vulca, grand sculpteur de Veies, du Ve s. av. J.-C., pour décorer le temple de Jupiter Capitolin), mais qui ne fut retrouvée (sans les deux jumeaux) qu'au Xe s. apr. J.-C.. Jusqu'en 1473, elle présida aux exécutions des condamnés à mort devant le Latran, puis elle fut donnée par Sixte IV aux Conservateurs du Capitole qui firent réaliser les enfants par A. Pollaiuolo, en 1471, et la firent transférer au Capitole. Depuis les restaurations de 1997, l'étude du bronze et de la technique de fusion permet d'affirmer que la louve aussi est de fabrication médiévale et non d'antiquité étrusque.
Au-delà des discussions sur l'origine exacte et l'histoire de la statue, les historiens s'accordent sur une chose : la louve est bien l'animal totémique de Rome, héritage du dieu-loup adoré par les Étrusques et les Sabins chez qui il était le symbole du dieu Mamers, équivalent du Mars latin. Un autre dieu-loup sabin était Soranus, en l'honneur de qui on célébrait des rites de purification par le feu dont les acteurs étaient revêtus de peaux de loups : le peuple, dit Varron, « februatur » (se purifiait) ; c'était en « février », le mois des purifications. Ces fêtes étaient aussi l'occasion de rites appelant la fécondité des femmes : les « Luperci » (ceux qui célébraient ce rite) découpaient des lanières de peau de bouc (« hircus » associé à « hirpus », le loup) et en frappaient le dos des femmes, assurant ainsi leur fécondité. On disait encore en français : « elle a vu le loup », d'une femme qui avait « connu » un homme (comme Rhéa Silvia avait « vu » Mars, dieu-loup !).
Mais un autre dieu est assimilé au loup, Apollon, le dieu du soleil. Apollon est dit aussi « Lycogenes », c'est-à-dire « engendré par un loup » : sa mère, Létho, aurait été transformée en louve par Jupiter ou aurait vu un loup pendant qu'elle était enceinte. En grec, « Lykos » (le loup) a la même racine que « Lyke » (la lumière). Le loup : dieu solaire, dieu fécondateur, dieu purificateur...
La reprise et la réélaboration par les Romains de mythes et de rites très anciens centrés sur le loup visaient donc à manifester l'origine divine de la ville, à l'enraciner dans un mythe fondateur divin : Rhéa descendait de Vénus par son ancêtre Enée, elle engendre Romulus et Remus, les fondateurs, avec le dieu Mars, dieu-loup, et c'est une louve qui sauve et nourrit les enfants, tout cela au pied de la colline (le mamelon, « Ruma ») du Palatin, site de la fondation de Rome, sous le figuier « Ruminal », c'est-à-dire sous l'arbre qui était le symbole universel de l'Arbre cosmique qui unit le ciel et la terre (cf l'arbre du Paradis terrestre dans la Genèse, celui dont Ève cueille le fruit et des feuilles duquel Adam et Ève recouvriront leur nudité) ; le figuier était aussi le symbole de Dionysos, autre image, avec Apollon, du dieu qui nourrit, informe et purifie le Cosmos. Si on ajoute que les jumeaux traversent les eaux, symbole du devenir, on peut dire que la fondation de Rome a en tous points la couleur d'une épiphanie, d'une manifestation divine : elle est née, la divine enfant...
Plus tard, l'empereur Constantin, voulant consacrer l'Empire au Christ, frappa une monnaie représentant une louve allaitant les jumeaux, au-dessus de laquelle trônait entre deux étoiles le monogramme du Sauveur. Depuis, les représentations de la louve sont innombrables chez les peintres et les sculpteurs, dont ce diptyque d'ivoire du Xe siècle, aujourd'hui au Vatican, représentant une louve romaine soutenant un Christ crucifié, après tout lui aussi fils d'une vierge fécondée par un dieu...
Alors qu'ailleurs la louve est volontiers un symbole négatif de lubricité (que rappelle Tite Live dans son explication de la louve - prostituée), Rome a retenu essentiellement le symbole positif de la louve divine nourricière. Tellement que, jusque vers les années 60 de notre siècle, une louve vivante était gardée dans une cage au bord de l'escalier qui monte au Capitole. Il existe une Via della Lupa.
Remarquez donc les louves... et tâchez de voir le loup pendant votre voyage !
L'éléphant
Autre animal romain symbolique, connu depuis la guerre contre Pyrrhus qui les avait introduits en Italie du sud en 280 av. J.-C. Les éléphants d'Hannibal ne furent donc pas une surprise pour les Romains en -218-201. L'ivoire était par ailleurs un matériau apprécié chez les Hébreux (le trône de Salomon), les Grecs et les Romains. Chez les premiers chrétiens grecs, on représentait la souveraineté divine du Christ par un trône d'ivoire et d'or portant l'Évangile et une colombe ou une croix de pierres précieuses avec les instruments de la Passion. Le blanc représentait la splendeur et la chasteté du Christ. Pline, décrivant la vie sexuelle des éléphants, disait déjà que l'éléphant était un modèle de pudeur et de pureté.
En 1514, le roi de Portugal offrit un petit éléphant au pape Léon X, qui le fit conduire triomphalement au Vatican et lui fit construire une grande étable. On l'appela Hannon, en souvenir du général d'Hannibal durant sa campagne d'Italie. L'éléphant était visité par le peuple de Rome et inspira de nombreux artistes. C'est un autre éléphant, introduit à Rome en 1630, qui inspira le Bernin pour sa composition de la Place de la Minerve. Voulu par le pape Alexandre VII et complété par l'obélisque, l'éléphant voulait signifier, outre la pudeur, l'intelligence et l'équilibre d'esprit sur lequel le chrétien peut faire germer la sagesse orientée vers le ciel. Ce qui n'empêcha pas le Bernin de donner à son petit éléphant une attitude très irrespectueuse pour les dominicains du couvent auquel il montre son derrière, indiqué par la trompe !
La truie, le porc et le sanglier
La truie, le porc et le sanglier sont liés aussi aux origines lointaines de Rome, et la ville en est parsemée. Quand Énée fut parvenu à l'embouchure du Tibre, il vit en rêve le dieu de la région, Tiberinus, qui lui annonça que le lieu où il fonderait la ville lui serait indiqué par une truie blanche couchée en train d'allaiter ses trente petits (Virgile, Énéide, Livre VIII) : la truie blanche représenterait Albe la Longue (Alba = blanc) et les trente peuples qu'elle engendrerait. Mais la truie évoque aussi un symbolisme plus profond : elle a dans la religion romaine les attributs de la Grande Mère, symbole de fécondité.
Quant au porc, il était déjà un élément important de la cuisine romaine. C'est seulement avec l'arrivée du christianisme que, sous l'influence du judaïsme qui le considérait comme impur, le porc prend une signification négative : animal sacré des Celtes, il est diabolisé par les chrétiens hostiles à la religion celte. Le petit cochon qui suit Saint Antoine Abbé, protecteur des fabricants de brosses, est cependant sans doute un écho d'anciens mythes populaires grecs ou celtes.
Cherchez à Rome les représentations des truies, porcs et sangliers !
Les oiseaux
Le coq, l'oie, le cygne, le pélican, le paon, la chouette, le faucon et la colombe sont les oiseaux les plus fréquemment présents dans l'iconographie et la sculpture romaine. Les oies avaient sauvé Rome de l'invasion gauloise en -390, et Pline appréciait leur foie énorme « qui continuait à grossir si on le plongeait dans le lait et le miel » ; il aimait aussi « les palmures d'oie passées à la poêle avec des crêtes de coq »... Le cygne était un symbole solaire ; il avait présidé à la naissance d'Apollon et c'est transformé en cygne que Jupiter séduit Léda pour donner naissance aux Dioscures et à Hélène et Clytemnestre. Le paon, symbole céleste consacré à Junon, représente le printemps et la résurrection. La chouette de Minerve est symbole de sagesse, puis représente le corps du Christ abandonné par ses disciples. Le faucon est emprunté par Auguste à la mythologie égyptienne où il représente le dieu solaire Horus, celui qui triomphe des forces du mal. La colombe était l'attribut de la Grande Mère de la fécondité et d'Aphrodite ; buvant l'eau d'un bassin, elle représente l'âme qui s'abreuve à la fontaine de Mnémosyne et conquiert l'immortalité ; elle est l'Esprit Saint et elle accompagne le Christ ; elle est la colombe de Noé qui rapporte le rameau d'olivier, et donc le Christ qui apporte le Salut. Ou, chez les Juifs, le symbole du peuple d'Israël.
Mais il faudrait ajouter l'aigle, le serpent, le dragon, le phénix, le poisson, le dauphin, la licorne, l'agneau, le cerf, le taureau, l'âne, le cheval, le lion, le chien, le chat, tous très présents dans le bestiaire romain... et dans le blason des familles romaines : le bouc dressé des Altemps, les abeilles des Barberini, le dragon des Boncompagni, l'aigle des Borghese, des Caetani, des Ludovisi, des Mattei, le bœuf des Borgia, le faucon des Falconieri, le grillon des Del Grillo, le lion des Massimo, des Odescalchi et des Sforza, l'anguille des Orsini, la colombe des Pamphilj, le hérisson des Ricci, la couleuvre des Visconti et le lynx de l'Académie des Lincei (académie romaine fondée en 1603, ... une sorte d'Académie française locale !). Sans oublier le singe, très présent à Rome, comme en témoigne l'existence au XIIe siècle d'un temple appelé Santo Stefano del Cacco (du macaque), d'une Tour du Singe et plus tard d'une « via del Babbuino » (du babouin).
Amusez-vous à découvrir ce grouillement de la faune romaine, dans les palais, les fontaines, les églises, les tableaux.
DEUXIÈME PARTIE
Rappels sommaires d'histoire et d'art
Note sur l'origine de Rome : Quand l'archéologie vient confirmer la vérité historique de la légende
Beaucoup de guides continuent à reprendre la vieille thèse selon laquelle le récit de fondation de Rome par Romulus en -753 ne serait qu'une légende. Ainsi Rome (Guides Voir, Hachette, 1995, p. 16), rappelant la présence ancienne des Étrusques et leur prise de pouvoir à Rome (premier roi étrusque en -616), ajoute : "Les vestiges laissés par ces derniers montrent que ce fut sous leur domination que Rome devint une véritable ville". Avant, il n'y aurait eu que des villages plus ou moins fédérés, mais pas une ville, mais pas une "fondation". Or les découvertes archéologiques d'Andrea Carandini à partir de 1985 sont venues confirmer qu'à une date située entre -750 et -725 un fossé avait bien été creusé autour du Palatin, une muraille avait bien été édifiée, une porte avait bien été ouverte (Porta Mugonia). Or, à quoi bon ouvrir une porte s'il n'y a pas de muraille ? Les historiens sont en mesure d'affirmer aujourd'hui qu'une ville a bien été "fondée" sur le Palatin vers le milieu du VIIIe siècle av. J.-C.
Recherchant les magasins et marchés impériaux et les maisons des consuls de la fin de la République, Carandini, les ayant trouvés, descend plus bas, découvre de grandes demeures à atrium des Tarquins (vers -530) ; il descend encore et trouve un fossé, des murs et une porte remontant au VIIIe siècle. Sous le seuil de la porte, il découvre dans une fosse un dépôt votif (comportant une coupe hémisphérique, une tasse à anse, un grelot en forme de poire, deux broches en bronze, un petit disque perforé en os) qui permet de confirmer la datation et de formuler l'hypothèse, confirmée pour d'autres lieux, d'un rituel de fondation peut-être accompagné d'un sacrifice d'une petite fille à la déesse primitive du Latium, Mater Larum, la Mère des dieux Lares, les rois mythiques du Latium. Ceux-ci étaient représentés par deux couples de frères, les jumeaux Picumnus (le pic, - l'oiseau qui assiste la louve, dans de nombreux récits -, et la hache) et Pilumnus (le « pilum », la lance), et les frères Faunus et Latinus, ancêtres de Romulus. Et deux sont par définition les ancêtres divinisés des Latins (les Lares), comme deux étaient les Dioscures (Castor et Pollux) dont le culte est attesté très tôt à Rome, comme deux seront Amulius et Numitor, ou Romulus et Remus.
Les résultats de ces découvertes ont été synthétisés dans l'ouvrage d'A. Carandini, La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà, Torino, 1997, et dans le catalogue de l'exposition Roma, Romolo, Remo e la fondazione della città qui s'est tenue à Rome de juin à octobre 2000 (Electa, 2000, 368 p.) et où tous ces matériaux ont été présentés au public. On peut lire en français l'ouvrage d'Alexandre Grandazzi, La fondation de Rome. Réflexions sur l'histoire, préfacé par Pierre Grimal, (Les Belles Lettres, 1991). Certes, les méthodes de l'histoire et celles de la mythologie diffèrent et il ne faut pas les confondre, mais il faut aussi reconnaître que sur ce point elles aboutissent à des résultats convergents : Rome a bien été fondée sur le Palatin vers le milieu du -VIIIe siècle.
D'autres fouilles confirment l'existence historique de réalités autrefois considérées comme de simples récits mythiques par les historiens positivistes : les cabanes du Palatin, dont la cabane royale, toujours reconstruite après les incendies ; toujours conservée intacte de toute autre construction ; les fouilles de la « Regia » (demeure royale) sur le Forum, qui confirment l'authenticité de la période royale primitive... La découverte récente (2007) d'une grotte se trouvant sous la maison d'Auguste au Palatin et décorée par les soins d'Auguste est un autre élément d'illustration de la force du mythe des origines de Rome.
D'autres mythes de fondation complètent l'histoire de Romulus et Remus : le récit de l'enlèvement des Sabines correspond à un rite nuptial primitif rappelant les pratiques des colons grecs, qui n'avaient d'autre possibilité que de se procurer, souvent par la violence, des femmes indigènes ; le rite se déroulait précisément dans la Valle Murcia (actuel Grand Cirque) au moment des fêtes rituelles en l'honneur du dieu des moissons Consus. Il rappelle aussi la tradition de la double origine ethnique de Rome : Latins et Sabins, déjà suggérée par le mythe des jumeaux.
Un autre mythe étiologique (analyse des origines) est celui d'Acca Larentia, à la fois femme de l'étrusque Faustulus et prostituée du temple d'Hercule sur le Forum Boarium, au pied du Palatin : la légende raconte qu'un prêtre d'Hercule (le premier héros grec à être passé à Rome), désoeuvré, aurait proposé au dieu un partie de dés, l'enjeu étant le don d'un repas et d'une prostituée. Ayant perdu, le prêtre enferme dans le temple, à la disposition d'Hercule, un bon repas et la plus belle des prostituées sacrées. Sortant du temple, Acca Larentia, selon la prédiction d'Hercule, rencontre un très riche marchand étrusque, un certain Tarutius, qui, frappé par sa beauté, l'épouse et lui laisse à sa mort des biens considérables qu'elle-même léguera en testament à la ville ; ce fut la première expansion territoriale de la Rome primitive, liée à l'activité marchande du Forum Boarium (présence très ancienne de marchands grecs et phéniciens, confirmée par les fouilles de S. Omobono, zone comprise dans le Forum Boarium). On rapproche ce mythe d'autres récits analogues d'union entre un dieu et une mortelle autour du temple étrusque de Pyrgi, en Toscane.
Depuis Tite Live et Denys d'Halicarnasse, depuis tous les historiens de Rome qui les ont précédés, on réfléchit sur le sens possible de ces mythes, de ces légendes. Un des derniers en date, Michel Serres, se livre à une recherche passionnante sur les histoires d'Hercule, d'Evandre, d'Enée, de Romulus, des Horaces et des Curiaces, sur la violence dans l'histoire (Rome, le livre des fondations, Grasset, 1983). Nous sommes à notre tour pris du « tremblement » dont parle M. Serres face à « ce nuage instable du temps », ce « flou » dans lequel naît l'histoire, se fonde une ville qui a conditionné notre propre histoire. Qui sait si ce voyage à Rome nous aidera à y voir plus clair ?
Commentaire du schéma ci-contre
A. Carandini a tenté de reconstituer les étapes de la fondation de Rome dans le schéma ci-contre :

- Romulus trace le sillon et déplace les mottes de terre vers l'intérieur ;
- Le tracé du sillon est renforcé par l'alignement de pierres terminales ;
- Le long des pierres est creusé le fossé de fondation du mur dans lequel les pierres sont ensuite poussées ;
- On remplit le fossé des matériaux de fondation et on commence à élever un mur en terre et en bois ;
- Le mur à créneaux et couvert de fragments de jarre s'adosse à une porte flanquée de bastions ayant à l'intérieur deux cabanes de garde / lieux de culte, au bord de la rue qui monte au Palatin. Un pont devant la porte permet de franchir le ruisseau et d'accéder à la Voie Sacrée au pied de la Velia, bordée d'une palissade en cours de construction (cf les descriptions de palissades et de créneaux dans Homère, Iliade, VII et XII).
Deux récits de la fondation de Rome
1) Tite-Live, Histoire romaine, préface et livre premier, Garnier, 1944, pp. 5 et 9-25.
« 7. On permet à l'antiquité... en mêlant le divin à l'humain, de rendre la naissance des villes plus auguste ; et s'il faut accorder à un peuple de sanctifier ses origines, et de les rapporter à des dieux comme à leurs créateurs, la gloire guerrière du peuple romain est assez grande pour que, quand à lui-même et à son fondateur il donne de préférence pour père Mars, les nations le souffrent aussi, sans plus d'humeur qu'elles souffrent son empire. 8. Toutefois, pour ces légendes et leurs semblables, de quelque façon qu'on les considère ou les juge, je n'y attacherai pas grande importance. 9. Mais je voudrais que chacun, de son côté, appliquât son attention à la vie, aux mœurs, aux hommes, aux moyens par lesquels, au dedans et au dehors, l'empire est né et a grandi ; ensuite, la discipline chancelant peu à peu, que chacun suivît par la pensée d'abord l'affaissement, pour ainsi dire, des mœurs, puis la façon dont elles chancellent de plus en plus et en viennent à une chute abrupte, jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque, où nous ne pouvons supporter ni nos maux, ni leurs remèdes.
1. - D'abord, on sait bien qu'après la prise de Troie, les ennemis s'acharnèrent sur tous les Troyens : envers deux seulement, Énée et Anténor, grâce aux droits d'une hospitalité ancienne, et parce qu'ils avaient toujours proposé de faire la paix et de rendre Hélène, les Achéens n'exercèrent pas les droits de la guerre. 2. Après diverses aventures, Anténor (accompagné de la foule des Énètes qui, chassés par une sédition de Paphlagonie, cherchaient à la fois une résidence et un chef, ayant perdu leur roi Pylaemène à Troie), vint au fond du golfe de l'Adriatique. 3. Chassant les Euganéens, qui habitaient entre la mer et les Alpes, Énètes et Troyens occupèrent ces terres. Le point où ils débarquèrent s'appelle Troie, d'où pour le district le nom de troyen. Leur nation entière s'appela « les Vénètes ». 4. Énée, par une défaite semblable exilé de sa demeure, mais destiné à une fondation plus grande où le menait le sort, alla d'abord en Macédoine, de là en Sicile, où, cherchant une résidence, il fut poussé ; de la Sicile, il dirigea sa flotte vers le territoire des Laurentins. 5. Ce lieu aussi porte le nom de Troie. Une fois débarqués, les Troyens, en gens auxquels, après leurs courses errantes et presque interminables, il ne restait que leurs armes et leurs vaisseaux, pillent la campagne. Le roi Latinus, et les Aborigènes, qui occupaient alors cette région, pour repousser les violences de ces étrangers, accourent, armés, de la ville et des champs. 6. À partir d'ici, on trouve deux traditions : pour les uns, Latinus, vaincu dans un combat, fit la paix avec Énée, puis s'allia à lui par un mariage ; 7. pour les autres, les armées étant en ligne, avant qu'on sonnât l'attaque, Latinus s'avança entre les deux fronts et invita le chef des étrangers à un entretien. Il lui demanda quelle sorte de mortels ils étaient, leur patrie, pour quel malheur ils l'avaient quittée, ce qu'ils cherchaient en débarquant au territoire des Laurentins. 8. Quand il apprit que cette multitude, c'étaient les Troyens ; leur chef, Énée, fils d'Anchise et de Vénus ; que, fuyant leur patrie incendiée, ils cherchaient une résidence et un endroit pour fonder une ville, admirant la noblesse de cette nation et de ce héros, et leur cœur prêt à la guerre comme à la paix, il tendit la main à Énée, gage loyal de leur amitié future. 9. Il s'ensuivit une alliance en règle entre les chefs, et, entre les armées, des marques d'amitié. Énée fut l'hôte de Latinus en son palais ; et là, devant ses dieux pénates, Latinus ajouta une alliance privée à l'alliance publique, en donnant à Énée sa fille en mariage. 10. Ce fait confirme pleinement les Troyens dans l'espoir de voir enfin un établissement stable et sûr terminer leurs courses. 11. Ils fondent une place forte. Énée, du nom de sa femme, l'appelle Lavinium. Bientôt un rejeton mâle naquit de ce nouveau mariage ; ses parents le nommèrent Ascagne.
II. - Une guerre survint ensuite, commune aux Aborigènes et aux Troyens. Turnus, roi des Rutules, à qui Lavinia avait été promise avant l'arrivée d'Énée, irrité qu'on lui eût préféré un étranger, contre Énée et Latinus à la fois avait engagé la lutte. 2. Aucune des deux armées ne sortit heureuse de ce combat : les Rutules furent vaincus ; les Aborigènes et les Troyens, vainqueurs, perdirent leur chef Latinus. 3. Sur ce, Turnus et les Rutules, doutant de leur force, ont recours au pouvoir florissant des Étrusques, et à Mezentius, leur roi, qui, maître de Caeré, place en ces temps opulente, dès le début avait été mécontent de la naissance d'une ville nouvelle, et alors, jugeant excessive pour la sûreté des voisins la croissance de l'État troyen, associa d'un cœur léger ses armes à celles des Rutules. 4. Énée, devant la crainte d'une telle guerre, pour se gagner le cœur des Aborigènes et mettre non seulement sous la même loi, mais sous le même nom toutes ces troupes, appela « latins » les deux nations. 5. Dès lors, les Aborigènes ne le cédèrent pas aux Troyens en dévouement et en loyauté envers leur roi Énée. Fort de ces sentiments qui se développaient chaque jour chez les deux peuples, Énée, quoique l'Étrurie eût assez de puissance pour avoir rempli déjà non seulement les terres, mais la mer, sur toute la longueur de l'Italie, de la gloire de son nom, quoiqu'il pût, des remparts, repousser l'attaque, fit sortir son armée en bataille. 6. Ce combat fut favorable aux Latins, mais aussi, pour Énée, le dernier de ses travaux mortels. Il gît, de quelque nom que le droit humain et divin permette de l'appeler, sur la rive du Numicus ; on l'appelle Jupiter Indigète.
III. Ascagne, fils d'Énée, n'avait pas encore l'âge d'exercer le pouvoir. Pourtant ce pouvoir, jusqu'à sa majorité, lui fut conservé sans dommage : la tutelle d'une femme - tant Lavinia avait de caractère - maintint, pour cet enfant, l'État latin, et le royaume de son aïeul et de son père. 2. Je ne discuterai pas - quel homme, sur un fait si ancien, donnerait pour certains ses dires ? - s'il s'agit là de l'Ascagne dont j'ai parlé, ou d'un autre, plus âgé, né de Créuse, avant la chute d'Ilion, donc compagnon de fuite de son père, et que, le nommant Jules, la gens Julia déclare l'auteur de son nom. 3. Ascagne, donc, quels que soient son lieu de naissance et sa mère, - son père étant sûrement Énée -, trouvant Lavinium surpeuplée, laissa cette ville, florissante pour l'époque et opulente, à sa mère, ou à sa belle-mère, et fonda lui-même, au pied du mont albain, une ville nouvelle, à laquelle sa situation de ville étendue sur une crête donna le nom d'Albe la Longue. 4. Entre la fondation de Lavinium et le départ de la colonie d'Albe la Longue, il s'écoula environ trente ans. Pendant ce temps, les forces de l'État avaient tellement augmenté, surtout par la défaite des Étrusques, que même à la mort d'Énée, ou, ensuite, pendant la tutelle d'une femme et l'apprentissage d'un roi-enfant, ni Mezentius et les Étrusques, ni aucun autre voisin n'osa bouger. 5. En faisant la paix, on avait convenu qu'entre les Étrusques et les Latins l'Albula, nommé aujourd'hui Tibre, serait la frontière. 6. Ensuite règne Silvius, fils d'Ascagne, né par hasard dans une forêt. 7. Il engendre Énée Silvius, et celui-ci Latinus Silvius, qui envoya fonder quelques colonies, dites des « Vieux Latins ». 8. « Silvius » resta, par la suite, comme surnom, à tous les rois d'Albe. De Latinus naquit Alba, d'Alba Atys, d'Atys Capys, de Capys Capetus, de Capetus Tiberinus, qui, s'étant noyé en traversant l'Albula, donna à ce fleuve son nom, si célèbre depuis. 9. Puis Agrippa, fils de Tiberinus, après Agrippa Romulus Silvius, avec le pouvoir reçu de leur père, furent rois. À Aventin Romulus, frappé lui-même de la foudre, laissa le royaume en mains. A Aventin, enterré sur la colline qui aujourd'hui fait partie de Rome, lui donna son nom. 10. Ensuite règne Proca. Celui-ci engendre Numitor et Amulius. À Numitor, aîné de la famille, il lègue l'antique royaume de la gens Silvia. Mais la violence fut plus forte que la volonté d'un père ou le respect de l'âge. 11. Chassant son frère, Amulius règne. À ce crime il ajoute un autre crime : il détruit la descendance mâle de son frère, et la fille de ce frère, Rea Silvia, sous prétexte de l'honorer, il la choisit comme vestale, vouée à une virginité perpétuelle, et lui ôte tout espoir de maternité.
IV. - 1. Mais il appartenait, je pense, aux destins, de faire naître une telle ville, et commencer l'empire le plus grand qui soit après le pouvoir des dieux. 2. Violentée, la vestale, ayant eu deux jumeaux, déclare (soit qu'elle le crût, soit parce que, comme agent de sa faute, un dieu était plus honorable) que Mars est le père de cette descendance douteuse. 3. Mais ni dieux ni hommes ne la préservent elle-même, ou sa descendance, de la cruauté du roi : la prêtresse, enchaînée, est mise sous bonne garde ; les enfants, Amulius ordonne de les jeter au cours de l'eau. 4. Par un coup divin du sort, le Tibre, débordé en nappes tranquilles, tout en ne permettant nulle part d'arriver à son lit ordinaire, laissait à ceux qui y portèrent les enfants l'espoir que ces eaux, si calmes qu'elles fussent, les submergeraient. 5. Aussi, pensant s'acquitter de l'ordre du roi, au point le plus proche où ils trouvent les eaux débordées, là où est maintenant le figuier Ruminal - appelé, dit-on, Romulaire - ils exposent les enfants. 6. Ces lieux étaient alors de vastes solitudes. La tradition s'est conservée que, le berceau flottant où étaient exposés les enfants ayant été laissé à sec par l'eau peu profonde, une louve altérée, venue des montagnes environnantes, se détourna aux cris des bébés et abaissa vers eux ses mamelles, avec tant de douceur qu'elle les léchait quand les découvrit un maître du troupeau royal, nommé, dit-on, Faustulus. 7. Il les porta aux étables et les donna à élever à sa femme Larentia. Il y a des gens pour penser que Larentia, une prostituée, était appelée « la louve » par les bergers, ce qui donna lieu à la fable miraculeuse. 8. Ainsi nés, ainsi élevés, les deux enfants, dès qu'ils furent grands, au lieu de rester oisifs dans les étables ou près des troupeaux, pour chasser courent les bois. 9. S'étant ainsi fortifié corps et âme, bientôt ce n'est plus seulement les fauves qu'ils affrontent : les brigands chargés de butin, ils les attaquent, répartissent leurs prises entre les bergers, et partagent avec ceux-ci, leur troupe de jeunes gens grossissant chaque jour, occupations et jeux.
V. - 1. Dès lors, sur le mont Palatin, notre fête des Lupercales avait lieu, dit-on ; et c'est Pallantée, ville d'Arcadie, qui fit nommer le mont Pallantium, puis Palatium. 2. Là Evandre, issu de cette race arcadienne, et, longtemps avant, maître de ces lieux, avait institué cette fête solennelle apportée d'Arcadie : des jeunes gens nus couraient, par jeu et libres ébats, en l'honneur de Pan du Lycée, que les Romains appelèrent ensuite Inuus. 3. Tandis qu'ils s'adonnaient à cette fête, dont la date solennelle était connue, des brigands qui s'étaient embusqués, dans leur colère d'avoir perdu leur butin, trouvent chez Romulus une résistance vigoureuse, mais saisissent Rémus, livrent ce prisonnier au roi Amulius, et, prenant les devants, l'accusent. 4. Ils lui imputaient surtout des incursions sur les terres de Numitor, où, disaient-ils, son frère et lui, ayant réuni une poignée de jeunes gens, enlevaient du butin. Ainsi on livre Rémus à Numitor pour le faire supplicier. 5. Dès le début, Faustulus avait eu l'espoir que c'étaient des rejetons royaux qu'on élevait chez lui : il savait l'abandon des enfants sur l'ordre du roi, et le moment où il avait recueilli ceux-ci coïncidait avec cet abandon. Mais, l'affaire n'étant pas mûre, sauf pour une occasion favorable ou par nécessité, il ne voulait pas la révéler. 6. La nécessité vint la première : la crainte l'y forçant, il révèle la chose à Romulus. Par hasard, Numitor lui-même, pendant qu'il tenait Rémus sous sa garde, ayant appris qu'il avait un frère jumeau, en rapprochant et leur âge, et leur caractère même, si éloigné de la servilité, eut le cœur touché du souvenir de ses petits-fils ; et, par son enquête, il arriva presque, lui aussi, à reconnaître Rémus. 7. Aussi de tous côtés on trame un complot contre le roi. Romulus, non avec sa troupe de jeunes gens (pour une lutte ouverte, ses forces n'étaient pas égales), mais en ordonnant aux bergers de venir, par des chemins différents, à l'heure fixée, au palais royal, attaque le roi ; tirant de la maison de Numitor une autre troupe, Rémus l'aide ; ils décapitent le roi.
VI. - 1. Numitor, au premier trouble, dit à tous que l'ennemi a envahi la ville, attaqué le palais royal. Ayant ainsi envoyé la jeunesse d'Albe occuper la citadelle et la défendre de ses armes, quand il voit les jeunes conjurés, leur meurtre accompli, s'avancer vers lui en se félicitant, il convoque aussitôt l'assemblée, et lui dévoile les crimes de son frère envers lui, l'origine de ses petits-fils, leur naissance, leur éducation, la façon dont on les a reconnus, enfin le meurtre du tyran, dont il est l'auteur. 2. Les jeunes gens, passant avec leur colonne au milieu de la réunion publique, saluent leur aïeul comme roi ; toute la foule approuve d'une voix, et confirme à ce roi son titre et ses pouvoirs. 3. L'état albain remis ainsi à Numitor, Romulus et Rémus sont pris du désir, à l'endroit où ils avaient été exposés et élevés, de fonder une ville. Il y avait surnombre d'Albains et de Latins ; des bergers s'y étaient ajoutés ; tout cela permettait facilement d'espérer qu'Albe serait petite, et Lavinium petit, en regard de la ville qu'on fonderait. 4. À la traversée de ces pensées vient alors un mal héréditaire, l'envie de régner. De là une lutte honteuse, qui commença de façon assez bénigne. Romulus et Rémus étant jumeaux, et la considération de l'âge ne pouvant décider entre eux, pour que les dieux tutélaires du pays indiquent par leurs augures qui donnerait son nom à la ville nouvelle, qui, après sa fondation, la gouvernerait, ils prennent comme observatoire Romulus, le Palatin, Rémus, l'Aventin, afin de consulter les augures.
VII. - 1. Le premier, Rémus vit, dit-on, venir un augure, six vautours ; il l'avait déjà annoncé ; mais un nombre double de vautours se présentant à Romulus, l'un et l'autre furent proclamés roi par leurs partisans ; 2. les uns pour l'antériorité de l'augure, les autres pour le nombre des oiseaux, ils tiraient le trône à eux. Une querelle les met donc aux prises, et le heurt de leurs colères tourne au meurtre : là, dans la foule, frappé, Rémus tomba. Une tradition plus répandue dit que, pour se moquer de son frère, Rémus sauta les murs nouveaux ; alors Romulus irrité, menaçant dans ses paroles mêmes, en ajoutant : « Autant désormais pour quiconque franchira mes remparts ! » le tua. 3. Ainsi, seul, Romulus s'empara de l'empire ; la ville fondée prit le nom de son fondateur. Ce fut d'abord le Palatin, où il avait été élevé, qu'il fortifia. Il fait les cérémonies aux dieux suivant le rite albain ; suivant le rite grec, toutefois, pour Hercule, comme Évandre l'avait établi. 4. Hercule, ayant tué Géryon, amena, dit-on, à cet endroit, des bœufs d'un aspect magnifique. Près du Tibre, à l'endroit où il avait en poussant devant lui son troupeau, traversé le fleuve à la nage, il s'arrêta dans un pré, pour que le repos et l'herbe abondante refissent ses bœufs ; et, fatigué de la marche, il se coucha lui-même. 5. Les vivres et le vin l'ayant alourdi, le sommeil le terrassa. Un berger de l'endroit, nommé Cacus, fier de sa force, séduit par la beauté des bœufs, voulut détourner cette proie. Mais s'il poussait le troupeau dans sa caverne, ses traces suffiraient, lors des recherches du maître, à l'y conduire : Cacus y tira donc, à reculons, tous les bœufs les plus beaux par la queue. 6. Hercule, éveillé à la prime aurore, parcourut des yeux son troupeau et s'aperçut qu'une partie manquait. Il alla vers la caverne toute proche voir si, par hasard, les traces y menaient. Quand il les vit toutes dirigées vers l'extérieur, sans mener nulle part, troublé et ne sachant que penser, il commença à éloigner son troupeau de cet endroit dangereux. 7. Mais certaines vaches qu'il emmenait ayant, comme il arrive, mugi au regret de leurs compagnes abandonnées, celles-ci, enfermées, répondirent de la caverne. Leur voix fit retourner Hercule. Comme il marchait vers la caverne, Cacus essaya de l'en empêcher par la force ; mais, frappé de la massue, en invoquant vainement l'assistance des bergers, il tomba mort. 8. À cette époque, Évandre, un Péloponésien réfugié là, gouvernait ces régions, par son ascendant plus que par son pouvoir : vénérable par sa connaissance des merveilles de l'écriture, chose nouvelle pour ces peuples encore sans art, il était plus vénérable encore par la croyance à la divinité de sa mère Carmenta, que comme prophétesse, avant l'arrivée en Italie de la Sibylle, ces nations avaient admirée. 9. Évandre donc, alors attiré par cette affluence de bergers s'agitant autour d'un étranger manifestement coupable d'un meurtre, après avoir appris son acte et les causes de son acte, considérant l'allure et la beauté de ce héros, sensiblement plus majestueuses et plus augustes que celles d'un homme, lui demanda qui il était. 10. Quand il connut son nom, son père et sa patrie : « Fils de Jupiter, Hercule, salut, dit-il, Ma mère, fidèle interprète des dieux, m'a prédit que de toi s'accroîtrait le nombre des êtres célestes, et qu'ici te serait consacré un autel que la nation qui sera un jour la plus puissante de la terre appellera « très grand » et honorera selon ton rite ». 11. Hercule, lui tendant la main, dit qu'il accepte l'augure et qu'il va accomplir le destin en fondant et en consacrant l'autel. 12. C'est là qu'alors, pour la première fois, avec une vache mugissante prise à son troupeau, on sacrifie à Hercule, en employant pour ce ministère et pour le banquet religieux les Potitius et les Pinarius, familles alors les plus illustres de cette contrée. 13. Il arriva par hasard que les Potitius furent là à temps et qu'on leur servit les entrailles, tandis que les Pinarius ne vinrent qu'une fois les entrailles consommées, pour le reste du banquet. D'où, dans la famille des Pinarius, cet usage, qui dura autant qu'elle, de ne pas manger les entrailles des victimes. 14. Les Potitius, instruits par Évandre, furent les chefs de ce culte pendant bien des générations, jusqu'à ce qu'ayant abandonné à des esclaves publics ce ministère solennel de leur famille, la race entière des Potitius périt. 15. Voilà le culte que Romulus accepta seul, entre tous les cultes étrangers : dès lors, cette immortalité due au courage, à laquelle le conduisait son destin, avait ses faveurs ».
2) Denys d’Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livres I et II, Les origines de Rome, Les Belles Lettres, 1990, pp. 33-34
« IX. De cette cité, maîtresse de l'ensemble de la terre et de la mer, qui est aujourd'hui habitée par les Romains, on dit que les plus anciens occupants, parmi ceux dont on a gardé le souvenir, furent des Barbares Sikèles, une nation indigène. Mais si avant eux, cette région était occupée par d'autres peuples ou bien déserte, nul ne peut le dire avec certitude. Plus tard elle tomba aux mains des Aborigènes qui, au terme d'une longue guerre, l'enlevèrent à ses occupants. Les Aborigènes habitaient auparavant dans les montagnes, dans des villages non fortifiés et dispersés ; mais quand les Pélasges et quelques autres Grecs qui s'étaient joints à eux les aidèrent dans leur guerre contre leurs voisins, ils chassèrent les Sikèles de cette région, s'emparèrent de nombreuses cités et entreprirent de soumettre à leur autorité l'ensemble du territoire compris entre deux fleuves, le Liris et le Tibre. Ils prennent leur source au pied de la chaîne des Apennins, qui coupe l'Italie en deux sur toute sa longueur et, distants à leur embouchure de quelque huit cents stades, ils se jettent dans la mer Tyrrhénienne, le Tibre débouchant au nord près d'Ostie et le Liris arrosant au sud Minturnes ; ces cités sont l'une et l'autre des colonies romaines. Ils continuèrent à habiter au même endroit, sans en être jamais plus chassés par d'autres, et en changeant deux fois de nom bien que demeurant identiques à eux-mêmes : jusqu'à la guerre de Troie, ils conservèrent leur ancienne appellation d'Aborigènes, mais sous le roi Latinus, dont le règne fut contemporain de la guerre de Troie, ils commencèrent à être appelés Latins. Et quand Romulus fonda la cité qui porte son nom, seize générations après la guerre de Troie, changeant leur dénomination pour celle qu'ils ont aujourd'hui, d'un peuple minuscule et obscur ils se préparèrent à faire avec le temps le peuple le plus grand et le plus brillant, en accueillant avec humanité tous ceux qui leur demandaient asile, en accordant le droit de cité à tous les vaincus qui s'étaient vaillamment battus, et en permettant à tous les esclaves qu'ils avaient affranchis de jouir des mêmes droits civils que les citoyens, en ne dédaignant aucun homme, quelle que fût sa condition, pourvu qu'il pût être utile à la communauté, mais plus que tout encore grâce à leur bonne organisation politique, qu'ils instituèrent à la suite de multiples expériences, en tirant avantage de chaque circonstance. »
Denys raconte la suite de l’histoire de la fondation de Rome dans les chapitres LV - LXXXIX de son livre, pp. 83-124. Lisez Tite-Live et Denys d’Halicarnasse, vous y trouverez grand plaisir.
LA ROME ANTIQUE
Sur la Rome antique, vous trouverez facilement des documents en grand nombre. Vous pouvez consulter en particulier pour en avoir une idée précise et des images les ouvrages de :
- Gilles CHAILLET et Jacques MARTIN, Rome I et Rome II, Collection « Les voyages d’Alix », Casterman.
- Gilles CHAILLET, Dans la Rome des Césars, Glénat, 2004.
- Filippo COARELLI, Guide archéologique de Rome, Hachette, 1994.
- Nathalie de CHAISEMARTIN, Rome. Paysage urbain et idéologie. Des Scipions à Hadrien (IIe s. av. J.C. – IIe s. ap. J.C.), Armand Colin, 2003.
Et consultez le vieux Guide Romain Antique de G. Hacquard, J. Dautry et O. Maisani, Hachette, 1952, le manuel le plus clair et complet de tous les aspects de la civilisation romaine.
Nous rappelons simplement quelques dates :
A) Avant Rome : des villages épars sur les collines depuis plusieurs siècles
B) Fondation de Rome sur le Palatin : 21 avril 753 av. J.C. : la « Roma quadrata » ; fusion entre Latins et Sabins.
C) La monarchie : 7 rois (comme il y avait 7 collines ? ...), de – 753 à – 509 :
- Romulus
- 3 rois sabins-latins :
- Numa Pompilius, inspiré, dit-il par la nymphe Égérie (Temple de Vesta)
- Tullius Hostilius, conquête d’Albe (les Horaces et les Curiaces)
- Ancus Martius, élargit Rome (Janicule, Ostie), ses enfants sont confiés à un Corinthien d’Étrurie, Tarquin.
- 3 rois étrusques :
- Tarquin l’Ancien prend le pouvoir sur les héritiers d’Ancus, profitant du chaos qui règne dans le Latium après la destruction d’Albe.
- Servius Tullius, organise et défend Rome (Constitution et muraille), assassiné par son gendre qui prend le pouvoir.
- Tarquin le Superbe, violent, combat les Latins extérieurs à la ville ; viole la femme d’un de ses parents, Lucrèce, qui se suicide ; son mari soulève le peuple romain qui chasse le roi étrusque et proclame la République en 509.
D) La République (de – 509 à – 44) :
Elle est gouvernée par le peuple réuni en COMICES (pouvoir en partie législatif, en partie judiciaire et religieux), par les MAGISTRATS (pouvoir exécutif, 2 préteurs, puis consuls + un préteur urbain + les tribuns de la plèbe à partir de – 493, assistés de 2 édiles + les censeurs et les questeurs. Ils sont tous renouvelés à échéance régulière) nommés par les Comices, et par le SÉNAT qui représente l’aristocratie, et qui est l’autorité permanente de la République, consultée en toute matière, législative, religieuse, militaire et de salut public, de politique extérieure. Les Sénateurs sont 300 jusqu’à Sylla, puis augmentent jusqu’à 1000 sous les Triumvirs. S.P.Q.R. = Senatus PopulusQue Romanus.
- Une petite république aristocratique dominée par les patriciens, affaiblie par des conflits internes entre patriciens et plébéiens : en – 494, sécession de la plèbe qui se retire sur l’Aventin pour y fonder une autre ville. Ménénius Agrippa règle le problème en – 493 (l’apologue des Membres et de l’Estomac) en créant des tribuns de la plèbe ; en – 451, la Loi des XII tables établit l’égalité civile des patriciens et des plébéiens ; un plébéien obtient le consulat en – 336.
- Elle conquiert peu à peu l’Italie entre – 509 et – 272 : domination sur les Étrusques entre – 507 (lutte contre Porsenna, exploits d’Horatius Coclès, Mucius Scaevola, Clélie) et –395 (Camille prend Véies), sur les Volsques en –486 (Coriolan), les Èques en – 458 (Cincinnatus), les Samnites de – 343 à – 304, enfin le Sud (Tarente est prise et Pyrrhus vaincu en – 272).
- Elle étend ses possessions hors d’Italie entre –272 et – 47 : lutte contre Carthage (de – 264 à – 146, destruction de Carthage, après quelques défaites romaines, celle du lac Trasimène en – 217 et celle de Cannes (dans les Pouilles) en – 216, mais heureusement pour Rome, Hannibal va attendre des renforts à Capoue plutôt que de marcher sur Rome) ; conquête de la Sicile en – 241, de la Gaule Cisalpine en – 219, de l’Espagne en – 210, de la Grèce et de la Macédoine en – 146 (après la victoire des Thermopyles en – 191), Jérusalem en – 63. César achève la conquête de la Gaule en – 51 (reddition de Vercingétorix en – 52), il triomphe en Égypte en – 47, il vainc les armées de Pompée en Tunisie et en Espagne.
- La conquête de la Grèce a fait pénétrer la culture grecque à Rome et l’art se développe à partir de – 100, ajoutant l’influence grecque à celle des Étrusques, dominante jusqu’alors.
- Elle connaît de grandes luttes de classes internes, conséquences des conquêtes impérialistes ; les chevaliers s’enrichissent tandis que les paysans, ruinés abandonnent la terre et viennent s’entasser à Rome ; les Gracques tentent d’apporter une solution avec une réforme agraire en faveur des pauvres, mais les Sénateurs les font assassiner, Tibérius en – 133 et Caius en – 121 ; la nation est ravagée par cent ans de guerres civiles, pour la possession du consulat (Marius et Sylla, puis Pompée et Crassus) ; les esclaves se révoltent (Spartacus en – 73). Le triumvirat Pompée – Crassus – César éclate, et César franchit le Rubicon avec ses armées en – 49, devient consul puis est nommé dictateur et roi d’Orient, mais le parti pompéien, dont Brutus et Cassius sont les chefs, le fait assassiner aux Ides de Mars, le 15 mars – 44. Le partage entre les triumvirs, Octave, Antoine et Lépide va marquer les derniers jours de la République : Antoine avait épousé la sœur d’Octave, Octavie ; possesseur de l’Orient, il part en Égypte, répudie Octavie et devient l’amant de Cléopâtre. Antoine et Cléopâtre sont vaincus à la bataille navale d’Actium le 1er août – 31 et se suicident. Lépide ayant été éliminé, Octave reste seul maître de Rome et se fait donner le 16 janvier – 27 le titre d’ « Augustus » dont il se pare comme d’un nouveau nom : l’Empire romain a commencé, sans modification apparente de structures.


E) L’Empire romain (27 av. J.C. – 192 après J.C.) :
Les pouvoirs républicains sont concentrés entre les mains d’un seul homme et les organes d’administration ne relèvent que de lui seul. Les Comices perdent leur pouvoir législatif puis disparaissent, le Sénat comprend 600 membres choisis par l’Empereur. Il a tous les pouvoirs, politiques, militaires, financiers et religieux (il est « Grand Pontife »). Il est l’objet d’un culte religieux, et sera considéré comme divinisé après sa mort.
Une formule mnémotechnique pour se souvenir des « Douze Césars », les empereurs du Ier siècle de la dynastie julio-claudienne:Cesauticaclauné galbovivestidoCÉS(ar) AU(guste) TI(bère) CA(ligula) CLAU(de) NÉ(ron)GALB(a) O(thon) VI(tellius) VES(pasien) TI(tus) DO(mitien)Ajoutez au IIe siècle la dynastie des Antonins: Netrhadanmauco NE(rva) TR(ajan) HAD(rien) AN(tonin) M(arc)-AU(rèle) CO(mmode)

F) Le Bas-Empire et le déclin (192-476)
L'Empire s'est encore étendu au Moyen-Orient, en Afrique et vers le Nord de l'Europe, à travers des guerres incessantes. Le nombre de citoyens s'est donc multiplié et à partir de 212 sera déclaré citoyen tout homme libre qui habite l'Empire, ce qui permet de percevoir l'impôt de 1/20 sur toutes les successions. Les citoyens représentent donc des ethnies, des cultures, des religions différentes ; la structure sociale s'est complexifiée : elle comprend toujours les citoyens, parmi lesquels aux hommes libres se sont ajoutés les « colons » (serfs des gros propriétaires, attachés à la terre, mais théoriquement libres), et les non-citoyens, esclaves et affranchis (ces derniers pouvant être cependant très riches). La hiérarchie des citoyens se durcit : au sommet la famille impériale, puis l'ordre sénatorial, puis l'ordre équestre, puis les « humiliores », les gens pauvres.
Les empereurs sont choisis par leurs soldats, prétoriens ou légionnaires :
- Pertinax, Didius Julianus, aussitôt assassinés,
- L'Africain Septime-Sévère (193-211), victorieux des Parthes,
- Ses fils, Géta (assassiné par son frère) et Caracalla (212-217),
- Macrin (217-218) assassiné,
- Élagabal (218-222) assassiné,
- Alexandre Sévère (222-235) assassiné.
Suit une période de 35 ans d'anarchie où les « Barbares » commencent à menacer les frontières. Aurélien (270-275) restaure la situation, construit une nouvelle enceinte de Rome, mais périt aussi assassiné. Tacite (275), Probus et Carus (276-283), les fils de Carus, Numérien et Carin (282-284) assassinés sont remplacés par l'Illyrien Dioclétien (284-305) qui institue une « tétrarchie » hiérarchisée avec Maximien, Galère et Constance-Chlore. En 306, le fils de Constance-Chlore, Constantin (306-337) gouverne avec Maxence, fils de Maximien, et Licinius. Maxence est vaincu en 312 et Constantin reste seul maître de l'Occident, puis il bat Licinius en 324 et devient maître de tout l'Empire.
En 313, il proclame l'édit de Milan, décrétant la liberté de tous les cultes, dont le christianisme auquel il donne sa préférence (il se fait baptiser sur son lit de mort, dit-on) ; en 325, il convoque le concile de Nicée qui adopte le Credo, Symbole des Apôtres et condamne l'arianisme ; en 330, il transfère la capitale de l'Empire de Rome à Constantinople. C'est la fin de l'Empire, progressivement envahi par les Barbares, partagé entre Orient et Occident, l'Empire d'Occident étant supprimé par Odoacre en 476. C'est maintenant l'évêque de Rome, le pape, qui devient le « Pontifex Maximus ».

Note sur les catacombes
Les catacombes forment autour de Rome un réseau évalué à 900 kilomètres, dont certains secteurs seulement sont explorés. La catacombe est un cimetière souterrain, en usage aux premiers siècles de l'ère chrétienne et situé dans la banlieue de Rome. L'expression « ad catacumbas » (au ravin) désigne anciennement un simple lieu-dit, le site de Saint Sébastien, sur la voie Appienne. Une nécropole s'y logeait dans un petit ravin ou « combe ». Seul connu au Moyen Âge, ce cimetière donna son nom à tous les autres, lors de leur découverte, à partir de la fin du XVIe siècle.
La législation romaine interdisant d'enterrer à l'intérieur de la Cité, les catacombes, sépulcres païens, se sont placées au bord des grandes routes. Le tuf de la campagne, facile à creuser, mais assez sec et résistant, favorisait ce mode de sépulture.
La catacombe se compose théoriquement des éléments suivants :
- Des couloirs en escaliers d'accès dont plusieurs remontent à l'antiquité ;
- Un ou plusieurs hypogées, chambres creusées à flanc de coteau ou construites primitivement en plein air pour contenir les sarcophages ou les urnes funéraires de riches familles païennes ultérieurement converties ;
- Des galeries ouvertes à partir ou dans le voisinage de ces hypogées, ramifiées de manière à constituer le cimetière lui-même ;
- De petites chambres ou « cubicula », ouvertes sur ces galeries et contenant comme elles des corps, mais dans une disposition plus ordonnée (aisance supérieure, souci de culte ...).
Le cimetière chrétien a débuté par l'utilisation d'une sépulture païenne dont les propriétaires se sont convertis. Dans la plupart des cimetières, on a pu identifier l'hypogée qui a joué ce rôle de cellule-mère. (Cf : à Domitille, vestibule des Flaviens). Ce réseau des couloirs s'est développé en partant de ces hypogées. Les besoins augmentant, on a cherché à approfondir le caveau d'un sous-sol ou d'une seconde pièce, à faire tenir dans ses parois le plus grand nombre possible de « loculi » (alvéoles). On a alors amorcé, à proximité immédiate, le réseau horizontal des galeries creusées d'abord à hauteur d'homme, puis accrues en hauteur par déblaiement du pied. Ce qui explique que, parmi des loculi étagés aujourd'hui sur 5 ou 6 mètres de haut, les plus anciens sont ceux des parties supérieures. Puis on a construit des étages superposés de couloirs.
C'est seulement à partir du IIIe siècle que l'église acquiert des domaines et équipe systématiquement des cimetières (Pape Callisto, 212-222).
Les catacombes ont donc servi essentiellement à enterrer les morts ; la mortalité de l’époque, notamment en ce qui concerne les enfants (dont les tombes sont très nombreuses dans les catacombes) justifie l’étendue des nécropoles qui ont servi pendant plus de 300 ans. Elles n’ont pas pu servir à cacher l’Église durant les persécutions (d’ailleurs inégales et discontinues : 202, 250, 257 ; 295, 303) ; les catacombes n’étaient nullement clandestines : un cadastre du sous-sol devait être fourni à l’autorité romaine ; elles n’ont pas été non plus le lieu du culte (exiguïté des locaux, caractère irrespirable de l’air, impossibilité d’allumer des torches). C’est aux « titres » ou « maisons d’église » qu’il faut chercher les premiers lieux de culte, dans des maisons amies en plein centre de Rome, qui constituaient les meilleures cachettes, encore visibles sous certaines basiliques romaines que l’on construit après 313.
L'art des catacombes : objets mineurs, sculptures (sarcophages), peintures :
- Reprise des motifs décoratifs romains : rubans, guirlandes, petits amours, corbeilles de fleurs ;
- Éléments traditionnels romains repris avec une signification symbolique différente : « véritable catéchisme en images » (le poisson = anagramme du Christ ; le paon = immortalité de l’âme ; l’ancre = l’espérance, etc.).
Les chrétiens se livrent ainsi à une subversion des signes connus de tous, auxquels ils donnent une signification symbolique autre. Il s’agit d’un art essentiellement symbolique, mais resté simple, accessible à tous les fidèles et nullement réservé à des initiés.





4) MOYEN-AGE : UNE PÉRIODE ESSENTIELLE DE L’HISTOIRE DE ROME (312-1420)
Après avoir été pendant plus de dix siècles la capitale d’un Empire universel, Rome devient peu à peu celle d’une Église universelle pendant encore plus de dix siècles. Certains historiens prolongent même ce Moyen-Âge jusqu’en 1527, date du sac de Rome par les armées de Charles Quint, comme Ferdinand Gregorovius, Histoire de Rome au Moyen-Âge (1854-1871) ou, plus récemment l’italien Ludovico Gatto, Storia di Roma nel medioevo (1999). C’est donc une longue période, souvent négligée dans les guides, source de très nombreuses créations culturelles encore fondamentales dans le visage actuel de Rome et auxquelles il faut consacrer du temps. C’est dire aussi que la « Renaissance » sera brève à Rome : elle ne commence vraiment qu’après le retour définitif des papes d’Avignon, en 1420, vers le milieu du XVe siècle (1453 = prise de Constantinople par les Turcs = fin de l’Empire d’Orient), et surtout avec les papes Della Rovere, de Savone (Sixte IV et Jules II) et Médicis (Léon X et Clément VII), d’origine florentine. Après 1527, on entre dans l’âge « baroque ».
L’importance de Constantin dans l’installation du christianisme comme religion officielle
Paul Veyne a fait récemment une belle mise au point sur le début du Moyen-Âge, dans son livre Quand notre monde est devenu chrétien (312-394), Albin Michel, Idées, 2007, 320 p. : « Un des événements décisifs de l’histoire occidentale et même mondiale s’est produit en 312 dans l’immense Empire romain. Ce IVe siècle de notre ère avait mal commencé pour l’Église chrétienne : de 303 à 311, elle avait essuyé une des deux pires persécutions de son histoire, qui avait fait des milliers de morts (...). Or l’année suivante, en 312, le plus imprévisible des événements éclata : un autre des co-empereurs, Constantin, le héros de cette grande histoire, se convertit au christianisme à la suite d’un rêve (« tu vaincras sous ce signe »). À cette époque, on pense que cinq ou dix pour cent à peine de la population de l’Empire (soixante-dix millions d’habitants peut-être) étaient chrétiens. ‘Il ne faut pas oublier’, écrit J. B. Bury, ‘que la révolution religieuse faite par Constantin en 312 a peut-être été l’acte le plus audacieux qu’ait jamais commis un autocrate, en défiant et en méprisant ce que pensait la grande majorité de ses sujets’ » (pp. 9-10).
L’Église chrétienne non seulement cesse d’être persécutée, mais elle devient la religion de presque tous les empereurs suivants ; devenue officielle, elle obtient peu à peu que l’ancienne religion romaine, le « paganisme », ne soit que tolérée, puis pratiquement interdite : au VIe siècle, l’Empire n’est presque peuplé que de chrétiens. Constantin considère que le paganisme n’est qu’une « superstition désavantageuse » face au christianisme qui est la « très sainte Loi divine ». C’est parce qu’il a été soutenu par Constantin et par ses successeurs que le christianisme a ainsi triomphé : la « supériorité » du christianisme était plus sensible aux avant-gardes sociales, culturelles et littéraires qu’à la masse analphabète de la population romaine attachée à sa religion traditionnelle. Les chrétiens, qui n’étaient qu’une « secte orientale » parmi d’autres (comme le culte de Mithra, très populaire. Avant 312, Constantin lui-même pratiqua la religion du « Soleil invincible ». Cf. le temple de Mithra de San Clemente), n’aurait pas triomphé sans ce soutien des empereurs, qui permettent la constitution d’une Église, - organisation nouvelle par rapport au paganisme -, dont une hiérarchie pourvue d’autorité contrôle la totalité de l’existence de ses fidèles, croyance, spiritualité, morale, métaphysique, vie quotidienne, sexualité, rites, dogmes, et peut sanctionner les déviations, imposant peu à peu son fonctionnement à l’ensemble de la population, punissant les « hérésies », etc. (« Hors de l’Église pas de salut »).
Et lorsque, en 330, Constantin déplacera à Byzance la capitale de l’Empire, Rome va se réorganiser comme capitale de l’Église chrétienne dont les évêques et le clergé deviendront les chefs à la fois religieux et politiques, faisant peu à peu triompher une intolérance, une hostilité aux non-chrétiens, hérétiques et juifs en particulier, qui n’était pas le fait de Constantin. L’histoire du Moyen-Âge à Rome est celle du progressif triomphe de cette Église sur l’ensemble de la société. Ce ne fut pas sans peine.
Une période d’équilibre entre paganisme et christianisme
Les premières constructions chrétiennes sont faites par Constantin lui-même :
- La première basilique de Saint Jean de Latran, qui contraste avec les lieux de culte antérieurs, plus discrets et pauvres. Elle est monumentale : 98 mètres par 56 et très richement ornée.
- Des basiliques extérieures aux murs sont agrandies : San Sebastiano sur la via Appia, San Lorenzo sur la Tiburtina, Santa Costanza sur la via Nomentana (près de la tombe de Sainte Agnès).
- La première basilique de Saint-Pierre (319-329), sur la tombe de Saint Pierre et une partie du cirque de Néron.
- La basilique de Saint-Paul sur la via Ostiense, et Santa Croce in Gerusalemme, édifiée en 329 après le retour de Palestine de Sainte Hélène, la mère de Constantin, avec le bois de la Croix du Christ « inventé » sur les lieux de la Passion.
Constantin fait construire d’autres monuments : l’arc de triomphe près du Colisée, l’arc à quatre faces du Vélabre, les thermes du Quirinal, le temple de Vénus génitrice dans le Forum de César ; achèvement de la basilique de Maxence sur le Forum ; restauration du temple de Cybèle au Vatican et de la muraille d’Aurélien. Mais, bien qu’il soit fier de Rome, Constantin transfère la capitale de l’Empire à Constantinople en 330 : c’est la fin d’un certain type d’État romain et le début de l’Empire byzantin.
Jusqu’au Ve siècle, Rome reste cependant une grande ville subventionnée par l’empereur, elle continue à comporter : 2 Capitoles, 2 hippodromes, 2 marchés, 3 théâtres, 2 amphithéâtres, 4 gymnases pour gladiateurs, 5 naumachies (spectacles sur l’eau), 15 nymphées, 11 grands établissements thermaux, 1352 bassins d’eau et fontaines, 36 arcs de triomphe, 6 obélisques, 423 temples, 28 bibliothèques, 11 forums, 10 grandes basiliques, 1797 « domus » (palais privés patriciens), 46.606 « insulae » (immeubles pour familles modestes), 16 portes, 28 voies militaires, sur un pourtour de 28 milles romains, soit 40 kms. La distribution de l’eau, essentielle pour la consommation, la fraîcheur et la lutte contre les incendies, est assurée par 19 aqueducs.
L’administration religieuse se développe rapidement à côté et parfois en concurrence avec l’administration civile romaine. Les « titres » (lieux de culte) se multiplient, souvent à partir de maisons privées (Cf les édifices romains souterrains existants à Saint-Clément, aux Saints Jean et Paul, à Sainte Cécile au Trastevere). On commence à transformer des édifices païens en églises : en 609, le Panthéon devient l’église de Sainte Marie des Martyrs, Santa Pudenziana est construite sur des thermes, Saint-Étienne Rotondo sur un édifice militaire : Saint-André du Quirinal, Saint-Sébastien, Saint-Théodore sont construits sur des temples païens, Santa Sabina naît d’un édifice privé (425-432), Santa Maria in Cosmedin des bâtiments de l’Annone, etc. ; on utilise de plus en plus de colonnes, chapiteaux, tuiles ou autres éléments de temples pour la construction et l’ornement des églises (calices, candélabres, marbres). Bien qu’on continue à entretenir les anciens monuments, cela donnera bientôt à Rome un visage nouveau centré sur la pratique de la religion chrétienne. De plus en plus, surtout à partir de la chute de l’Empire d’Occident en 476, c’est du pape que dépendent la vie et le salut de Rome.
Sur un autre plan, Constantin intervient dans l’Église pour imposer une orthodoxie contre les « hérésies », par exemple il condamne Arius et sa théorie de l’inégalité dans la Trinité entre le Père et le Fils pour faire approuver la doctrine d’Athanase condensée dans le Credo encore valable, adopté en 325 (« Figlioque procedit »). En 382, l’empereur Gratien supprime de nombreuses indemnités aux prêtres païens et aux vestales : la querelle entre chrétiens et païens a aussi ses aspects économiques !
Le christianisme va devoir s’affirmer dans une série de conflits :
- Avec les hérésies parfois soutenues par quelques empereurs, l’arianisme (affirmation qu’il n’y a pas égalité entre le Père et le Fils qui n’est qu’une créature), le nestorianisme (la Vierge a été mère d’un homme, pas d’un Dieu. Contre cette affirmation sera construite la première basilique consacrée à la Vierge, Santa Maria Maggiore), le manichéisme (combattu par Léon I en 440), les cultes solaires...
- Contre les abus d’intervention des empereurs dans la vie interne de l’Église. L’Église luttera entre autres contre les empereurs byzantins qui veulent continuer à contrôler Rome, à l’encontre du pape. Le pape Gélase I (492-496) affirmera le primat du pape contre les représentants de Byzance installés à Ravenne.
- Avec le Sénat (dont les pouvoirs se limiteront à la seule ville de Rome) et les pouvoirs civils de Rome encore tenus en main par des païens (le paganisme se maintient jusqu’en 392, date de l’édit de Théodose qui élimine les restes des religions autres que le christianisme) ; au début des années 60 du IVe siècle, Julien l’Apostat tente un retour au paganisme qui garde quelques grands intellectuels comme Symmaque, Aurelius Avianus, Quintus Aurelius et Fabius Memmius.
- Mais aussi de conflits internes à l’Église, luttes pour le pouvoir entre des évêques, parfois violents et sanglants : le pontificat de Rome est un nouveau pouvoir important, source de richesse et de célébrité, et, comme dans tout pouvoir, on se bat pour le conquérir ! Contre ces pratiques de pouvoir, quelques ecclésiastiques, comme le pape Léon I (440-461), développent les activités caritatives, l’aide aux communautés pauvres, les restaurations et constructions d’églises (Santa Maria Maggiore, 420-440).
- Un autre sujet de conflit est l’affirmation de Rome comme centre de la chrétienté par rapport aux églises africaines et moyen orientales.
La dégradation de Rome par les invasions barbares
La transformation de Rome est accélérée à partir du Ve siècle par les invasions « barbares » (« barbare » vient du grec et désignait tous ceux qui n’étaient pas grecs, et qui bredouillaient le grec, « bar-bar-bar », et non ceux qui avaient une barbe) qui n’hésitent pas à faire le siège de la ville, pillent et détruisent les monuments romains : sièges d’Alaric, roi des Goths en 410, de Genséric, roi des Vandales en 455, qui dépouille la ville de beaucoup d’objets précieux mais endommage peu les édifices. En 476, Odoacre, roi d’une tribu germanique, les Érules, dépose Romulus Augustule, le dernier empereur d’Occident, et règne sur l’Italie par délégation de Zénon, l’empereur d’Orient.
La dégradation sera aggravée par la guerre gréco-gothique. Le roi des Ostrogoths, Théodoric (454-526), avait été élevé à la cour de Byzance et y avait reçu une éducation classique ; mais, comme il devenait menaçant pour Constantinople, l’empereur l’envoya combattre Odoacre qu’il vainquit et assassina en 493 ; il devient roi d’Italie avec Ravenne comme capitale et Patricien d’Orient. En 493, il vient passer 6 mois à Rome, qu’il admire, s’installe au Palatin, aide à la restauration de la ville, et redonne de l’importance au Sénat. Mais il est arien (disciple d’Arius) et veut contrôler l’Église de Rome ; cela va bientôt le brouiller avec le pape et avec le Sénat : à la mort du pape Athanase II en 498, il soutient comme successeur Symmaque (qui était diacre et arien, et partisan du rapprochement entre Romains et Ostrogoths contre Byzance), alors que le Sénat soutient Laurent, partisan des philo-byzantins. Le conflit dure 7 ans et finira par la victoire de Symmaque, pape jusqu’en 514. Les partisans romains de Théodoric, de grands intellectuels comme Albi, Boèce et Cassiodore, partisans d’un rapprochement entre Rome et les « barbares », l’emportent, mais sont eux aussi éliminés par Théodoric qui ne les trouve pas assez antibyzantins. Surtout, le nouvel empereur Justin I est farouchement antiarien, et fait condamner les ariens, c’est-à-dire presque tous les « barbares » d’Europe et d’Afrique. Boèce et Jean I échouent dans leur mission pour convaincre l’empereur d’être plus tolérant. À leur retour de Constantinople, Théodoric fait assassiner Boèce en 426, de même que le pape Jean I, tandis que Cassiodore est éloigné de Rome.
Cela tendit les rapports entre Ostrogoths et Romains ; la guerre éclate entre les descendants de Théodoric et le général de l’empereur Justinien, Bélisaire qui conquiert Rome en 536, avec une armée composite, qui comprend une dizaine de races. Les armées des Goths assiègent Rome pendant un an en 536 ; elles détruisent les aqueducs dont un seul sera ensuite réparé par Bélisaire. Vaincues, elles se réorganisent sous l’autorité de Totila, et refont en 544 le siège de Rome qui est conquise par trahison et pillée gravement, tandis que beaucoup de Romains s’enfuient : Rome passe de 200.000 à 100.000 habitants. Un troisième siège aura lieu en 550, et l’occupation des Goths ne s’achèvera qu’en 553 par leur défaite définitive.
Rome est donc détruite, matériellement et psychologiquement par ces années de guerre entre les Byzantins et les Goths ; c’est là que commence vraiment le processus de crise qui achèvera le passage de la Rome païenne à la Rome chrétienne.










Rome entre les Byzantins et les Lombards. L’appel à l’intervention carolingienne
Les Romains ne s’entendent pas mieux avec les Byzantins, dont l’empereur a signé l’Édit des Trois Chapitres favorable aux monophysites (affirmation que le Christ a une seule nature et n’est pas à la fois homme et dieu). En 554, la Pragmatique Sanction tente de régler les rapports entre Byzance et l’Italie : le représentant de l’empereur en Italie, l’exarque de Ravenne, a les pouvoirs civils et militaires ; aux évêques la charge des édifices publics, la protection des faibles, la reprise économique (travaux publics, annone, justice), administrative ... et religieuse. Cela augmente considérablement le pouvoir civil du pape. Les anciens privilèges sont rendus au Sénat et à l’évêque de Rome, moyennant des taxes coûteuses, que l’empereur devra diminuer, les Romains étant trop pauvres pour les payer. Et par là, Rome perd aussi l’autonomie administrative qu’elle avait conservée. C’est la période où se développe l’art de style byzantin dans Rome occupée par le général Narsès et par une importante colonie grecque. Beaucoup d’églises seront restaurées ou reconstruites dans ce style au cours du VIe siècle ; parallèlement, le clergé augmente. Le pape fait passer de 14 à 7 le nombre des « regiones » de la ville. C’est aussi l’époque où apparaît une nouvelle menace, celle des Lombards (Longobardi), peuple venu de la Scandinavie et de l’embouchure de l’Elbe. Ils descendent vers l’Italie en 568 et installent leur capitale à Pavie. La capitulation des Byzantins ôte tout prestige à l’Etat, et dans chaque ville menacée, c’est vers l’évêque que se retourne la population pour sa sauvegarde et la défense du droit. À Rome c’est Grégoire I le Grand, devenu pape en 590, qui assure la survie de la ville contre les Lombards et contre la peste qui s’est déclarée. Outre le développement de la vie religieuse (processions, etc.), il accroît les propriétés foncières de l’Église pour alimenter la ville en blé, vin et huile (l’empire a cessé d’assurer l’alimentation romaine, l’assistance sociale de l’Église augmente aux pauvres, malades, estropiés, esclaves : le pape finance le rachat des esclaves baptisés). D’autre part, il traite avec les Lombards pour qu’ils n’attaquent pas Rome, et il augmente son indépendance vis-à-vis de Byzance. À la mort de Grégoire I, en 604, l’Église s’est développée, mieux et plus largement organisée, considérablement enrichie ; elle a pris une place centrale dans l’administration de Rome ; les Lombards se sont convertis de l’arianisme au catholicisme et se sont romanisés, intégrés à la culture d’origine latine et à la langue, alors que le grec ne reste que dans le vocabulaire savant, médecine, chimie, astronomie, philosophie, jurisprudence. D’autres conflits à la fois politiques et religieux opposeront pendant le VIIe siècle l’Église de Rome aux empereurs byzantins. En 663, l’empereur Constance II enlève de Rome tous les bronzes qu’il a fait arracher aux monuments, même au toit du Panthéon pourtant devenu église chrétienne ; dans la seconde moitié du VIIe siècle, Rome est réduit par l’empereur à être capitale d’un « duché » dont le chef est nommé par l’exarque de Ravenne. Un quartier grec se développe autour de S. Maria in Cosmedin. Le conflit iconoclaste, sur le culte des images, approfondit encore la division entre Rome et Constantinople qui considère les images comme une idolâtrie. Le pape déclare les iconoclastes comme hérétiques et s’appuie sur les Lombards de Liutprand, qui en profitent pour envahir le territoire romain en 728. Pris entre les Lombards et les Byzantins, le pape se retourne alors vers les Francs de Charles Martel, puis de Pépin le Bref, manifestant ainsi son autonomie politique. En 751, les Lombards s’emparent de Ravenne, puis marchent sur Rome et la pillent. Finalement le roi lombard Didier est battu par Charlemagne qui sera couronné empereur à Rome le 25 décembre 800 par le pape Léon III. C’est la fin d’une époque, on entre dans un autre rapport entre l’Église et l’Etat impérial : le principe est posé de la dualité du pouvoir, spirituel (le pape) et temporel (l’empereur) ; pendant ces conflits, profitant de la diversité des alliances, le pape a réussi à renforcer son pouvoir, à agrandir son territoire et à devenir, outre le maître de Rome, un point de référence pour toute l’Europe. Le « don » par Pépin le Bref des anciens territoires de l’exarque de Ravenne au pape est à l’origine des Etats temporels du pape.
De la Renaissance carolingienne à l’apparition de la Commune (1143)
Un autre péril se profile bientôt, les invasions arabes. Les Sarrasins, vaincus à Poitiers en 732, profitent de la chute de l’empire d’Occident et de l’affaiblissement de l’empire byzantin pour faire des excursions en Italie à partir de l’Afrique du Nord qu’ils ont conquise, ils occupent la Sicile et rentrent dans une partie de Rome en 846, ce qui pousse le pape Léon IV à renforcer les murailles d’Aurélien, englobant désormais Saint Pierre et ses quartiers environnants (847-853), ainsi que la basilique de St Paul Hors les Murs. Pour cette défense contre les Sarrasins, les papes du IXe siècle sont aussi amenés à développer une armée proprement romaine dont ils sont les chefs.
Le problème de l’Église de cette époque est que, en même temps, elle a besoin de soutiens politiques et financiers, et qu’elle doit se battre pour conserver son indépendance religieuse : elle passe donc des compromis permanents avec le Saint Empire germanique (lui-même convoité par des puissances contradictoires), les Francs, les Lombards, les Byzantins, et les diverses grandes familles romaines qui se combattent pour conquérir le pouvoir pontifical, en particulier les Colonna et les Orsini. Cela détermine aussi l’urbanisme de Rome : les papes essaient à la fois de restaurer la ville pour offrir une sécurité aux habitants et aux pèlerins et de lui redonner une splendeur qui marque la puissance du pape et de l’institution et qui rappelle la grandeur de la Rome de l’époque de Constantin. Charlemagne est pensé comme héritier de Constantin et protecteur de l’Église, tandis que le pape est l’héritier de Pierre et l’origine de tout pouvoir. On assiste à une renaissance de l’empire et à une affirmation de l’Église, qui multiplie les constructions religieuses dont St Pierre est le sommet et le modèle.
Il faut souligner que Rome devient un lieu de pèlerinage de plus en plus fréquenté par les étrangers venus du Nord, d’Allemagne, des pays anglo-saxons, des territoires francs ou d’Afrique et du Moyen-Orient. Rome était un des trois grands lieux de pèlerinage, avec Jérusalem (les lieux où vécut le Christ) et St Jacques de Compostelle (réputé « matamore », vainqueur de Maures, protecteur de la lutte contre les Arabes). Les papes développèrent les pèlerinages à Rome autour des tombes de Pierre et de Paul et de celles de très nombreux martyrs ; de plus, avait été instituée une liste de péchés très graves que seul le pape pouvait remettre, inceste, homicide, viol, sacrilège, parricide, simonie, assassinat d’un clerc, une liste toujours plus longue ... ; l’institution du Jubilé en 1300, avec l’obtention d’une indulgence plénière pour les pèlerins, fit de la ville le plus grand centre de pèlerinage, la nouvelle Jérusalem. Or cela était la source de revenus importants, argent, dons, legs qui contribuèrent au développement de la richesse et de la puissance de l’Église romaine.
Après l’extinction de la dynastie carolingienne, Rome entre dans une période de crise : les grandes familles romaines se disputent pour conquérir le pouvoir pontifical et se battent pour l’élection des papes, dont aucun ne sera canonisé d’Adrien en 885 à Léon IX en 1054, tant ils sont corrompus, de moeurs légères et scandaleuses. Parmi ces familles, s’imposeront particulièrement les Théophylactes (de 900 à la mort d’Albéric en 954), les Crescenzi (985-1014) et les comtes de Tusculum (papes Benoît VIII, 1012-1024, Jean XIX, 1024-1032, Benoît IX, 1032-1045, alliés des empereurs). Les empereurs germaniques en profitent pour tenter de rétablir l’autorité impériale sur Rome et l’Italie et ils placent leurs amis sur le trône pontifical (Grégoire V et Sylvestre II) ; les Allemands occupent le quartier qui entoure le Vatican, le « Burg » (en italien le « Borgo ») et se construisent des forteresses dans toute la ville et ses alentours. Rome devient un mélange complexe de quelques sites anciens encore magnifiques et demeures riches reconstruites dans les décombres des monuments anciens, et une masse de décombres d’où émergent des colonnes, statues, arcs, portiques qui font l’admiration de beaucoup de visiteurs. Les collines ont été abandonnées et l’habitat se concentre dans la plaine du Champ de Mars, le seul lieu où arrive encore de l’eau.
Mais en 1059, une réforme confia l’élection pontificale, jusqu’alors dépendante des grandes familles romaines et de l’empereur, aux seuls cardinaux réunis en Conclave et dont la décision devra être acclamée par le peuple romain. Cela suscita la fureur de l’empereur Henri IV qui commença par faire élire un antipape, Honorius II (1061-1072) qui s’opposa au pape Alexandre II (1061-1072) ; il est excommunié en 1076 ; puis en 1081, pour se venger de l’humiliation qu’il a subie de Grégoire VII et de la comtesse Mathilde de Toscane à Canossa, il descendit en Italie et assiégea Rome. En 1084, le pape Grégoire VII (1073-1085) appela à son secours le roi normand Robert Guiscard qui le délivra mais saccagea et incendia la ville qu’il laissa dans le chaos. La Rome ancienne est maintenant détruite de façon irréversible, y-compris une partie de St Pierre et de St Paul, les murailles « léonines » et beaucoup d’églises. La ville reste aux mains de l’antipape Clément III (1084-1100) imposé par l’empereur, tandis que les papes élus ne peuvent y entrer que dans les quartiers où résident leurs alliés. Le pape Urbain II (1088-1099) parvient cependant à convoquer à Rome un Concile qui appellera à la première croisade, en 1099. Pourtant, malgré cette débâcle, Rome reste la « ville éternelle », l’unique héritière à la fois de l’antiquité impériale et des saints Pierre et Paul, et les pèlerinages ne cesseront pas.
La période communale (1143-1305). La querelle avec les empereurs.
Dans ce contexte troublé, la population romaine est de plus en plus amenée à s’organiser elle-même pour se défendre ; elle l’a déjà fait contre les Byzantins et contre les Germains. Ainsi apparaissent des « scholae » d’artisans ; le peuple intervient toujours plus dans la vie romaine : par exemple, il défend par des émeutes efficaces le pape Grégoire VII. Las des querelles entre les familles aristocratiques – les Pierleoni contre les Frangipani, les Corsi ou les Orsini contre les Colonna, les Cenci, Papareschi, Crescenzi, etc. –, et des jeux d’alliance des papes et des antipapes avec les Normands, les empereurs ou les Francs, etc., le peuple ressuscite l’ancien Sénat (56 membres, plus tard réduits à un seul élu pour six mois), s’empare du Capitole et donne naissance, longtemps après d’autres villes italiennes, à une Commune romaine laïque indépendante, en 1143. Les monnaies communales reprennent les inscriptions « S.P.Q.R. » (Senatus populusque Romanus) et « Roma caput mundi ». À côté du Vatican, le lieu saint de la tombe de St Pierre, et du Latran, centre de l’administration pontificale et résidence du pape, un troisième lieu se manifeste définitivement à Rome, le Capitole comme siège du pouvoir communal, expression d’une composante laïque toujours présente dans la ville.
La période communale est traversée à ses débuts par la prédication d’un réformateur religieux, Arnaldo da Brescia. Disciple d’Abélard à Paris, il est éloigné après la disgrâce de celui-ci et il arrive en 1145 dans la ville de Rome, en plein conflit entre le pape Eugène III (1145-1153) et les empereurs Conrad III et Frédéric Barberousse auxquels la commune s’adresse pour en obtenir un renforcement de sa fonction laïque. Arnaldo prêche violemment contre la richesse et la mondanité du clergé, pour la réforme des moeurs ecclésiastiques, pour le développement du clergé féminin tenu dans la soumission du clergé masculin, mais aussi pour la construction de logements pour les pauvres et pour la restauration d’une ville en ruines, dont il souhaite le retour à une république vertueuse. Cela inquiète la hiérarchie catholique, et le pape Adrien IV (1154-1159), d’autant plus que Arnaldo tente de prendre contact en 1152 avec Frédéric Barberousse qui vient d’être nommé empereur, mais celui-ci le fait arrêter et livrer au préfet de Rome qui le fait pendre, brûler et disperser ses cendres dans le Tibre pour que son corps échappe à la vénération populaire. L’empereur était en train de descendre à Rome pour se faire couronner par le pape et avait préféré ne pas se compromettre avec Arnaldo, classé parmi les « hérétiques » de l’époque.
En ce XIIe siècle, la ville commence à renaître, on en a le témoignage à travers les documents qui attestent la présence de nombreuses corporations d’artisans, dans une population qui est peut-être encore de 70 à 80.000 habitants ; changeurs, travailleurs de fer forgé, de maçons, de charpentiers, de chausseurs, selliers, tourneurs, fabricants de peignes, de laine, bouchers, poissonniers, marchands d’huile, tanneurs, tailleurs, taverniers pour recevoir des pèlerins qui redeviennent de plus en plus nombreux (« tourisme religieux » pour lequel on publie des « Itinéraires », guides des lieux conseillés, basiliques, tombeaux des saints, cimetières, monuments anciens, par exemple les Mirabilia Urbis Romae, qui indiquent aussi les légendes, les lieux où manger, dormir, s’amuser sans tomber dans les mains des escrocs ou des prostituées. C’est de ce livre que sera tirée en 1323 la Planimétrie de Fra Paolino). Les destructions ont libéré de la place et à la place des ruines on voit se créer de nombreux jardins potagers. La vie agricole se développe, l’élevage se pratique jusqu’à l’intérieur de la ville ; le rapport à la campagne et les petits marchés agricoles restent une caractéristique de Rome encore aujourd’hui. Les artisans forment des corporations toujours plus fortes, représentées par un conseil de 13 « boni homines ».
Même lorsque le pape tentera de la maîtriser, la Commune se préoccupera du développement de la ville, de l’entretien des ponts et des voies consulaires qui assurent l’ouverture vers le monde extérieur. Elle reprend intérêt à l’entretien des anciens monuments romains et de leur restauration : Panthéon, Colisée, Théâtre de Marcellus, Mausolée d’Auguste, Forum de Trajan, thermes de Caracalla, pyramide Cestius, arcs de Constantin et de Janus, aqueducs. La louve redevient, à côté du lion, le symbole de la ville. Parallèlement à son importance religieuse, Rome reprend donc une importance civile et culturelle toujours plus marquée, qui viendra renforcer la gloire de l’Église romaine, pourtant toujours hostile au pouvoir civil qui s’est mis en place.
C’est aussi l’époque où les papes et les grandes familles aristocratiques construisent et agrandissent leurs palais, et les dotent de tours (Margana, Carboni, delle Milizie, Mesa ...).
Cependant la jeune Commune entre vite en conflit aussi bien avec l’empereur qu’avec les papes. L’arrivée de Frédéric Barberousse en 1155 est l’occasion de batailles violentes entre les citoyens romains et les troupes allemandes ; mais la Commune s’appuie éventuellement sur l’empereur pour se renforcer face aux papes, elle cherche à intervenir dans les conclaves qui élisent le pape : par exemple en 1159 elle soutient un candidat contre Rolando Bandinelli qui sera pourtant élu sous le nom d’Alexandre III, et fait élire un antipape, Victor IV qui meurt en 1164. Toutes les dernières années du XIIe siècle et le XIIIe siècle seront ainsi marqués par ce rapport de la Commune et du peuple romain entre papes, antipapes et empereurs, chacun jouant son jeu avec l’un ou l’autre selon les intérêts du moment. À noter que l’empereur Frédéric Barberousse a été vaincu par les Communes du Nord de l’Italie et a dû reconnaître leur indépendance par la paix de Constance en 1183.
Dans cette période de lutte entre le pape et l’empereur, Rome est tantôt sous la tutelle pontificale (Innocent III, 1198-1216), tantôt sous celle de l’empereur (Frédéric II soutient la révolte de 1234 contre le pape, considérant que c’est le peuple romain qui a le droit de consacrer l’empereur, et non le pape) ; à Rome, l’emportent alternativement les Guelfes (partisans du pape) et les Gibelins (partisans de l’empereur), mais les uns et les autres se refusent à être soumis au pape ! Parfois ils recherchent un « Sénateur » extérieur à la ville, comme en 1252 où ils demandent à Bologne, ville juridiquement riche, de le leur fournir ; les Bolonais envoient en 1255 un gibelin, Brancaleone degli Andalò, qui, par dérogation, sera élu pour trois ans et jumellera le sénatorat avec la charge de Capitaine du Peuple qui lui donne le gouvernement de la ville, affaiblissant le pouvoir pontifical. Il réorganise la justice, aux dépens des nobles habitués à défendre leurs privilèges, il étend le territoire romain par la conquête de Tivoli et de la zone d’Ostie, il réforme et renforce le système des corporations. Éloigné en 1255 puis rappelé, Brancaleone fait détruire 150 tours des nobles qui l’avaient combattu et des amis du pape Alexandre IV. Il meurt en 1258, témoignage de la force qu’a prise la vie communale romaine.
Après Brancaleone, les papes feront désigner comme Sénateur le français Charles I d’Anjou qui bat définitivement les Gibelins à la bataille de Bénévent (1266) où est tué Manfred, le fils de Frédéric II, dont le dernier descendant est vaincu et exécuté à Naples en 1268. Charles est nommé roi de Sicile et doit renoncer au Sénatorat de Rome.
Les papes commencent à s’installer au Vatican où est construit un premier palais forteresse. Ils revendiquent la seigneurie de Rome dans les Fundamenta militantis Ecclesiae, qui rappellent la « donation » de Rome par Constantin au pape Sylvestre I, et Nicolas III Orsini est élu Sénateur de Rome en 1278 jusqu’en 1292 ; il est remplacé par Boniface VIII de 1295 à 1303. Rome connaît alors un maximum de richesse et de splendeur ; de grands artistes (Giotto, Pietro Cavallini, Pietro Torriti, les « Cosmatesques », le florentin Arnolfo di Cambio...) viennent travailler à Rome ; les parties anciennes sont pourtant abandonnées, le Forum et le Palatin sont plantés de vigne, les buffles et les porcs viennent y paître.
Mais c’est aussi par l’élection de Boniface que commence la fin de cette époque florissante. Boniface, de la puissante famille des Caetani, enrichie par des moyens douteux pendant son cardinalat, se rend célèbre par l’organisation du premier jubilé de 1300, qui amène chaque jour à Rome, dit-on, 200.000 pèlerins, qui remplissent les poches des commerçants romains ; il exploite ainsi le mysticisme et les aspirations populaires du XIIIe siècle qui attendent un changement de l’Église (Cf le mouvement franciscain, les pauvres de Lyon de Pierre Valdo, Arnaldo da Brescia, et la quantité de groupes qui seront déclarés « hérétiques »). Mais sa politique partisane, les conflits entre les Orsini, favorisés par le pape et les Colonna qu’il déteste et excommunie, crée bientôt dans la ville un climat insupportable ; sa théorie de la supériorité du pape sur les rois (la bulle Unam Sanctam) lui attira l’hostilité des rois, en particulier celle de Philippe le Bel, qui fit appel au Concile, fit arrêter Boniface à Anagni par son conseiller Guillaume de Nogaret ; il fut maltraité par Sciarra Colonna et, libéré par une révolte populaire des habitants d’Anagni, mourut un mois après en 1303. Son successeur, Clément V (1305-1314), archevêque de Bordeaux, décidera en 1305 de quitter Rome et de s’installer à Avignon. Rome est seule, privée de pape pour plus d’un siècle.
L’exil d’Avignon et le Grand Schisme (1305-1420)
L’absence des papes de Rome ouvrira une grande période de décadence dans la vie économique, politique et culturelle de la ville.
L’activité économique des papes et des fonctionnaires de la Curie se déplace de Rome à Avignon ; la vie sociale se dégrade sous le commandement des Sénateurs nommés par le pape et étrangers à la ville. En 1308, un incendie endommage gravement Saint Jean de Latran ; les rues deviennent sales et puantes. Les nobles relèvent la tête. En 1323, les Colonna font couronner empereur Ludovic le Bavarois par les représentants du peuple romain ; or c’est un adversaire du pape Jean XXII (1316-1334) qui l’excommunie et lance l’interdit contre sa ville, invitant le clergé à s’en éloigner. Ludovic réplique par l’élection d’un antipape, Nicolas V, tandis que les Romains se retournent contre les soldats allemands de Ludovic, qui abandonne Rome avec l’antipape en 1328. Rome est privée des deux grands pouvoirs, le pape et l’empereur.
Le couronnement poétique de Pétrarque en 1341 sera comme un prélude de l’arrivée au pouvoir de Cola di Rienzo. Celui-ci, jeune notaire éloquent, désireux de redonner à Rome sa grandeur passée, convainc Pétrarque et le pape Clément VI (1342-1352) de le nommer notaire de la Chambre Apostolique. Il est combattu par les nobles, mais, grâce à l’affichage d’immenses manifestes publicitaires et par trois ans de discours enflammés, il parvient à se faire nommer « Tribun » de Rome le 20 mai 1347 sur un programme politique clair de lutte antibaronale pour le salut de Rome ; il rétablit pour lui les anciens rites impériaux, se baigne dans la vasque de Constantin, proclame Rome « caput mundi » et accorde la liberté à toutes les villes italiennes en leur donnant la citoyenneté romaine. Désavoué pour sa cruauté et ses discours illuminés, il doit quitter Rome en novembre 1347. Il revient triomphant en août 1354, nommé Sénateur avec l’appui du pape Innocent VI (1352-1362) et du cardinal Albornoz. Il est arrêté et tué le 8 octobre 1354.
Rome est épargnée par la peste de 1348, mais ébranlée par un tremblement de terre en 1349 ; elle connaît encore un succès lors du second jubilé de 1350 dont les diverses parties du clergé se disputent les revenus. Dans les années qui suivent, Rome est en proie des conflits entre les familles nobles, les bourgeois et les artisans, sous la direction impuissante de sénateurs étrangers. Urbain V (1362-1370) tentera un premier retour dans la ville en 1367 ; il devra la quitter à nouveau en 1370.
En 1378, éclate le Grand Schisme : le Conclave a élu un pape italien, Urbain VI (1378-1389), mais les cardinaux français lui opposent un autre pape, Clément VII (1378-1394), source de conflits religieux, politiques et militaires dans lesquels interviendra Catherine de Sienne pour tenter d’arrêter le Schisme. Entre 1409 et 1415, il y aura même trois papes, à Rome, Avignon et Pise. Ce n’est qu’en 1420 que Martin V Colonna (1417-1431) ramènera définitivement la papauté à Rome ; le dernier pape d’Avignon, Benoît XIV, ne mourra qu’en 1430.
Pendant toute cette période, Rome reste d’une part le centre incontesté de la chrétienté, avec la présence de grandes personnalités (3 empereurs, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, Pétrarque ...), la création d’une institution communale et d’une activité populaire vivantes, souvent anarchique et destructrice. D’autre part, la ville est dans un état déplorable, déserte dans certains quartiers, les rues sont impraticables, les maisons sans toit, les loups tournent dans les rues la nuit et dans les cimetières, de nombreux cadavres restent sans sépulture ; les denrées alimentaires manquent, la faim règne, il n’y a plus d’argent ; le Forum est réduit à « une étable de porcs et de buffles », le Palatin à des pâturages, le théâtre de Marcellus à une boucherie ; partout on voit dans les rues des morceaux de colonnes et de statues, les marbres des édifices anciens sont brûlés pour faire de la chaux, le saccage est général, les voleurs et brigands pullulent ; la population est estimée entre 20.000 et 25.000 habitants.









5) Un siècle de « Renaissance » (1420-1527)
Le premier souci de Martin V est de remettre de l’ordre et de la sécurité dans les rues de Rome, d’autant plus que s’approche le jubilé de 1430 ; il confie l’administration à un Maire général, supérieur au sénateur et aux plus hauts fonctionnaires, il nomme un Maître des rues et des responsables des édifices, fontaines, cours d’eau, égouts et ponts ; il travaille à civiliser un peuple de commerçants et d’artisans et une plèbe sans aucune culture ni souci d’hygiène ; il se met à la restauration des monuments anciens : il s’occupe lui-même de St Pierre, St Jean de Latran, St Paul, Ste Marie Majeure et le Panthéon, mais il impose aux cardinaux, généralement riches, de pourvoir à la restauration des églises dont ils sont titulaires. Il restaure aussi la vie spirituelle, aidé par une mystique comme Francesca Romana (1384-1440), dont la dépouille sera transportée, après sa sanctification, dans l’église du Forum qui porte son nom.
Son activité sera poursuivie par son successeur Eugène IV (1431-1347) (qui prendra soin de se débarrasser pourtant de la présence des Colonna... !).
Nicolas V (1447-1455) sera le premier pape d’esprit humaniste. Il institue un jubilé en 1450, qui sera une grande affaire, spirituelle certes, mais aussi commerciale : de façon significative, Cosme l’Ancien de Médicis vient lui-même au jubilé, il y gagne des centaines de milliers de florins. Nicolas V fera venir aussi de nombreux humanistes avec lesquels il développe l’Université et la Bibliothèque Vaticane.
Il faut penser que, dans une ville comme Florence, la Renaissance est commencée depuis déjà longtemps, que le régime communal est déjà transformé en « seigneurie » que commence à dominer la famille des Médicis. Rome a du retard, et la « renaissance » y sera brève. Le 20 mai 1453, les Turcs s’emparent de Byzance et abattent l’empire d’Orient, dans la plus grande indifférence des Occidentaux en général et de Rome en particulier.
Calixte II (1455-1458) est un Borgia, considéré comme inculte et peu religieux, a pour principal souci de placer famille et amis dans les propriétés et les postes importants ; peu favorable aux humanistes, il marque un retour en arrière et l’installation d’un clergé qui n’a comme visée que la conquête du pouvoir ecclésiastique. Il tente cependant d’organiser une croisade contre les Turcs, mais sans succès : Isabelle d’Aragon vient d’épouser Alphonse de Castille, et ils sont surtout préoccupés par les problèmes espagnols et par la conquête de l’océan Atlantique.
Cette conscience du péril turc sera aussi le fait de son successeur, Pie II Piccolomini (1458-1464), homme de grande culture et humaniste actif de qualité : il s’occupe peu de Rome, mais fait construire Pienza.
Il faut attendre les papes suivants pour que s’amorce vraiment à Rome un mouvement culturel de « renaissance » : d’abord Paul II (1464-1471, né Pietro Barbo à Venise) qui améliore la vie économique de Rome, s’intéresse à l’agriculture et à l’élevage, mais fait aussi renaître une tradition toute vénitienne de fêtes (carnaval, etc.). Il introduit à Rome l’imprimerie ; il reçoit en 1466 Georges Castriote Scandenberg, le héros albanais qui a défendu les Balkans contre les Turcs.
Ensuite Sixte IV (1471-1484), un Della Rovere, poursuit le travail de restauration de Rome, aqueducs, ponts, bonification des quartiers, pavage des rues, églises ; il introduit à Rome Botticelli, Cosimo Rosselli, Pinturicchio, Perugino, Piero di Cosimo ... ; Rome devient un grand centre commercial ; la chute de Constantinople amène à Rome un grand nombre d’intellectuels et d’artistes grecs ; Laurent le Magnifique épouse Clarisse Orsini, ce qui resserre les liens entre les deux villes, même si le pape favorise les Pazzi qui tenteront d’arrêter la montée au pouvoir des Médicis. Cela renforcera plus tard la présence d’artistes florentins, Michel-Ange, Léonard, Leon Battista Alberti. Innocent VIII marie son fils à Madeleine de Médicis, créant une alliance entre les ligures et les florentins, qui rendra possible l’arrivée des Médicis à la papauté au siècle suivant.
Après la transition d’Innocent VIII (1484-1492), est élu un second Borgia, Alexandre VI (1492-1503), cardinal déjà célèbre pour sa vie débauchée et son attachement à la promotion de ses fils et à l’augmentation de leur patrimoine (César et Lucrèce), pour lequel il dépouille toutes les grandes familles romaines, les Orsini comme les Colonna ; malgré son soutien à l’Espagne et à un pacte anti-français, le roi Charles VIII, aidé par les Colonna et les Della Rovere entre à Rome en 1494, et ses troupes saccagent la ville ; cela force Alexandre à renforcer ensuite la fortification du Vatican ; il contribue par contre à développer l’Université de Rome.
Le plus ancien recensement connu de Rome est de 1526, il trouve une population de 55.000 habitants sur 9285 foyers. On y compte une majorité d’hommes, fonctionnaires pontificaux (prêtres célibataires) et personnel du pape et des grandes familles, nobles attirés par ce centre de pouvoir, moines, pèlerins, mais aussi artistes. La ville avait aussi une quantité de prostituées et de mondaines entretenues, de 5000 à 9000 personnes !
Par ailleurs, le style de vie romaine, l’abondance des cérémonies (conclaves, consistoires, célébrations liées à la présence de rois ou d’empereurs, funérailles ...) qui provoquent une consommation énorme de bougies et de cire, fait que Rome est une ville qui achète beaucoup (tissus, vêtements civils et ecclésiastiques, outils, vases, plats, miroirs, rosaires, verres, épices...) et ne produit que peu de choses ; une quantité de personnes ne vivent que des libéralités du pape, référence de toute la vie économique, et une plèbe misérable tourne autour des résidences des très riches familles romaines, s’abritant dans les ruines persistantes des monuments romains anciens, Forum, Palatin, Septizonium, etc.
Par contre les cardinaux entretiennent une vie de cour somptueuse, ils s’occupent de tout, d’administration urbaine, d’affaires, ils dirigent des travaux, vont à la chasse, font des concours de chevaux et de chiens, organisent des banquets, concerts, souvent terminés dans des scènes orgiaques qui font de Rome, malgré ses destructions, la capitale d’un Etat de l’Église rénové, doté d’une cour et d’une administration efficace. L’ « Urbs » devient de plus en plus la capitale de l’Église, et à mesure qu’augmente le pouvoir du pape, le pouvoir civil et laïque, celui de la commune, perd de son autorité. Mais jamais il ne s’effacera dans l’histoire de Rome : reste forte la référence à la République romaine, non dépourvue d’une dose d’anticléricalisme. L’humanisme de la Renaissance exprimera cette référence (Cf. la naissance en 1483 de l’Académie romaine, évocatrice de la grandeur de l’antiquité romaine : Pomponio Leto, Bartolomeo Platina, Filippo Buonaccorsi, Marcantonio Cocci ...).






6) NOTE SUR LA ROME BAROQUE
I. Le Baroque : Origine et place dans l'histoire de l'art et des idées
- Phénomène culturel manifesté dans toute l’Europe aux XVIe et XVIIe siècles, né à Rome vers 1600.
- Expression d’une époque de crise générale :
- Crise socio-politique et économique : guerres incessantes sur le territoire italien convoité par la France et l’Espagne depuis la fin du XVe siècle.
- Crise religieuse : division entre catholiques et protestants (95 Thèses de Luther en 1517, excommunication en 1521).
- Crise intellectuelle : découvertes astronomiques de Copernic et Galilée remettent en question la vision chrétienne de l’univers.
- Phénomène religieux :
- Fruit de la Contre-Réforme : le Concile de Trente (1545-1563) réaffirme le rôle éducatif de l’art religieux.
- À Rome, volonté des papes d’embellir la capitale chrétienne pour reconquérir les âmes par la beauté des arts.
- Le baroque continue la Renaissance mais :
- Abandonne les proportions harmonieuses au profit du mouvement et du déséquilibre.
- Voile la nudité (cf. Daniele da Volterra sur le Jugement dernier).
- Exalte le mystère divin plutôt que l’homme.
- Privilégie l’imagination et l’émotion sur la raison.
II. Caractéristiques générales : Formes anciennes, liberté nouvelle
- Mouvement et espace :
- Préférence pour les courbes, l’opulence, le mouvement.
- Contrastes d’ombre et de lumière (ex. San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini).
- Théâtralité :
- Places et villes conçues comme des scènes.
- Façades d’églises comme décors animés.
- Nefs sans bas-côtés, mais avec balcons et loges.
- Églises-scènes sur places-théâtres (ex. Sant'Ignazio).
III. Les grands maîtres de l’architecture et de la peinture baroque romaine
1) Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
- Maître du baroque romain, sculpteur, peintre, décorateur et architecte.
- Œuvres :
- Saint-Pierre : baldaquin, chaire, colonnade.
- Sant’Andrea al Quirinale.
- Extase de Sainte Thérèse d’Avila (S. Maria della Vittoria).
- Fontana dei Fiumi (piazza Navona).
- Nombreuses sculptures (David, Apollon et Daphné – Galleria Borghese).
2) Francesco Borromini (1599-1667)
- Virtuose original, moins monumental que Bernini.
- Œuvres :
- San Carlo alle Quattro Fontane (triomphe de l’ovale).
- Sant’Ivo alla Sapienza.
- Sant’Agnese in Agone (piazza Navona).
- Campanile de S. Andrea delle Fratte.
3) Pietro da Cortona (1596-1669)
- Peintre officiel de la cour pontificale.
- Architecte : invente la façade d’église courbe.
- Œuvres :
- Santa Maria della Pace (1656-57).
- San Carlo al Corso (1668-72).
- Santi Martina e Luca (1635-1650).
- Peintures : fresques de la Chiesa Nuova, Triomphe de Bacchus, Aurore, Palais Barberini.
IV. La peinture
1) Le Caravage (1571-1614) – naturalisme dramatique, luminisme
- Peintre indépendant et révolutionnaire de l’art italien.
- Rejette les traditions, revendique la nature comme seul modèle.
- Peinture réaliste et dramatique :
- Contrastes violents d’ombre et de lumière.
- Sujets équivoques ou vulgaires : Bacchus, David, Narcisse (Galerie Borghese), Les Apôtres (aux ongles sales...), La mort de la Vierge, La vocation de Saint Paul (S. Maria degli Angeli), La vocation de Saint Matthieu (S. Luigi dei Francesi).
2) Annibale Carracci (1560-1609)
- Originaire de Bologne, invité à Rome par le cardinal Farnese en 1598.
- Décore la galerie du palais Farnese.
3) Giovanni Battista Gaulli, dit Baciccia (1639-1709)
- Voûte du Gesù : Triomphe du nom de Jésus (1679).
- SS. Apostoli : Triomphe de l’ordre franciscain (1707).
- Peintures à S. Andrea al Quirinale (1705), portrait de Clément XI.
4) Andrea Pozzo (1642-1709)
- Voûte de S. Ignazio (1691-1695).
- Chapelle de S. Ignace au Gesù (1700).
5) Autres artistes
- Peintres : Giovanni Lanfranco, Carlo Saraceni, Orazio Borgianni, Domenichino, Guercino.
- Sculpteurs : Alessandro Algardi, François Duquesnoy.
Œuvres de Caravage mentionnées
- Jeune garçon avec panier de fruits (1593-94).
- Vocation de Matthieu (1599-1600), S. Louis des Français.
- S. Matthieu et l’Ange (1602), S. Louis des Français.
- Conversion de S. Paul (1600-01), S. Maria del Popolo.
- Crucifixion de S. Pierre (1600-01).
- Martyr de S. Matthieu (1599-1600).









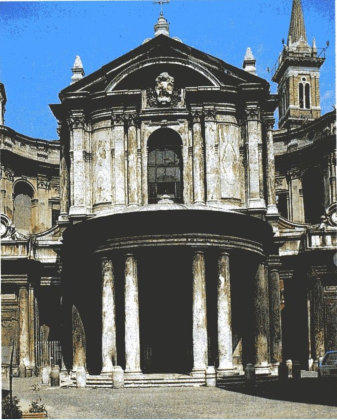










VII. Du XVIIIe siècle à l’occupation française (1809-1814) et à Rome capitale (1870)
Au XVIIIe siècle, les papes poursuivent les travaux d’urbanisme pour faire de Rome une véritable capitale digne de l’importance du nouvel empire chrétien :
- Fontaine de Trevi (Nicola Salvi, 1732-1762)
- Escalier de la Trinità dei Monti (Francesco De Sanctis, 1723-26)
- Port de Ripetta (Alessandro Specchi, 1703-04, détruit)
- Palais de la Consulta (Ferdinando Fuga, 1732-34)
- Palais Doria Pamphilj (Gabriele Valvassori, 1731-34)
La décoration picturale se développe avec des élèves des grands baroques et des artistes étrangers : Boucher, Natoire, De Barbault, Füssli, Goya, David, Fragonard, Hubert Robert... Parmi les figures majeures : Giovanni Paolo Panini et Giovanni Battista Piranesi, source iconographique majeure (1748-1760).
Le goût néo-classique renaît, porté par Johann Joachim Winckelmann, directeur des Antiquités Romaines dès 1763.
Rome devient un lieu majeur du « Grand Tour », fréquenté par l’élite intellectuelle européenne (Goethe entre 1786-1788).
Occupation française (1809-1814)
Napoléon annexe l’État pontifical, divisé en départements du Trasimène (Spolète) et du Tibre (Rome). Camille de Tournon, préfet, modernise la ville : activités productives, marchés, abattoirs, cimetières, transports, égouts, travaux d’assainissement et réaménagement urbain (Piazza del Popolo, Pincio, Capitole, Panthéon, Quirinal).
Rome après 1815
Rome, redevenue papale, tente d’effacer la trace révolutionnaire mais conserve quelques avancées industrielles. Travaux : pavage (sampietrini), usine à gaz, manufacture de tabac, chemin de fer, plans d’urbanisme (1864). Fouilles archéologiques, plans cadastraux fondés sur les travaux de Piranesi, Nardini, Ligorio.
Rome de Pie VII puis Pie IX (1846-1878) : régime répressif post-1848, République romaine écrasée en 1849. Répression par le cardinal Antonelli, exécutions politiques, concile Vatican I (1869), infaillibilité pontificale votée malgré résistance épiscopale.
Rome devient capitale (1870)
20 septembre 1870 : troupes italiennes entrent dans Rome par Porta Pia, après le retrait français. Plébiscite en faveur du rattachement à l’Italie. Le pape se retire au Vatican. Rome devient capitale de l’État italien, séparation Église-État proclamée.
Transformation de la ville : installation des institutions (famille royale, ministères), ouverture de grandes rues (via Vittorio Emanuele), modernisation du Quirinal, aménagement des quais du Tibre, ouverture de parcs publics, expropriations populaires.
Rome moderne et contemporaine
Rome devient un vaste chantier : spéculation immobilière, corruption, Exposition universelle de 1911, musée de la Valle Giulia, Monument à Victor-Emmanuel II.
Fascisme : démolitions pour propagande (Via dei Fori imperiali, Via della Conciliazione), mais aussi nouveaux quartiers (Cité universitaire, Cinecittà, Foro Italico, EUR). Marcello Piacentini en est un architecte phare.
Rome après 1945
Population : 1,5 million en 1945, 2,5 millions aujourd’hui, 4,5 millions dans l’agglomération. Urbanisation triplée depuis 1950. Spéculation immobilière, inégalités, émergence de quartiers comme la Magliana (problèmes sanitaires, insécurité).
1962 : plan d’urbanisme inefficace. Congestion routière aggravée par manque de transports publics. Métro, GRA (périphérique), mais trafic asphyxiant.
Phénomène des borgate : constructions illégales en périphérie, sans services. Documentées par le cinéma d’Ettore Scola (Brutti, sporchi e cattivi, 1976). 15.000 hectares occupés illégalement dans les années 1980.
Évolutions récentes (1970-2000)
Nouvelles industries (chimie, optique, électronique, aérospatiale), mais le tertiaire domine (80% des actifs). Tourisme de masse dans le centre historique (population passée de 424.000 en 1951 à 165.000 en 1971).
Concentration des pouvoirs : Présidence (Quirinal), gouvernement (Palazzo Chigi), Parlement (Montecitorio, Palazzo Madama), ministères (centre et EUR).
Effets : trafic intense, rues bloquées, stationnements réservés.
Rome au XXIe siècle
Municipalités plus créatives : Rutelli, Veltroni. Restauration des musées (Borghese, Massimo, Altemps, Montemartini), places historiques (Montecitorio, Campidoglio), nouvelles constructions (Mosquée, Auditorium de Renzo Piano).
2003 : nouveau Plan Régulateur Général. Objectifs : réforme du trafic, maintien des espaces verts, récupération des banlieues, arrêt des constructions sur 70% de la surface urbaine, Nouvelle Foire (Rome-Fiumicino), Parc archéologique Appia Antica-Capitole.










