Firenze - Florence
introduction
Recherche esthétique de « beauté », peut aussi se lire comme œuvre philosophique et politique, illustration du rapport entre le divin, le pouvoir politique, la richesse, la sexualité, la femme et la beauté. La « Renaissance » est une façon de voir le monde, non seulement intellectuellement mais « sensiblement », selon l’optique de la perspective centrale.
Les Florentins ont été pendant deux siècles les inventeurs et les porteurs d’une très haute vision de l’homme et du monde, que l’on résume sous le mot d’ « humanisme ». Ils avaient déjà « inventé » le capitalisme et les techniques bancaires (la comptabilité en partie double..), pratiqué la grève (les « Ciompi » représentent les premières formes d’organisation ouvrière), ils ont donné son nom à l’Amérique (Amerigo Vespucci, fils d’une grande famille florentine), et beaucoup d’autres choses.
C’est sans doute pour cela qu’ils sont restés si fiers au point d’en paraître hautains, n’ayant pas la familiarité populaire des Napolitains et n’étant pas extrovertis comme les Vénitiens. À les rencontrer, à pratiquer leur ville, plus austère sans doute mais combien riche de culture, on gagne toujours en humanité. Et puis, ils savent aussi bien manger, bien boire, faire la fête ; la campagne toscane est magnifique, très « humanisée » elle aussi, et il fait bon se promener dans les collines, les jardins, les villas.
Ce dossier ne remplace pas votre guide préféré, mais vise à le compléter, à illustrer quelques-uns des sites et monuments que vous visiterez, afin que chacun soit mieux à même de l’apprécier par lui-même, à son rythme, selon ses goûts et ses rêves.
Jean Guichard, 5 juin 2015
Dossier Florence : histoire, art et politique
Les origines historiques et légendaires
Vers le Xe-VIIIe s. av. J.C., des populations villanoviennes (vers Bologne) franchissent les Apennins et s’installent au confluent de l’Arno et du Mugnone, à l’endroit où le fleuve, plus étroit, est plus facile à franchir. Site stratégique : par le fleuve navigable, on atteint la mer, le site de Pise où arriveront les marchands orientaux (un culte d’Isis s’y installe) ; passage Nord-Sud par voie de terre. Un peu plus tard, les Etrusques s’installent, selon leur habitude, sur la colline, à Fiesole (Cf. Musée archéologique).
Les Romains y établissent un « Municipium » qui sera dit « splendidissimum ». Celui-ci, ayant pris parti pour Marius, sera détruit par Sylla. Une colonie romaine est rétablie par César vers 59 av. J.C., avec son Decumanus Est-Ouest et son Cardo Nord-Sud en direction du pont unique. Le Forum se trouvait à l’emplacement de l’actuelle Piazza della Repubblica. La ville est appelée FLORENTIA, la « florissante », la ville des fleurs : elle avait été fondée à la saison des « Ludi florales », les jeux floraux (28 avril-3 mai), pour la déesse Flore. Le nom vient plus probablement d’ « Arva Florentia » (les riches terres labourées) dont la fertilité était due à la proximité du fleuve. Plus tard Florence sera connue pour ses fleuristes, qui vendaient des fleurs « et d’autres grâces secrètes ». La campagne conquise autour de la ville est divisée en rectangles (« centuria ») d’un demi-hectare (« centuriation ») dont la trace sera encore visible à la Renaissance. La ville a 10.000 habitants au IIe siècle.
Un unique pont en bois est construit au début du 1er s. après J.C. C’est un point de passage important sur la route de la France et de l’Allemagne vers Rome, en évitant la zone côtière marécageuse et source de malaria. Le pont est élargi par Hadrien en 120, puis reconstruit en briques : il est appelé Ponte Vecchio, à partir du moment où sont construits le pont Alla Carraia (1220), le pont Alle Grazie (1227), à la suite de l’intervention d’une Vierge miraculeuse, et le pont de Santa Trinità (1252). Ponte Vecchio est régulièrement détruit par les crues de l’Arno, dont celle de 1333 qui, pour les Franciscains « Spirituels » vient punir les trois vices des Florentins, l’orgueil, l’avarice et la luxure. La reconstruction de 1345 est à peu près le pont actuel, dont les boutiques sont occupées d’abord par les bouchers (bientôt interdits parce qu’ils jetaient leurs déchets dans le fleuve) puis par les orfèvres.
Le camp romain avait une enceinte de 1800 m. de long. Parmi les monuments repérables, l’amphithéâtre (ovale de 113m /64m. et 335 m. de circuit) dont on voit la trace dans la courbe des maisons de Via Torta, Via dei Bentaccordi, Piazza dei Peruzzi (vers Santa Croce) qui suivent encore l’ancien tracé du monument. La Via delle Terme conserve encore le souvenir des anciens Thermes. Le Prétoire se trouvait sur le lieu du Baptistère San Giovanni.
Mais, comme toute fondation, Florence a besoin de se donner des origines légendaires divines : une ville devenue si grande, « la très belle et très fameuse fille de Rome » - disait Dante – devait s’inventer des titres de noblesse. Origines romaines d’abord : Fiesole aurait été fondée par Atalante aidé par Apollon : ce fut la « première ville » (« Fia sola ») reconstruite après le déluge, et Troie aurait été l’œuvre du fils du constructeur de Fiesole. Quant à Florence, elle aurait été fondée par un certain Florinus, noble citoyen romain qui lutta contre Fiesole où s’était réfugié Catilina. Celui-ci le tua ; ce fut César qui le vengea, détruisit Fiesole et construisit Florence qui devenait ainsi une copie de Rome avec son Forum (sous l’actuelle Piazza della Repubblica), son Capitole, son amphithéâtre, ses thermes, etc.
Mais les légendes les plus importantes sont d’origine religieuse plus que romaine. Le christianisme est introduit très tôt par les marchands syriens venus de la très dynamique Eglise du Moyen-Orient, et elle eut ses martyrs dont les légendes remontaient de Rome le long de la Via Cassia. Qui furent les premiers évangélisateurs, S. Barnabé ? S. Martial ? S. Frontin ? Les catacombes du Mons Florentinus font état d’une Sainte Félicité, martyre romaine de Palestine qui eut son église dès le Ve s. (au bout de Ponte Vecchio, côté Oltrarno). On invente pour la période suivante un saint Romulus envoyé par S. Pierre (en réalité, il s’agit d’un évêque plus tardif dont les reliques sont à la Badia de Fiesole).
Il y eut surtout San Miniato (S. Miniatus, S. Minias), mort martyr sous l’empereur Décius en 250, dont on fait un roi arménien, mais qui était en réalité florentin du Borgo dei Greci. C’est le type même du saint que l’on ne parvient pas à tuer : il est livré en vain à un léopard et à un lion qui viennent lui lécher la main (on pense que le personnel chrétien des amphithéâtres nourrissait abondamment les fauves les jours où des martyrs devaient être livrés aux bêtes qui, repues, refusaient d’y toucher !) ; on lui coule du plomb fondu dans les yeux et la bouche, il y passe comme du miel. Enfin on le décapite ; il prend alors sa tête sous son bras et va en volant la poser sur la colline, là où il désire qu’on lui construise une église (Cf. la fiche sur San Miniato).
Au moyen âge, les Florentins se choisissent un nouveau patron, S. Jean-Baptiste, un modèle de courage spirituel, de fierté et de rectitude, le successeur chrétien du dieu Mars, protecteur de la ville chez les Romains. On disait : « San Giovanni non vuole inganni » (S. Jean ne veut pas de tromperies) ; il était le garant de la valeur permanente du florin (créé en 1252. À g. florin XVe s.) dont les pièces portent un Agnus Dei. Garant de la monnaie, il est choisi comme emblème de l’Art de la Laine, attestant l’honnêteté des commerçants de cette corporation. En 1535, le duc Alexandre fait supprimer l’Agnus Dei, qui rappelle trop les premiers idéaux de l’époque républicaine.
Florence, ville épiscopale, connaît aussi la prédication de S. Ambroise de Milan qui y prononce son discours sur la chasteté et qui consacre en 393 l’église de Santa Reparata, autre sainte patronne de Florence, originaire de Palestine. Il faut rappeler enfin San Zanobi, dont une colonne près du Baptistère garde le souvenir : elle marque le lieu où un orme desséché reverdit après avoir été touché par le cercueil du saint.

La période féodale et la formation de la commune
1) Le Haut Moyen Âge. L’alliance avec le pape contre l’empereur.
Florence connaît les invasions barbares : les Goths (attaque de Radagaise en 406) et les Ostrogoths (Totila la détruit en 552), puis les Longobards qui la délaissent au profit de Lucques, mieux située sur la route qu’ils préféraient (Milan-Plaisance-Pavie-Sarzana-Pise), ce qui explique que Florence végète par rapport à Lucques et à Pise, mais garde aussi une plus grande indépendance du fait de sa marginalité (d’où son goût pour la liberté ?). Il en reste un culte des saints guerriers, comme Saint Michel, patron du peuple lombard (la première église San Michele est construite sous les Lombards en 570).
Le renouveau de la cité commence avec la domination de Charlemagne, vainqueur des Lombards. Les Carolingiens réorganisent l’Italie selon une hiérarchie de « comtes », fonctionnaires nommés dans chaque diocèse, et de simples seigneurs vassaux du comte et du roi. En 854, Lothaire I réunit le territoire de Florence et le comté de Fiesole, faisant de Florence le plus grand comté et « contado » de la Toscane. La Toscane est une « marche ». Les marquis de Toscane prennent alors le titre de comtes de Florence. La veuve du marquis Uberto fonde en 967 la Badia Fiorentina, la plus grande abbaye de la ville ; son fils, le marquis Ugo (+ 1001) abandonne Lucques pour venir résider à Florence.
La population s’accroît au Xe s. du fait des invasions hongroises qui poussent les paysans à se réfugier en ville. Florence construit sa troisième puis sa quatrième enceinte (y compris l’enceinte romaine). L’évêque Hildebrand, aidé par l’empereur Henri II, fonde sur la colline le monastère et l’église de San Miniato (1014-1050).
En ce temps de conflits entre le pape et l’empereur sur la question des investitures, Florence prend parti pour le pape. Le développement de la ville sera ainsi constamment lié à cette alliance avec la papauté, et souvent avec la France : c’est un phénomène central dans l’histoire de Florence. La papauté s’est transformée en un pouvoir à la fois spirituel et temporel, depuis la création des Etats pontificaux par Pépin le Bref en 776. À sa mort en 1113, la comtesse Mathilde de Canossa, marquise de Toscane, laisse ses biens en héritage au pape, héritage contesté, mais qui contribue à placer Florence dans le camp pontifical ; en 1077, lors de l’épisode de Canossa, sommet de la lutte entre Grégoire VII et l’empereur Henri IV, la ville a été fidèle au pape.
C’est en intervenant dans le mouvement de réforme qui traverse l’Eglise aux XIe et XIIe s. que le peuple florentin manifeste son identité et son autonomie. Dans une Eglise qui a désormais un pouvoir temporel, politique (les évêques sont aussi des seigneurs féodaux), financier (richesse foncière et patrimoniale des évêques et des monastères), s’affirme un mouvement réformateur qui trouve son centre à Florence. Jean Gualbert (995-1073) naît dans une famille de chevaliers florentins, se fait moine, se retire à San Miniato, puis fonde l’Ordre monastique de Vallombrosa (1038), sur la colline à quelques kms de Florence, pour contribuer à la sauvegarde de la Règle de S. Benoît, silence, pauvreté, clôture, mais sans exigence de travail manuel ; l’ordre prend la tête du mouvement réformateur contre l’évêque et les prêtres simoniaques et débauchés, appuyé par le pape Alexandre II. C’est ce qui vaut à Florence d’accueillir en 1055 le Concile auquel assistent le pape, l’empereur et 120 évêques ; le marquis de Toscane choisit Florence comme résidence définitive en 1057 ; l’évêque de Florence, Gherardo, devient pape sous le nom de Nicolas III (1059-61) mais garde sa charge d’évêque de Florence, dont il consacre le Baptistère. Jean Gualbert est canonisé en 1193 par le pape Célestin III.
Or le peuple appuie Jean Gualbert à la fois contre le pouvoir épiscopal (en 1068, un moine de Vallombrosa, Pietro « Igneo », subit avec succès l’épreuve du feu contre l’évêque Pietro Mezzabarba accusé de simonie et que le pape dut déposer) et contre le pouvoir féodal du vicomte. Dans ce mouvement, se développe une organisation autonome du peuple florentin, dont les délégués se substituent au vicomte et à l’évêque pour représenter la ville et son « contado » (les territoires de campagne lui appartenant). La victoire de 1082 sur l’empereur Henri IV qui assiégeait la ville renforce cette apparition du peuple florentin sur la scène politique à côté des nobles et du clergé. En 1125, la mort d’Henri V, dernier empereur de la dynastie salienne, et la prise et destruction de Fiesole, assurent la domination de Florence sur tout le « contado » dont chaque bourgade sera contrainte d’offrir des cierges au Baptistère de Florence le jour de la Saint Jean-Baptiste, devenu patron de la ville. « C’est la reconnaissance imposée à tous de la suprématie de la ville, symbolisée par le saint qui est devenu peu à peu son patron principal … C’est aussi l’apparition de la volonté collective d’une communauté à laquelle l’évêque a frayé la voie, mais qui tend à se substituer à lui » (Yves Renouard).
2) Les luttes contre la féodalité et l’intégration des féodaux dans la ville.
Au début du XIIe siècle, la région de Florence est encore partagée entre plusieurs systèmes de production et d’organisation socio-politique : l’économie féodale laïque, l’économie féodale ecclésiastique et l’amorce d’une économie urbaine « bourgeoise ».
a) La féodalité laïque est représentée par quelque 250 châteaux autour de Florence, souvent au sommet des collines. Ils vivent sur la base d’une économie domestique fermée autour de la « villa » (« curtis ») ou « castello », la source de la richesse réside dans la propriété foncière. Les rivalités entre les seigneurs font régner une atmosphère de violence permanente, qui s’exerce d’abord sur les paysans (les « contadini », habitants du « contado »). Le système vit aussi des artisans, les « ministeriales », les hommes de métier. Les contradictions sont nombreuses dans ce milieu féodal : les petits nobles, les artisans et les paysans subissent la domination sans contrôle des grands propriétaires (impôts, arbitraire, tortures …) ; ils tendent à fuir la campagne et à se réfugier dans la ville. Mais les campagnes ont connu aussi le développement des « pievi ». La « pieve », paroisse, dont l’église est souvent fortifiée, représente le premier et le seul centre de rassemblement et de prise de conscience des paysans, la première organisation « démocratique » de résistance au pouvoir féodal (les curés étaient confirmés ou nommés par l’Assemblée populaire).
b) Quant à la féodalité ecclésiastique, elle est représentée par le clergé régulier des abbayes et le clergé séculier plus mêlé à la vie mondaine de la ville. Les abbayes, souvent très riches, tirent leurs revenus de la terre, de la dîme (obligatoire dès 585), du casuel (messes, mariages, etc.) et des aumônes, mais aussi de l’exploitation des reliques (celles de San Miniato sont vendues à l’évêque de Metz, mais continuent à être exposées à Florence… ; San Giovanni conservait des fragments du corps de Charlemagne …), et surtout du travail industriel. Dans la crise qui suit la chute de l’empire romain, tous les métiers, intellectuels et manuels, étaient restés concentrés au sein de l’Eglise, qui transmet les techniques, forme les artisans, pratique le commerce de leurs produits et garde d’importants dépôts d’argent, plus en sûreté qu’ailleurs (Cf. les Templiers).
c) Toutes ces forces antagonistes de la grande féodalité laïque convergent peu à peu vers la ville héritée de la ville romaine, protégée par ses remparts, résidence du comte et de l’évêque, lieu de marché. C’est à partir de ces petits nobles, de ces artisans, de ces paysans rassemblés autour du clergé urbain que s’élabore la révolution communale contre la féodalité et l’Empire en lutte avec l’Eglise sur la question de l’investiture des évêques. Il y a une convergence d’intérêts entre ce peuple laïque, l’évêque et la féodalité ecclésiastique contre les grands féodaux. En 1183, Frédéric Barberousse doit reconnaître l’autonomie des villes (Paix de Constance). Bientôt la ville pourra entreprendre la conquête et la destruction des châteaux féodaux (ceux des Alberti, celui de Montecascioli, celui du cardinal Ottaviano degli Ubaldini à Montaccianico, etc.) dont on voit parfois encore les ruines au sommet des collines ; les biens du seigneur sont remis à l’Eglise et les familles aristocratiques sont contraintes de venir habiter en ville, d’y construire des palais dont la hauteur de la tour sera le signe de la puissance et de la richesse passées (les maisons tours). Grâce à leur culture et à leur expérience politique et militaires, ces nobles, regroupés dans les « sociétés des tours », fournirent les premiers « consuls » ; les artisans et les marchands commencent à s’organiser en corporations (« arte »). Quand les « arti », source de la richesse de la ville, prendront de l’ampleur, le conflit avec la noblesse deviendra inévitable.
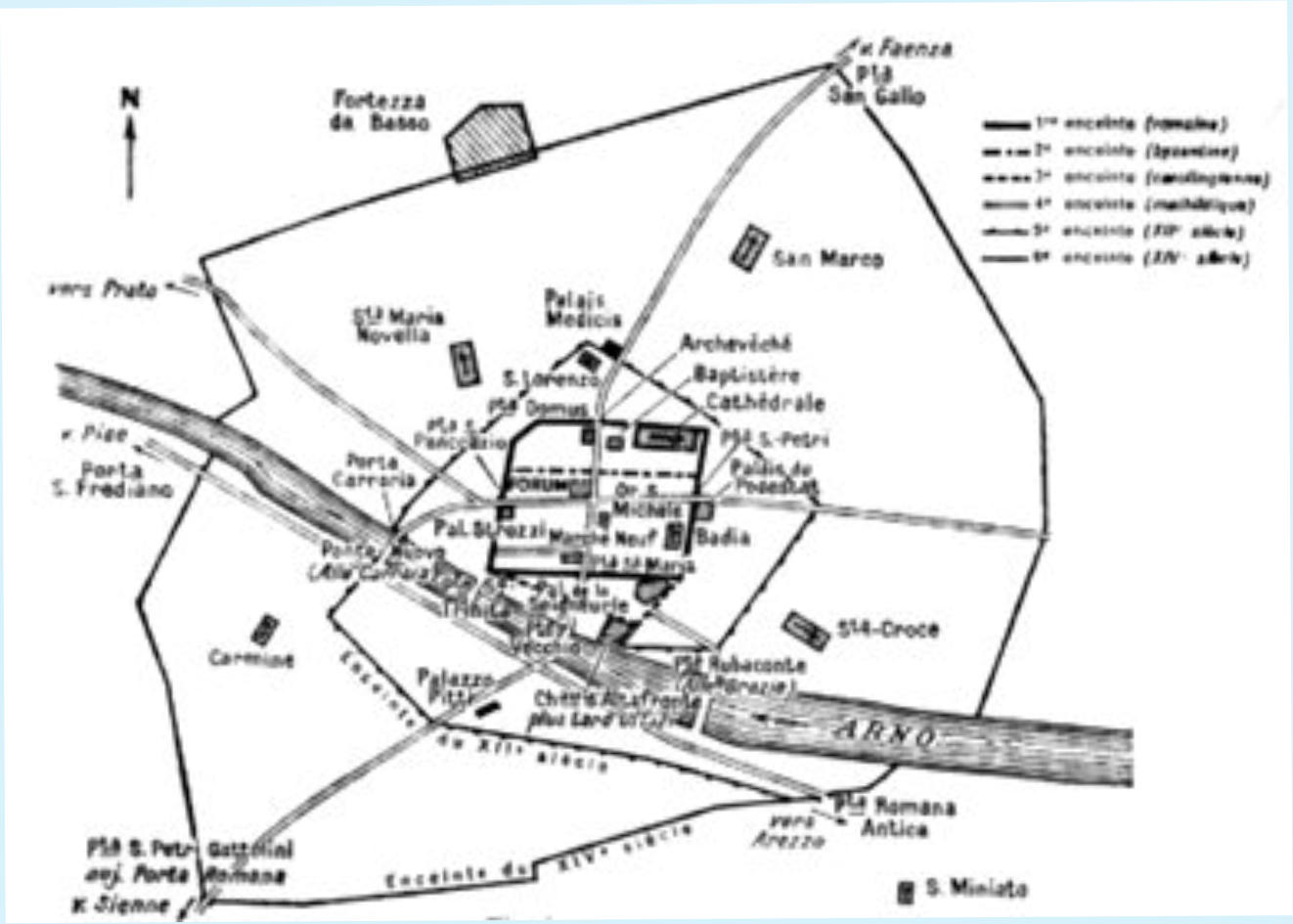
L’organisation communale, les “arti”
1) Le système des « Arti »
La société communale est divisée en 4 classes : les paysans (la ville a maintenant un pouvoir total sur les campagnes ; mais la servitude est abolie en 1289), la plèbe urbaine dépourvue de droits, la noblesse urbaine (les « Magnati », propriétaires de maisons et de terres rapatriés en ville), et la bourgeoisie organisée en corporations (« arti »). Florence est une démocratie, mais limitée à ceux qui ont une maison et qui paient des impôts. Le développement et l’histoire de la ville résultent de la combinaison et des conflits entre ces divers éléments.
L’organisation des corporations est mise en place par les « Ordonnances de Justice » de 1293 (« Ordinamenti di Giustizia ») et restera identique avec quelques variantes. On distingue :
a) Les « Arti Maggiori »
qui forment le « popolo grasso », corporations des métiers intellectuels, des professions libérales, de la banque, du commerce et de la grande industrie :
- Mercatanti (Arte di Calimala) : assuraient la teinture et apprêt des draps importés de France et de Flandre. Siège Via Calimala, la « mauvaise rue », mal fréquentée… Occupaient 30.000 personnes dans 200 entreprises. Corporation éliminée au cours du XIVe s.
- Giudici e notai : juges et notaires, élément essentiel de l’activité commerciale ; regroupe des nobles qui seuls pouvaient aller faire des études de droit à Bologne ;
- Cambiatori : les « changeurs », et les banquiers, d’abord intégrés dans l’Arte di Calimala.
- Arte della Lana : tissage de la laine florentine et de la laine importée d’Angleterre, France, Flandre. Fabricants de drap.
- Arte della seta, dei Setarioli (ou de Por Santa Maria), le travail de la soie prend de plus en plus d’importance au XIVe s. à mesure que la ville s’enrichit et que le luxe s’accroît.
- Medici e Speziali : médecins et pharmaciens, épiciers-droguistes, merciers, où se retrouvent aussi les barbiers, les peintres et les écrivains (il n’y a pas de corporations d’enseignants : l’Université est à Bologne ; le « Studio fiorentino » n’ouvre ses portes qu’en 1348).
- Vaiai e Pelliciai : travail du vair (fourrure d’écureuil), fourreurs et pelletiers.
b) Les « Arti Mediane e Minori »
(Les 5 « Arti mediane » seront plus tard intégrées dans les « Arti Maggiori »). Les « Arti Minori » forment le « popolo minuto » :
- Baldrigari, Rigattieri et Linaioli : détaillants de drap, fripiers et lingers ;
- Beccai ; bouchers, de création plus récente, la viande suppose la richesse. Parfois à la tête des révoltes populaires …
- Calzolai : chaussetiers, bonnetiers ;
- Maestri di Pietra e Legname, corporation qui incluait les architectes ;
- Fabbri e Ferraioli : métiers du fer.
- Vinattieri, marchands de vin ;
- Albergatori, tenanciers d’auberges ;
- Oliandoli, Pizzicagnoli, Funicellai : marchands d’huile, de sel, d’épices de fromages et de cordes ;
- Spadai e Corazzai, fabricants d’épées et de cuirasses ;
- Correggiai, corroyeurs ;
- Chiavaioli ; serruriers, taillandiers, chaudronniers ;
- Fornai : boulangers ;
- Legnaioli : marchands de bois en gros.
- Conciatori (Galigai), Cuoiai : tanneurs, travail du cuir.
Pendant environ deux siècles, le pouvoir politique sera entre les mains des « Priori » élus par les corporations ; pour participer au Priorat, les « Magnati » doivent s’inscrire à une corporation et payer une lourde « garantie » financière. Les 12 premières corporations ont un étendard, un chef (le « gonfalonier », porte-étendard), un conseil et une milice. L’emblème des corporations est visible sur les monuments qu’elles ont financés (Calimala au campanile, etc.), ainsi que le saint protecteur de chacune d’entre elles : S. Jean-Baptiste, protecteur de Calimala, S. Etienne, protecteur de l’Arte della Lana, etc. (cf. par exemple les statues extérieures d’Orsammichele).
2) Une forme avancée de capitalisme.
L’organisation des entrepreneurs, commerçants, banquiers constitue un système capitaliste très perfectionné. À la source, l’industrie textile : la laine est la base de la richesse de la ville, à la différence du moyen âge où dominaient les préoccupations militaires et la demande de toile. Plus tard, la soie remplacera la laine. L’apogée du système se situe entre le milieu du XIIIe s. et le milieu du XVe s. La classe dominante est formée d’un ensemble de grandes familles, souvent d’origine aristocratique mais enrichies dans l’activité industrielle et surtout bancaire : les Alberti, Albizzi, Bardi, Peruzzi, Pitti, Soderini, Cerchi, Donati, Frescobaldi, Strozzi, Tornabuoni, Villani, Medici … Ces familles sont écartées du pouvoir politique direct mais n’en exercent pas moins une influence décisive sur la ville.
C’est désormais l’entrepreneur, et non plus l’artisan, qui contrôle le processus de production et de commercialisation, depuis l’acquisition des matières premières jusqu’à la vente des produits finis ; les ateliers (la « bottega ») d’artisans travaillent sous son contrôle ; ils emploient eux-mêmes des ouvriers salariés. En 1338, les 200 ateliers de Calimala vendent de 70 à 80.000 pièces de drap pour 1.200.000 florins et font vivre 30.000 personnes sur 90.000 habitants. Les « botteghe » sont décentralisées de façon très peu rationnelle, mais les méthodes de production sont très élaborées (héritage des moines Humiliates, branche des Bénédictins, qui employaient des travailleurs salariés dans leurs ateliers).
Le commerce florentin d’exportation a conquis le monde chrétien et islamique ; il est organisé à une grande échelle internationale, avec un système d’agences et de succursales qui exportent les produits de l’industrie florentine, et importent d’Orient les épices, les articles de luxe (perles, pierres précieuses, colorants, fourrures) qui sont consommés à Florence ou revendus dans le reste de l’Europe. En particulier les Florentins ont en mains le commerce de Rome et de Naples (exportations de blé). Les Acciaiuoli, marchands d’acier originaires de Brescia et venus à Florence au temps de Frédéric Barberousse, ont un « banco » à Naples, où ils contrôlent le commerce de blé, d’épices (poivre, gingembre, noix muscade, cannelle, clous de girofle), d’huile, de vin, de laine, de chanvre. Ils deviennent les banquiers de Robert d’Anjou, roi de Naples, sont les amis de Boccace et Pétrarque ; ils acquièrent de nombreux fiefs en Campanie, et deviennent de véritables monarques bourgeois, mal vus à Florence à cause de leur puissance excessive.
Les paiements se font en florins d’or à partir de la victoire de la bourgeoisie guelfe sur la noblesse gibeline (1282). Le florin, dont le taux d’or est toujours le même (3,33 gr.), devient la monnaie internationale sur le marché, à la différence des monnaies d’argent dont le taux d’argent est fluctuant. C’est pourquoi on payait les ouvriers en monnaie d’argent qui se dévaluait par rapport au florin d’or ; en 1378, lors de la révolte des « Ciompi », les ouvriers du textile, une des revendications fut de fixer la valeur du florin, qui pouvait osciller de 1 livre à 3 livres 6 sous.
L’organisation de la banque florentine est remarquable. Boniface VIII appelait les Florentins « le cinquième élément de l’univers ». Ils s’étaient formés comme « campores », banquiers de la Chambre Apostolique romaine, percepteurs chargés de ramasser les impôts de l’Eglise, dîmes, tributs, taxes, à Rome, à Florence, en Espagne, en Angleterre. Le « banco » était un lieu d’échange dont le réseau de filiales permettait de connaître le pouls du marché mondial, de passer des ordres d’achat ou de vente en fonction de la conjoncture, d’acheter où les prix étaient bas et de vendre où ils étaient hauts. Chaque « banco » (cf. gravure ci-dessus, 1490) avait des courriers qui informaient rapidement les marchands. Le Palais Bartolini-Salimbeni, place Santa Trinità, porte encore une décoration de pavots avec l’inscription « Per non dormire » (Pour ne pas dormir) : les marchands devaient se lever très tôt pour arriver sur le marché avant les concurrents !
Une ou plusieurs familles formaient des « corpi di compagnie » avec des « banchi » dans toutes les villes, des « fattori » (directeurs), « scrivani » (comptables), « chiavai » (caissiers), « garzoni » (employés) et « notai » (notaires) sous la direction du chef d’entreprise. C’est aux « Compagnie » que s’adressaient le pape et les souverains (France, Angleterre) pour financer des entreprises de nature différente (l’artisan, lui, ne travaillait que dans un domaine) et assurer le ramassage des impôts ; les banquiers leur faisaient des prêts à haut risque, mais compensés par d’immenses privilèges, comme le monopole de certaines matières premières ; et les taux d’intérêt étaient tels (de 15 à 25%, et parfois plus) que, même lorsque le capital était perdu, une partie avait déjà été récupérée. Cependant en 1345, la Compagnia des Bardi fait faillite : durant la Guerre de Cent ans, les Bardi ont financé le roi d’Angleterre qui ne rembourse pas ses dettes ; les clients de la banque, alarmés, retirent leurs capitaux. Cela provoquera une crise de toute l’économie florentine.
Ces banquiers sont aussi de grands mécènes. Ils embellissent leurs palais, mais c’est aussi grâce à eux que les églises et les monastères s’ornent de fresques réalisées par les plus grands peintres. Ces banquiers doivent se faire pardonner leur activité de prêt à intérêt considéré comme de l’« usure » et interdit à ce titre par l’Eglise ; ils compensent par de riches dons pour l’ornement de leur chapelle (Cf. Santa Maria Novella et Santa Croce) ou pour obtenir d’être enterrés dans un couvent.
3) Les Ordres religieux.
Enfin, parmi les forces qui déterminent le développement de la ville, il faut compter l’Eglise, et en particulier les ordres religieux, en premier lieu les Franciscains et les Dominicains. Les Franciscains arrivent à Florence dès 1209 (Cf. la Légende des Trois Compagnons, et les personnalités de Bernardo da Quintavalle et d’Egidio). François d’Assise lui-même y passe en 1211 et en 1221 ; la tradition veut qu’il y ait rencontré S. Dominique. Les trois vœux (humilité, pauvreté, chasteté) répondent aux trois vices des Florentins (Orgueil, avarice, luxure) !
Les deux ordres s’installent d’abord hors les murs, les Franciscains à Santa Croce (quartier des teinturiers), les Dominicains à Santa Maria Novella (quartier des tanneurs) ; la construction des nouvelles enceintes intègre bientôt les couvents dans la ville, où ils deviendront les conseillers spirituels et politiques des différentes factions en présence.
4) Les luttes internes à la Commune.
Sortie victorieuse de la lutte contre l’empereur, reconnue commune libre en 1183, Florence traverse presque un siècle de luttes internes entre les tendances qui traversent la noblesse, la grande bourgeoisie, la petite et moyenne bourgeoisie et le peuple.
La noblesse d’origine féodale constitue le parti « gibelin » (du nom de l’une des 2 familles rivales candidates au siège impérial, les Souabes du château de Weibling). La petite noblesse établie en ville et la bourgeoisie du « peuple gras » se retrouvent dans le parti « guelfe » (du nom de l’autre famille impériale, d’Othon IV de Brunswick, les Welf).
À la bataille de Bénévent (1266), Manfred, dernier héritier de Frédéric II, est tué par les soldats de Charles d’Anjou, appelé par le pape pour combattre la famille de Souabe. Avec l’appui de la France, les gibelins sont défaits, doivent quitter la ville en 1267 ; la victoire reste au parti guelfe, le gouvernement est assuré par les nobles guelfes et le « popolo grasso ». Florence l’emporte aussi sur les villes rivales de tradition gibeline, Pise, Pistoia, Arezzo, Sienne. La ville s’étend jusqu’à sa dernière enceinte et prend le visage qu’elle a encore aujourd’hui dans le centre historique, avec ses rues étroites, sa vie artisanale et commerciale intense. Elle fixe son emblème : le lys blanc sur fond rouge, puis rouge sur fond blanc en 1251, lorsque triomphe la « révolution » anti-gibeline. Le lys de Florence n’est pas le lys héraldique classique, il est ouvert et en bouton, plus proche de l’iris (giaggiolo = ireos florentina, divisé en 3 feuilles) ; il serait une concession de Charlemagne (le lys était considéré comme la plus noble des fleurs). Est-ce le nom de Florentia qui a suggéré de choisir le lys, ou la richesse en fleurs du site qui a suggéré le nom de Florentia ? Bientôt, à l’intérieur du parti guelfe au pouvoir, deux tendances s’opposent :
- les guelfes Blancs représentent la moyenne bourgeoisie et les familles anciennes écartées du pouvoir et du service pontifical (Cerchi, Cavalcanti, Frescobaldi, Mozzi) ;
- les guelfes Noirs représentent les familles plus récentes de la grande bourgeoisie d’affaires (Acciaiuoli, Donati, Peruzzi, Spini qui venait d’obtenir la clientèle pontificale convoitée par les Cerchi), partisans d’une alliance sans compromis avec la papauté et d’une politique internationale de conquête des villes voisines.
Le conflit éclate en 1300, à l’occasion d’une querelle entre des jeunes gens des Donati et des Cerchi (une histoire à la Roméo et Juliette !) : les Noirs font appel au pape et à Charles d’Anjou ; les Blancs sont arrêtés ou exilés, leurs biens sont confisqués. Parmi ceux-ci, Dante Alighieri, qui condamne cette politique de la grande bourgeoisie, son luxe croissant, son abandon des valeurs sur lesquelles s’était fondée la Commune (Cf. Divine Comédie, Paradis, chant XV).
Pendant encore plusieurs années, Florence sera en conflit avec des gibelins exilés qui s’allient aux villes ennemies. Contre eux, Florence refait son unité, se fait aider militairement par la famille d’Anjou, qui règne maintenant à Naples, avec l’appui du pape : Robert d’Anjou envoie son fils Charles, duc de Calabre en 1325, puis un de ses anciens vicaires, Gautier de Brienne, duc d’Athènes, qui est élu seigneur à vie en 1342, grâce à une alliance entre les « Magnati » et le « popolo minuto ». Il organise un régime de pouvoir personnel, aux dépens des « Prieurs » qui sont relégués à S. Pietro Scheraggio, il grève la ville d’impôts qui servent à financer sa vie de luxe (les lois « somptuaires » limitant le luxe sont oubliées, la mode française est introduite pour les hommes, on organise des joutes sur la place Santa Croce comme à l’époque féodale …), il fait régner la terreur en même temps qu’il pratique la démagogie envers le « popolo minuto » des « Arti mediane ». Il est chassé du pouvoir par une conjuration menée par les « Magnati », la grande bourgeoisie d’affaires des Bardi, Frescobaldi, Donati, Pazzi, Adimari, Aldobrandini, qui tente de faire abolir les « Ordonnances de Justice » qui lui interdisent de participer au pouvoir politique : ils réduisent le nombre des quartiers (les « sestieri ») de 6 à 4 et le nombre de Prieurs issus des corporations.
Mais le « popolo minuto » s’est développé sous la tyrannie du duc d’Athènes ; par ailleurs les « Magnati » sont affaiblis par la guerre entre la France et l’Angleterre qui entraîne la faillite de plusieurs « Compagnies » de banque (les Bardi, Peruzzi, Acciaiuoli, Bonaccorsi …). Enfin, le prolétariat urbain, dépourvu de tout droit politique ne supporte plus des conditions de vie et de travail très dures, que dénoncent les Fraticelli (les Frères Mineurs « spirituels » restés fidèles à l’idéal de pauvreté des origines franciscaines). Profitant de l’affaiblissement des « Magnati » et de la crise économique encore aggravée par la peste noire de 1348, les « Arti mediane » réaffirment à leur profit les « Ordonnances de Justice » ; une nouvelle génération de bourgeoisie d’affaires apparaît sur la scène, les Alberti, Ricci, Strozzi, Medici …
C’est cette bourgeoisie qui, à partir du XIIe s., est à la source, non seulement de l’art florentin mais de l’humanisme de la Renaissance, qui commence non pas au XVe s. comme on le lit parfois, mais dès le XIIe siècle. Elle en a fourni du moins l’infrastructure matérielle et idéologique, servie pendant quelques siècles par l’apparition d’une floraison de génies qui n’a d’équivalent que la Grèce des Ve et IVe siècles av. J.C. Même la France du siècle de Louis XIV n’a pas eu un caractère aussi universel que la Grèce antique et la Toscane de la Renaissance, et, souligne Yves Renouard, « aux fêtes de Versailles même, c’étaient les Florentins Lulli et Francini qui faisaient jouer les musiques et les eaux ». Les Florentins créent la langue italienne (Dante), la prose (Boccace), la pensée médiévale trouve sa synthèse dans l’œuvre de Dante, Giotto ouvre une nouvelle époque dans l’histoire de la peinture, Michel-Ange dans celle de la sculpture et de l’architecture, Léonard de Vinci est une des sources de la pensée technique, Machiavel de la pensée politique, et il faudrait y ajouter Masaccio, Fra Angelico, Botticelli, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Alberti, Verrocchio, Marsile Ficin pour la philosophie ; c’est à Florence que quelques intellectuels, poètes, mathématiciens, philosophes, musiciens, élaborent la formule de l’opéra. À cette époque, c’est Florence qui apparaît comme la véritable héritière de la Rome antique ; Rome n’est alors qu’une bourgade affaiblie par l’exil d’Avignon (1309-1377) et par le grand Schisme de 1378 à 1417 ; le pape Martin V ne rentre à Rome qu’en 1420.
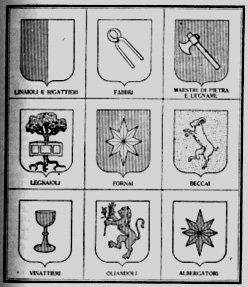

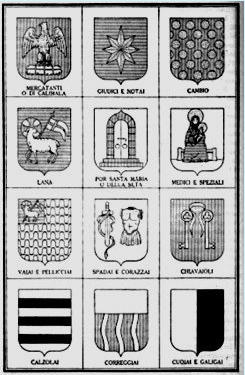



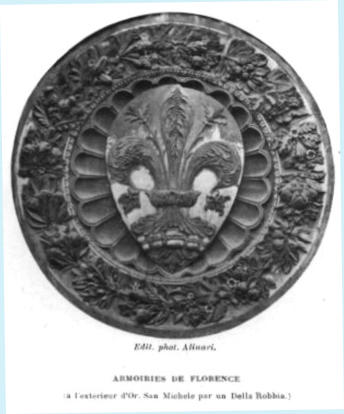
L’art de la commune
La création artistique est inséparable de cette organisation communale et de l’activité économique, elle-même imbriquée avec la vie religieuse qui lui donne souvent sa forme et son sens.
1. Architecture et urbanisme.
La ville s’est développée : en 1336, elle a 125.000 habitants ; la peste de 1348 la réduit à 30.000 ; après la peste de 1376, elle se stabilise autour de 60.000 pendant deux siècles.
Ce développement induit un renouveau de la construction, accru par les nouveaux besoins de luxe, mais aussi par les incendies fréquents, provoqués par les guerres civiles, et par les inondations dues aux crues de l’Arno (dont celle de 1333).
Le mouvement communal s’exprime à travers de grandes constructions civiles, qui sont à la fois une nécessité pour les nouveaux pouvoirs et un instrument de vie démocratique. La grandeur et la beauté des monuments doivent exprimer la puissance économique et politique de la Commune, mais aussi maintenir au moins les apparences de démocratie par leur ouverture à toutes les classes de la population. Les commanditaires sont la Commune elle-même, à travers les Arts Majeurs. Florence devient une ville-chantier, dont le maître d’œuvre est un personnage important (Arnolfo di Cambio, puis Giotto).
La foi populaire, encadrée et stimulée par les ordres religieux, s’exprime dans de grandes constructions religieuses, financées par les dons des riches familles marchandes.
Monuments civils
a) Le Palais du Podestat, puis siège du Bargello.
Au XIIIe s., il fut le siège du « Podestat », capitaine du Peuple, défenseur des libertés florentines ; son emblème est le « marzocco », le lion, symbole du gouvernement populaire. Plus tard, il devient le siège du « Bargello » (du latin médiéval « barigildum » = homme libre chargé de maintenir l’ordre, peut-être d’un mot lombard), préfet de police, capitaine de Justice, élu souvent parmi des personnalités politiques ou militaires étrangères pour qu’il ne soit pas l’instrument de l’une des factions. Construit à partir de 1255, achevé en 1346, le palais est le symbole de la victoire de la bourgeoisie en 1250 (Ordonnances dites « del primo Popolo »). C’est à ce moment que la Commune limite la hauteur des tours des palais aristocratiques et démolit les palais des familles gibelines. Encore marqué par les risques de la guerre civile : fortifié à l’extérieur, avec une tour (57 m.) mais beau à l’intérieur (MUSÉE NATIONAL).
b) Palazzo della Signoria (Palazzo Vecchio), siège des Prieurs et d’autres magistrats de la Commune, le palais Cerchi où ils siégèrent d’abord étant devenu trop petit.
Construit de 1299 à 1314 (Arnolfo di Cambio), il marque la conquête définitive du pouvoir par la bourgeoisie en 1293. Comme le Bargello, il a encore comme modèle les châteaux fortifiés de l’ancienne noblesse, plus précisément le château des comtes de Poppi, un des plus grands feudataires de la Toscane. Il est fortifié en 1342 par le Duc d’Athènes, puis modifié par les Médicis jusqu’en 1598.
c) Le « logge » citadines
Au XIIIe s., les « magnati » s’enferment dans leurs maisons-tours ; au début du XIVe s., les Conseils se réunissent dans les couvents puis dans les deux grands palais communaux. Vers le milieu du XIVe s., les citoyens sortent de cet enfermement rendu nécessaire par les exigences de sécurité, et ouvrent leurs palais sur l’extérieur.
La Loggia dei Priori servit de modèle. Elle est construite entre 1376 et 1382 (Benci di Cione et Simone Talenti) dans un but démocratique, permettre à la Signoria de haranguer le peuple réuni sur la place ; elle fut ensuite un lieu de réceptions, et fut appelée « Loggia dei Lanzi » à partir de 1531 lorsque Alessandro de’ Medici revint d’exil accompagné par une troupe de lansquenets qui campèrent sous la loggia. En haut, sur fond d’émail bleu, représentation des Vertus : de dr. à g. la Force, la Tempérance, la Justice et la Prudence ; sur le côté, l’Espérance, la Charité, la Foi. Depuis la chute de la République, elle abrite un petit musée de sculpture : l’Enlèvement des Sabines (Giambologna, 1583), Persée (Benvenuto Cellini, 1553), Hercule en lutte avec le centaure Nessus (Giambologna, 1599), Ajax soutient le cadavre de Patrocle (copie de grec IVe s. av. J.C.), Enlèvement de Polyxène (Pio Fedi, 1866), 6 statues de femmes romaines.
La mode se répandit : à côté de chaque palais se dressa une « loggia » : celle des Cerchi, des Peruzzi, des Adimari (représentée sur un « cassone », coffre de noces) … Chaque quartier a aussi sa loggia ornée des gonfalons et des emblèmes du quartier, pour les inscrits à la milice.
Le palais du Bigallo, place San Giovanni, était le siège de l’Archiconfrérie de la Miséricorde qui pourvoyait à l’assistance gratuite aux malades et aux blessés et à leur transport à l’hôpital ; elle est le modèle des institutions semblables dans le monde. La loggia del Bigallo (1352-8) était le lieu où l’on déposait les enfants égarés ou abandonnés, qui étaient ensuite accueillis par l’institution.
Monuments religieux
a) Orsanmichele.
Ce fut d’abord l’oratoire de Saint Michel construit sur un jardin (« or » = orto = jardin) au VIIIe s., qui devient un lieu de dévotion mystique pour les compagnies de « laudesi » (les chanteurs de « laudes ») et les communautés de « fraticelli » franciscains ; en 1243, Arnolfo di Cambio y édifie la Loggia del Grano, siège des magasins et de la vente du blé. Elle brûle en 1304, et en 1337, on y construit, sous la direction de l’Arte della Seta, une loggia-marché plus grande dont la surélévation contient les réserves de blé pour les cas d’urgence jusqu’en 1569. C’est du haut de Orsanmichele que la Commune faisait surveiller la maturation du blé dans les campagnes et donnait l’ordre de moissonner.
La Loggia est consacrée à la Vierge et à Sainte Anne, et confiée aux soins des Arti qui font construire, sur les pilastres extérieurs, des tabernacles portant les statues des saints protecteurs et les emblèmes des corporations. Les arcades sont fermées en 1387 : on avait installé à l’intérieur le tabernacle d’Orcagna, créé en 1349 après la Grande peste de 1348.
Ainsi, Orsanmichele réunit les symboles de la vie religieuse, de la vie politique et de la vie de travail.
b) La cathédrale, le « Duomo ».
La construction est décidée en 1294, après les « Ordonnances de Justice » : on ne restaurera pas l’ancienne cathédrale, Santa Reparata, mais on en édifiera une nouvelle, plus grande « en l’honneur et louange de Dieu et de la Bienheureuse Vierge Marie, et en l’honneur de la Commune et du Peuple de Florence, et pour embellir la ville ». On l’appellera Santa Maria del Fiore, associant pour la première fois depuis l’Antiquité romaine (Temple à Vénus et à Rome construit par Hadrien) la divinité (Vierge) et la ville (Fiore) dans un même culte. Florence veut avoir la plus grande cathédrale, signe de puissance économique de la ville et du pouvoir de la bourgeoisie. La direction des travaux est confiée à Arnolfo, puis à l’Art de la Soie, puis à l’Art de la Laine qui administre les fonds (impôts et taxes sur les successions).
c) La décoration du Baptistère
Construit au IVe s. sur un ancien lieu de culte au dieu Mars, et consacré à S. Jean-Baptiste, il est restauré en 1200 par les corporations des « Baldrigari » et des « Linaioli », édifice octogonal à deux étages, revêtu de marbre blanc et vert sombre, et surmonté d’une coupole. Entre 1330 et 1336, Andrea Pisano décore la porte Sud de 20 reliefs (Histoires de S. Jean) et de 8 autres rappelant les 3 Vertus théologales (Foi, Espérance et Charité), les 4 Vertus cardinales (Force, Tempérance, Justice, Prudence) et la Vertu d’Humilité. La direction des travaux est confiée à l’Arte di Calimala.
d) Le clocher, Campanile.
Commencé sous la direction de Giotto en 1334, continué par Arnolfo jusqu’en 1348 et achevé entre 1348 et 1359 par Francesco Talenti qui le porte à une hauteur de 81,75 m. Travaux sous la direction de l’Arte dells Lana, dont l’emblème figure dans la montée d’escalier de 414 marches. Il frappe par la légèreté de ses murs (15 m. de côté et moins de 50 cm d’épaisseur au sommet) accrue par le jeu des fenêtres géminées et trilobées et par son revêtement de marbre blanc de Carrare, vert de Prato et rose de la Maremme toscane.
Il est remarquable surtout par sa décoration sculptée d’Andrea Pisano (quelques dessins de Giotto) et d’Alberto Arnoldi. C’est une œuvre populaire, comprise alors par tous, selon le schéma des Encyclopédies du XIVe s. telles qu’elles étaient répandues par les poèmes didactiques diffusés en Toscane. Sur le thème général du Salut des hommes, sont représentées à la fois les anciennes catégories scolastiques (la mystique du nombre 7) mêlées aux activités de la vie quotidienne, aux classiques 7 Arts libéraux, et aux activités productives, rurales et urbaines (arts mécaniques, peu représentés jusqu’alors, industrie de la laine, tissage, etc. avec leurs inventeurs). S’y ajoutent les Arts figuratifs, ce qui est nouveau, par exemple la sculpture, représentée par un nu (et non plus par un saint) ; les planètes remplacent les traditionnels signes du zodiaque, selon la leçon de S. Thomas d’Aquin reprise par Dante dans la Divine Comédie. La décoration du Campanile est donc une exceptionnelle synthèse entre l’ancienne théologie et la nouvelle société fondée sur le travail urbain, l’activité industrielle et scientifique (le travail, imposé à Adam et Eve est ce qui limite les effets du péché originel ; c’est à travers lui que se réalise l’histoire du Salut) et magnifiée par les Arts figuratifs, sous la conduite des Planètes autour desquelles s’organise le Cosmos créé par Dieu.
e) Santa Croce.
Commencée en 1294 pour les Franciscains sur dessin d’Arnolfo di Cambio, à la place d’une petite église franciscaine de 1228. Les fonds proviennent des dons de grandes familles de banquiers qui se font ainsi pardonner leur péché d’usure (Bardi, Peruzzi, Alberti, Baroncelli …). La façade est de 1853-1863, le clocher n’est construit qu’en 1847 (il était à l’origine interdit par l’Ordre, parce que considéré comme symbole de puissance).
La construction rencontra l’opposition des Franciscains « Spirituels » (Ubertino da Casale) et des Augustiniens (Fra Simone Fidati) qui voyaient dans le luxe de Santa Croce un signe de l’Antéchrist et dans l’inondation de 1333 un châtiment de cet excès de faste contraire à l’idéal de pauvreté qui réglementait strictement les constructions (ordonnances du Chapitre Général de Narbonne en 1260).
f) Santa Maria Novella.
Est commencée en 1246 pour les Dominicains (S. Dominique est mort en 1221), achevée en 1360. L’intérieur est commandé par le schéma cistercien (L. = 100 m. ; l. = 28 m. ; H. = 62 m.). L’illusion de profondeur est accrue par la diminution de l’intervalle entre les piliers (de 15 m. à 11,50 m.) à mesure que l’on avance de la façade vers l’abside.
Le style de ces églises a plusieurs éléments communs :
- C’est un style de gothique tardif particulier, marqué par l’horizontalité plus que par la verticalité ; il est plus rationnel que mystique, plus clair que le gothique français ou allemand : « Il manque décidément à Florence cette spiritualité dynamique, ce verticalisme qui tend vers le ciel, si typiques de pays également bourgeois, mais d’une bourgeoisie moins développée, et moins ‘grande bourgeoise’ » (Frédéric Antal, p. 185). Beaucoup d’éléments sont repris de l’Antiquité plus que du gothique.
- Une importance première est donnée à la prédication au peuple : chaque fidèle devait être en mesure de voir et d’entendre le prédicateur et le célébrant. Il y a donc une salle unique, l’intervalle entre les piliers est important. L’espace de l’église prend un caractère plus « démocratique ». Le soin accordé à la décoration des chaires confirme l’importance des prédicateurs populaires dans les villes toscanes.
- En conséquence, le chœur est une longue paroi (à Santa Croce en T, croix égyptienne) interrompue par un grand nombre de chapelles privées. Le maître-autel n’est donc plus isolé mais entouré de nombreux autres autels, ce qui permettait d’augmenter le nombre de messes simultanées. Les riches familles étaient propriétaires des chapelles et en faisaient assurer la décoration par les peintres les plus renommés.
- Ces églises expriment donc très bien le compromis socio-politique réalisé entre le pouvoir communal qui contrôle le programme architectural, le pouvoir de l’Eglise et des Ordres religieux qui conçoivent les grands programmes décoratifs, le pouvoir des grandes familles bourgeoises qui financent la décoration. Les espaces ainsi conçus et décorés encadrent la masse du peuple sans pouvoir et assurent sa formation spirituelle et son intégration sociale.
2) La peinture
La peinture du XIVe s.
- est la plupart du temps destinée à la décoration des églises des ordres mendiants. Elle répond à une exigence démocratique (on peint dans les lieux où le peuple se rassemble) ; elle exprime parallèlement le prestige personnel des grandes familles bourgeoises ;
- privilégie la fresque (la mosaïque disparaît : la dernière est celle de l’abside de San Miniato, de 1297) et la peinture sur bois des tableaux d’autel ;
- plus tard, décorera les chapelles privées des églises et commencera à décorer l’intérieur des palais.
La personnalité de Giotto
Giotto (1266-1337) est l’initiateur d’une nouvelle ère de la peinture, qui se développe en convergence avec la montée du pouvoir de la bourgeoisie à Florence.
- Il travaille pour les milieux les plus modernes de l’Italie de l’époque, d’une part au service des cours
- pour la Commune de Florence (dont il deviendra le maître d’œuvre),
- pour la Curie romaine (à San Pietro, la mosaïque de la Navicella, symbole de l’Eglise triomphante), alliée de la bourgeoisie florentine. Il travaille au temps de papes comme Boniface VIII, fauteur d’une politique dominatrice de la papauté et d’un art au service de cette politique, et de Jean XXII, auteur de la bulle contre la pauvreté du Christ.
- pour le roi de Naples, allié et de Florence et de la Curie. À Naples, Giotto était un « familiaris » du roi et logé au palais royal.
- pour les Franciscains « conventuels », installés dans de grands couvents, en contradiction avec l’idéal franciscain des origines (Vies du Christ et de François à Assise, quartier général de l’Ordre).
- d’autre part pour les grandes familles riches dont il décore les chapelles privées
- Les Scrovegni à Padoue : le père était un usurier assez célèbre pour que Dante le mette parmi les damnés dans l’Enfer ;
- Les Bardi et les Peruzzi à Santa Croce : ce sont les banquiers du roi d’Angleterre et du roi de Naples.
C’est un artiste riche, un des seuls de l’époque : outre son atelier de peintre, très important du fait de sa position d’architecte de la ville, il possédait des métiers à tisser qu’il louait aux tisseurs pauvres, pour un profit annuel de 120 % ; il prêtait de petites sommes d’argent, et si le débiteur ne remboursait pas à temps, il s’appropriait ses terres ou son atelier. En 1314, Giotto emploie 6 hommes de loi pour faire payer ses débiteurs.
Dans les débats religieux de l’époque, il se prononce contre la pauvreté, dont il dit qu’elle est la cause des maux, qu’elle conduit au péché et à l’hypocrisie. Un de ses sonnets commence par « Nombreux sont ceux qui louent la pauvreté … », ils ont tort. Il se prononce donc contre les « Spirituels » attachés à l’idéal de pauvreté de François d’Assise, en faveur des thèses pontificales condamnant l’idée que le Christ et les apôtres ne possédèrent aucun bien, et des Franciscains « conventuels » alliés des « Magnati » ; il partage l’idéologie de la grande bourgeoisie florentine dont il sera le peintre. Ses protecteurs à Rome étaient les cardinaux Stefaneschi et Orsini, adversaires des « Spirituels ». Les scènes de la Vie de S. François dans la chapelle Bardi de Santa Croce (1320) sont inspirées par la vie du saint rationalisée et officialisée par Saint Bonaventure. À la chapelle Bardi, il peint les saints choisis par les Bardi, ceux de souche royale à l’exception de sainte Claire : S. Louis roi de France, S. Louis de Toulouse, petit-neveu de Louis IX et fils de Charles d’Anjou, à peine canonisé (1317), S. Elisabeth de Hongrie, fille du roi André II de Hongrie, patronne du Tiers ordre franciscain.
Il se forme à l’école des peintres romains : Pietro Cavallini (1240-1302) et Cimabue (1272-1302) qui furent ses maîtres à une période où la bourgeoisie florentine est en pleine affirmation mais n’est pas encore installée au pouvoir ; elle manifeste encore un dynamisme conquérant, une impétuosité, une inquiétude aussi, que ces deux peintres traduiront dans un style passionné, un mouvement dramatique intense (cf. les représentations du Christ crucifié, ou d’un S. François ascétique, priant dans la nature, proche du peuple des pauvres, peu conforme aux idéaux montants). Giotto appartient à la période suivante où la grande bourgeoisie a triomphé et conquis le pouvoir. Son style est moins tourmenté, plus rationaliste, il situe le plus souvent ses personnages dans le cadre de la ville, il insiste plus sur les scènes officielles de la vie de François (l’approbation de la Règle par le pape) que sur les miracles et les guérisons plus mystiques et conformes à la foi populaire. Il introduit le décor monumental d’inspiration antique ; il traite le corps humain en figures solides, inspirées de la statuaire, avec un naturalisme prononcé ; il intègre dans ses fresques des éléments classiques d’architecture romaine antique. On disait de Giotto que son art émerveillait les connaisseurs mais laissait froids les ignorants. L’art des Siennois connaîtra pour cette raison une diffusion internationale plus importante, en particulier à Avignon ; son caractère plus populaire influença aussi des successeurs de Giotto comme Maso di Banco, Bernardo Daddi.
Le contraste est en effet évident avec DUCCIO, plus lié à la moyenne bourgeoisie siennoise, plus lyrique, émotif, contemplatif, qui reste aussi plus proche d’un style décoratif gothique et byzantin. On peut aussi opposer Giotto à des peintres contemporains comme le MAITRE DE LA SAINTE CECILE (fin XIIIe- début XIVe s. Réalisme des détails) et PACINO DI BUONAGUIDA (actif entre 1303 et 1320. Schématisation des personnages), dont les ateliers travaillent pour des milieux plus modestes, qui sont moins liés aux Franciscains officiels et plus sensibles aux thèses des « Spirituels ». Pacino travailla d’ailleurs aussi pour les Dominicains, dont le public est plus populaire.
Il reste que le génie de Giotto fait de lui le pivot d’une nouvelle orientation de la peinture italienne. Sa clarté, sa précision, sa mesure influenceront toute la peinture du XIVe s. Il est certes réactionnaire, peintre de la grande bourgeoisie, mais il a un grand génie pictural.
Les successeurs de Giotto
Parmi les peintres qui travaillèrent comme Giotto pour la grande bourgeoisie, citons TADDEO GADDI, qui décore la chapelle Baroncelli de Santa Croce (1332-38, Vie de la Vierge) et le Réfectoire de Santa Croce (Allégorie de la Croix, illustration de la doctrine de la Rédemption, avant 1366) et peint les panneaux décoratifs des armoires de la Sacristie (Histoires du Christ et de S. François). BERNARDO DADDI (Chapelle des Pulci à Santa Croce, 1330, Martyr de S. Laurent et S. Etienne ; Tableau d’autel du Tabernacle d’Orcagna à Orsanmichele, 1347) a une sensibilité plus délicate (couleurs), moins aristocratique et moins austère que Giotto (cf. aussi tableau du maître-autel de Santa Maria Novella : Couronnement de la Vierge, auj. à l’Académie).
MASO DI BANCO décore la chapelle des Bardi di Vernio, (1336-1341, Histoires de S. Silvestre et de l’empereur Constantin, Jugement dernier : Constantin est celui qui officialise le christianisme sous l’impulsion de S. Silvestre).
Les frères NARDO DI CIONE (actif entre 1343 et 1365, Jugement dernier, Enfer et Paradis) et ANDREA ORCAGNA (1308-1368, Polyptyque avec le Christ, S. Pierre et S. Thomas d’Aquin) décorent la chapelle des Strozzi à Santa Maria Novella. L’inspirateur fut sans doute Don Piero Strozzi (l’oncle du donateur Tommaso Strozzi), dominicain, professeur de théologie et prieur de Santa Maria Novella, auteur des premières prédications contre la spéculation sur les prêts d’Etat qui avaient perdu de la valeur (1353). Son inspiration est à la fois ecclésiastique et plus populaire ; Nardo di Cione fut aussi conseillé par le prédicateur populaire, Jacopo Passavanti. (Cf. fiches Santa Maria Novella).
GIOVANNI DA MILANO peint les Histoires de la Vierge et de S Madeleine pour les Franciscains de Santa Croce (chapelle Rinuccini, 1365).
Par contre les grandes fresques d’ANDREA DA FIRENZE (1333-1392) commandées par les Dominicains pour Santa Maria Novella en 1365, reflètent déjà le temps où s’affaiblit l’influence de la grande bourgeoisie d’affaires et où monte à Florence la petite et moyenne bourgeoisie (CF. fiches Santa Maria Novella).
On peut suivre la même évolution stylistique dans la sculpture : sous la direction de l’Arte della Lana, ANDREA PISANO (1290-1348), contemporain et disciple de Giotto, sculpte la porte Sud du Baptistère (Histoires de S. Jean-Baptiste, 1330-1336) et les bas-reliefs du Campanile. FRANCESCO TALENTI réalise en 1357 un projet de façade du Dôme (aujourd’hui au Musée de l’Oeuvre du Dôme), ORCAGNA dresse à Orsanmichele le grand tabernacle de la Vierge de 1352 à 1359, sur commande de la Corporation des Banquiers.
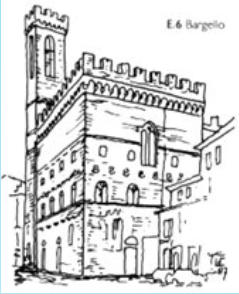

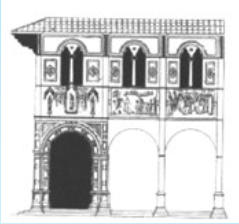

Vers la fin de la commune et vers le principat
1) Affaiblissement de l’ancienne bourgeoisie et montée d’une nouvelle classe dominante
Les faillites dues à la mauvaise conjoncture internationale affaiblissent l’ancienne grande bourgeoisie d’affaires ; la crise est accrue par la grande peste de 1348 (« la grande morìa ») qui réduit la population de Florence à 30.000 habitants. La peste est apportée par des pèlerins et alimentée par les guerres, les famines conséquentes et les conditions hygiéniques désastreuses de la ville (manque d’égouts, saleté des rues, etc.). Les plus riches fuient dans leur villa à la campagne (Lire l’Introduction du Décaméron de Boccace, qui raconte la peste de 1348 et le départ des jeunes gens) ; en ville, on réorganise les hôpitaux (en 1340, il y a à Florence 30 hôpitaux et une capacité de 1000 lits) gérés par les ordres religieux et financés par des particuliers (par exemple les Portinari, la famille de la Béatrice de Dante). Le culte de S. Roch se développe. Pour éviter la contagion, les gens désertent les églises, on construit donc au croisement des rues de petits autels et tabernacles (cf. : angle via Ricasoli / via de’ Pucci : Tabernacle des 5 lampes ; angle via Borgo Pinti / via Alfani : Tabernacle de la Compagnie de l’Assunta ; angle Borgo la Croce / via dei Macci : Tabernacle de S. Ambroise ; à l’angle du Palais de l’Art de la Laine, Tabernacle de Santa Maria della Tromba, etc.).
La peste de 1348 sert de prétexte à un nouveau mouvement réactionnaire de la « Parte guelfa » : la bourgeoisie tente de réduire le nombre des Corporations de 21 à 14 en excluant les « Arti minori ». Or le duc d’Athènes et les Bardi avaient fait appel au petit peuple et au prolétariat pour se maintenir au pouvoir. Le mécontentement est donc grand de ces petits artisans et des ouvriers salariés, surtout du textile, les « ciompi » (étymologie du mot incertaine), qui sont encadrés par les Arti dont ils jurent de respecter les règlements, mais qui ne sont pas représentés dans les conseils. Plusieurs tentatives de reconstituer les Arti supprimées et plusieurs grèves (les Teinturiers en 1368) sont réprimées durement ; elles étaient appuyées par les Fraticelli franciscains et par quelques citoyens nobles et riches, dont Salvestro de’ Medici, hostile à l’attitude réactionnaire du Parti Guelfe et favorable aux droits d’association réclamé par le peuple.
En mai 1378, Salvestro de’ Medici est élu Gonfalonier de Justice, malgré l’hostilité des Capitaines du Parti Guelfe. Il propose une loi contre les « Magnati », qui est repoussée par les Conseils. Les « Ciompi » se révoltent, Salvestro démissionne pour ne pas avoir à réprimer la révolte et il est acclamé par le « Popolo minuto ». Le 19 juillet, la répression provoque un nouveau mouvement guidé par le cardeur Michele di Lando. C’est la victoire du petit peuple qui impose la création de trois nouvelles corporations, les « Tintori » (Teinturiers), les « Farsettai » (Fabricants de pourpoints) et les « Ciompi » (qui rassemblent tous les ouvriers non qualifiés). Les Arts Mineurs se regroupent en une « Consorteria » qui obtient une part importante dans les Conseils. Le mouvement se maintient au pouvoir pendant 4 ans. Puis Michele di Lando est acheté par les « Magnati », nommé Capitaine du Peuple à Volterra en 1381 ; le « Popolo grasso » engage des troupes de mercenaires qui remportent la victoire en 1382. Les privilèges des « Arti Maggiori » sont rétablis, le Gonfalonier ne peut être choisi que parmi ces corporations ; les Ordonnances de Justice sont abolies. On modifie le système électoral : on procédait par « imborsazione », c’est-à-dire on mettait dans une bourse les noms des personnes éligibles et on tirait au sort (la « tratta ») ; après l’abolition, on exclut du tirage au sort les noms des Arti Minori au profit de ceux des « Magnati ». À la « tratta » du 1er mars 1382, ne sortent que des noms hostiles au petit peuple, à l’exception de 2 artisans : on avait empli la bourse de noms nobles, y compris des nouveau-nés, malgré l’opposition de Donato Acciaiuoli et de Alamanno de’ Medici (fils de Salvestro) qui sont alors bannis de la ville.
C’est le triomphe d’une nouvelle oligarchie ; le pouvoir est partagé entre un petit nombre de « Magnati », Maso degli Albizzi, Gino Capponi, Niccolò da Uzzano. Ce petit groupe accapare les postes de prieurs et fait exiler les familles économiquement les plus puissantes qui menacent leur pouvoir, d’abord les Alberti, puis les Ricci, les Strozzi, les Medici ; la succession des chefs de famille devient héréditaire, Florence marche lentement vers un système de pouvoir personnel.
Cette oligarchie se maintient au pouvoir grâce à une politique étrangère dynamique : conquête de nouveaux marchés (Espagne, Portugal, Normandie) et conquêtes territoriales. Pise est conquise en 1406, ce qui donne à Florence l’accès à la mer et la met à la tête d’une flotte de galères qui lui permet d’ouvrir des filiales non seulement en Méditerranée mais dans l’Atlantique (Lisbonne, Rouen …). Florence se rebelle même à l’autorité du pape alors réfugié à Avignon : déjà en 1376, à l’occasion d’un refus du cardinal Noellet de fournir du blé à Florence, la ville était entrée en conflit avec le pouvoir pontifical qui lance un interdit et envoie contre elle des troupes commandées par le condottiere anglais John Hawkwood. Florence élit un Conseil d’urgence de 8 membres, qu’on appelle par dérision envers le pape les « Otto Santi » (les 8 saints) ; ils achètent le condottiere et sa « condotta » (« Compagnia di ventura », compagnie de mercenaires), constituent une ligue des villes toscanes contre Grégoire XI, confisquent les biens de l’Eglise florentine, et obtiennent la victoire. John Hawkwood est célébré comme un héros national sous le nom de Giovanni Acuto et Paolo Uccello sera chargé de lui consacrer une fresque dans le Dôme en 1436. Le conflit sera résolu à la paix de Tivoli, après l’intervention de S. Catherine de Sienne, ambassadrice du pape à Florence, en 1377.
Florence achète le bon port de Livourne en 1421 pour 100.000 florins d’or ; le commerce de la soie se développe aux dépens de celui de la laine, brocards, filés d’or et d’argent ; le luxe des vêtements augmente, on utilise des couleurs végétales plus riches et plus voyantes : rouge violacé, cramoisi, écarlate, jaune réséda, safran, indigo, violet foncé. L’Art de la Soie choisit comme protecteur S. Jean l’Evangéliste, le plus jeune des évangélistes comme l’Art de la Soie est la plus jeune des corporations.
1) L’élaboration de l’humanisme
« C’est dans ces années 1375-1430 où une oligarchie d’affaires gouverne Florence avec le concours des élèves des génies intellectuels du XIVe siècle, que celle-ci devient le foyer où se forge l’humanisme et prend pleinement conscience de sa supériorité intellectuelle, artistique et morale comme de sa puissance économique et politique » (Yves Renouard). Plusieurs éléments contribuent à la création de ce foyer d’humanisme :
a) L’héritage antique et l’humanisme « civile »
De grands humanistes comme Coluccio Salutati (1375-1406 élève de Pétrarque, et Leonardo Bruni (1415-1444) s’inspirent de la pensée de Cicéron pour développer l’idée que Florence est l’héritière de la République romaine, une cité que les citoyens gèrent activement au nom de la Vertu et où la vie politique est animée par les grands intellectuels et philosophes selon l’idée platonicienne de la République. Ces humanistes poursuivent aussi une grande tradition littéraire florentine, celle de la triade Dante, Boccace et Pétrarque, celle du Dolce Stil Novo, celle aussi de la musique de l’Ars Nova florentine du XIVe s. L’arrivée à Florence des intellectuels grecs chassés par l’invasion turque renforcera ce mouvement (Emanuele Crisolora, 1350-1415, enseigne le grec à Florence de 1397 à 1400). Il y a donc une double continuité :
- entre les origines romaines de la ville et la réalité actuelle ; par rapport à une Rome décadente, Florence est la véritable héritière de la Ville éternelle, et l’on parle de « Renaissance ». C’est par ailleurs un humanisme « civile », démocratique et civique, il n’y a pas de rupture de continuité entre la culture et la politique, la seconde est au service de la première et sert à la réaliser.
- entre cette Florence « renaissante » et la ville de l’époque précédente : le nouveau mode de pensée n’est qu’une maturation artistique et culturelle de ce que les intellectuels du XIVe s. avaient déjà préparé par leurs œuvres littéraires.
b) La bourgeoisie florentine est porteuse d’une mentalité nouvelle.
Ce sont des industriels, des marchands, des banquiers, la banque l’emportant d’ailleurs de plus en plus sur la production industrielle, et leur travail les porte à la rigueur scientifique et à l’élaboration d’une science nouvelle, une science des chiffres, une nouvelle rationalité ; ils ont besoin de contrôler le mouvement de la réalité, de le quantifier, de le mesurer. Les mathématiques ont un rôle central ; le mathématicien (mais aussi astronome, astrologue, médecin, géographe, inspirateur de l’entreprise de Christophe Colomb) Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) enseigne à Florence. Brunelleschi fonde sur ses calculs l’élaboration d’une coupole révolutionnaire ; la géométrie, la physique, en particulier l’optique, connaissent une diffusion en rapport avec leur intérêt pratique. Sur cette base, s’élabore une esthétique scientifique nouvelle, dont la perspective géométrique est l’une des expressions. Mais la tradition médiévale avait déjà imposé la pratique de la « divine proportion », le nombre d’or, qui permettait de maîtriser par la géométrie et le dessin des nombres irrationnels (racine carrée de 2 ou de 5) et de réorganiser le réel selon ces nombres. Là encore, la tradition philosophique médiévale se conjugue avec la pratique sociale pour laquelle la science et la technique permettent de connaître la nature et de la transformer. D’où l’importance de la représentation des métiers dans la sculpture (Cf. fiche/ Campanile).
c) Une nouvelle conception de l’homme
Une nouvelle conception de l’homme s’affirme dans cette pensée inséparablement classique, scientifique, politique et artistique : sommet de l’univers, dont il est comme le microcosme, l’être humain est en mesure de se déterminer par lui-même, de dominer et de modifier la nature et ce que l’on n’appelle plus la « Providence » mais la « Fortuna » (l’objectivité de la réalité). La dignité humaine réside dans la valorisation et la réalisation de ces capacités naturelles, à la fois spirituelles et physiques : l’homme est un tout, créature divine certes, mais autonome, vouée au bonheur terrestre, capable de trouver une harmonie entre le corps et l’esprit, l’homme et la nature, l’homme et Dieu aussi, le passé et le présent. Autant dire que l’idée de « péché » disparaît de l’horizon mental de la Renaissance, ce péché qui avait précisément brisé l’harmonie originelle. Cet idéal se réalise dans la recherche de la Beauté, indissociablement esthétique (dans les arts figuratifs), pratique (dans l’architecture qui dessine les espaces de vie quotidienne, dans la création de jardins « paradisiaques », dans le vêtement, etc.) et physique : beauté du corps masculin et féminin dans sa totalité, d’où la représentation permanente du nu.
Ainsi, l’art, la vie sociale et professionnelle, la politique qui permet de réaliser l’idéal de beauté, cela fait un tout ; en conséquence, l’artiste sera aussi bien poète que sculpteur, et architecte, et mathématicien, et philosophe et conseiller politique du Prince, comme le furent les grands intellectuels de cette époque exceptionnelle. Ajoutons que c’est une pensée profondément laïque : bien sûr, Dieu y est présent, mais il a créé l’homme libre et beau, il cesse de peser sur ses déterminations par le biais d’une institution ecclésiale toute puissante.
d) Cette vision du monde et de l’homme
Cette vision du monde et de l’homme s’impose si fortement qu’elle nous apparaît encore aujourd’hui comme une vision « naturelle », conforme à la réalité objective. L’innovation technique de la perspective centrale n’était en fait qu’une façon parmi d’autres de représenter l’espace à partir de règles mathématiques choisies subjectivement : c’est un œil unique qui regarde le miroir dans la boîte optique de Brunelleschi, et le miroir est placé à une distance arbitraire de l’œil correspondant à la longueur du bras. Cette convention était en consonance avec la mentalité des marchands habitués par leur métier à évaluer d’un coup d’œil les volumes et les distances, mais elle s’est enracinée dans nos habitudes de perception à tel point que nous avons de la peine à apprécier un art « moderne » reposant sur d’autres bases mathématiques, par exemple sur la vision d’un espace non plus linéaire mais courbe…
e) Les trois artistes qui représentent le mieux ce tournant dans l’histoire de l’art et de la pensée sont :
- pour l’architecture, Filippo Brunelleschi (1377-1446), constructeur des églises de San Lorenzo, Santo Spirito, de la Chapelle des Pazzi, du Portique de l’Ospedale degli Innocenti, du palais Pitti et surtout de la coupole de Santa Maria del Fiore (1420).
- pour la sculpture, Donatello (1386-1466).
- pour la peinture, Masaccio (1401-1428) : décoration de la chapelle Brancacci à l’Eglise du Carmine, sur commande de Felice Brancacci, riche marchand de soie, gendre de Palla Strozzi (1424) ; Trinità de Santa Maria Novella (1426-28).
2) L’arrivée au pouvoir des Médicis.
Les guerres coûtent cher et suscitent un mécontentement dans le peuple et dans la moyenne bourgeoisie ; de plus la guerre de conquête de Lucques aboutit en 1433 à un échec, Lucques reste et restera indépendante de Florence. Par ailleurs, la lutte est rude à l’intérieur de cette petite oligarchie : Rinaldo degli Albizzi, fils de Maso, au pouvoir depuis 1417, sent son autorité contestée, et craint en particulier la popularité de Giovanni de’ Medici (Giovanni di Bicci), dont la famille était d’autant plus appréciée que Salvestro avait soutenu la révolte des « Ciompi » en 1378. C’est Cosmo de’ Medici, fils de Giovanni, qui a négocié la paix avec Lucques. Rinaldo le fait traduire devant une commission spéciale comme responsable de la guerre contre Lucques ; il est déclaré « Magnate », c’est-à-dire exclus des offices publics, et banni de Florence pour 10 ans, le 3 octobre 1433. Côme est accueilli à Padoue et Venise avec des honneurs princiers ; sa famille est si riche que son départ crée une crise économique à Florence. Le 29 septembre 1434, la commission spéciale révoque sa sentence de 1433, et le 6 octobre 1434, anniversaire de son départ, Côme rentre à Florence, accueilli par les acclamations populaires. Il sera élu gonfalonier en janvier 1435, fera aussitôt bannir ses principaux adversaires ou rivaux, dont les Albizzi et Palla Strozzi, installe les clients de ses entreprises dans l’administration de la ville, et accable d’impôts les familles les plus puissantes de la ville : la riche famille des Brancacci est réduite à la misère. C’est le début d’une période de plus de trois siècles où Florence sera gouvernée par une seule famille, à l’exception de brèves parenthèses républicaines. Mais Côme n’oublie pas que Florence a une tradition de liberté, et il conserve l’apparence du gouvernement républicain, se contentant d’être le premier parmi les citoyens plutôt que d’être chargé de responsabilités officielles (il n’est gonfalonier que 6 mois en 30 ans) ; il règne par sa puissance financière et par le réseau de ses amis florentins (les Pitti, Soderini, Rucellai, Alberti, Tornabuoni, Sassetti) et étrangers. Pendant tout le XVe s., les Médicis seront les arbitres de l’Italie, « l’aiguille de la balance » des Etats italiens, comme on le dira de Laurent.
Les Médicis ont les « boules »
Le blason des Médicis apparaît alors partout dans la ville : des « bisanti » (besant = figure héraldique circulaire semblable à une monnaie non imprimée), autrement dit des « palle », boules rouges sur fond or. Elles rappellent d’abord l’origine légendaire de la famille qui la rattachait à Charlemagne, le refondateur de Florence : un certain Averardo, commandant de l’armée de Charlemagne aurait chassé les Longobards de Toscane et combattu dans le Mugello, région d’origine de la famille (mais une thèse récente la fait provenir de la région de Naples…), pour chasser un terrible géant ; celui-ci aurait frappé l’écu d’Averardo avec les boules de sa masse d’armes, en y laissant leur trace. Mais le choix des « palle » est sans doute plus récent : les Médicis avaient fait fortune au XIVe s. comme banquiers dans l’Arte del Cambio, dont faisaient partie Francesco et Giovanni, fils d’Averardo Bicci. Or le blason de la corporation était un champ vermeil semé de besants d’or, et l’inversion des couleurs signifia probablement ici la complémentarité plus que l’hostilité.
Le nombre des boules a varié de 3 à 10, et tend à se stabiliser à 6 ; celle du haut devient bleue et ornée d’un lys angevin, par licence du roi de France Louis XI en 1465. Plus que le nombre importe le symbole de la boule : c’est d’abord une sphère, donc une forme géométrique parfaite propre à intéresser les humanistes et les savants ; elle est aussi le globe terrestre, symbole de pouvoir et d’éternité, que l’on place au sommet des coupoles et des clochers ou dans la main du Christ en majesté. La boule est enfin mobile, elle roule, elle était utilisée pour représenter la « Fortuna », avec les risques inhérents que cela comportait, bien en harmonie avec l’activité de marchands et banquiers qu’exerçait la famille. Les boules deviennent le mot d’ordre politique des Médicis : le cri de leurs partisans était « Palle, palle », sans oublier le double sens populaire d’un mot chargé de virilité.
Chaque membre de la famille avait aussi son « impresa », sa devise avec son « motto » (le mot), que l’on retrouve dans les fresques, tableaux, sur les monuments, les clés de voûte des églises, etc. Côme l’Ancien avait choisi trois plumes d’autruche, blanche, rouge et verte, rappelant à la fois le lys de Florence, la Trinité et les trois vertus théologales ou trois des vertus cardinales, chères à Côme, Prudence, Tempérance et Force. Piero il Gottoso avait pour « impresa » un faucon tenant dans ses griffes un anneau à pointe de diamant lié au mot « Semper » (toujours), emblème de divinité, de grandeur, de victoire, hérité de l’Egypte ancienne, mais rappelant aussi l’aigle qui était l’emblème du Parti Guelfe.
Laurent le Magnifique, comme son père Piero et son grand-père Côme, avait pour devise l’anneau, au nombre de un, trois et parfois quatre. On l’interprète souvent comme allusion au Concile de Florence de 1439-42, qui tente de répondre à la poussée turque en réalisant l’union entre les Eglises latine et grecque. L’anneau, symbole d’unité et de fidélité, au nombre de trois, serait le symbole de la Trinité (celui du Concile de Nicée) reconnu au Concile de Florence par les deux Eglises ; forme circulaire, il fait aussi allusion à l’éternité et au continuel renouvellement du temps.
Cette omniprésence du blason et des devises des Médicis est la marque symbolique de leur pouvoir sur la ville, forme ancienne de publicité politique.
Quelques œuvres qui évoquent les Médicis
- Benozzo GOZZOLI (1420-1498), héritier du XIVe s ; mais apprend le style nouveau auprès de son maître Fra Angelico. Peint en 1469 le Cortège des rois mages dans la chapelle du Palais Medici-Riccardi.
- Sandro BOTTICELLI (1445-1510) :
- Portrait d’homme avec médaille de Cosimo il Vecchio 1474 (Offices) ;
- Adoration des Mages, 1475 (Offices) cf. Fiche :
- Le Printemps, 1477-8 (Offices), portrait de Simonetta cf. Fiche ;
- Minerve dompte le centaure, 1482 (Offices) ;
- Vénus et Mars, 1483 (Londres), Giuliano et Simonetta Vespucci ;
- nombreux portraits de Giuliano, Simonetta Vespucci, etc.
- Domenico GHIRLANDAIO (1449-1494) :
- Eglise Santa Trinità, chapelle Sassetti (1483-6), Histoires de S. François d’Assise ;
- Eglise Santa Maria Novella, Chœur, Histoires de Marie (1485-90).
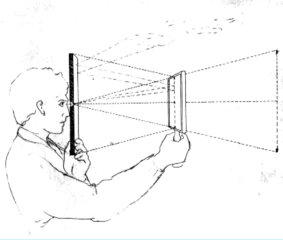
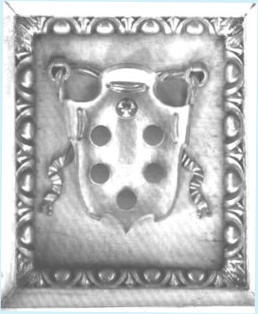

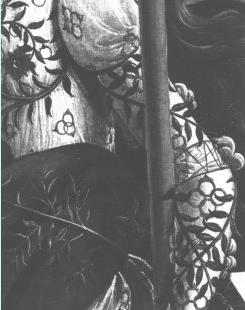
Les Médicis au XVe siècle
1) Triomphe et mécénat des Médicis
La bataille d’Anghiari (1440) fut une victoire des Florentins sur les troupes coalisées des Visconti, du roi de Sicile et des exilés florentins et assura la domination de Florence sur le Casentino. Puis, la dynastie des Visconti s’étant éteinte, Côme de Médicis renverse les alliances traditionnelles de Florence, néglige Venise au profit d’un rapprochement avec Milan et Naples. En 1454, Côme profite de la paix de Lodi entre les États italiens, face à la menace des Turcs qui viennent de prendre Constantinople, pour faire reconnaître Sforza comme duc de Milan. Il devient l’arbitre de l’équilibre des États italiens.
En 1441, Côme achète Sansepolcro pour 25.000 florins. Le capitaine Baldaccio, vainqueur d’Anghiari, apparaissant comme un rival possible allié au sage Neri Capponi, Côme le fait assassiner ; en compensation, il fait peindre pour sa veuve un tableau de Fra Angelico (la Vierge et l’enfant du Musée de San Marco).
Un des moments clés de son règne fut le transfert à Florence du concile de Ferrare en 1439. L’enjeu en était l’union de l’Église latine et de l’Église grecque contre la menace turque. Au Concile œcuménique de Florence participent le pape Eugène IV, le patriarche de Constantinople, l’empereur Jean VII Paléologue. Quatre points sont en discussion : la nature de l’Esprit Saint (les orientaux refusent le « Filioque procedit », mais on arrive à un accord), l’existence du Purgatoire, la consécration du Corps du Christ (les Grecs gardent le pain au levain, les Romains le pain azyme), le primat du Pontife romain. Le Concile arrive à un décret d’union ; le Grec Bessarion est fait cardinal, il jouera un rôle important dans l’histoire de l’Église et de Florence. Le souvenir de ce concile est évoqué dans les fresques de Benozzo Gozzoli dans la chapelle du palais Medici-Riccardi : portraits des Médicis et des personnages du concile dans le cortège des Mages.
2) L’homme universel. L’apogée de la Renaissance
Grand banquier et grand commerçant, Côme contrôle personnellement son réseau de compagnies financières qui s’étend sur toute l’Europe ; il est également un grand politique et diplomate. Mais c’est aussi un homme qui considère la philosophie, la science et l’art comme aussi importants que les affaires, complément indispensable des affaires. Il crée à Florence une Académie platonicienne qui sera un centre de réflexion permanente sur les grands problèmes de la philosophie ; Marsile Ficin y enseigne, traduit Platon ; on y rencontrera aussi bien des mathématiciens comme Toscanelli, qui ouvre la voie de l’Amérique (cf. fiche sur C. Colomb et Verrazano), qu’un théologien comme Leonardo Dati. Cette multiplicité d’activités conduit à l’idée de l’homme universel qui sera une des créations de Florence : « Ce type d’hommes apparaît tout naturellement dans ce milieu de grands hommes d’affaires dont, depuis trois siècles, la curiosité et la connaissance du monde et de tous les objets de la nature sont la base même de l’activité professionnelle, qui font commerce de tout dans tous les pays, qui doivent tout savoir pour réussir et qui sont hommes d’État, diplomates, financiers, chevaliers, entraînés à vivre sur les routes, en bateau, à l’étranger aussi bien que dans les entrepôts et le palais au bord de l’Arno, qui connaissent la valeur du savoir et de la science comme celle du faste et du luxe pour s’imposer aux hommes. L’homme universel est un produit longuement mûri de Florence où la structure des compagnies commerciales et bancaires conduit à l’universalité. » (Yves Renouard)
Ce sont donc naturellement les Médicis et leur entourage qui deviennent les principaux commanditaires des œuvres d’art, les nouveaux mécènes. Sur sa fortune personnelle, Côme consacre aux arts et aux lettres une somme qui est à peu près deux fois le budget de l’État florentin. Il construit ses palais, ses villas, constitue ses collections d’œuvres d’art, ouvre au public son immense bibliothèque, mais surtout il embellit la ville d’églises, de couvents, d’un hôpital pour accueillir les « gettatelli », les enfants abandonnés. Il commence par moissonner ce qui avait été déjà semé : Masaccio avait déjà été appelé à Florence par les Brancacci, Ghiberti avait déjà fondu la porte du Baptistère, Donatello avait déjà reçu la commande du tabernacle d’Orsanmichele, Brunelleschi ferme la coupole du Dôme en 1436. Mais il ajoute ses propres créations : il dépense 40.000 florins pour faire restaurer le couvent de San Marco par Michelozzo, pénitence imposée par le pape Eugène IV, et il en confie la décoration à Fra Angelico. Il fait moderniser la vieille église de San Lorenzo par Brunelleschi, construire par Michelozzo le palais Médicis et les villas de Cafaggiolo, Careggi, Trebbio.
3) La fin de la grandeur des Médicis … et de la Renaissance
Côme meurt en 1464, laissant le pouvoir à son fils Piero (dit « le goutteux ») qui « règne » jusqu’à sa mort en 1469. Les organes communaux continuent à fonctionner, mais le pouvoir réel, devenu héréditaire, est entre les mains de conseils parallèles créés par Côme et ses successeurs en fonction des nécessités politiques. À la mort de Piero, ce sont donc ses fils, Laurent et Julien, qui assurent sa succession. En fait, Laurent seul, Julien étant plus intéressé par l’art et la beauté des femmes que par le pouvoir politique. Laurent « le Magnifique » est un autre prototype d’homme universel : formé par les humanistes, le philosophe Marsile Ficin (1433-99), le poète et philologue Politien (Angelo Poliziano, 1454-94), le linguiste, philosophe, théologien Pic de la Mirandole (1463-94), poète lui-même, brillant diplomate et homme politique, Laurent est par contre un piètre banquier et commerçant. Il laisse à sa mort une compagnie financière ruinée (faillite des filiales de Londres et de Bruges en 1478, affaiblissement de la filiale de Lyon). Il a assuré son pouvoir, devenu monarchique, par des méthodes brutales et un cynisme qui provoquent en avril 1478 la conjuration des Pazzi et des Salviati appuyée par le pape Sixte IV et le roi de Sicile ; il la réprime avec une violence inouïe et fait créer un système de Conseils choisis par lui et dont il est membre. Il gouverne aussi par un système d’alliances, mariages (il épouse lui-même une noble romaine, Clarice Orsini, il marie son fils Julien à Philiberte de Savoie …), promotion de sa famille (en 1489, il obtient un chapeau de cardinal pour son fils Jean, qui deviendra pape sous le nom de Léon X), créant une véritable dynastie princière qui va à l’encontre de la tradition démocratique de la République de Florence.
À sa mort en 1492, éclate une révolte anti-médicéenne menée par le moine dominicain Jérôme Savonarole, dernier confesseur de Laurent, grand prédicateur contre la corruption et l’enrichissement de l’Église à la tête de laquelle vient d’être élu pape le cardinal Borgia sous le nom d’Alexandre VI. Le fils de Laurent, le médiocre Pierre (dit « le malchanceux ») est chassé en 1494, Savonarole domine la ville jusqu’à sa condamnation au bûcher en 1498. C’est le début des guerres d’Italie : Charles VIII descend en Italie avec son armée pour s’emparer du trône de Naples dont il estime être l’héritier. C’en est fini de la paix, de l’équilibre des États italiens et de la domination des Médicis, qui, après deux tentatives de rétablissement de la République (de 1494 à 1512 et de 1527 à 1530), ne retrouveront un pouvoir monarchique stable qu’en 1530, grâce à l’appui des papes Médicis, Léon X, puis Clément VII.
C’est aussi la fin de la « Renaissance ». Après 1530, commence une autre histoire de Florence et de l’art en Italie.

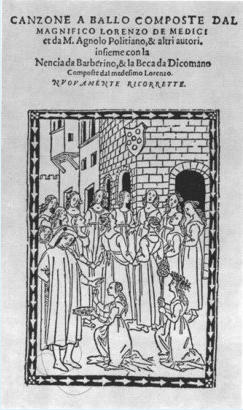

Paix et équilibre de l’Italie du XVe s., grâce à Laurent

« Mais les calamités de l'Italie (puisque je veux faire connaître quel était alors son état et, en même temps, quelles raisons furent à l'origine de tant de maux) commencèrent avec d'autant plus de peine et d'effroi dans les esprits des hommes que la situation universelle était alors plus allègre et plus heureuse. En effet, après que l'Empire romain, affaibli avant tout par la transformation de ses moeurs antiques, eut commencé, voici plus de mille ans, à décliner, depuis ces hauteurs qu'une vertu et une fortune étonnantes lui avaient fait atteindre, il est manifeste que jamais l'Italie n'avait connu une telle prospérité, ni joui d'une situation si désirable et si sûre que celle dans laquelle elle se reposait en l'an de grâce 1490 et durant les années qui précédèrent et suivirent. En effet, la paix et la tranquillité parfaites régnaient partout en Italie : elle était cultivée dans les endroits les plus montagneux et les plus stériles non moins que dans les plaines et les régions les plus fertiles, elle n'était soumise à d'autre empire qu'à celui des siens ; non seulement elle abondait en habitants, marchandises et richesses, mais elle se distinguait superbement par la magnificence de nombreux princes, par la splendeur de nombreuses villes très nobles et très belles, par le siège majestueux de la religion, par la floraison d'hommes excellents dans l'administration de la chose publique et d'esprits fort nobles en chaque science, et dans tous les arts éminents et mécaniques ; elle n'était pas non plus, au regard des usages de l'époque, privée de gloire militaire ; ornée à ce point de si nombreux talents, elle jouissait à juste titre auprès de toutes les nations d'une renommée et d'une réputation très éclatantes.
Elle était maintenue dans cette heureuse situation, fruit d'occasions variées, par bien des raisons : mais surtout, de l'avis général, on attribuait des louanges non négligeables à l'industrie et à la vertu de Laurent de Médicis, citoyen si élevé au-dessus de la condition privée dans la ville de Florence que c'était suivant son conseil qu'on gouvernait les affaires de cette république, plus puissante par son site favorable, les talents de ses habitants, la quantité d'argent disponible que par l'étendue de son domaine. Comme il venait d'établir des liens de parenté avec Innocent Vlll, souverain pontife, amené à ajouter foi sans restriction à ses conseils, grand était son renom dans toute l'Italie, grande son autorité lors des délibérations sur les choses communes. Et, conscient que, pour la république florentine et pour lui-même, il serait très dangereux que l'un des plus puissants accrût encore sa puissance, il s'employait de toutes ses forces à maintenir les choses de l'Italie si bien équilibrées que la balance ne penchât ni d'un côté ni de l'autre ; ce qui ne pouvait se faire sans la préservation de la paix et sans surveiller avec la plus grande diligence chaque événement, fût-il minime ».
(Francesco Guicciardini, Histoire d’Italie, 1492-1534, Bouquins, Robert Laffont, 1996, Vol. I, pp. 4-5)
Conséquences de la mort de Laurent et d’Innocent VIII
Tel était l'état des choses, tels étaient les fondements de la tranquillité de l'Italie, disposés et équilibrés de sorte que non seulement on ne craignait nul changement pour le présent, mais que l'on ne pouvait. prévoir aisément par quelles décisions, dans quelles circonstances ou par quelles armes pourrait être perturbé un tel repos. Quand, au mois d'avril de l'an 1492, survint la mort de Laurent de Médicis, mort prématurée pour lui, puisqu'il mourut avant la fin de sa quarante quatrième année, prématurée et cruelle pour sa patrie, où foisonnaient admirablement, grâce à sa réputation et à sa prudence, grâce à son esprit très ouvert à toute chose honorable et excellente, les richesses et tous ces biens et ornements qui accompagnent d'ordinaire, dans les choses humaines, une longue paix. Mais ce fut aussi une mort fort dommageable pour le reste de l'Italie, tant par l'activité qu'il déployait sans cesse en faveur de la sécurité de tous, que parce qu'il était un facteur de modération et presque un frein dans les désaccords et les soupçons qui, pour diverses raisons, naissaient souvent entre Ferdinand et Lodovico Sforza, princes d'une ambition et d'une puissance presque égales.
La mort de Laurent - les choses s'acheminant chaque jour davantage vers les calamités futures - fut suivie, quelques mois plus tard, par la mort du souverain pontife ; la vie de ce denierr, pour le reste inutile au bien commun, avait au moins une utilité : après avoir bien vite déposé les armes qu'il avait prises sans succès contre Ferdinand à l'instigation de nombreux barons du royaume de Naples au début de son pontificat et après avoir par la suite tourné totalement son esprit vers des passe-temps d'oisif, il n'avait plus, ni pour lui-même ni pour les siens, nourri de projets qui eussent pu troubler la félicité de l'Italie.
Le successeur d'Innocent fut Rodrigue Borgia, natif de Valence, une des cités royales d'Espagne, cardinal parmi les plus anciens et les plus importants de la cour de Rome, élevé cependant au pontificat par les dissensions qui régnaient entre les cardinaux Ascanio Sforza et Giuliano de Saint-Pierre-aux-Liens, mais bien davantage - exemple sans précédent pour l'époque - parce qu'il acheta ouvertement, partie avec de l'argent et partie en promettant certains de ses offices et bénéfices, qui étaient considérables, les voix de nombreux cardinaux qui, au mépris de l'enseignement évangélique, vendirent sans vergogne la possibilité de faire commerce des trésors sacrés au nom de l'autorité divine, dans la partie la plus sainte du temple. Ce fut le cardinal Ascanio qui incita nombre d'entre eux à un marché si abominable, moins par la persuasion et les prières que par l'exemple ; en effet, corrompu par l'appétit infini des richesses, il obtint pour lui-même, comme prix de tant de scélératesse, la vice- chancellerie - principale charge de la cour de Rome - des églises, des châteaux et, à Rome, le palais de la Chancellerie, rempli de meubles d'une très grande valeur. Mais il n'échappa pour autant ni, par la suite, au jugement divin, ni, alors, à l'infamie et à la juste haine des hommes, pleins d'effroi et d'horreur devant cette élection, parce qu'elle procédait de manoeuvres si détestables, et aussi parce que la nature et les habitudes de la personne élue étaient, pour bonne part, connues de beaucoup.
(Francesco Guicciardini, Histoire d’Italie, 1492-1534, Bouquins, Robert Laffont, 1996, Vol. I, pp. 7-8)
DEUX EXPLORATEURS FLORENTINS : VESPUCCI ET VERRAZANO
Amerigo Vespucci (Florence 1454- Séville 1512) est le descendant d’une famille aristocratique florentine très liée à la ville, originaire du Mugello (au nord de Florence, la région d’où venaient peut-être aussi les Médicis) ; il passa une partie de son enfance dans le château du Trebbio à San Piero di Sieve, que son oncle administrait pour le compte des Médicis.Ami de Pier Soderini, gonfalonier de justice de la République, c’est par lui qu’il fut invité à Séville pour diriger une succursale de la banque des Médicis. Il y connut Christophe Colomb qu’il contribua à financer et il se targua d’avoir fait des expériences de navigation si bien que le roi d’Espagne lui confia une première expédition en 1499, puis le roi du Portugal en 1501-02 le fit embarquer dans l’expédition de Goncalo Coelho en partance pour le Brésil, avec la tâche de rédiger la relation du voyage. Ce que fit Amerigo dans une lettre à Pier Soderini et un livret, Mundus Novus, plein d’erreurs et d’omissions (il ne cite jamais le nom de Coelho !) mais intéressant par ses descriptions de paysages, flore, faune coutumes des indigènes d’Amérique centrale et méridionale, de la Guyane presque jusqu’au détroit de Magellan...Un professeur allemand du collège de Saint-Dié, Martin Waldseemüller, qui préparait en 1507 une nouvelle édition du Traité de Ptolémée écrivit : « La quatrième partie du globe, découverte par Amerigo peut être appelée Amerigo ou Terre d’Americus ou Amérique », et il inscrivit de dernier nom sur sa carte. C’est ainsi qu’un Florentin inventa l’Amérique.Domenico Ghirlandaio a fait son portrait dans l’église d’Ognissanti. Mais le nom des Vespucci est surtout connu grâce à sa cousine par alliance, Simonetta Vespucci, maîtresse de Julien de Médicis et qui servit de modèle à divers peintres, dont Botticella pour le Printemps et pour la Naissance de Vénus.
Giovanni et Girolamo da Verrazzano (Verrazzano 1485-Brésil 1528) sont eux aussi florentins, nés selon les uns dans le château de Greve dans le Chianti, au sud de Florence, soit dans la communauté florentine de Lyon selon les autres. Giovanni signait Janus Verazanus ou Jan Verason. Issu d’une autre grande famille aristocratique (blason avec une étoile à 6 pointes), formé comme un « preux gentilhomme », il participa aux explorations de l’Amérique du Nord au service du roi de France, François I, en 1523-4 et en 1528, et il fut le premier à entrer dans la baie de New York qu’il appela Sainte Marguerite. Il n’y resta que 18 heures, croyant avoir découvert le passage vers le Pacifique. Il donnait aux localités qu‘il découvrait des noms de son Chianti natal, Rio della Foresta, Punta dell’Ulivo, Selva dei Lauri, Capo dei Cedri, Vallombrosa, ou de lieux de Florence : Orto dei Rucellai (Gli Orti oricellari).. Il mourut, dit-on, dévoré par des cannibales des Antilles. Les bourgeois lyonnais qui financèrent leur voyage étaient intéressés par le commerce de bois rouge utilisé pour la teinture des textiles, par l’or, et par le négoce de peaux d’animaux, de singes et de perroquets. C’étaient surtout … des Florentins : Thomassin Gadagne (Guadagni), Guillaume Naze (les 3/4 du commerce de poivre), Robert Albisse (Albizzi), Antoine Gondy (Gondi), et Julien Bonacorcy (Bonaccorsi) auxquels se joignirent 3 Lyonnais, Jehan et François Le Buatier et Anthoine de Martigny. Les Florentins donnèrent 3000 écus d’or, et les Lyonnais 600 ! … Mais les Florentins avaient à se faire pardonner l’alliance militaire de Florence avec Charles Quint.C’est Giovanni da Verrazzano qui initia Jacques Cartier à l’exploration de la côte Ouest du Nouveau Monde, et celui-ci découvrit, dix ans après lui, la Nouvelle France du Canada. Quant à Girolamo, géographe de qualité, il fit une mappemonde de 1,33 m. sur 2,62, aujourd’hui au Vatican, comportant 1365 noms de lieux de l’Afrique, de l’Asie et de la côte Ouest de l’Amérique..Le Palais Communal de Prato conserve de lui un portrait. Les Américains ont donné son nom au pont construit en 1964 entre Brooklyn et Staten Island (4800 m. de long, .portée centrale de 1298 m.).
(Cf. Bell’Italia, I luoghi, le città, le regioni, n. 57, octobre 2000) ; Michel Mollat du Jourdin et Jacques Habert, Giovanni et Girolamo Verrazano, navigateurs de François Ier, Collection Voyages et découvertes, Imprimerie Nationale, 242 p. Paris, 1982 ; Gérard Buétas, Verrazano, le Lyonnais qui découvrit New York, Le Monde, 9-10 avril 1995).
Bref rappel de l’art à Florence sous les Médicis au XVe siècle
1) Une pléiade d’artistes
La prospérité économique a attiré à Florence une foule d’artistes et d’artisans d’art. En 1470, il y a, selon les registres, 70 bouchers et charcutiers, 66 épiciers, 83 ouvriers de la soie, mais 84 ateliers artisanaux de sculpture sur bois et marqueterie, 54 ateliers pour le travail du marbre et de la pierre, 44 orfèvres travaillant l’or et l’argent. Quant aux artistes, ils sont recensés dans le cadre des diverses corporations et plus difficiles à compter, mais on sait qu’en 1472, il y avait dans la seule guilde Saint Luc, 30 « peintres de composition », dont 8 sont restés célèbres. Par ailleurs, le caractère public de l’art, héritage de la démocratie médiévale, a développé une sensibilité aux œuvres d’art : Vasari raconte qu’en 1501, quand Léonard de Vinci exposa dans son atelier le carton de la Sainte Anne, il y eut une véritable foule d’hommes et de femmes de tout âge et de toute condition venus contempler « l’œuvre merveilleuse de Léonard ». L’arrivée des Grecs après la chute de Constantinople et le développement de la culture platonicienne de la Beauté, la découverte des Antiquités romaines (Donatello et Brunelleschi font un long séjour à Rome pour mesurer les monuments romains, entre 1420 et 1430), contribuèrent enfin à l’épanouissement du style nouveau, de la « Renaissance ».
2) Quelques dates parmi beaucoup d’autres…
- 1377 : naissance de Filippo Brunelleschi (+ 1446)
- 1420 : nommé avec Ghiberti architecte de la coupole du Dôme
- 1420 : Vieille Sacristie de S. Lorenzo
- 1430 : commence la Chapelle des Pazzi
- 1433 : commence l’église de Santo Spirito
- 1434 : termine la coupole
- 1378 : naissance de Lorenzo Ghiberti (+ 1455)
- 1403-24 : porte Nord du Baptistère
- 1425-1452 : porte Est (du Paradis) du Baptistère
- 1386 : naissance de Donatello (+ 1466)
- 1409 : David (Bargello)
- 1425 : Crucifix en bois (Santa Croce)
- 1430 : David (Bargello)
- 1383 : naissance de Masolino
- 1387 : naissance de Fra Angelico
- 1433-40 : décoration de San Marco
- 1396 : naissance de Michelozzo (+ 1472)
- 1437 : reconstruction de San Marco
- 1397 : naissance de Paolo Uccello
- 1436 : portrait de Giovanni Acuto dans le Dôme
- 1445-50 : fresques de S. Maria Novella
- 1399 : naissance de Luca della Robbia
- 1438 : prépare avec Donatello les sculptures de l’orgue du Dôme
- 1401 : naissance de Masaccio
- 1423-6 : fresques de S. Maria del Carmine
- 1427 : Trinità de S. Maria Novella
- 1404 : naissance de Leon Battista Alberti (+ 1472)
- 1451 : Palais Rucellai
- 1470 : termine la façade de Santa Maria Novella
- 1406 : naissance de Filippo Lippi
- 1438 : Vierge de Santo Spirito
- 1465 : Vierge à l’Enfant (Offices)
- 1420 : naissance de Benozzo Gozzoli
- 1460 : fresques de la chapelle du palais Médicis
- 1423 : naissance d’Andrea del Castagno
- 1450 : fresques de S. Apollonia
- 1435 : naissance d’Andrea del Verrocchio
- 1435 : naissance d’Andrea della Robbia
- 1445 : naissance de Sandro Botticelli (+ 1510)
- 1445 : naissance de Giuliano da Sangallo
- 1480-5 : villa de Poggio a Caiano, Palais Strozzi
- 1449 : naissance de Domenico Ghirlandaio (+ 1494)
- 1470 : Vierge et famille Vespucci (église Ognissanti)
- 1485-90 : fresques de S. Maria Nov. fresques de l’église Santa Trinità (Vie de S. François)
- 1452 : naissance de Léonard de Vinci
- 1478 : Annonciation
- 1457 : naissance de Filippino Lippi
- 1488 : fresque de Santo Spiritofresques de S. Maria Nov. (chapelle Strozzi)
- 1474 : naissance de Michelangelo Buonarroti
- 1501 : David
- 1504 : Sainte Famille avec S. Jean (Offices)
3) Les influences
- BRUNELLESCHI : Michelozzo
- ALBERTI : Bernardo Rossellino, Luciano Laurana
- GHIBERTI : Benedetto da Maiano, Mino da Fiesole
- DONATELLO : Desiderio da Settignano, Antonio Pollaiuolo, Verrocchio
- MASACCIO : Mantegna
- VERROCCHIO : Lorenzo di Credi, Léonard de Vinci
- MASACCIO : Piero della Francesca, Filippo Lippi
- FILIPPO LIPPI : BOTTICELLI
- BOTTICELLI : Filippino Lippi
Les derniers Médicis
Chassés de Florence, les Médicis rentrent en 1512, après 18 ans d’absence durant lesquels s’est établie une République. Il ne reste de la branche de Cosme l’Ancien que :
- Giovanni (1475-1521), fils de Laurent le Magnifique, fait cardinal à l’âge de 14 ans, devient pape sous le nom de Léon X (de 1513 à 1521), grand mécène et dernier représentant de la « Renaissance ».
- Giuliano (1479-1516), 3e fils de Laurent le Magnifique, dux de Nemours.
- Giulio (1478-1534), fils naturel de Giuliano, frère de Laurent tué en 1478 durant la conjuration des Pazzi, devient pape sous le nom de Clément VII (1523-1534), subit le schisme luthérien, le sac de Rome par les armées impériales, et impose le retour des Médicis à Florence en 1530.
- Lorenzo II (1492-1519), fils de Pierre le Malchanceux, petit-fils de Laurent, duc d’Urbin.
- Alessandro (1510-1537), fils naturel du duc d’Urbin, assassiné par Lorenzino (le « Lorenzaccio » de Musset).
- Ippolito (1511-1535), fils naturel du duc de Nemours, devenu cardinal.
C’est pour les tombeaux du duc d’Urbin et du duc de Nemours que Michel-Ange sculpte les statues de la Sagrestia Nuova de San Lorenzo en 1520, puis en 1530-33.
La fille du duc d’Urbin, Catherine (1519-1589), épouse Henri II de Valois et devient reine de France, mère de François II, Charles IX et Henri III.
Les Médicis sont à nouveau chassés par un retour de la République de 1527 à 1530.
À la mort d’Alessandro, 1er duc de Florence à partir de 1530, le pouvoir passe donc à l’autre branche de la famille, issue de Lorenzo (1395-1440), le frère de Cosme l’Ancien. Giovanni, dit « dalle bande nere » (bandes noires qu’il faisait porter à ses soldats en signe de deuil après la mort de Léon X), grand condottiere, meurt à 28 ans en 1526, pendant la guerre contre les lansquenets impériaux.
C’est son fils Cosme qui devient duc en 1537, puis grand-duc en 1569, sous le nom de Cosme I, mais il ne réussit pas à obtenir le titre de roi : l’empereur, les rois de France et d’Espagne ne veulent pas accorder ce titre à des fils de marchands ! Il épouse Eléonore de Tolède, fille du Vice-roi de Naples à qui Cosme remet la salle capitulaire de Santa Maria Novella qui devient « Cappellone degli Spagnoli ». Eléonore achète en 1549 un palais commencé par Luca Pitti sur plans de Brunelleschi, et elle confie à Niccolò Pericoli (il Tribolo) la construction du jardin à destination de ses 8 enfants (Jardin des Boboli).
En 1540, Cosme quitte le palais Medici pour s’installer à Palazzo Vecchio (décoré par Giulio Vasari à partir de 1556) puis au palais Pitti qu’il fait agrandir par B. Ammanati. À partir de ce moment, les motifs religieux et « civiques » des monuments florentins (emblèmes républicains, lions, vierges, saints …) disparaissent pour laisser la place aux motifs dynastiques ou mythologiques (personnages de la famille des Médicis, divinités païennes, références à la littérature classique). Les travaux pour l’aménagement des « Uffizi » (les bureaux de l’administration florentine, devenus musées) commencent en 1560.
Le retour à la terre et le temps des « villas » et des jardins
Le règne des Médicis fut marqué par quelques conquêtes (prise de Sienne en 1555, malgré la défense acharnée dirigée par un capitaine français, Blaise de Montluc, Voir ses Commentaires), faisant de Florence la capitale de la Toscane, dont toutes les autres villes perdent leur autonomie. Pour défendre ce nouvel État, Cosme crée une armée, un Ordre militaire, les chevaliers de Saint-Etienne (1561) pour défendre la flotte des attaques des barbaresques ; en 1569, il construit la Fortezza da Basso pour s’y réfugier en cas de révolte. Mais l’industrie de la laine, principale source de richesse, périclite, et la nouvelle production, les tapisseries, ne suffit pas à la remplacer. Ferdinand I développe l’industrie de la soie et la culture du ver à soie. Cosme II ferme définitivement la banque des Médicis au début du XVIIe s. et supprime ses filiales des 4 continents.
Les marchands et les banquiers abandonnent le commerce et les grandes entreprises (parmi les derniers grands voyageurs, Vespucci et Verrazano. Cf. fiche) et investissent désormais dans la terre et l’agriculture. La grande bourgeoisie d’affaires se transforme en aristocratie terrienne. C’est le temps des villas résidentielles, palais transférés à la campagne, qui permettent de vivre dans le luxe tout en surveillant le travail des paysans. Buontalenti aménage la Petraia entre 1576 et 1589, Artimino en 1894 ; les anciennes villas du XVe s. sont restructurées et aménagées de façon plus luxueuse. Elles s’assortissent de jardins, sur le modèle de celui des Boboli (Cf. fiches sur les « Orti oricellari » et sur la Petraia). Cosme entreprend de grands travaux d’assèchement des marécages de la maremme, du Val di Chiana, du Val di Nievole. Eléonore et 4 de ses enfants meurent des fièvres contractées dans la Maremme.
On commence aussi à exploiter le sous-sol toscan : les marbres de Carrare, l’argent de Pietrasanta, l’albâtre de Volterra, le lignite du Valdarno, le fer de l’île d’Elbe. Le centre d’intérêt est la Toscane, plus que le monde extérieur.
La vie artistique s’étiole aussi ; la cour entretient certes des artistes de qualité, architectes (Sangallo et Ammanati), sculpteurs et orfèvres (Benvenuto Cellini), peintres (Pontormo, Bronzino, Vasari, Allori, les « maniéristes » toscans), mais les grands sont partis travailler ailleurs. Le centre de la créativité artistique est maintenant à Rome, et Florence n’a qu’une place très marginale dans la création de l’art baroque. Les artistes travaillent surtout à orner les palais et les places : Vasari achève la décoration de Palazzo Vecchio et construit le couloir secret qui permet d’aller du Palazzo Vecchio au palais Pitti ; Bartolomeo Ammanati installe sur la place la Fontaine de Neptune (1559) à l’emplacement même du bûcher de Savonarole ; pour mieux marquer la rupture avec l’esprit franciscain et dominicain, il y sculpte le premier nu féminin exposé sur une place publique (Naïade) de toute l’histoire européenne.
Les seuls domaines où se manifeste encore le génie toscan sont :
- les Académies : l’Académie florentine (1541), l’Académie du Dessin (Vasari, 1563) et l’Académie de la Crusca (1582), installée dans la villa de Castello et chargée de rédiger un grand dictionnaire de la langue italienne qui en fixerait les règles (séparer la « crusca », le son de la pure farine), dans la tradition de Dante, Pétrarque, Boccace, Poliziano et Laurent de Médicis, lui-même poète en langue « vulgaire ». De ce point de vue, Florence reste un grand centre culturel ; le toscan fournit la base de ce qui deviendra la langue italienne officielle.
- la création musicale : la Camerata Bardi - qui se réunit dans le palais du comte Bardi, ordonnateur des fêtes de la cour, et où se rencontrent les intellectuels, savants (Vincenzo Galilei, père de Galilée, Girolamo Mei), poètes (Pietro Strozzi, Ottavio Rinuccini), musiciens (Jacopo Peri, Giulio Caccini), - invente un genre nouveau qui envahira l’Europe, la « fable en musique », l’OPÉRA : la Dafne de Peri en 1597 et son Euridice, créée en 1600 pour les noces de Marie de Médicis et d’Henri IV de France. Monteverdi reprendra le flambeau en 1607 avec son Orfeo.
Dante aurait rugi en constatant l’amollissement des mœurs qui caractérise la cour. Après la mort d’Eléonore, Cosme vit avec sa maîtresse Leonora degli Albizzi, puis avec Camilla, fille de Leonora. Son fils et héritier Francesco I épouse en secret sa maîtresse, la belle vénitienne Bianca Cappello, après la mort de sa femme Jeanne d’Autriche. Isabella, fille d’Eléonore, mariée jeune pour raison politique à Paolo Giordano Orsini, s’éprend de Troilo Orsini, un cousin de son mari, qui la tue en 1576. Sa cousine est aussi tuée par son mari la même année. Giovanni de’Medici, fils naturel de Cosme I, épouse Livia Vernazza, une prostituée de Lucques. Ferdinand, fils de Cosme III, qui aimait les chanteuses et encore plus les castrats, meurt en 1713 de maladie vénérienne contractée à Venise. Les derniers grands-ducs meurent sans enfants : c’est le cas de Gian-Gastone et de sa sœur Anna-Maria-Ludovica, dont le mari, électeur palatin, était syphilitique. À la mort de Gian-Gastone, le grand-duché est assigné à François de Lorraine, mari de Marie-Thérèse d’Autriche, qui prend la succession des Médicis sous le nom de François III.
Les derniers Médicis auront aimé la musique (Scarlatti, Haendel viennent à Florence, ainsi que le claveciniste Bartolomeo Cristofori, inventeur en 1700 de « l’arpicimbalo », ancêtre du pianoforte), développé leurs palais, fait de belles collections de maïoliques, et introduit en Toscane la culture de la pomme de terre. Mais l’histoire se développait désormais ailleurs qu’à Florence qui attendra la période 1864-1870, où elle fut capitale de l’Italie unifiée, pour connaître une nouvelle phase de développement.
Eglise de San Miniato al Monte
Construite de 1013 à 1063, peut-être sur une construction carolingienne antérieure ; occupée par les Bénédictins de Cluny, puis par les Olivétains à partir de 1373. L’église, prototype de l’art roman florentin, est sous la protection de l’Arte di Calimala (aigle et ballot de drap en cuivre doré au sommet du fronton). La mosaïque de la façade est ajoutée au XIIIe s. (Christ bénissant entre la Vierge et San Miniato). Harmonie du rythme géométrique de la façade, repris dans l’intérieur de l’église.
Intérieur
-
Chapelle du Crucifix (commandée à Michelozzo en 1447-8 par Piero il Gottoso). Dans la voûte, caissons de Luca della Robbia ; derrière l’autel, tableaux d’Agnolo Gaddi (1333-1396) (Annonciation, Ascension, Histoires de la Passion, S. Miniato et Jean Gualbert). Sur la frise et la balustrade, emblèmes de Cosimo il Vecchio et de Piero.
Sur les parois latérales droites de l’église, fresques XIVe et XVe s.
-
Sacristie : décorée après 1387 par Spinello Aretino (1333-1410) sur commande d’un marchand : Histoires de S. Benoît, selon le récit de la Légende dorée de Jacopo da Varazze :
- le saint quitte sa famille et part accompagné de sa nourrice,
- Il rend à sa nourrice le plat qui s’était brisé,
- il se retire à Subiaco et reçoit l’habit,
- le jour de Pâques il est visité par un moine envoyé par Dieu,
- il vainc la tentation en se jetant dans les épines et les orties,
- il est élu abbé par les moines de Vicovaro ; mécontents, ils essaient de l’empoisonner, il brise le vase d’un signe de croix,
- il abandonne les Frères,
- il reçoit Mauro et Placido,
- il fonde Montecassino et ressuscite un frère tombé d’un mur,
- il libère un novice du démon,
- il fait jaillir l’eau et remonter un fer tombé dans l’eau,
- il fait sauver par Mauro Placido tombé dans un lac,
- il chasse le diable qui faisait peser une pierre sur la construction,
- il reconnaît l’écuyer qui se faisait passer pour Totila,
- Reproches à Totila et mort du saint.
-
Autel de S. Jean Gualbert : Histoires de sa vie. (XIVe s.)
-
Autel avec rétable de Jacopo del Casentino (début XIVe s.) : 8 Histoires de San Miniato
-
Perfection géométrique de San Miniato
-
Abside. Remarquer l’unité géométrique avec le reste de l’église. Mosaïque (Christ bénissant, entre les symboles des Evangélistes, la Vierge et San Miniato). Crucifix des Della Robbia. Stalles du XVe s.
-
Crypte (correspondant à 1/3 de l’église) : autel de 1013 construit pour recueillir les restes du martyr. Marbres précieux.
-
Chapelle du cardinal du Portugal, commandée à Antonio Manetti, élève de Brunelleschi, par le roi Alphonse de Portugal en 1459 pour son neveu, Jacques de Lusitanie, mort à Florence à 36 ans. Voûte : Esprit Saint et Vertus cardinales de Luca della Robbia (1451).
- Tombe du cardinal (Antonio Rossellino, 1459-61)
- Autel : rétable (1467) d’Antonio del Pollaiuolo (SS. Vincent, Jacques et Eustache)
- Annonciation d’Alessio Baldovinetti (1466-7).
-
Clocher (Baccio d’Agnolo, 1524-27), fortifié en 1529 par Michel-Ange qui y plaça deux couleuvrines confiées à l’artificier Lupo pour tirer sur les troupes impériales qui assiégeaient Florence ; et pour protéger le clocher, il le fit entourer de matelas et de ballots de laine. Pavement de la nef : animaux symboliques et signes du zodiaque (1207). Plafond à chevrons peints (1322).
Les légendes
-
La fondation par Charlemagne : De retour de Rome où il avait fait couronner roi des Longobards et d’Italie son fils Pépin, Charlemagne (dont on opposait la beauté à la laideur d’Attila, « chauve et aux oreilles de chien ») arriva à Florence avec sa belle épouse Hildegarde, qui voulut s’agenouiller sur la tombe de San Miniato. Son mari se souvint d’elle, agenouillée dans la petite chapelle, et quand elle mourut 2 ans après, à 26 ans, il fit un don à la petite église « pour le salut de la belle âme d’Hildegarde la pieuse ».
-
En 1018, l’évêque Hildebrand commença la construction de l’église et de l’abbaye bénédictine, la plus riche de Toscane ; il y nomma comme abbé un moine appelé Dragone et le chargea de rédiger une vie de San Miniato plus ornée et séduisante. Et, comme la tombe du saint était vide (on soupçonnait l’évêque de Metz, Théodoric, d’avoir volé les reliques de San Miniato), il découvrit par hasard, tout près, un petit cimetière avec les os de martyrs chrétiens ; il en transporta discrètement quelques-uns dans la tombe du saint, et put inventer les biographies des martyrs morts avec lui à San Miniato.
-
Le Crucifix miraculeux (maintenant à Santa Trinità) : le Vendredi Saint de 1003, Jean Gualbert degli Azzini recherchait sur la colline l’assassin de son frère et se trouva tout à coup face à lui ; l’homme s’étant jeté aux pieds de Jean Gualbert, les bras en croix, celui-ci, au lieu de le tuer l’embrassa et le conduisit devant le Crucifix qui bougea la tête en signe d’approbation. Jean Gualbert se fit moine et fonda l’ordre de Vallombreuse.



Eglise de Santa Croce, “Pantheon” de Florence
Sur une petite église franciscaine de 1228, la basilique actuelle est construite en 1294, sous la direction d'Arnolfo di Cambio, malgré l'opposition d'Ubertino da Casale, représentant du courant des « Spirituels » franciscains, qui condamne le luxe de l'église et les fresques des chapelles. Dès 1295, la Commune s'engage à donner une contribution annuelle pour la construction, les riches banquiers financent la décoration de leur chapelle privée ; en 1361, l'Arte di Calimala est chargée de diriger les travaux de construction du monastère, consacré en 1442. Il reste dans le pavement 276 pierres tombales, du XIVe au XIXe s. La façade est de 1863, en marbre blanc et vert, à partir de dessins anciens (on avait l'habitude de commencer la construction d'une église par le transept et l'abside) ; vitrail de la rosace : Descente de Croix, XVe s. Le clocher est de 1842. Dimensions : 115 m de long, 38 m. de large (73 m. au transept). La crue de l'Arno de 1966 avait causé d'énormes dommages à la basilique.
Intérieur
- Tombe de Gino Capponi (1884), patriote et historien ;
- Tombe de G.B. Niccolini (1883), patriote et poète ;
- Chaire en marbre de Benedetto da Maiano (1472-76) Histoires de S. François ;
- Mon. à Leon Battista Alberti (Bartolini, 1840) ;
- Tombe de Francesco Neri, tué en 1478 lors de la conjuration des Pazzi. Bas-relief d'Ant. Rossellino (1478) ;
- Tombe de Michel-Ange (Vasari, 1570), statues de la Peinture, de la Sculpture et de l'Architecture ;
- Cénotaphe de Dante Alighieri (S. Ricci, 1829). La Poésie pleure ;
- Mon. de Vittorio Alfieri (Canova, 1810) ;
- Porte à incrustation (Da Maiano) pour l'accès à la chaire ;
- Mon. de Niccolò Machiavelli (1787) avec statue de la Politique ;
- SS. Jean Baptiste et François (Domenico Veneziani (XVe s.) ; Annonciation de Donatello (1435), en collaboration avec Michelozzo, surmontée d'anges en terre cuite ;
- Tombe de Leonardo Bruni, humaniste et chancelier de la République (1369-1444), B. Rossellino : c'est le premier monument funéraire florentin de la Renaissance ;
- Mon. de Gioacchino Rossini (1796-1868) ;
- Tombe de Ugo Foscolo installée en 1936. Statue d'A. Berti (1938) ;
- Sépulcre du prince don Neri Corsini (1860) ;
Nef Gauche
- Mon. à Luigi Cherubini (1760-1842 : l'Harmonie couronne le génie musical de Cherubini ;
- Mon. au graveur Raffaello Morghen (1758-1833) de O. Fantacchiotti (1854) ;
- Mon. à Carlo Marsuppini (+ 1455), humaniste et Secrétaire de la République florentine (Desiderio da Settignano (1428-1464) : inspiré du sépulcre de Leonardo Bruni, situé en face ;
- Mon. à Vittorio Fossombroni (ingénieur hydraulicien et homme d'État, 1754-1844) de Bartolini. Au-dessus du monument, Assomption de la Vierge d'Agnolo Gaddi. Au-dessus de la porte latérale de la basilique, orgue colossal de Noferi da Cortona (1579) ;
- Pietà de Bronzino (1560) ; dans le sol, tombes de Lorenzo et Vittorio Ghiberti ;
- Mon. à Galileo Galilei (1574-1642), buste et Astronomie de G.B. Foggini, Géométrie de Girolamo Ticciati (1737).
Les chapelles du chœur
-
Chapelle Castellani (du Sacrement) : Histoires de S. Nicolas de Bari, S. Antoine Abbé, S. Jean-Baptiste et S. Jean l'Évangéliste (Agnolo Gaddi, 1385) ; 2 terres cuites des Della Robbia ; mon. à la Comtesse d'Albany (+ 1824).
-
Chapelle Baroncelli, Histoires de Marie et polyptyque du Couronnement de la Vierge (Taddeo Gaddi, 1332-38).
-
Couloir de la Sacristie de Michelozzo, 1445 pour Cosimo dei Medici.
-
Sacristie (avant 1332) ; triptyque : Vierge entre les SS. Grégoire le Grand et Job (Nardo di Cione, 1375) ; fresques de Spinello Aretino et Lorenzo di Niccolò ; terre cuite de G. Della Robbia.
-
Chapelle Rinuccini Histoires de la Madeleine et de Marie (Giovanni da Milano, 1366).
-
Chapelle du Noviciat (des Médicis) : Michelozzo (1445) pour Côme l'Ancien ; rétable en terre cuite émaillée d'Andrea della Robbia.
-
Chapelle Velluti (de S. Michel) : restes de fresques d'un disciple de Cavallini ou Cimabue.
-
Chapelle Calderini/Riccardi (XVIIe s.).
-
Chapelle Giugni / Bonaparte, Tombe de Caroline Bonaparte (+ 1839).
-
Chapelle Peruzzi, fresques de Giotto (post 1320), Histoires de S. Jean l'Évangéliste, Histoires de S. Jean-Baptiste.
-
Chapelle Bardi, fresques de Giotto (post 1317), Histoires de S. François d'Assise. À l'autel, S. François et 20 histoires de sa vie (Barone Berlinghieri, fin XIIIe s. : tradition byzantine).
-
Chapelle Majeure, fresques d'Agnolo Gaddi, Histoires de la Croix (1380).
-
Chapelle Tosinghi et Spinelli (Sloane), fresques de G. Martellini (1837).
-
Chapelle Capponi (de S. Anne), consacrée à la Mère italienne (1926).
-
Chapelle Ricasoli (de S. Antoine de Padoue) (1836) : Histoires de S. Antoine de Padoue.
-
Chapelle Pulci et Berardi (Bardi di Libertà), fresques de Bernardo Daddi (Martyres de S. Laurent et de S. Etienne, 1330).
-
Chapelle Bardi di Vernio, fresques de Maso di Banco (1340), Histoires de S. Sylvestre. À l'autel, Histoires de S. Jean Gualbert.
-
Chapelle Niccolini, du napolitain G. A. Dosio, marbres polychromes (XVIIe s.).
-
Chapelle Bardi, Crucifix en bois de Donatello, critiqué par Brunelleschi : Ghiberti a peint le Christ comme un paysan mis en croix « et non un corps semblable à Jésus-Christ, qui fut très délicat et, dans toutes ses parties, l'homme le plus parfait qui fût jamais né ».
-
Chapelle Salviati (de S. Laurent) : Martyr de S. Laurent (Jacopo Ligozzi, 1611), Tombe de la princesse polonaise Lamoyski Csartoryski (Bartolini, 1837).
Par les cloîtres, on arrive à la Chapelle des Pazzi, création de Brunelleschi, une des premières œuvres de la Renaissance (1430-1446), construite pour Andrea de' Pazzi :
- pronaos sur 6 colonnes corinthiennes qui soutiennent un attique interrompu au centre par un grand arc ; sur l'entablement, frise de petits médaillons avec des têtes de chérubins (Desiderio da Settignano) ;
- voûte en berceau de l'atrium, à caissons et rosaces, qui s'ouvre au centre sur une petite coupole hémisphérique décorée de petites rosaces en terre cuite émaillée de Luca della Robbia ;
- porte en bois sculptée par Giuliano da Maiano (1472) ; au-dessus, S. André de Lucz della Robbia.
Intérieur rectangulaire parfaitement proportionné, éclairé par 4 fenêtres, parois blanches et nues parcourues de pilastres et encadrements de grès bleuté ; décoration de frise en terre cuite émaillée qui surmonte de grands médaillons de Luca della Robbia (Apôtres) ; coupole avec petite lanterne ; dans les retombées de la coupole, Evangélistes (L. Della Robbia).
Dans le pré, statue du Père éternel (Baccio Bandinelli, 1549). À l'angle, portail d'accès au second cloître (Benedetto da Maiano, Michelozzo, 1450) ; le grand cloître est de Brunelleschi.



Basilique Santa Maria Novella
Construite sur la place d’un oratoire du Xe s. (restes du XIIe dans la Chapelle Bardi : fenêtre géminée), correspondant à l’actuel transept ; alors hors des murs, il est cédé aux Dominicains en 1221, tandis que les Franciscains s’installaient à Santa Croce, de l’autre côté de la ville ; il est intégré dans les murs lors de la construction de la troisième enceinte, entre 1284 et 1333. L’édifice actuel est commencé en 1278, achevé pour l’essentiel en 1360, y compris le clocher, la sacristie et la salle capitulaire (de Jacopo Talenti da Nipozzano) et consacré en 1420 par le pape Martin V. L’église et le couvent s’enrichissent ensuite grâce aux dons des grandes familles florentines dont les tombeaux (avelli) se trouvent dans l’ancien cimetière et sous les arcades du mur d’enceinte, sur la place et dans la Via degli Avelli (remarquer les blasons). La place fut créée par la République florentine en 1331-1344. En 1533, Côme I y institue la course de fiacres qui tournaient autour de deux obélisques en marbre, que Giambologna place sur des tortues en bronze en 1608.

Il y a donc deux façades, l’une achevée en 1367, dont on voit encore les 6 tombeaux avec un arc en ogive et deux portails rectangulaires dotés d’une flèche « cuspide »), et l’autre réalisée par Leon-Battista Alberti et commencée en 1458 ; il ouvre me grand portail classique, qui inclut le portail rectangulaire initial, avec ses montants ornés, et au-dessus un entablement (« trabeazione ») et un attique, qui supportent la seconde façade, avec ses volutes latérales, ornées de disques qui rappellent la rosace centrale --> grande unité des deux façades, sur un modèle géométrique, et par les deux couleurs, le vert et le blanc.
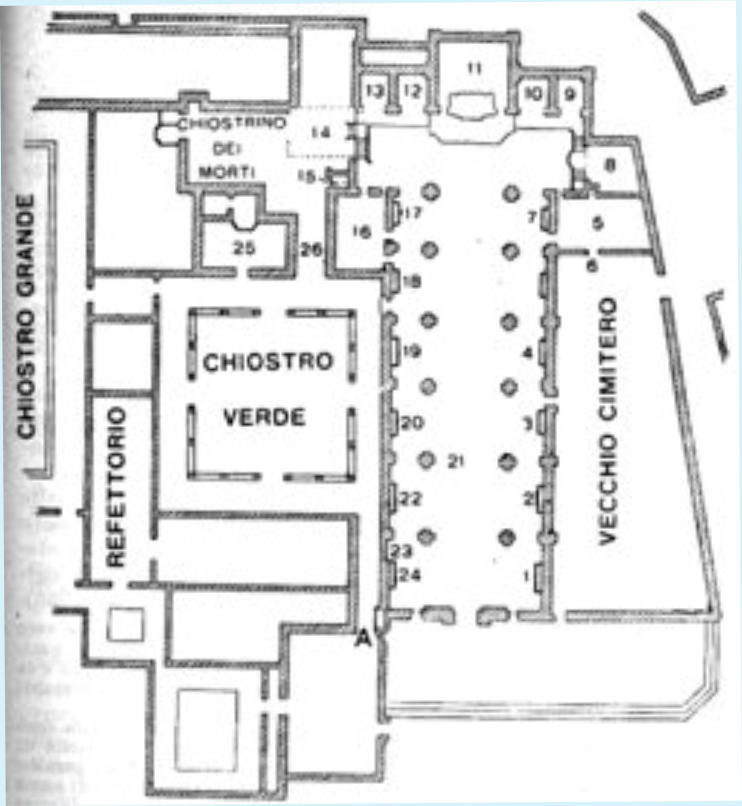
-
Tombe du sénateur Ippolito Venturi (+ 1817)
-
Mon. de la Bienheureuse Villana morte 1360 (Rossellino, 1451) et du Bien. Jean de Salerne (1340)
-
Présentation de Marie et Déposition (Naldini, 1577)
-
Mon. Minerbetti (1521). Pilier nef, bénitier (1412)
-
Chapelle della Pura (1474) voulue par les Ricasoli pour conserver la Vierge à l’Enfant considérée comme miraculeuse ; à l’autel, croix XIVe s.
-
Ancien cimetière.
-
S. Raymond ressuscite un enfant (XVIIe s.)
-
Chapelle Rucellai : Tabernacle, buste de S. Antonin, 3 tombeaux gothiques (en bas, Joseph, Patriarche de Constantinople, mort ici en 1439 pendant le Concile de Florence. À l’autel se trouvait la Madonna Rucellai de Duccio (aux Offices), à l’origine de la construction de l’église. Tombe de Paolo Rucellai.
-
Chapelle Bardi : grille XVIIe s. ; pilier d’entrée : S. Grégoire bénit le fondateur de la chapelle (1335) ; aux murs, histoire de S. Grégoire (Spinello Aretino) ; à l’autel, Vierge du Rosaire (Vasari, 1570)
-
Chapelle Filippo Strozzi : fresques de Filippino Lippi (1502) : voûte (Adam, Noé, Abraham, Jacob), paroi dr. (S. Philippe Apôtre fait sortir un monstre de sous le Temple de Mars, son haleine avait tué le fils du roi). Lunette (Crucifixion de S. Philippe). Paroi g. (S. Jean Evangéliste ressuscite Drusiana) ; lunette (Martyre du saint) ; autour décoration de Lippi ; derrière l’autel, tombeau de F. Strozzi (Benedetto da Maiano, 1491-3).
-
Chapelle Majeure : pierre tombale en bronze de L. Dati (Ghiberti, 1423). Fresques (sur commission de G. Tornabuoni) de Domenico Ghirlandaio (1485-90), avec son atelier (dont le jeune Michel-Ange : Voûte (Evangélistes) ; paroi g. (Histoires de Marie) ; paroi du fond (Couronnement de Marie, et sur les côtés de la fenêtre, S. Dominique brûle les livres hérétiques et Mort de S. Pierre Martyr ; Annonciation ; Départ de S. Jean au désert ; orants : G. Tornabuoni, le commanditaire et sa femme Francesca Pitti). Vitrail sur carton de Ghirlandaio. Paroi dr. (Histoires de Jean-Baptiste ; dans la lunette, Banquet d’Hérode). Beaucoup de personnages sont des portraits de contemporains.
-
Chapelle Gondi : Crucifix en bois de Brunelleschi (1410 ? 1425 ?).
-
Chapelle Gaddi, architecture maniériste de G.A. Dosio (1575-77)
-
Chapelle Strozzi, modèle de chapelle toscane du XIVe s., décorée à partir de 1357 par Nardo di Cione, frère d’Orcagna. Voûte (portraits de S. Thomas d’Aquin, et Vertus : Foi, Obéissance, Espérance et Force, Charité, Chasteté, Justice et Paix). Paroi du fond (Jugement dernier et vitrail sur carton de Nardo). Paroi g. (Paradis). Paroi dr. (Enfer, selon le schéma de la Divine Comédie). À l’autel, Rédempteur sur le trône et saints (Andrea Orcagna, 1357).
-
Chapelle du clocher : restes de fresques XIVe
-
Sacristie : lavabo en marbre encadré d’une terre cuite de G. Della Robbia. Crucifix de Giotto (1312)
-
S. Jacinthe (Allori, 1596)
-
Histoires de S. Catherine ; Orgue.
-
Résurrection (Vasari, 1568)
-
Annonciation (Santi di Tito, XVIe s.)
-
Chaire dessinée par Brunelleschi (1443-8).
-
Trinité (Masaccio, 1427)
-
Sarcophage en marbre noir d’Ant. Strozzi (1524)
-
Résurrection de Lazare (Santi di Tito)
Salle Capitulaire du Couvent de Santa Maria Novella (Cappellone degli Spagnoli)
1) CRUCIFIXION
.png)
Andrea da Firenze peint son grand cycle de la Salle capitulaire du couvent entre 1366 et 1368 ; celle-ci est d’abord consacrée au Très Saint Sacrement, avant de devenir « Grande Chapelle des Espagnols » lorsque, vers 1540, Eléonore de Tolède, femme de Côme I de Médicis, décida de la destiner à ses sujets espagnols pour les récompenser d’avoir aidé son mari dans ses entreprises commerciales. L’ensemble a pour but de montrer le rôle central de l’Ordre dominicain dans l’économie du salut des âmes. Les Dominicains sont représentés comme les chiens du Seigneur, les Domini canes. C’est le Prieur du couvent, Jacopo Passavanti (1298-1357), auteur d’un Miroir de la vraie pénitence où il reprend ses prédications, qui inspire le programme des fresques.Mais la société florentine a changé, elle connaît un essor de la petite et moyenne bourgeoisie aux dépens de la grande bourgeoisie qui dominait jusqu’alors la ville ; c’est une période de grande agitation politique et sociale. Les Dominicains s’adaptent au changement, font tout pour conserver la confiance du petit peuple (en 1378, ce sont eux qui seront les conseillers des « Ciompi », les ouvriers textiles révoltés contre la bourgeoisie), et le styledes fresques, s’il reste très ecclésiastique, devient aussi plus « démocratique », plus populaire. La Chapelle fut d’ailleurs construite et décorée grâce au don de 500 florins (et 200 pour son frère) du marchand Buonamico di Lapo dei Guidalotti, en 1343 ; à chaque fête du Corpus Domini, il donnait de plus 5 florins et nourrissait laCommunauté. Lapo avait été « ministre des finances » du duc d’Athènes qui, quand il fut chassé par les Florentins, se réfugia auprès d’Angelo Acciaioli, évêque de Florence et dominicain de Santa Maria Novella.Lapo fut enseveli plus tard dans la Chapelle avec l’habit de l’ordre et une pierre tombale à sa mémoire. On s’explique mieux alors l’importance de la foule populaire représentée sur les murs, en costumes d’époque, la présence de portraits de contemporains, de scènes profanes. Le symbolisme de la Doctrine thomiste se mêle ainsi au naturalisme de la représentation : les fresques pourront être lues et comprises par les Frères comme par le petit peuple, touché et séduit par ces représentations conformes à sa vie quotidienne et à son idéologie.
2) PREDICATION, MARTYRE ET MIRACLES DE S. PIERRE MARTYR
.png)
S. Pierre Martyr (1205-1252) naît à Vérone dans une famille cathare. Étudiant à Bologne, il est fasciné par les prédications de S Dominique, des mains duquel il reçoit l’habit en 1221. Son zèle et ses qualités oratoires lui valent d’être nommé prieur de diverses communautés dominicaines puis inquisiteur pour Milan puis pour tout le Nord de l’Italie en 1232. Il fut un grand persécuteur d’hérétiques cathares et patarins et organisateur de compagnies anti-hérétiques à tendance cléricale, dont la Compagnia Maggiore della Vergine (del Bigallo) à Florence vers 1250. Les patarins (du nom de la patarìa, marché aux chiffons de Milan, aux « pattes », comme on dit à Lyon) exprimaient la religiosité des classes les plus humbles en lutte contre le Haut Clergé simoniaque et inféodé à l’Empire ; en Italie, ils étaient liés aux cathares et aux albigeois. Ce sont eux qui l’attirent dans un piège entre Côme et Milan, le 6 avril 1252, et l’assassinent d’un coup de hache dans la tête tandis qu’ils décapitent le frère qui l’accompagnait ; son assassin, Carino, abjura ensuite, devint frère dominicain et mourut en odeur de sainteté. S. Pierre Martyr est invoqué pour les maux de tête ! Premier martyr dominicain, son culte fut popularisé par l’Ordre, d’abord dans de petits tableaux, puis dans les fresques monumentales de Santa Maria Novella qu’Andrea traite en intensifiant l’usage des costumes contemporains, les personnages populaires (cf. les infirmes, les malades et les pèlerins qui s’accrochent au sarcophage du saint, la scène de la prédication sur la place, etc.). Ce style démocratique va de pair avec son caractère ecclésiastique (cf. par exemple les rouleaux avec inscriptions et les figures d’Evangélistes et de Pères de l’Eglise qui ornent les bandes de séparation des fresques).
3) L’EGLISE TRIOMPHANTE ET MILITANTE
.png)
4) APOTHEOSE DE S. THOMAS D’AQUIN
.png)
Santa Maria Novella - quatre peintres, quatre styles (Giotto, Masaccio, Uccello, Ghirlandaio)
1) Le Crucifix de GIOTTO : le 11 avril 2001, le Crucifix de Giotto, en restauration depuis 12 ans à l’Opificio delle Pietre Dure, a été réinstallé dans l’église. À l’origine, il faisait peut-être pendant à la Maestà de Duccio (maintenant aux Offices) dans le transept ; puis en 1565, Vasari l’installe sur la contre façade (le support de la Croix est encore visible au-dessus de la porte). En 1937, l’œuvre se trouve dans la Sacristie. Elle a été installée au milieu de la nef centrale, accrochée à la voûte par une subtile structure métallique sans vis ni clous, au niveau des deux marches qui séparaient autrefois la partie réservée aux fidèles de celle du clergé.
Peint entre 1288 et 1290, par un Giotto encore très jeune (1266-1336), ce Christ a représenté une révolution dans la façon de peindre la crucifixion. Ses dimensions avaient frappé le public par leur ampleur (5,40 m. de haut par 4 m. de large et un poids de 250 kgs) mais surtout par l’allongement du corps : Giotto avait fait ajouter en bas du bois préparé un morceau de 30 cm puis un autre où il représenta le Golgotha avec le crâne d’Adam.
Or, « dans ces trente centimètres de bois ajouté se concrétise un profond renouvellement de la peinture », écrit Marco Ciatti, responsable de la restauration : le Christ de Giotto n’est plus une représentation symbolique, mais un corps humain tiré vers le bas par sa pesanteur physique, dépassant ainsi les dimensions traditionnelles des crucifixions.
Comparez avec la Crucifixion de Cimabue (1274) au Musée de Santa Croce : les bras sont horizontaux, l’arc du corps aux courbes très accentuées ne semble pas peser sur les membres, le symbolisme géométrique (l’ovale du visage, etc.) est encore celui de la tradition byzantine. Chez Giotto, il s’agit de la représentation d’un homme qui souffre réellement et qui s’appuie sur la croix de façon naturelle ; le sang gicle du côté et coule des mains, les côtes ressortent sur la poitrine, le pagne moule les formes. Le réalisme est encore accentué par le caractère très sculptural du Christ, de la Vierge et de Jean-Baptiste (cf. les drapés).
Ce naturalisme nouveau est en consonance avec le message religieux que les Dominicains de Santa Maria Novella voulaient faire passer, dans leur lutte contre les cathares qui condamnaient comme un mal la réalité physique. Et l’impact de l’œuvre de Giotto fut grand sur le public. En 1312, un certain Ricuccio del fu Puccio del Mugnaio insère dans son testament un legs pour que « soit toujours allumée une lampe à Santa Maria Novella devant le Christ de Giotto ». Et, dans le Purgatoire, Dante déclare la supériorité de Giotto sur son maître Cimabue (Purg. XI, 95).

2) Santa Maria Novella vient aussi de retrouver une autre œuvre restaurée par l’Opificio delle Pietre dure, la Trinità de MASACCIO (1401-1428), réalisée en 1424 ou 1426-8. Masaccio a assimilé le nouveau style théorisé par Filippo Brunelleschi, la perspective géométrique. La fresque de Masaccio présente la Crucifixion à l’intérieur d’une voûte en berceau longtemps attribuée à Filippo lui-même, tellement l’ensemble est structuré par cette recherche d’architecture.
La construction géométrique fait apparaître des triangulations ascendantes (des commanditaires du bas jusqu’à la tête du Père, dans une montée verticale de la caducité matérielle - le squelette horizontal portant l’inscription : « Je fus ce que vous êtes, et ce que je suis, vous le serez » – à la divinité éternelle) et descendantes (des angles supérieurs de la fresque aux pieds du Christ). Au milieu des deux, la figure du Christ, point central de la fresque, comme hors de la perspective, seigneur immuable du monde, Homme Dieu faisant le lien entre l’humanité d’en bas et le monde divin.
Masaccio ne se contente donc pas d’appliquer les règles nouvelles de la perspective, mais il accentue violemment la perspective de la voûte pour exprimer de façon plus forte et personnelle sa vision d’un monde à la fois géométrique et rationnel, selon l’idéologie de la bourgeoisie florentine (les marchands donateurs du bas, figures massives, peut-être de la famille Cardoni, représentés pour la première fois aussi grands que les personnages divins), mais dont l’humanité doit son affirmation à la médiation du Christ crucifié.
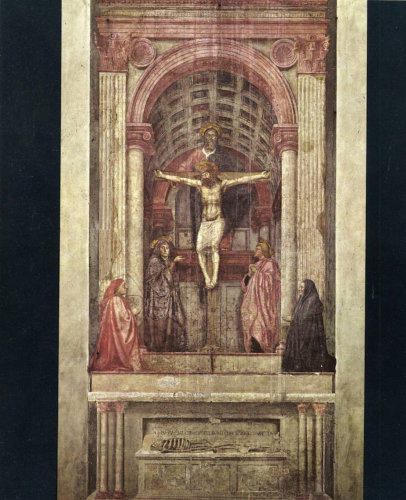
3) Avec Paolo UCCELLO (1397-1475), Santa Maria Novella présente un troisième peintre florentin représentatif de ce nouveau style de la « Renaissance », dans ses fresques déposées maintenant dans le Réfectoire du cloître, Création d’Adam, d’Eve et des animaux, Péché originel (vers 1425 ou 1430 ?) et les Histoires de Noé (vers 1447).
Uccello s’intéresse à la forme pure, à la géométrie, aux jeux d’optique et de perspective. Élève et ami de Ghiberti, il reste encore attaché aux formes gothiques (cf. les paysages fantaisistes à rochers, le drapé de Dieu le Père, etc., plus orientés par une recherche décorative que par la création d’un espace géométrique cohérent).
À la différence de Masaccio, Uccello ne s’intéresse pas à l’architecture, mais aux beaux objets et aux belles formes mises en relief par la lumière dans cet espace défini par les nouvelles règles de la perspective (cf. le Déluge, ci-dessus). Il crée des objets fantastiques comme le « mazzocchio », sorte de chapeau ou turban à facettes, qui constitue un des éléments ornementaux presque surréalistes de l’œuvre de Uccello.

4) Les fresques de Domenico GHIRLANDAIO (1449-1494), dans la Chapelle Majeure de l’église (1485-90), complètent ce panorama de la peinture florentine entre XIVe et XVe siècles. Elles sont commandées par l’oncle de Laurent de Médicis, Giovanni Tornabuoni, qui accepte de financer la décoration du chœur à la condition que ses armes figurent en bonne place et que le peintre insère des portraits de la famille Tornabuoni dans les scènes de la Vie de la Vierge.
Depuis que Gozzoli avait représenté les Médicis dans la Chapelle de leur palais, la mode du portrait collectif s’était imposée. L’emprise des grandes familles de la ville sur les commandes de peinture est de plus en plus forte : non seulement elles continuent, comme au XIVe siècle, à payer la décoration d’une chapelle pour se faire pardonner leur activité d’usure condamnée par l’Église, mais elles imposent les peintres de leur choix (c’est Giovanni Tornabuoni qui choisit Ghirlandaio) et les sujets, parfois profanes.
À Florence, ce mécénat est le fait de l’entourage immédiat des Médicis qui contrôlent toujours plus la production artistique à partir du retour à Florence de Cosme l’Ancien, en 1433.

Décoration du Campanile
La décoration du Campanile constitue un des grands programmes décoratifs de Florence. Elle actualise l’histoire chrétienne du Salut dans la Florence bourgeoise, rationaliste des XIIIe et XIVe siècles.
La structure est la suivante :
1) La faute d’Adam et Eve induit le TRAVAIL qui répond dorénavant à la NECESSITÉ de manger, s’habiller, s’abriter. Les hommes sont désormais entrés dans l’histoire à travers laquelle ils devront travailler à leur Rédemption.
2) Ce travail s’organise selon les 7 ARTS MÉCANIQUES, les 3 ARTS FIGURATIFS, illustrés par leur nature et par leurs 7 INVENTEURS (17 représentations).
3) Pour réaliser ce travail, Dieu a donné à l’homme la SAGESSE et les SCIENCES (les 7 ARTS LIBÉRAUX) qui correspondent aux 7 PLANÈTES.
4) Dieu aide l’homme en lui donnant l’ETHIQUE (les 7 VERTUS représentées par 7 PERSONNAGES), les 7 SACREMENTS ; les 9 PROPHÈTES le guident.
Les bas-reliefs de la base sont divisés en 2 zones :
1) Première zone
a) Ouest (vers le Baptistère, en partant de l’angle g.) :
Création d’Adam, Création d’Eve, Le travail de la terre (fruit de la chute et désormais nécessaire pour se procurer le pain. Cf image de gauche), la Vie pastorale (Jabal), la Métallurgie (Toubal-Caïn), la Vendange (Noé, père de l’agriculture).
b) Sud (vers la place latérale) :
L’Astronomie (Gionitus), l’Art de construire (2 ouvriers de petite dimension empilent des pierres, le contremaître est 2 fois plus grand), la Médecine (un médecin regarde en transparence un flacon d’urine), la Chasse (Cf image ci-contre), le Tissage, la Législation (Phoronée, inventeur de la loi), la Mécanique (Dédale, ingénieur).
c) Est (vers la coupole) :
La Navigation, la Justice sociale (Hercule, fondateur de Rome, et Cacus, l’éleveur), l’Agriculture, la Théatrique (ou art des jeux du cirque, de guider les chars), l’Architecture. Au-dessus de la porte, Jésus entre Elie et Moïse.
d) Nord (vers l’église) :
La Sculpture (Phidias), la Peinture (Apelle), la Grammaire (Priscinien ou Donat), la Logique et la Dialectique (Platon et Aristote), la Musique et la Poésie (Orphée), la Géométrie et l’Arithmétique (Euclide et Pythagore), l’Harmonie (Toubal-Caïn).
2) Deuxième zone
a) Ouest :
Les 7 Planètes : Saturne, Jupiter (représenté par un moine), Mars, Soleil, Vénus (un couple d’amants nus), Mercure (la science, salle de classe), la Lune.
b) Sud :
Les 7 Vertus : Foi, Charité, Espérance, Prudence, Justice, Tempérance, Force.
c) Est :
Les 7 Arts libéraux : Astronomie, Musique, Géométrie, Grammaire, Rhétorique, Logique, Arithmétique.
d) Nord :
7 Sacrements : Baptême, Confession, Mariage, Sacerdoce, Confirmation, Eucharistie, Extrême-Onction.
3) Au-dessus, Troisième zone :
4 niches par côté, contenant les Prophètes et les Sibylles, maintenant au Musée de l’Œuvre du Dôme (Cf. ci-contre les 3 zones décorées).



Santa Maria del Fiore (Duomo)
- 1) Vitrail (S. Etienne et 2 anges, Ghiberti)
- 2) S. Catherine d’Alexandrie et un dévôt (B. Daddi)
- 3) Vitrail (Assomption, Ghiberti)
- 4) Couronnement de Marie (G. Daddi)
- 5) Tombe d’A. D’Orso, évêque de Florence (Tino da Camaino)
- 6) Vitrail (S Laurent et anges Ghiberti)
- 7) Médaillon (Buste de Brunelleschi, 1447)
- 8) Tabernacle (Statue d’Isaïe, Donatello)
- 9) Médaillon (Buste de Giotto, B. da Maiano, 1490)
- 10) Bénitier gothique (1480)
- 11) Tabernacle (S. Antonin, XVIe s.)
- 12) Tabernacle gothique (S. Barthélemy sur le trône, XVe s.)
- 13) Tabernacle de marbre (Isaïe, 1427)
- 14) Faux mon. sépulcraux (Luigi Marsili e P. Corsini, arch. de Florence, 1405). Dans la 4è travée, vitrail d’A. Gaddi et buste de Marsile Ficin (1539)
- 15) S. Matthieu (XVIe s.)
- 16) S. Philippe (XVIe s.)
- 17) S. Jean Mineur (XVIe s.)
- 18) S. Jean (XVIe s.)
- 19) S. Pierre (XVIe s.)
- 20) S. André (XVIe s.)
- 21) S. Thomas (XVIe s.)
- 22) S. Jacques le Majeur (XVIe s.)
- 23) Tribune de dr. : chapelle centrale : autel de Michelozzo
- 24) Lunette de la porte : Ascension (terre cuite émaillée de Luca della Robbia, 1450)
- 25) Sacristie des Chanoines : peintures (Évangélistes et anges, XVe et XVIe s.)
- 26) Tribune centrale (de S. Zanobi), fragments de fresques giottesques (Vierge du Peuple)
- 27) Autel et urne des reliques de S. Zanobi avec scènes de la vie du saint (Ghiberti, 1432-42). Paroi du fond : Cène (Giov. Balducci, XVIe s.)
- 28) Nouvelle Sacristie, où Laurent trouva refuge en 1478 lors de la conjuration des Pazzi
- 29) Lunette : Résurrection (terre cuite émaillée de Luca Della Robbia, 1444) ; porte de bronze (1446-74, Vierge, Jean-Baptiste, évangélistes et Docteurs de l’Église, Luca della Robbia, Michelozzo) ; Armoires gravées, lavabo
- 30) Pietà (Michel-Ange, 1550). Il la destinait à sa tombe. Vierge, Nicodème, Madeleine
- 31) Pacino da Buonaguida (XIVe s., Vierge et saints)
- 32) Autel en marbre de Buggiano (1447)
- 33) S. Joseph (Lorenzo di Credi, fin XVe - début XVIe s.)
- 34) Porte de montée à la coupole, décorée des grandes fresques de Vasari (1572-4) et Zuccari (1574-9) : Jugement dernier. Montée de 463 marches jusqu’à la terrasse (91 m.) de la Lanterne (107 m.)
- 35) Sarcophage (XIVe s.)
- 36) Alessio Baldovinetti : Dante tient ouvert le livre de la Divine Comédie d’où émane la lumière sur Florence (1465)
- 37) Tabernacle avec les S. Cosme et Damien (Bicci di Lorenzo, début XVe s.)
- 38) Paolo Uccello, Faux mon. équestre de Giovanni Acuto (fresque transportée sur toile, 1436)
- 39) Andrea del Castagno, Faux mon. équestre (1456) de Niccolò Manuzi da Tolentino, condottiere des Florentins à la bataille de Maclodio (1435)
- 40) David (Ciuffagni, 1460)
- 41) Buste de l’organiste Ant. Squarcialupi (Ben. da Maiano, 1490)
- 42) Sarcophage de Pietro da Toledo (1553), Vice-roi de Naples et père d’Éléonore de Tolède, femme de Cosme I
- 43) Buste d’Arnolfo di Cambio (1843)
- 44) Josué (Tabernacle en bois, Ciuffagni, Donatello et Nanni di Bartolo, 1415-21)
- 45) Buste d’Emilio De Fabris (1808-83)
- 46) Tabernacle de S. Zénobe piétinant l’orgueil et la cruauté (fin XIVe s.)


Intérieur en croix latine, de pur gothique d’une grande ampleur (long. = 153 m. ; larg.aux nefs = 38 m. ; au transept = 90 m.) : comparer avec l’ancienne cathédrale SantaReparata, encore visible en sous-sol.
L’Eglise Santa Trinità et La Place
Place S. Trinità
Colonne de la Justice, monolithe de granit oriental provenant des Thermes de Caracalla, don du pape Pie IV (Gianangelo de’ Medici) à Cosme I (1560), qui la place ici pour rappeler la victoire de Montemurlo. Elle est surmontée d’une statue de la justice en porphyre, de Tadda (1581).
À gauche de l’église :
Palais Bartolini-Salimbeni (Baccio d’Agnolo, 1517-23), avec niches et colonnes flanquant les fenêtres surmontées de frontons classiques triangulaires ou arrondis ; les étages sont séparés par des bandeaux sculptés ; en haut, une grande corniche abrite l’édifice. Le contraste est saisissant avec les bossages lourds et encore défensifs des palais du XVe siècle qui font place à une paroi lisse dont les angles sont soulignés par des harpes de pierre. Cour centrale ornée de graffitis avec loggia (Cf. photo à gauche).
À droite :
Palais Buondelmonti (XIIIe s., refait sans doute par Baccio d’Agnolo à la fin du XVe siècle). Style plus proche de celui des palais traditionnels. La loggia de l’étage supérieur est le fruit d’une transformation récente.
À droite de la via delle Terme :
Palais Spini Ferroni, le plus grand des palais florentins du Moyen Âge (1289). La restauration de 1874 et l’aménagement récent de la partie inférieure ont supprimé l’ancienne tour d’angle et une loggia.
Actuellement siège des magasins et du Musée Salvatore Ferragamo : musée de la chaussure depuis 1927 (les chaussures fabriquées par Ferragamo pour les acteurs et actrices ou personnalités politiques, accompagnées de grands portraits ou images de films. Ouvert du lundi au samedi, 9h-13h et 14h-18h ; entrée gratuite par petits groupes).
Église
Construite dans la seconde moitié du XIIIe siècle, sur l’emplacement d’un oratoire du IXe siècle ayant fait partie d’une église de l’Ordre de Vallombreuse. Façade entre maniérisme et baroque (Buontalenti, 1593-94).
Intérieur
Parmi les premières constructions de style ogival. Sur la façade intérieure, restes de la construction romane avec fresques romanes, ainsi que sur les arcs des chapelles.
À remarquer :
- Bras droit du transept :
- Sacristie : à gauche de l’autel, tombe d’Onofrio Strozzi (1421), une des premières tombes en style Renaissance, sous un arc.
- Chapelle SASSETTI : fresques de Domenico GHIRLANDAIO (1485) :
- Sur l’arc extérieur : statue peinte de David et Sibylle Tiburtine annonçant à Auguste la naissance du Christ.
- Sur la voûte : 4 Sibylles.
- Aux murs : 6 Histoires de S. François (Répudiation des biens, Stigmates, Épreuve du feu, Approbation de la Règle, Résurrection d’un enfant de la famille Spini – avec paysages de Florence et portraits des Médicis).
- À l’autel : Adoration des bergers.
- Sur les côtés : tombes de Francesco Sassetti et de sa femme (Giuliano da Sangallo, 1485-91).
- Bras gauche du transept (2e chapelle à gauche du chœur) :
- Tombe de l’évêque Benozzo Federighi (+ 1450), œuvre de Luca DELLA ROBBIA (1455-56).
Les banquiers Médicis dans la fresque de S. François…


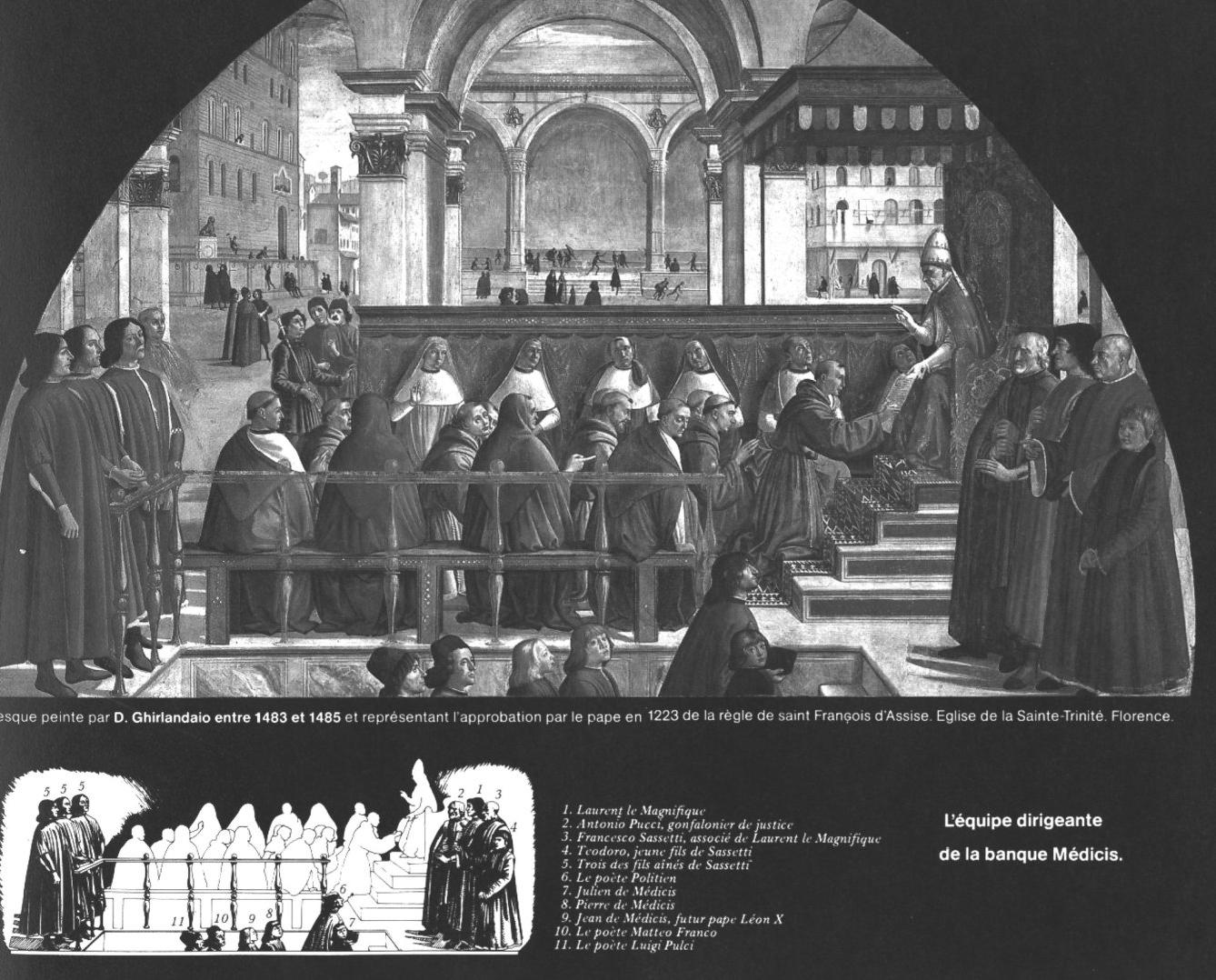
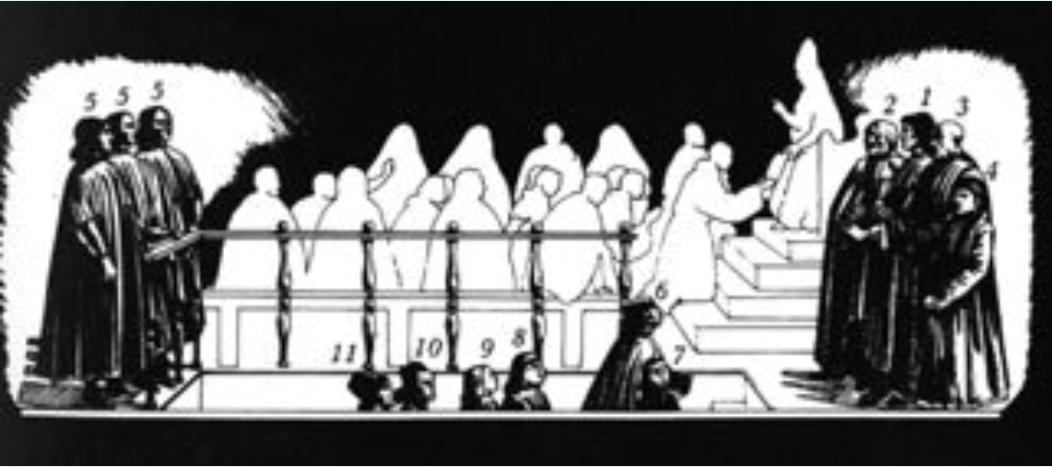
1)Laurent le Magnifique ; 2)Antonio Pucci, gonfalonier de justice ;3) Francesco Sassetti, associé de Laurent le Magnifique ; 4) Teodoro, jeune fils de Sassetti ;5) Trois des fils aînés des Sassetti ; 6) Le poète Angelo Poliziano (1454-94), humanistefamilier de Laurent ; 7) Julien de Médicis ; 8) Pierre de Médicis ; 9) Jean de Médicis, fils deLaurent, futur pape Léon X ; 10) Le poète Matteo Franco ; 11) Le poète Luigi Pulci (1432-84), auteur du poème épique burlesque Morgante.
La Chapelle Brancacci, les fresques de Masaccio et Masolino
Les numéros des tableaux correspondent au schéma de la fin du document
.png)
.png)
MASACCIO : LE DÉBUT DE LA RENAISSANCE ?
L’ensemble retrace l’Histoire du Salut, opéré par le Christ quirachète les hommes du péché originel, et que l’on atteint parl’intermédiaire de l’Eglise de Rome fondée par S. Pierre. Lesépisodes de la vie de Pierre sont tirés des Actes des Apôtres.D’autres fresques de la voûte et des lunettes ont été détruites auXVIIIe s.

Botticelli, l’Adoration des Mages


Identification probable des personnages1) Le commanditaire, Gaspare Lami(2) Lorenzo il Magnifico(3) Angelo Poliziano(4) Pico della Mirandola(5) Cosimo il Vecchio(6) Piero il Gottoso(7) Giovanni de’ Medici(8) Giuliano de’ Medici(9) Filippo Strozzi ?(10) Giovanni Argiropulo(11) Lorenzo Tornabuoni(12) Autoportrait de Botticelli
Le Jardin des “Orti Oricellari”
Lorsque la culture était le fait d’une petite minorité, les débats n’avaient pas lieu dans de grandes salles fermées, mais au grand air : on estimait que le contact avec la nature permettait de mieux jouir du plaisir de la dissertation et de la réflexion. C’est donc dans les jardins que les élites se retrouvaient pour jeter les bases des nouvelles théories philosophiques et scientifiques à appliquer dans la vie pratique ou à transposer dans les livres.
Les jardins Oricellari sont un de ces lieux historiques où s’élabora la pensée de l’humanisme florentin. C’est ici que se réunit la célèbre « Académie Platonicienne des Jardins » animée par Laurent le Magnifique et Marsile Ficin. Le jardin fut alors chanté par l’humaniste florentin Pietro Crinito (1465-1507) dans son De Silva Oricellaria. C’était un microcosme, une forme symbolique de l’univers où, tel Dieu, régnait le Prince.
Un lieu d’échanges intellectuels
Alors que Careggi (autre villa médicéenne des environs de Florence) était plus littéraire et philosophique, ici on parlait plutôt d’histoire, de politique, de philosophie politique, au milieu des bosquets, des statues de divinités protectrices des arts et des sciences, et des héros de l’Antiquité classique. S’y réunirent Jacopo da Diaceto, le poète Luigi Alamanni, l’historien Jacopo Nardi, Nicolò Machiavelli et beaucoup d’autres dont les noms sont rappelés sur la base d’une colonne du jardin.
En 1523, l’Académie fut fermée, suspecte d’être favorable à la République et hostile aux Médicis de retour à Florence ; Alamanni et Nardi durent s’exiler et Machiavel fut soumis à la torture, refusant de confesser un complot auquel il n’avait pas participé. Mais le jardin continua.
Origines et transformations
Il avait été créé en 1481 par Nannina de’ Medici, sœur de Laurent, qui avait épousé en 1461 Bernardo Rucellai (forme moderne de l’ancien « Oricellari ») et avait acquis des terrains dans cette zone dite « il pantano », le marais. Plus tard, son mari avait agrandi le terrain pour y construire un grand jardin de réception, où se rendit Charles Quint lors de son passage à Florence.
Le jardin passa aux Médicis en 1573 et fut le lieu des amours passionnées de Francesco I et de sa maîtresse vénitienne Bianca Cappello qui aimait particulièrement ce lieu sensuel pour rencontrer Francesco qui l’avait acheté pour elle, jardin excentrique de délices, marginal par rapport à l’axe traditionnel des jardins médicéens, qui allait de San Marco aux Boboli.
Ainsi, ayant finalement épousé Francesco après la mort de sa femme et devenue Duchesse de Toscana, Bianca donna la villa à don Antonio de’ Medici qui la loua à l’Ambassadeur de Venise.
Le jardin au XVIIe siècle
En 1640, elle revint au frère du grand duc Ferdinand II, le cardinal Giovanni de’ Medici qui transforma le jardin en lieu de divertissement et de loisir, selon la mode du XVIIe s. : aménagement scénographique, grotte de Polyphème (symbole du passage de la réalité à l’inconnaissable), jeux d’eau et statue gigantesque du Cyclope (symbole de la Nature brute dans un lieu organisé par l’Art) réalisée par le sculpteur Antonio Novelli (1601-62).
La statue, de 11 m de haut, semble de marbre, alors qu’elle est faite de briques recouvertes de stuc, à partir d’une armature de fer qui passe par les jambes, forme l’ossature du torse dans lequel se trouve un grand récipient en cuivre destiné à recevoir l’eau qui circule ensuite jusqu’à la vasque à laquelle il s’abreuve. Outre les jambes, l’ensemble est soutenu par un drap qui voile sa nudité et cache un axe métallique, et par le bâton sur lequel il s’appuie.
Évolutions ultérieures
Le jardin changea ensuite plusieurs fois de propriétaires qui en modifièrent le style en fonction des modes du temps. Au XIXe s., le marquis Giuseppe Strozzi-Ridolfi chargea l’architecte Louis de Cambray Digny de lui donner un aspect romantique et d’y construire un petit Panthéon, au milieu des polémiques et des critiques des Florentins qui appréciaient peu que l’on transformât ce lieu historique.
Le jardin fut encore réduit par le percement de la rue Bernardo Rucellai (degli Orti Oricellari).
État actuel
Aujourd’hui l’ensemble est loué à la Caisse d’Épargne de Pise qui l’entretient (souvent mal !) et l’ouvre au public. On y trouve encore le grand cèdre du Liban, un bosquet, quelques haies dans le pré, la statue de Polyphème ; mais la grotte appartient à d’autres propriétaires.
On peut encore y rêver aux temps où s’y retrouvaient les intellectuels qui pensèrent l’humanisme et où Bianca Cappello y aimait Francesco… Après les pensées, les baisers… Un lieu magique, comme tous ces jardins fermés qui voulaient retrouver un paradis perdu.




Le Jardin de Castello et La Villa de La Petraia
LE JARDIN DE CASTELLO
« La villa de Castello se situe non loin de Careggi, au nord-ouest de Florence. Ancien château fort du XIIIe siècle conçu autour d'une cour à portique, il fut acheté et transformé en villa par les Médicis en 1477. Jean des Bandes noires y habita avec sa mère Catherine Sforza. Fort appréciée, elle fut saccagée par leurs opposants, en 1527, lors de leur exil de Florence. C'est en 1538 que le nouveau duc Cosme I, désireux de profiter du calme de Castello après sa nomination mouvementée et la bataille victorieuse de Montemurlo, chargea Niccolò Tribolo de restructurer entièrement la villa et son jardin. Il y passa les dernières années de sa vie avec sa seconde épouse, Cammilla Martelli. Après sa mort en 1574, la propriété demeura dans la famille (Bianca Cappello y habita) jusqu'au milieu du XVI11e siècle, puis passa à la maison de Lorrame, qui lui fit subir quelques transformations, en particulier sous l'égide du grand-duc Pietro Leopoldo qui en fit orner de fresques l’intérieur. L'Etat en hérita en 1924.
La grande façade blanche aux lignes simples qui s'allonge sous le soleil de midi devant une pelouse desséchée semble décourager les éventuels visiteurs. La belle porte d'entrée en bossage de Buontalenti reste obstinément close, L’intérieur ne se visite pas (c’est le siège de l’Académie de la Crusca). Pourtant, il faut dépasser cette première impression, franchir le portail d'entrée sur la droite et accéder au pré qui précède la façade arrière. Là, l’œil ébloui embrasse la totalité d'un immense jardin à l'italienne, qui gravit en douceur par terrasses successives, la pente du mont Morello jusqu'au bois. Tribolo (1500-50), un artiste aux multiples facettes, sculpteur, topographe et hydraulicien, composa un quadrillage géométrique, réparti autour d'un axe central qui reliait l'Arno, au sud, au mont Morello, au nord, comme le montre la vue de Giusto Utens. Sur les côtés est et ouest du bâtiment, il délimite deux petits jardins secrets, aujourd'hui disparus, remplis de fleurs et de plantes aromatiques. Au sud, l'esplanade actuelle était auparavant creusée par deux viviers et prolongée dans l’axe de la porte principale par une allée formant une pergola de mûriers, qui descendait vers l'Amo.
Au nord s'étend le jardin principal, clos par un mur d'enceinte et savamment composé de parterres de buis aux formes géométriques, agrémentés de pots de fleurs et de citronniers. Au centre se détache la blanche silhouette de la fontaine octogonale, scuIptée par Tribolo. Tandis que huit pattes de griffons s'accrochent à la partie inférieure du fût, quatre joyeux chérubins serrent le cou à des oies, et l’eau, jalllie de leurs becs, alimente la première vasque. De la deuxième pendent quatre hideuses têtes de boucs, surmontées par quatre autres chérubins, perchés au sommet du fût, qui dominent le Jardin en arborant un air moqueur. Le groupe impressionnant d' Hercule terrassant Antée complétait l'ensemble (sculpture de B. Ammanati).
Plus haut, l'allée centrale mène à une autre partie du jardin, close sur la gauche par la serre à citronniers et sur la droite par l'entrepôt aux agrumes, et découpée en pelouses rectangulaires bordées de pots de citronniers. Au début de cette section s'élevait la fontaine de la Vénus Anadyomène, scuIptée par Giambologna et transférée depuis le XVIIIe siècle à la villa médlcéenne de La Petraia. Elle se trouvait au centre d'un labyrinthe surprenant, "bois sauvage et touffu de hauts cyprès, de lauriers et de myrtes", dans lequel le promeneur errait avant de la découvrir.
Le jardin se clôt par l'actuel mur d'enceinte, mais on découvre dans l'axe principal l'entrée d'une grotte bien préservée. Dans la pénombre, on distingue peu à peu une remarquable voûte aux dessins de grotesques, entièrement composés de mosaïque, coquillages et éponges, puis trois niches qui abritent un peuple d'animaux étrangement anthropomorphes, sculptés en pierre polychrome et dont les yeux vous fixent avec insistance..Au sortir de la grotte, le visiteur, ébloui par le soleil, songe à se réfugier à l'ombre du mur. Sur la droite, il découvre une ouverture qui, par quelques marches, le conduit au bois. Se perdant quelque peu dans le dédale des arbres, il parvient finalement à un grand bassin, au centre duquel surgit sur un îlot rocheux, la statue de bronze d'un vieil homme barbu et voûté figurant le mont Apennin (ou l'Hiver selon certains). Les bras croisés, l'air mi~perplexe, mi~courroucé, il semble demander: "Mais comment diable avez~vous fait pour parvenir jusqu'ici ?"L’eau des divers bassins circulait à Castello à travers un réseau complexe de canalisations, mis au point dès 1537 par Piero da San Casciano, un expert en hydraulique, et achevé après sa mort en 1541 par Tribolo : provenant de la colline de la Castellina et de la villa de la Petraia, située plus haut, L’eau cheminait par un aqueduc avant d'être distribuée dans le jardin selon la pente du mont.
Sous une apparence trompeuse de liberté le parcours du promeneur était en fait rigoureusement tracé et répondait à un programme élaboré par Cosme I et enrichi par l'écrivain Benedetto Varchi, en 1543 : chaque élément décoratif s'inscrit ainsi dans une affirmation politique du pouvoir par les Médicis, à travers le concept du retour à Florence d'un nouvel âge d'or, grâce au règne de Cosme I. Ce concept se trouve en particulier développé dans la grotte, où la figure purificatrice de la licorne permet, selon la légende, aux autres animaux de s'abreuver en toute sécurité, après qu'elle ait pIongé sa corne dans un cours d'eau empoisonné. Cosme I, symbolisé par la licorne, entend ainsi instaurer un nouveau paradis terrestre qui réunisse les Florentins sous sa protection. Cette idée est également illustrée par le thème prédominant du Printemps, à travers les forces de la nature en présence autour de la Vénus sortant de l'onde, symbole de Florence, inspirée des deux célèbres tableaux de Botticelli, Le Triomphe du Printemps et La Naissance de Vénus, qui sont précisément transférés à cette époque dans la villa.Cependant, Tribolo, accablé par les autres commandes du duc, n'eut pas le temps d'achever son fabuleux projet. Celui-ci fut poursuivi avec quelques modifications, de 1550 à 1574, par Giorgio Vasari, qui relata dans ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes une complète description de la villa, puis en 1592, par Buontalenti.
Le jardin de Castello, bien que modifié, demeure un exemple original d'imagination scénique au service du pouvoir médicéen, s’exprimant par le biais d'un parcours étonnamment artificiel, semé d'allégories et de mythes. Le premier du genre en Europe, il enthousiasma tous ses contemporains et fut fréquemment copié jusqu'au XVIIIe siècle.
(Sophie Bajard et Raffaello Bencini , Villas et jardins de Toscane, Terrail, 1992, pp. 49-52)




LA VILLA DE LA PETRAIA
Ancienne casa da signore du XIIIe siècle, créée par les Brunelleschi (qui y soutinrent l’assaut de Giovanni Acuto), elle passe aux mains des Strozzi au XIVe siècle, avant d'être confisquée par les Médicis en 1530. En 1568, Cosme 1 en fait cadeau à son fils Ferdinand et en 1591, celui-ci se décide à y faire quelques travaux et charge, semble-t-il, Buontalenti de la transformer en villa de plaisirs. L’architecte conserve la structure carrée de l’édifice médiéval, creusée par une cour centrale. La façade harmonieuse aux larges fenêtres est dominée par l'ancienne tour de garde du XIVe siècle, posée sur des consoles moulurées, qui conserve encore son aspect fortifié, malgré l'ajout de l'horloge et des fenêtres à meneaux au XVIe siècle. Buontalenti, enfin, restructure le jardin le long de la pente, qui gardera son aspect originel jusqu'au XVIIe siècle.
.png)
La cour centrale intérieure est toute décorée de fresques qui représentent d’une part les actions héroïques de Godefroy de Bouillon lors de la prise de Jérusalem (de Cosimo Dati, 1590) et d’autre part les Fastes des Médicis (de Voterrano, 1636-1647). La couverture fer et de verre est de 1872.On peut visiter avec grand intérêt les autres pièces de la villa, salle à manger, studio, salons , chapelle du rez-de-chaussée et du premier étage.
