











Storia dei popoli d’Italia e canzone - 2° partie suite 3
II. - La féodalité s’installe, et subsiste même dans le modèle communal
(La feodalità si stabilisce e rriane anche nel modello comunale)
L’Italie a donc connu une période où s’est développée une économie féodale, entre le VIIIe et le XIe siècle, en commençant par les Longobards, mais surtout après
l’éclatement de l’empire carolingien. Qu’est-ce que la féodalité ? Ruggiero Romano (1923-2002) a très bien résumé cette
question 11. Il en définit trois caractéristiques :
* Un bénéfice (il beneficio) : la concession à usage précaire (sans propriété) d’un bien, une terre, un droit, une fonction, et
cela existait déjà dans le bas-empire romain. Mais ce qui est nouveau, c’est que celui qui reçoit le bénéfice devient le «
vassus », le vassal, du gaulois « uassos » devenu en latin médiéval « vassus » = « serviteur », puis « homme en arme »,
qui donne « vassal » comme adjectif puis comme substantif dans le sens de « noble dépendant d’un seigneur dont il tient un
« fief » (il fèudo) », mot d’origine discutée, probablement germanique venu par les Longobards. La nouveauté du vassal est
qu’il est solennellement « investi » dans une cérémonie au cours de laquelle le seigneur le touche ave un symbole de son
autorité (son sceptre par exemple), c’était ce qu’on appelait « l’inféodation ». Le vassal est le « feudataire » (il feudatario).
* Cela obligeait le vassal à la fidélité au seigneur (senior, dominus), principe de vassalité (il vassallaggio), éthique et
religieux plus que juridique, un vassal peut par exemple divorcer si sa femme ne veut pas le suivre lorsqu’il doit
accompagner le seigneur à la guerre. La nature de « l’hommage » (l’omaggio) peut être différente. Le vassal peut aussi
concéder une partie de son bien à un sous-vassal appelé « vavasseur » (il valvassore), qui s’engage à son tour à lui prêter
fidélité, et cela va peu à peu désagréger l’autorité du seigneur. Car le vavasseur peut à son tour diviser son bien en le
remettant, dans les mêmes conditions, à un arrière-vassal (il valvassino) qui n’a pas les mêmes droits juridictionnels.
* D’autant plus que le bénéficiaire dispose d’une immunité, par laquelle le seigneur renonce à son propre droit de justice et
de fiscalité. Ainsi le feudataire peut empêcher des fonctionnaires du seigneur d’inspecter son territoire ; c’est une véritable
capitulation du pouvoir central devant les droits du feudataire, alors que l’hommage féodal visait à renforcer le contrôle du roi
ou de l’empereur sur tous ses sujets à travers cette pyramide féodale. Bientôt, vue la faiblesse des héritiers de
Charlemagne, la société féodale est conduite à la multiplication des duchés, des comtés (comes, comitis), des grands
seigneurs qui se rendent indépendants de l’empereur, et ce sera souvent le conflit entre eux. (Voir :
www.herodote.net/histoire).
Ainsi on peut dire qu’il n’y a pas de féodalité « pure », mais qu’il y eut dès l’origine une corruption du principe et que ce qui
prévalut, ce fut l’usage (la consuetudine). Or les usages étaient multiples selon les régions féodalisées, de la Marche du Frioul au
Marquisat d’Ivrée, du Marquisat de Toscane au Duché de Bénévent, chaque région étant elle-même divisée en plusieurs petits
Marquisats dominés par autant de dynasties : la fragmentation se développe dans le tissu féodal, et deux juridictions s’y affrontent, le
droit franc et le droit lombard. Le premier, qui s’affirme dans l’Italie méridionale et en Sicile, établissait que le patrimoine n’est
transmissible qu’à l’aîné des fils et il est indivisible ; le second, dominant dans l’Italie du centre et du nord, dit au contraire que le
patrimoine est divisible entre les enfants. Cela explique la permanence des fiefs en Italie du Sud et la fragmentation en Italie centrale et
septentrionale, qui se traduit par un développement du particularisme provincial du centre et du nord, une sorte d’anarchie, qui va à
l’encontre de ce grand projet impérial où les féodaux devaient former une courroie de transmission entre le sommet de la
pyramide de l’État et l’ensemble du peuple, et ce faisant assurer l’unité générale, la justice et la paix. Seul Frédéric II (ci-contre
Frédéric II et son faucon, image de son De arte venandi cum avibus) tentera d’imposer cette vision de l’État à ses féodaux, avec cet idéal
de justice et de paix, qui incluait aussi l’utilisation de la force militaire et une violence parfois immense. Après lui, on retrouva cette
situation où les féodaux rivalisaient, s’accordaient, se combattaient, selon les moments historiques. L’anarchie fut la même dans
l‘aristocratie religieuse : les évêques des villes et les abbés des monastères se comportent de plus en plus comme n’importe quel
seigneur féodal laïque.
Cela va conduire à l’élection par les féodaux d’un roi d’Italie toujours plus faible face à leur importance économique et sociale. La liste
des rois d’Italie entre 813 et 973 (voir ci-dessous) manifeste très bien cette faiblesse face aux féodaux qui les élisent ; Hugues de
Provence sera un des rares à résister un peu à la pression des Grands. Puis la dynastie des Othons s’opposa à la grande féodalité au
profit des évêques et des feudataires mineurs. Et plus tard, c’est Arduin (965-1014), le marquis de la Marche d’Ivrée, qui fut élu roi
d’Italie par la grande féodalité laïque contre l’empereur germanique Henri II de Saxe (976-1014-1024), mais il dut se retirer quand Henri descendit en Italie en 1004 puis
en 1013. Ce sont des exemples de cette anarchie qui règne alors en Italie, et qui, de la
même façon, influence l’élection des papes romains.
L’accentuation de l’anarchie contribua peu à peu à affaiblir les Grands au profit des
petits feudataires et des évêques, à qui les Souverains concèdent de plus en plus de
privilèges pour affaiblir les Grands féodaux. La féodalité ne disparaît pas, mais elle
change de forme, et sombre dans un désordre incroyable d’alliances, puis de conflit
entre évêques, rois d’Italie, empereur, pape, comtes, bourgeoisie, etc. Et de là sort
souvent l‘apparition des premières Communes libres, comme à Milan (Voir dans le
texte de Romano l’histoire des conflits entre le roi Conrad II et l’évêque de Milan
Ariberto (970-1018-1045). C’est souvent dans les interstices de l’histoire que se
forgent des éléments nouveaux. En effet la bourgeoisie prend de l’ampleur, et le «
modèle communal » se crée peu à peu. Celui-ci n’investit cependant qu’une partie
des villes italiennes : de 200 à 300 villes forment des communes à la fin du XIIe siècle,
mais au moins 80% de la population vit dans les campagnes, atteignant au total 6,5
millions de personnes en 1100 et 11 millions en 1300. Et dans toutes les communes qui
se forment (Pise en 1081, Asti en 1095, Milan en 1097, Arezzo en 1098, Gênes en
1099, etc.), le gouvernement est certes autonome et constitué dans une sorte de
démocratie, mais il faut comprendre aussi que le lien reste fort avec la féodalité qui
s’est infiltrée dans la commune et continue à contrôler l’armée et une partie de la
Justice. Certes les communes luttent contre les féodaux et souvent détruisent leurs
châteaux, les obligeant à venir habiter en ville, mais les hommes qui dépendaient du
seigneur du château continuent d’être sous sa dépendance. La limite est donc floue
entre féodalité et commune, les petits féodaux s’intègrent dans la gestion de la
commune, se rapprochent de la grande bourgeoisie ; on arrivera ainsi à une évolution
vers les « seigneuries » dans presque toutes les communes à partir du XVe siècle : voir
déjà la domination des « Noirs » (le « popolo grasso ») dans la Florence de Dante
Alighieri (1265-1321), exilé et condamné à mort parce qu’il était « blanc » (petite
bourgeoisie).
C’est pourquoi Giambattista Vico parle dans sa Scienza Nuova (1724 et 1742) de «
nature éternelle des fiefs » (Chap. XXXI). De nouveaux châteaux se construisent à côté
des villas (le château reste le symbole de la puissance de la noblesse de sang), et il
faut attendre la Révolution Française et les suites de l’Unité Italienne (fin XIXe s.) pour
voir véritablement affaiblie la féodalité : bien au-delà de la Sicile et de l’Italie du Sud, les
grands fiefs continueront à exister. Bien sûr, les « purs » rapports personnels définis au début de ce texte ne se maintiendront plus, il ne restera que les « abus » du
système, comme dit Romano (pp. 116 sq). Un exemple est celui de la pratique de ce qu’on appelle souvent le jus primae noctis, selon lequel le seigneur aurait eu le droit
(jus) de passer la nuit de noces (la première nuit = primae noctis) avec la jeune mariée et de la
déflorer. Or ce « droit » n’a jamais existé, c’était simplement une pratique (une fruitio = une
jouissance) déviante de beaucoup de seigneurs, qui n’avaient le droit que de percevoir de
leurs vassaux une taxe de mariage. Ainsi David Winspeare (1775-1847) a pu établir une
liste de ces abus pour le Royaume de Naples (Storia degli abusi feudali, Naples,1883) ;
ainsi, on pratique la torture dans les interrogatoires de justice alors que les statuts officiels
ne l’autorisent pas, etc. Les droits réels du citoyen deviennent donc flous, parce que non
appliqués par les gouvernants qui ne font que ce qui leur plaît, ce qui fait peser une menace
permanente pour tout le peuple. Si à Florence, qui n’est déjà plus une république
communale, le duc Francesco de Médicis (1574-1587) a pu « reféodaliser » la ville et son
gouvernement, c’est probablement aussi parce que, dans la commune modèle qu’était
Florence, la féodalité n’avait jamais disparu entre le XIIe et le XVIe siècle, et cela
représente une forme d’esprit, un mode de vie, qui pèsent sur la vie quotidienne des plus
faibles, et qui persisteront jusqu’au XIXe siècle, et, qui sait ?, jusqu’à l’Italie devenue
bourgeoise et capitaliste…
Le « modèle » communal
L’Italie a été incontestablement le pays d’Europe, avec les Flandres, où il y eut le plus grand développement du régime « communal ». Encore faut-il s’entendre sur ce
qu’il représentait.
D’abord, comme on l’a dit, la féodalité italienne n’atteignit jamais son épanouissement total : elle se développa relativement tard, et on ne peut pas dire que la commune
se substitue à la féodalité, alors qu’en réalité, les deux régimes coexistent et coexisteront longtemps. Inversement, l’Italie a été dès l’an Mille une civilisation urbaine qui,
de plus, héritait de la civilisation romaine, elle-même très urbanisée face aux Germains qui représentaient une civilisation plus nomade et guerrière ; et c’est à partir des
villes que se développa le nouveau régime socio-économique des communes dans l’Italie du centre et du nord. Les villes du sud (Naples, Sorrente, Amalfi, Gaète, etc.)
avaient anticipé le développement du nord, et avaient acquis leur autonomie communale, mais les rois normands puis les Hohenstaufen suffoquent très vite ces
autonomies pour renforcer le pouvoir central de l’Empire tandis qu’au centre et au nord, les communes étaient déjà assez fortes pour s‘affirmer contre la volonté de
Frédéric Ier Hohenstaifen Barberousse (1122-1152-1190) et de Frédéric II (1194-1250), finalement vaincu, par sa mort et par la défaite et la mort de son fils Manfred
(1232-1266) en 1266. Les communes purent donc prendre de plus en plus d’extension sur le « contado », c’est-à-dire les circonscriptions agricoles qui les entourent (de
là le mot de « contadino » = le paysan, face au « cittadino », = le citadin et le citoyen).
Inversement, les communes, qui atteignent leur plus grande splendeur après la mort de Frédéric II, ne sont jamais l’équivalent d’« États » libres au sens moderne du
terme, car elles ne sortent jamais du respect de l’autorité impériale ou pontificale : c’est déjà de Frédéric Barberousse que les communes obtiennent des privilèges
économiques, fiscaux, juridictionnels, dans le cadre de la loi impériale, après la défaite de l’empereur en 1176 à Legnano et les paix de Venise en 1177 et de Constance
en 1183, mais cela ne supprime pas l’autorité impériale. Simplement celle-ci devient plus lointaine, elle est affaiblie, tandis que l’autorité pontificale doit aussi s’éloigner
en se transférant à Avignon, et cela permet aux communes de consolider leur liberté et leur puissance et de constituer des entités politiques et juridiques qui peuvent
avoir leur propre indépendance de politique intérieure et extérieure. De ce point de vue, l’Italie fut pendant trois siècles à l’avant-garde de toute l’Europe.
Mais, de même qu’il n’y a pas eu de régime féodal « pur », il n’y a pas eu de communes « à l’état pur ». D’abord parce qu’il y a une grande diversité de communes : à
part la plaine du Pô et l’Italie centrale, les régions périphériques comme le Frioul, le Trentin, le Piémont, le Val d’Aoste ou les régions du sud n’ont connu qu’un système
communal réduit. Ensuite parce que la nouvelle classe « bourgeoise » communale a toujours dû passer des compromis avec l’aristocratie des grands propriétaires
fonciers et avec l’aristocratie urbaine. Le seul élément dominant dans toute l’Italie est l’affirmation de l’indépendance de la ville, sous la gestion collective d’une classe
dominante oligarchique qui étend toujours plus son pouvoir sur les territoires environnants. L’existence d’une monnaie d’or communale en est le meilleur symptôme, le «
zecchino » de Venise, le « fiorino » de Florence, le « genoino » ou ducat de Gênes. C’est une société « marchande », d’un nouveau type, mais où le mot « marchand »
inclut avec les bourgeois les couches aristocratiques qui se sont insérées dans la production préindustrielle et dans la transformation et commercialisation des produits,
d’abord et surtout des produits agricoles.
Au départ, les hommes « libres » de la ville vont former peu à peu une classe de notables (i maggiorenti) qui gouvernent avec l’évêque et avec les détenteurs de
pouvoirs publics désignés par l’empereur ou le roi, et c’est l’évêque qui domine : il a été le protecteur de la ville dans les périodes de crise, il est souvent devenu le saint
patron pour avoir sauvé sa ville ; il a aidé au développement des nouvelles activités industrielles, commerciales, bancaires, il a construit et entretenu les murailles de la
ville, fait construire des cathédrales d’autant plus grandes que la ville voulait marquer sa grandeur, il a souvent exercé l’ensemble des pouvoirs publics, y-compris
militaires.
Mais quand le développement économique et démographique des villes devient assez importante, les notables vont lutter pour diminuer le rôle de l’évêque et pour gérer
eux-mêmes leurs affaires, formant un corps politique homogène qui élargit le groupe des dirigeants mais le limite toujours aux notables propriétaires enrichis, et ne
ressemble en rien à une « démocratie » au sens propre du mot : les révoltes des ouvriers des différentes corporations, comme celle des « ciompi » (les ouvriers cardeurs
les plus pauvres de l’industrie textile) à Florence en 1378, sous la direction de Michele di Lando (1343- ? ) (Cf. image ci contre à la Loggia
del mercato Nuovo de Florence) en seront la meilleure preuve. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de conflit entre les divers éléments de la
classe dirigeante, en particulier avec l’aristocratie féodale qui continuait toujours à assurer la défense militaire de la ville (les « milites »), et
contre l’empereur à qui on réclame toujours plus de libertés sans remettre en cause son autorité.
Dans un premier temps, à partir du XIe siècle, se crée une magistrature qui gouvernera la ville : les « consuls », élus par l’assemblée des
citoyens qui lui donnent tous les pouvoirs de justice, d’administration et de défense, au nombre de deux ou trois et jusqu’à 20, pour une durée
maximale d’un an. En même temps, la commune se donne des statuts, et toute une administration de spécialistes se développe, où
s’intègrent les aristocrates féodaux du « contado » que l’on oblige à venir habiter en ville, où la tour de leur palais devient le symbole de leur
puissance ; les luttes politiques se déroulent en général entre différentes factions nobiliaires qui se disputent le pouvoir (voir les histoires de
Romeo Montechi et Giulietta Capuleti à Vérone, lutte entre les Montaigus et les Capulets, à la tête des factions guelfe et gibeline). La
commune consulaire est attaquée d’une part depuis le haut par les clans nobiliaires, d’autre part depuis le bas par la bourgeoisie (notaires,
juges, marchands … ) et les petits aristocrates exclus du pouvoir, tous ceux qui se constituent en corporations (le « arti »), c’est-à dire le «
popolo », le peuple, qui ne fait partie ni des millites, les « soldats » ni des nobles, mais qui va bientôt s’organiser lui-même en « società delle
armi » dans les quartiers ou les paroisses, en accord avec les associations économiques des corporations : deux conceptions de la commune
s’opposent, et les conflits se font vite jour dès la victoire extérieure sur Frédéric Barberousse. À
Milan apparaît la « Credenza di Sant’Ambrogio » représentant le peuple avec celle qu’on appelle déjà la « Motta »
représentant l’aristocratie foncière, les grandes familles marchandes, contre les nobles et le clergé, et la violence et le
désordre augmentent de façon insupportable.
C’est alors qu’apparaît une nouvelle forme de pouvoir communal, celle du « podestat ». Dans un premier temps, il alterne
avec les consuls, puis vers le milieu du XIIIe siècle on passe à un podestat étranger, extérieur et supérieur aux factions, qui
correspond aussi aux attentes de la religiosité populaire et des Ordres mendiants dont les manifestations se multiplient (les «
flagellants » de 1260), mais aussi des marchands, des banquiers, des grands artisans qui ont besoin de paix pour travailler et
qui appuient le « popolo grasso » contre leurs adversaires, les « magnati », les grands aristocrates fonciers et les restes de la
féodalité, affaiblis par l’institution d’impôts directs selon le cadastre (la grandeur de la propriété foncière) et « l’allibramento »
(l’allivrement = fixation du revenu net imposable selon le cadastre et la classification des parcelles).
Le podestat est un professionnel, venu généralement de l’aristocratie, mieux formée à tous les niveaux, militaire, juridique,
économique : cela fait aussitôt apparaître un certain nombre de grandes familles qui donneront naissance à une bureaucratie
professionnelle qui se déplace avec toutes ses composantes, juges, administrateurs, hommes d’armes, etc., et la fonction
devient souvent héréditaire à partir du XIVe siècle.
Si bien que peu à peu, le « peuple mineur » s’organise parallèlement avec son capitaine du peuple, équivalent populaire du
podestat, mais qui, pour des raisons de compétence vient souvent aussi de l’aristocratie urbaine mieux formée ou de la vieille
féodalité ; cela sera la base de « seigneuries », exemptes d’impôts et bénéficiant de privilèges en échange de leur service
militaire. Ainsi se crée une fusion entre l’ancienne aristocratie et la nouvelle classe dirigeante communale du « popolo grasso ».
C’est alors que les villes accroissent leur pouvoir sur le « contado », la campagne environnante dont les châtelains sont de plus en plus contraints de venir habiter en
ville.
Les « communes » sont donc une organisation évolutive dans laquelle, même dans celles où les corporations marchandes sont les plus développées, ce sont les « Arts
majeurs » qui l’emportent, s’opposant et se substituant peu à peu à l’ancienne classe dominante féodale, dans un conflit qui est moins d’intérêts de classe que de vision
de la vie sociale :
* d’un côté, le modèle de vie nobiliaire chevaleresque, fondé sur les armes, la vengeance privée, le luxe, dans les châteaux ;
* de l’autre, un modèle de comportement « bourgeois » selon la « vita civile », « consciemment fondé sur une tradition de goût du travail (« laboriosità »),
d’accumulation et de réinvestissement des capitaux, d’ordre public confié à des lois ayant valeur territoriale avant tout. Les pivots centraux de ce nouveau modèle
de comportement sont constitués par la substitution de la justice publique à la représaille ou à la vengeance privée, par la lutte pour une plus grande équité fiscale,
par l’extension de l’autorité politique et juridictionnelle de la ville sur toute la campagne, avec l’affirmation de la pleine propriété allodiale (exempte de droits féodaux)
et avec le déclin du pouvoir territorial des seigneurs de la campagne et de l’aristocratie urbaine. Enfin, surtout à partir du XIVe siècle, ce nouveau modèle de
comportement joue sur la démilitarisation de la société communale : en effet, les marchands, banquiers, entrepreneurs préfèrent payer des troupes mercenaires
plutôt que de tolérer la présence agitée des soldats (« milites ») urbains » (Storia d’Italia, Bompiani, op. cit., p. 215) . D’où les « Ordonnances de Justice » de
Florence ou de Bologne.
Mais pratiquement partout, ce nouveau modèle se développe au profit d’une nouvelle oligarchie marchande qui va résister tant au tentatives de retour à un pouvoir
seigneurial comme celle du Duc d’Athènes à Florence en 1343 qu’aux tentatives d’insurrection populaire comme la révolte des « Ciompi » en 1378. Et c’est la ville qui
continue à être l’élément dominant de l’histoire italienne, au moins dans le centre-nord. Les habitants de la campagne restent l’immense majorité de la population
dominée par la ville : les paysans furent esclaves sous l’empire romain, mais, toujours moins nombreux, devinrent des serfs de la glèbe, attachée à la terre de leurs
seigneurs, et même devenus formellement « indépendants », ils sont soumis à la loi de leurs propriétaires ; et la ville dépend de la campagne d’abord pour son
alimentation, qui se commercialise peu à peu (voir l’importance des marchés et des foires), pour son industrie textile (la laine des moutons, le lin et le coton, la culture du
mûrier pour les vers à soie), pour de nombreux artisans (le cuir des animaux, le bois des forêts …). La paysannerie reste la classe dominée souvent sans beaucoup de
droits, livrée parfois à des révoltes sans succès possible.
Écoutons ce « contrasto » entre le paysan et le citadin : le contrasto est un des genres les plus traditionnels de représentation populaire, souvent improvisé par les
cantastorie sur un thème convenu, et qui avait un large auditoire, du fait de ses termes simples qui évoquaient des conflits de la vie quotidienne, richesse-pauvreté, bon-
méchant, justice-prévarication ; le contrasto était toujours écrit en hendécasyllabes et en strophes de 8 vers (« l’ottava rima »), et le dernier vers de la strophe devait
rimer avec le premier de la strophe suivante. Ici le contrasto se termine par le triomphe du paysan, évocation non du présent mais d’un avenir possible. Il est difficile de
dater cette chanson, traditionnelle en Toscane et dans d’autres régions, on la retrouve jusqu’à Cuba. Celle-ci a été recueillie par Leoncarlo Settimelli (1937-2001) en
1972.
Elle rappelle dans la présentation que le Christ était mort « fra la gentaccia », parmi les vilaines gens, c’est-à-dire les paysans ; on oppose donc Florence à « Signa »,
une localité de l’ouest de Florence, entre plaine et colline, au bord de l’Arno ; les « stropicci » (les frottements) évoquent avec ironie les efforts des classes moyennes les
plus aisées pour se rapprocher des classes les plus élevées par le soin de leurs corps, en se frottant avec du savon et du son, en se parfumant, mais ça ne te servira à
rien, tu vieillis et tu n’es plus capable de tenir ta canne ; le citadin préférerait jeter à la mer toute cette populace, mais alors, dit le paysan , notre travail (« le opre ») ne te
nourrirait plus ; je ne discute pas avec toi, dit le citadin, tu es un ignorant et tu as des parasites : tu oublies que Giotto était un petit berger qui se mit à peindre sans que
personne ne le lui ait enseigné (et c’est là une affirmation de ce qu’était la culture populaire florentine, qui connaissait et admirait ses grands artistes, Dante, Giotto, etc.).
Finalement le paysan rappelle que c’est dans ses champs que pousse tout ce que mange le citadin, tandis que sur les belles dalles des rues de Florence, rien ne
pousse, et tu n’auras qu’à mourir de faim en n’ayant plus que les dalles à manger : la ville est certes plus confortable, mais elle est stérile et suffocante, et ne peut pas se
passer des paysans, allusion « écologique », dirait-on aujourd’hui :
Contrasto tra cittadino e contadino
Débat entre citadin et paysan
(Tradizionale
Cittadini e contadini
Canto del Folklore toscano
Canzoniere Internazionale,1972)
Cristo volle morì fra la gentaccia
Le Christ a voulu mourir dans la racaille
la maggior parte gl’eran contadini
la plus grande partie, c’étaient des paysans
quando se n’avvide g1i cascò le braccia
quand il s’en aperçut, les bras lui en tombèrent
disse : son nella man degli assassini
il dit : je suis dans la main des assassins.
DECLAMATO :
DÉCLAMÉ :
« Gentilissimo pubblico / prestate
« Très noble public / Prêtez
Attenzione / Assisterete adesso allo
attention / Vous assisterez maintenant à
storico contrasto che oppone, in
l’historique débat qui oppose, dans
pubblica disfida, il cittadino di
un défi public, le citadin de
Firenze al campagnolo delle Signe …
Florence au paysan de Signa …
CITTADINO :
CITADIN ;
Come tu puzzi disse i’ fiorentino
Comme tu pues dit le florentin
tu se’ più lercio te d’una latrina
tu es plus crasseux qu’une latrine
fai ritornare a gola i’ pane e i’ vino
tu fais remonter dans la gorge le pain et le vin
la zuppa la braciola e la tacchina.
La soupe, la côtelette et la dinde.
CQNTADINO :
PAYSAN :
Te con tutti gli stropicci che ti fai
Toi, avec tous les frottements que tu te fais
con quell’acqua di crusca e saponetta
avec cette eau de son et de savonnette
con tutti quegli odori che ti dai
avec toutes ces odeurs que tu te donnes
dai fondamenti per infino in vetta,
De ton derrière jusqu’à ta tête,
presto la vita tua terminerai
tu finiras vite ta vie
‘un sei più bono a regger la gianetta
tu n’es plus capable de tenir ta canne
ti resta solo il fiato per parlare
il ne te reste que le souffle pour parler
dimmi cosa ti conta i’ tu lavare.
Dis-moi à quoi ça te sert de tant te laver ?
CITTADINO :
CITADIN :
Se fussi la giustizia vorrei fare
Si j’étais la justice, je voudrais faire
de’ contadini tutti una brancata
des paysans une seule poignée
e po’ a Livorno gli vorrei portare
et je voudrais les emmener à Livourne,
a i’ porto dove giunge ogni fregata.
Au port où arrivent toutes les frégates.
Poi gli vorrei buttar dentro ni mare
Puis je voudrais tous les jeter à la mer
pe’ levar questa setta tribolata
pour éliminer cette secte tourmentée
e buttar giù finché il mar non è pieno
les jeter jusqu’à ce que la mer soit pleine
senza rimorso nè coscienza in seno.
Sans remords ni crise de conscience.
CONTADINO :
PAYSAN :
Per pietà fiorentino parla meno
Par pitié, Florentin parle moins
lo vedo ben che t’hai perso i’ cervello
je vois bien que t’as perdu la tête
i contadin lavora i’ terreno
les paysans travaillent la terre
costudisce la pecora e l’agnello.
Ils gardent la brebis et l’agneau
Poi raccoglie frumento paglia e fieno
puis ils récoltent le blé et le foin
costudisce la pecora e i’ vitello
ils gardent la brebis et le veau
l’opre di contadin son gran talento
les fatigues du paysan sont un grand talent
bastano a prepararti i’ nutrimento.
Elles suffisent à préparer ta nourriture.
CITTADINO :
CITADIN :
Contadini io non mi ci cimento
Paysans, je ne m’abaisse pas à vous parler
i’ contadino quando parla e becca
le paysan, quand il parle il ennuie
guardalo con la mano sotto i’ mento
regarde-le la main sous le menton
in quella po’ di barba ci ha una zecca …
dans sa petite barbe, il a des parasites …
Dà più fastidio che l’inverno l’vento
il dérange plus que le vent en hiver
guardalo con la lingua i’ piatto lecca
regarde-le qui lèche l’assiette avec sa langue,
a quella mensa ove mangiate voi
dans cette cantine où vous mangez
ci mangiano maiali vacche e buoi.
Les bœufs et les vaches y mangent.
CONTADINO :
PAYSAN :
E contadini biasimar tu vuoi
Tu veux critiquer les paysans
sai dalla spina viene un be’ rosaio
tu sais que dans les épines pousse un beau rosier
se leggi i’ libro degli antichi eroi
si tu lis le livre des anciens héros
troverai Giotto gl’era un pecoraio
tu trouveras que Giotto était un berger
che pascolava gli animaletti suoi
qui faisait paître ses petits animaux
senza dinanzi di tizzone o caio
sans avoir eu personne pour lui apprendre
prese una lastra (14) bella e poi in quella
il prit une belle dalle et sur celle-ci
pitturava l’effige di una agnella.
ll peignait l’image d’une agnelle.
CITTADINO :
CITADIN :
Guarda qui grullo cosa mi favella
Regarde là, nigaud, ce que tu me racontes
a ragionar di Giotto un ti conviene
il ne faut pas que tu parles de Giotto
quello che fece lui un si cancella
ce qu’il a fait ne s’efface pas
quello che fece lui sta tutto bene
tout ce qu’il a fait va bien
lascialo stare parlarne un ti conviene
laisse-le tranquille, il ne faut pas que tu en parles
e unn’era un mammalucco come tene
ce n’était pas un idiot comme toi,
te cosa ne ragioni o montanaro
qu’est-ce tu peux en dire, oh montagnard
tu ‘n sai nemmen dar bere a i’ tu’ somaro.
Tu ne sais même pas faire boire ton âne.
CONTADINO :
PAYSAN :
Certo io non so e non imparo
certes moi, je ne sais pas et je n’apprends pas
perchè un somaro unnê mi compagnia
parce que l’âne n’est pas ma compagnie
l’ho trovato oggidì pe’ caso raro
je l’ai trouvé aujourd’hui par une cas rare
a desinare in questa trattoria.
En train de déjeuner dans cette auberge.
Oste la venga qua prenda i’ denaro
Hôtelier, viens ici, prends l’argent
gli lascio i’ posto libero e vo via
je lui laisse la place libre et je m’en vais
che molte miglia ci ho da far di strada
j’ai plusieurs milles de route à faire
do bere a i’ ciuco una mezzetta di biada.
Je donne à l’âne sa part d’avoine.
CITTADINO :
CITADIN :
Villan fottuto contadino bada
Foutu vilain paysan, fais attention
se avrò d’accordo gli altri fiorentini
si j’ai l’accord des autres Florentins
vi metterò alla porta con la spada
je vous mettrai à la porte avec mon épée
l’ingresso proibirò pe’ contadini.
J’interdirai l’entrée des paysans
E a rifinar vada come la vada
et que ça finisse comme ça voudra
sian di piano di poggio o d’Appennini
qu’ils soient de la plaine, de la colline ou des Apennins
sian di colline di coste o di valle
qu’ils soient des collines, des côtes ou de la vallée
e si rinserran tutti nelle stalle.
qu’ils s‘enferment tous dans leurs étables.
CONTADINO :
PAYSAN :
Quando avremo pieni baliri sacchi e balle
Quand nous aurons des barils pleins, des sacs et des bottes de foin
che ogni raccolto a noi tanto ci preme
dont chaque récolte nous importe tant
e quelle pesche colorite e gialle
et ces pêches colorées et jaunes
‘gni genere di frutta ed ogni seme.
Toutes sortes de fruits et de graines
Que’ prosciutti que’ salami e quelle spalle
ces jambons, ces saucissons et ces épaules
fra noi villani mangeremo insieme
nous mangerons entre nous les vilains
tacche piccioni galletti e pollastre
des dindes, des pigeons, des poulets et des poulardes
e tu grullarello a Firenze mangerai le lastre.
Et toi petit nigaud tu mangeras tes dalles.
Angelo Branduardi (1950- ) a écrit en 2000 une série de 11 chansons tirées des Sources franciscaines, quelques-unes sont des résumés des Fioretti, entre autres
l’histoire du loup de Gubbio. On peut la lire de plusieurs façons, mais l’une des interprétations intéressantes dit qu’elle évoque la période communale, et la lutte entre les
seigneurs des campagnes héritiers des pouvoirs féodaux et qui effraient encore aussi bien les paysans que les habitants des communes et la nouvelle vie communale
qui pourrait intégrer et entretenir les seigneurs, en échange de la remise de leurs terres à la commune. Le loup est donc le méchant seigneur, invité par François –
représentant la vie communale – à rejoindre la ville et à respecter la discipline « civile », auquel cas il sera protégé, n’aura plus faim et n’aura plus besoin d’exploiter les
paysans et les citadins. Cela représente l’évolution des rapports sociaux de cette époque où les communes durent limer peu à peu les pouvoirs des féodaux en les
intégrant dans les pouvoirs communaux. Certes François d’Assise ne se limite pas à ce type d’intervention mais c’est un aspect probable de son action charitable, que
l’on retrouve dans cette xylographie reproduite dans la première édition illustrée des Fioretti au XVIIe siècle, avec le loup entouré de membres déchiquetés, qui tend la
patte à François, et au fond les murs de la ville communale, ayant à droite une partie noire ornée de hautes tours, celles de palais urbains où se sont installés les
féodaux, la tout étant le symbole de leur puissance, et à gauche la ville blanche à l’intérieur de se murailles :
Il Lupo di Gubbio
(Angelo Branduardi
L’infinitamente piccolo
EMI, 2000)
Francesco a quel tempo in Gubbio viveva
François en ce temps-là vivait à Gubbio
e sulle vie del contado
et sur les route de la campagne
apparve un lupo feroce
apparut un loup féroce
che uomini e bestie straziava
qui déchirait hommes et bêtes
e di affrontarlo nessuno più ardiva.
Et personne n’osait plus l’affronter.
Di quella gente Francesco ebbe pena,
De ces gens François eut de la peine,
della umana paura,
de leur peur humaine,
prese il cammino cercando
il prit le chemin en cherchant
il luogo dove il lupo viveva
le lieu où vivait le loup
ed arma con sé lui non portava.
Et avec lui aucune arme ne portait.
Quando alla fine il lupo trovò
Quand à la fin il trouva le loup
quello incontro si fece, minaccioso,
celui-ci s’avança, menaçant,
Francesco lo fermò e levando la mano :
François l’arrêta et levant la main :
« Tu frate Lupo, sei ladro e assassino,
« Toi, Frère Loup, tu es voleur et assassin,
su questa terra portasti paura.
Tu as apporté la peur sur cette terre.
Fra te e questa gente io metterò pace,
Entre toi et ces gens je ferai la paix,
il male sarà perdonato
le mal sera pardonné
da loro per sempre avrai cibo
d’eux tu auras toujours de la nourriture
e mai più nella vita avrai fame
et plus jamais dans ta vie tu n’auras faim
che più del lupo fa l’Inferno paura ! »
car plus que le loup l’Enfer fait peur ! »
Raccontano che così Francesco parlò
On raconte que François parla ainsi
e su quella terra mise pace
et qu’il mit la paix sur cette terre
e negli anni a venire del lupo
et dans les année à venir du loup
più nessuno patì.
Plus personne ne souffrit.
« Tu Frate Lupo, sei ladro e assassino
« Toi, Frère Loup, tu es voleur et assassin
ma più del lupo fa paura l’Inferno ! »
mais plus que le loup l’Enfer fait peur ! ».
Les nouveaux maîtres, les « marchands-banquiers »
Ce qui est vrai c’est que les communes représentent l’essor de nouveaux maîtres, les marchands et banquiers qui se développent entre le XIIe et le XIVe siècles. Ce
n’est pas pour autant la mise en place d’une république démocratique, et si les paysans obtiennent plus d’indépendance par rapport aux seigneurs féodaux, ce n’est pas
par « humanisme », mais d’abord pour affaiblir les seigneurs féodaux en leur ôtant leur main d’œuvre, sans laquelle leurs terres ne rapportent plus rien. Ce n’est pas
pour autant que les « seigneurs » disparaissent ; les plus entreprenants s’intègrent dans la « commune », s’assimilent à l’aristocratie urbaine et aux « magnats » (i
magnati) de la ville pour former avec eux une nouvelle classe dirigeante qui s’orientera bientôt vers une nouvelle aristocratie terrienne et vers des « seigneuries ».
« Pays des villes », l’Italie devient aussi le « pays des marchands » ; on disait : « Génois donc marchand », ce serait valable pour toutes les villes importantes où avaient
pris de la force les « Lombards », comme on appelait les marchands-banquiers italiens dans toute l’Europe. Leur force est bien sûr économique, mais aussi politique,
sociale, et culturelle, car ils relèvent d’autres valeurs, d’autres modèles sociaux, et l’argent, la finance, est pour eux l’objectif suprême, le véritable nerf de la guerre ; ce
sont les banquiers guelfes florentins qui financeront l’entreprise de Charles d’Anjou (1226-1285) contre Manfred,
l’héritier de Frédéric II en 1266-1267, première opération de conquête du sud de l’Italie financée par des banquiers
; derrière la lutte entre les Anjou et la famille d‘Aragon (1282-1302), il y a le conflit économique entre Florence et
Gênes ; et la quatrième croisade de 1004, et le pillage de la ville chrétienne de Constantinople par les navires
vénitiens est significative de la supériorité des marchands sur les religieux. À l’occasion des Croisades, les
marchands s’ouvrent de nouvelles routes commerciales vers l’Orient
Et ce qui est dominant par rapport à la production, c’est le commerce : les marchands-banquiers fabriquent ce qui
va se vendre sur les marchés européens et orientaux, passant s’il le faut, de la laine à la soie, d’un produit à un
autre, on est banquier et marchand avant d’être producteur.
Ce sont ainsi les marchands italiens qui dominent l’Europe et l’Orient du XIe au XIVe siècle ; ils deviennent les
créditeurs des grands feudataires civils ou ecclésiastiques (les ducs de Bourgogne, les comtes de Flandre), des
nouvelles monarchies (France et Angleterre) et de la Curie pontificale. C’est aussi ce qui provoquera leurs faillites
par manque de paiement lors des crises économiques, politiques ou militaires : les Bonsignori à Sienne en 1298,
les Riccardi à Lucques en 1300, les Frescobaldi en 1311 à Florence, et toujours à Florence entre 1341 et 1347 les
Buonaccorsi, les Bardi, les Peruzzi, les Acciaiuoli par la perte des prêts aux rois de France et d’Angleterre
(Guerre de cent ans entre la France et l’Angleterre de 1337 à 1453).
C’est aussi l’époque où les marchands italiens mettent au point de nouvelles techniques commerciales et bancaires
dans la pratique du crédit qui devient peu à peu leur activité principale, à côté du transport des marchandises le
long des côtes de la Méditerranée. Les compagnies développent la « commenda » à Gênes, la « colleganza » à
Venise etc. La « commenda » était à Gênes un grand édifice, point de référence durant tout le Moyen-Âge de tous
ceux, marchands, chevaliers, soldats, pèlerins, etc. qui allaient de l’Europe du Nord au Moyen-Orient, à l’Afrique du
Nord, à la Terre Sainte, elle servait à la fois de station maritime et d’hôpital ; à Venise la « colleganza » était une
forme d’accord particulière, où un financier confiait son capital à un marchand qui le lui restituait à son retour, tandis
qu’ils partageaient les profits, ou bien les deux tiers du capital, le marchand fournissait un tiers plus son travail et au
retour ils partageaient les bénéfices. Même des doges comme Sebastiano Ziani (1102-1178), Orio Mastropiero
(1178-1192) et d’autres, faisaient déjà d’énormes bénéfices grâce à ces pratiques, dans le commerce du poivre, des
tissus précieux, des soies, des cotons, des pierres précieuses, des produits tinctoriaux, de l’or, de l’argent, du riz,
des fèves, des dattes, des plumes d’autruche, des dents d’éléphant, sans oublier les esclaves noirs, etc. ou plus
tard l’alun, le corail, le mercure, ou encore les draps des Pays-Bas, la laine, le plomb, l’étain d’Angleterre. C’est
ainsi que Venise et Gênes dominèrent pendant plusieurs siècles le commerce européen grâce à leurs flottes, les
plus puissantes de la Méditerranée : les galères vénitiennes pouvaient porter jusqu’à 200 et 250 tonnes ; même après la fin de la chrétienté au Moyen-Orient (perte de
Saint-Jean-d’Acre en 1291), les marchands italiens continuent à acheter les produits orientaux, car pour les marchands orientaux, la mer reste peu accessible ; ils
fréquentent donc toutes les grandes villes côtières de Gibraltar à l’Égypte et à la Syrie ; ils poussent même à l’intérieur des terres : en 1447, le marchand génois Antonio
Malfante ( ? -1450) va jusqu’à Touat en direction de l’or du Soudan. Mais ils pratiquent aussi la direction du Nord par l’Atlantique pour le commerce avec les Flandres :
on connaît le portrait du marchand de Lucques, Giovanni Arnolfini (1400-1472), peint à Bruges avec sa femme par Jan van Eyck vers 1434 (Cf. image ci-dessus).
C’est à travers ces échanges entre nord et sud que se prépare la Renaissance culturelle à partir du XVe siècle.
Mais les marchands italiens dominent aussi les voies terrestres, vers l’Allemagne par le Brenner, Cologne, Nuremberg, Bâle, Augsbourg, tandis que les Allemands
s’installent à Venise (l’énorme magasin du XIIIe siècle qu’est le Fondaco dei Tedeschi). Le commerce italien est parfois comparé à une sorte de pieuvre dont les bras
enserrent toute l’Europe.
Et le développement de cette nouvelle économie pousse aussi à la création de grands États ; comme écrit Fernand Braudel (1902-1985), « C’est une poussée générale
qui, en privilégiant l’économie monétaire, précipite les rapports, multiplie les échanges, rend fragiles les formations politiques trop restreintes et fabrique, pour des succès
comme marqués à l’avance, d’universelles aragnes », c’est-à-dire les nouvelles grandes monarchies de France (Louis XI, 1461-1483), l’Espagne (les Rois catholiques,
Isabelle, 1474-1504 et Ferdinand, 1479-1516), d’Angleterre (Henri VIII, 1486-1509) 12. Les villes-États italiennes vont croître de la même façon, en Italie ou en
Allemagne, mais elles rendront impossible la formation de grands États unifiés, sauf là où elles ne sont pas assez développées, comme au Piémont-Savoie, dans l’État
pontifical et dans le Royaume de Naples conquis par la famille d’Aragon en 1442 ; au Nord au contraire, les villes développées s’étendent peu à peu, Venise conquiert
Padoue, Vicence, Vérone,, Brescia, Bergame, Udine, Gênes conquiert Savone, Milan tout le Milanais, Florence s’empare de Pise en 1406, son premier accès à la mer.
Tout en restant des citées, ces villes deviennent en fait des petits États, toujours aussi dynamiques et dominants, par leurs navires de plus en plus énormes : les galères
génoises du XIVe siècle atteignent de 1200 à 1500 tonnes, et on ne fera guère mieux pendant encore 4 siècles. Mais ils ne seront ni assez grands ni assez peuplés pour
aller vers une véritable révolution industrielle et une véritable « démocratie », et ils redeviendront bientôt des États aristocratiques et princiers, dont la classe dominante
vit à nouveau de la terre.
La réalité essentielle pour comprendre l’évolution de l’Italie est l’apparition de cette nouvelle classe dirigeante formée par les grands industriels-banquiers-commerçants
qui, une fois au pouvoir en ayant éventuellement lutté contre l’aristocratie féodale, tend de plus en plus à s’assimiler aux magnats, patriciens issus de cette ancienne
aristocratie : dans le domaine économique, ils investissent dans les terres et l’agriculture, et dans le domaine culturel, ils se convertissent à un mode de vie «
chevaleresque », se font construire de splendides palais ornés pas les meilleurs artistes, recherchent des mariages qui les ennoblissent et augmentent leur puissance,
tout en n’abandonnant pas l’activité mercantile, le commerce et la finance. Le riche marchand de Prato, Francesco di Marco Datini (1335-1410) (Voir à gauche sa
statue à Prato), continue à ouvrir ses lettres par ces mots : « Au nom de Dieu et du profit … » (In nome di Dio e del guadagno…). L’Église continue certes à condamner
le profit comme « usure », mais les grands banquiers sont aussi les percepteurs des impôts recueillis par la Curie Pontificale, soit
ils prêtent aux évêques (autres grands seigneurs de la classe dominante) soit ils font fructifier l’obole de Saint-Pierre avant de le
livrer à Rome.
Cette nouvelle culture « humaniste » (le terme ne sera inventé que beaucoup plus tard) est exigée par cette classe de
marchands, dont les fils doivent apprendre à lire, écrire, compter, ils doivent connaître l’arithmétique et son application aux
opérations commerciales ; le Liber abaci (1202) de Leonardo Fibonacci (1175-1250 - Cf à droite sa statue à Pise) est une des
bases des nouvelles écoles, il introduit le nouveau mode de calcul indo-arabe dans notre civilisation alors que l’on utilise encore
la notation romaine, beaucoup plus lente et difficile, et il aborde tous les problèmes concrets
de comptabilité commerciale ; cela permet de réaliser de nouveaux livres de comptes et
d’inventer de nouvelles techniques financières, le chèque, la lettre de change, l’assurance, la
comptabilité en partie double, le calcul des changes sur les places méditerranéennes, les
prêts (dont certains, excessifs, coûteront la faillite de quelques grandes banques). Et tout
cela suppose une gestion du temps pris par chaque opération, « Ne perds jamais une heure
de temps » dit Leon-Battista Alberti (1404-1472). Les manuels de commerce italiens sont
utilisés dans toute l’Europe, comme La pratica della mercatura (1335-1343) du banquier
florentin Francesco di Balducci Pegolotti (1290-1347). Ces marchands sont en même
temps friands de lettres et d’art, ils encouragent le développement de la « novellistica » à la
manière du Décaméron (1349-1353) de Giovanni Boccaccio (1313-1375) ou des Contes de
Canterbury (vers 1387) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), puis l’écriture de poèmes
chevaleresques, ils pratiquent une abondante correspondance commerciale et littéraire.
Contre eux se dresseront les mouvements populaires de pauvres, au nom de l’Évangile, qui
combattent l’avidité des marchands, leur goût de l’argent et du luxe ; ils sont considérés
souvent comme hérétiques par une Église dont les responsables sont eux-mêmes de riches et puissants seigneurs, qui condamne
l’usure, mais en arrivera à vendre les « indulgences » : on connaît l’histoire de Pierre Valdo (1140-1218) de Lyon et des dits «
Vaudois », ou celle de François d’Assise (1181-1226), fils de l’un de ces grands marchands. La religiosité se transforme donc et les
marchands compensent leur usure par la construction d’églises, d’hôpitaux, par des donations aux Ordres religieux lorsqu’ils sont à
l’article de la mort. La mentalité des marchands évolue vers une conscience que l’économie et la politique sont liés, mais que
l’économie n’a rien à voir avec l’éthique, ni la politique avec la morale. Un peu plus tard, Niccolò Machiavelli (1469-1527) théorisera
cela.
On connaît peu de choses de la musique populaire d’alors : que chantaient les ouvriers du textile, les artisans, les membres des arts mineurs, les femmes qui élevaient
leurs enfants ou qui effectuaient chez elles un travail artisanal ? Par contre cette poussée du monde nouveau des marchands, industriels, banquiers génère aussi une
musique nouvelle, qui vient à la fois de France, à travers Marchetto de Padoue (1275-après 1318) qui semble avoir importé les théories et la polyphonie de l’École de
Notre Dame de Paris (vers 1160-1250), mais qui est sûrement aussi influencée par la chanson populaire et sa polyphonie, antérieure à la celle du chant grégorien. Sont
alors apparus des musiciens professionnels, généralement des religieux mais dont les œuvres étaient profanes, comme Francesco Landini (1325-1397), Giovanni da
Firenze (XIVe siècle), Donato da Firenze (seconde moitié du XIVe siècle), Lorenzo Masi ( ? -1372), etc. qui imposent « l’ars nova » en opposition à la seule polyphonie
religieuse et préparent le temps du madrigal, des « cacce », des « chansons », des ballades.
Et celles-ci reprennent souvent des thèmes de la vie populaire, peut-être déjà exprimés dans des poésies comme celles du mal identifié Puccio di Aldrovandesco
Bellondi (fin XIIIe siècle), par exemple celle-ci, sur un texte anonyme, qui évoque l’activité de lessive, si importante dans la vie des femmes :
Non posso far bucato che non piova.
(Ballata anonima del secolo XIV
Landini e la musica fiorentina del secolo XIV
Ensemble Micrologus, 1994)
Non posso far bucato che non piova.
Si je lave mon linge il se met à pleuvoir.
S'è '1 tempo bello, subito si turba,
Si le temps est au beau, aussitôt il se couvre,
Balena, tuona, e l'aria si raturba
il tonne, il fait du vent, l'air de nouveau se trouble,
Perch'io non possa vincer la mia prova.
afin de me gâter ce que j'ai entrepris.
Cosl sança ragion m' è fatto torto
C'est ainsi sans raison que l'on me fait du tort,
Ch'io servo ogni uomo
je sers tout un chacun,
e ciascun mi vuol morto ;
et chacun veut ma mort ;
Di che la vita mi' viver non giova.
Ce pourquoi vivre cette vie n’est pas agréable.
On peut citer à ce propos ce chant populaire, Il canto delle lavandaie del Vomero, qui date environ de l’époque de Frédéric II, du XIIIe siècle, c’est-à-dire d’un temps où
la colline qui surplombe Naples, le Vomero, était encore couverte de forêts de châtaigniers, avec quelques maisons rustiques occupées par des lavandières qui
descendaient ensuite dans la ville pour rapporter aux palais aristocratiques le linge qu’elles avaient lavé, remontant avec le linge à laver dans les nombreuses sources du
lieu. Ce chant, considéré comme le plus ancien chant napolitain connu, devint ensuite un chant de protestation contre la domination aragonaise et de revendication de la
terre : la « moccatora » est soit un mouchoir soit un morceau de terre :
RETOUR A LA TABLE DES MATIERES SUITE 2.4 DU FICHIER


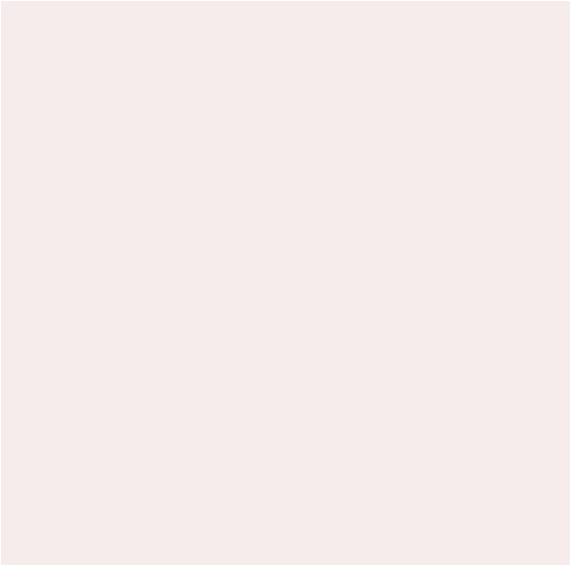
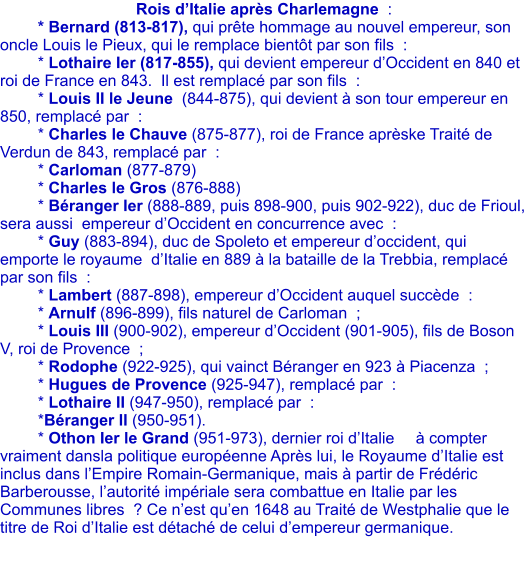
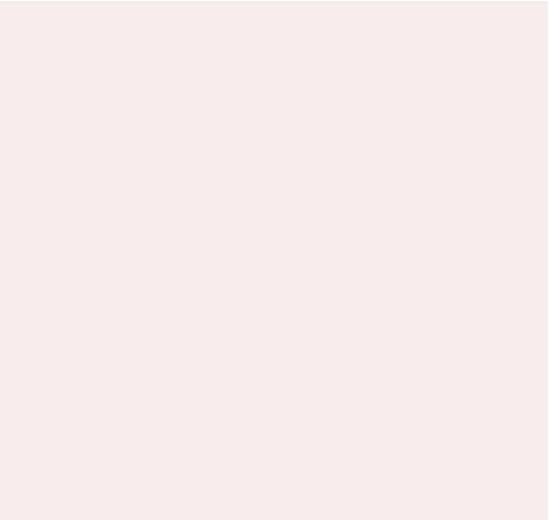
Les dynasties des Othons (Ottoni) de Saxe, des Saliens, des
Hohensataufen :
* Enrico I (919-936), dit « l’uccellatore » (l‘oiseleur) pour sa passion
de la chasse au faucon, grand vainqueur des envahisseurs hongrois ;
* Ottone I (962-973), dit « le Grand », son fils, couronné empereur
en 962 et roi d’Italie ;
* Ottone II (973-983), son fils, vaincu dans sa lutte contre les
musulmans en Sicile ;
* Ottone III (983-1004), son fils fasciné par la Rome impériale mais
décédé trop jeune ;
* Enrico II (Henri II) (1002-1024), dit « le Saint », cousin d’Othon III.
Meurt sans héritier.
C’est la dynastie Salienne de Franconie, avec Corrado II Salico (le
Salique) qui succéda aux Othons :
* Conrad II (1027-1039) le Salique, petit-fils d’Othon III. Roi d’Italie en
1026, empereur en 1027.
* Henri III (1046-1056) dit Le Noir
* Henri IV (1084-1108), fis du précédent. Querelle des investitures
avecle pape Grégoire VII, à qui il se soumet à Canossa en 1077.
* Henri V (1105-1125), fils du précédent qu’il détrône.
Après un intermède féodal, ce sont les Hohenstaufen de Souabe qui
reprennent l’empire :
*Conrad III (1138-1152)
* Frédéric I Barberousse (1152-1190)
*Henri VI (1190-1197), son fils, époux de Constance d’Altavilla, père
de :
* Frédéric II (1220-1250).
* Conrad IV (1250-1254).
















